
La transition est plus à la mode dans les médias non-binaires qu’en musique (binaire ou non). C’est pourtant à cette activité qu’Ali Hirèche s’adonne dans la deuxième partie de son récital Schubert-Liszt tout juste paru sur le label Bion.
L’affaire a commencé par la « Wandererfantasie », chroniquée ici, dont on sait qu’elle a été souvent adaptée ou transcrite par des compositeurs de renom, parmi lesquels Franz Liszt en personne. L’ogre du piano-et-pas-que a aussi pianisé – et hop – des lieder de Franz Schubert, parmi lesquels Ali Hirèche a pioché trois propositions : « Der Wanderer », « Gretchen am Spinnrade » et « Erlkönig ».
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vrI9J-xnPhE[/embedyt]
Nous avons bestofisé les paroles de « Der Wanderer » dans le précédent épisode – l’histoire d’un voyageur désespéré d’être séparé de sa patrie, de ses amis et de sa joie. La noirceur s’échappe de l’introduction pour gagner l’ensemble du registre, des grondements et blanches gravissimes aux suraigus qui rappellent le bonheur avant que les triolets et le médium n’ensuquent l’errant dans sa séparation avec la patrie originelle donc la joie. Le jeu posé d’Ali Hirèche, sans pose ni effet dramatique, sans résonance abusive, sans surjeu visant à produire un grand effet, rend joliment raison d’une première partie méditative. Puis l’interlude en 6/8 anime les regrets avec la tentation lisztienne de la virtuosité échevelée. Peine perdue : la joie, la respiration, l’espérance sont à jamais inaccessibles au voyageur.
La fin dramatique, exploitant toute l’étendue
- du piano,
- des nuances et
- des possibles musicaux (parmi lesquels, évidemment, le silence),
en témoigne d’autant plus cruellement que la mélodie en do dièse mineur s’achève en Mi majeur. D’ordinaire, le mode majeur est plus rassérénant que le mode mineur. Ici, au contraire, il enfonce la désespérance dans
- une normalité,
- une ontologie, bref,
- une fatalité humaines.
L’ultime accord, posé pianissimo, n’a guère de concurrence pour définir en un éclair le romantisme, lequel n’est pas la déprime nonchalante mais la lucidité qui consiste à contempler l’infinitude de la tristesse.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BK6HNQHIHcw[/embedyt]
Pas étonnant que les pianistes de rang raffolent de la faustienne et goethienne « Gretchen am Spinnrade » (Marguerite au rouet), défi technique encore plus redoutable à cause
- de la disposition pianistique adoptée par le transcripteur,
- de l’exigence de régularité réfléchie à tenir pendant cinq minutes, et
- du spectre sonore utilisé, essentiellement concentré dans les nuances douces.
Le lied enchaîne sur l’errance du maudit sans proposer une atmosphère plus Daft Punk pour autant. Tandis qu’elle file, Marguerite regarde par la fenêtre en sachant qu’elle ne le reverra plus alors que son corps a soif de lui. Bilan : elle voudrait crever. Avec délicatesse et « pas trop vite », comme exigé par le compositeur, Ali Hirèche ouvre la partition à quatre voix (mélodie, mouvement du rouet, balancement du ténor et basse). Sa sérénité ajoute à la force d’un désarroi passé du côté du désespoir et tentant de s’en satisfaire comme on aime se faire mal en grattant les plaies de l’âme.
La capacité du pianiste à créer de parfaits crescendi-decrescendi souligne néanmoins que cette acceptation noire reste fragile. Derrière la zen attitude, le chagrin vrai plus que le vrai chagrin, celui que ressasse le refrain, n’est pas loin. Dès lors, l’on salue la capacité du musicien
- à devenir poète dans la douceur du ronronnement abattu,
- à se transformer en marin affrontant la houle quand les coups au cœur sont trop forts, et
- à se muer en enragé pour claquer franchement les accords de la révolte…
avant de redescendre dans les bas-fonds du triple piano, du registre médian et de la résignation.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=X4l2tkWH9n8[/embedyt]
On passe encore un step dans le drrrrramatique avec le roi des aulnes (« Erlkönig »), dernier des trois lieder au programme. Ce célèbre morceau de choix est un road-movie qui se déroule dans la nuit et le vent et que narrent, de façon fragmentaire donc presque énigmatique, trois voix :
- celle d’un homme qui galope dans la forêt avec son fils dans les bras ;
- celle du roi des aulnes qui essaye de rapter le gamin en lui promettant monts et merveilles ;
- celle du gamin qui alerte vainement son père sur le danger et arrive mort à destination.
Les derniers instants de la vie d’un môme sont contés presto agitato dans un esprit « dramatico ». Ceux qui préfèrent la douceur peuvent toujours demander à Elisa Point l’heure qu’il est.
- Clarté des octaves ascendants,
- perfection des octaves répétés,
- limpidité de la polyphonie :
on entend le vent, la nuit et la mort qui tisse ses rets.
- Changement de couleurs,
- pureté des arpèges,
- investissement des modulations :
on entend les promesses souriantes du roi faucheur.
- Solidité des interventions graves d’un père stupidement réaliste,
- tentation aiguë de l’enfant frissonnant grâce à un agitato où fougue et foucade naïves se rejoignent,
- retour sonnant mais pas trébuchant du sol mineur justement martelé :
on entend la mort qui gagne, cette fois encore, ce que confirme une minuscule coda.
Or, est-il plus juste symbole de la vie humaine, schubertienne mais pas exclusivement, qu’un petit bout de machin qui finit comme prévu bien que nous ayons, un temps, été convaincus que nous échapperions à la fatalité de notre condition ? Comme l’enfant qui pense roi des Aulnes plutôt que camarde et comme le rappelait Sigmund Freud, nous savons que nous sommes mortels mais nous peinons longtemps à y croire, c’est là peut-être toute l’Histoire de l’humanité…
À suivre…
Pour écouter sans attendre l’intégrale du disque, c’est par exemple ici.















































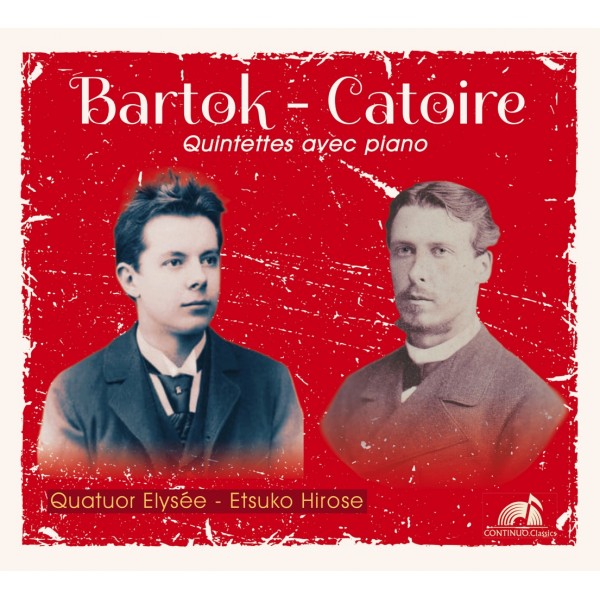

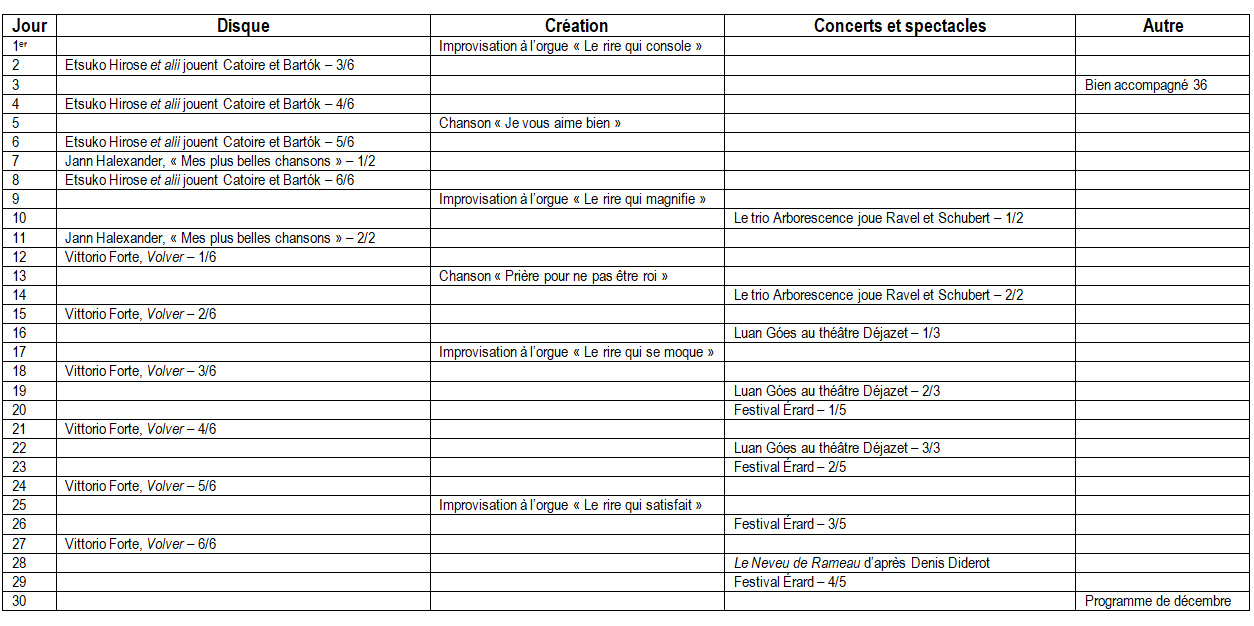

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)










