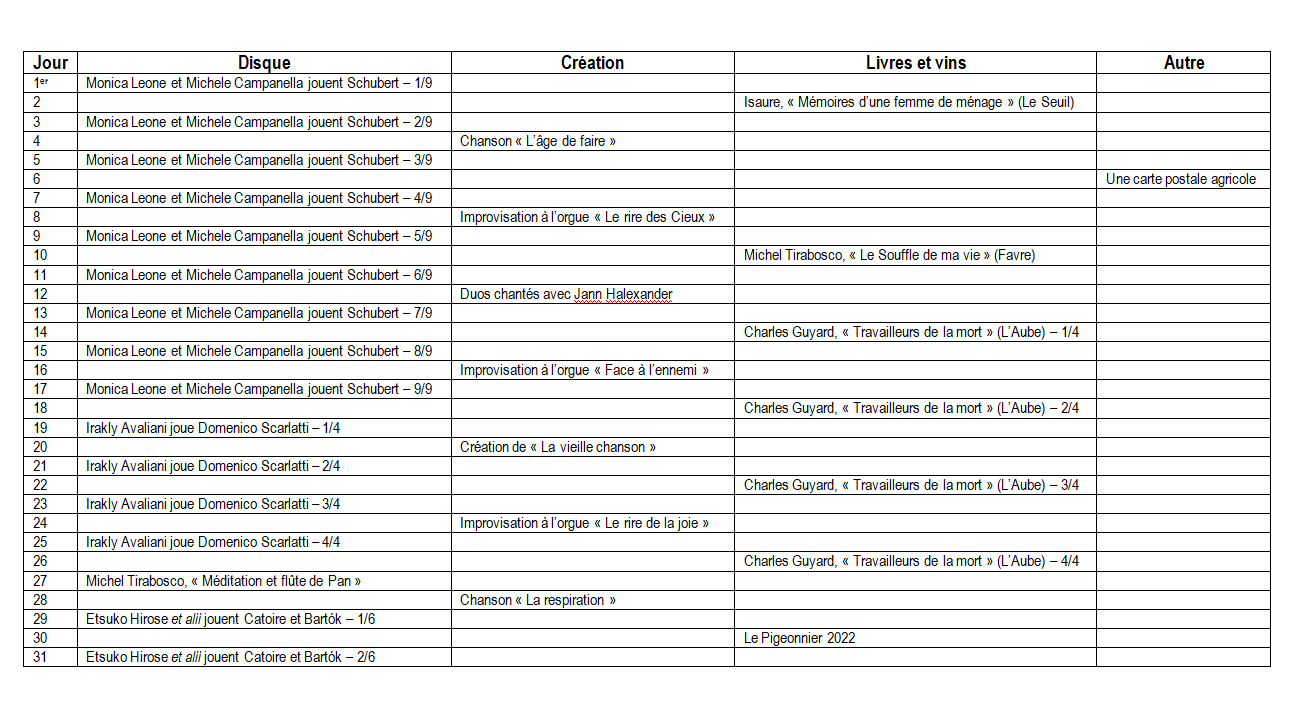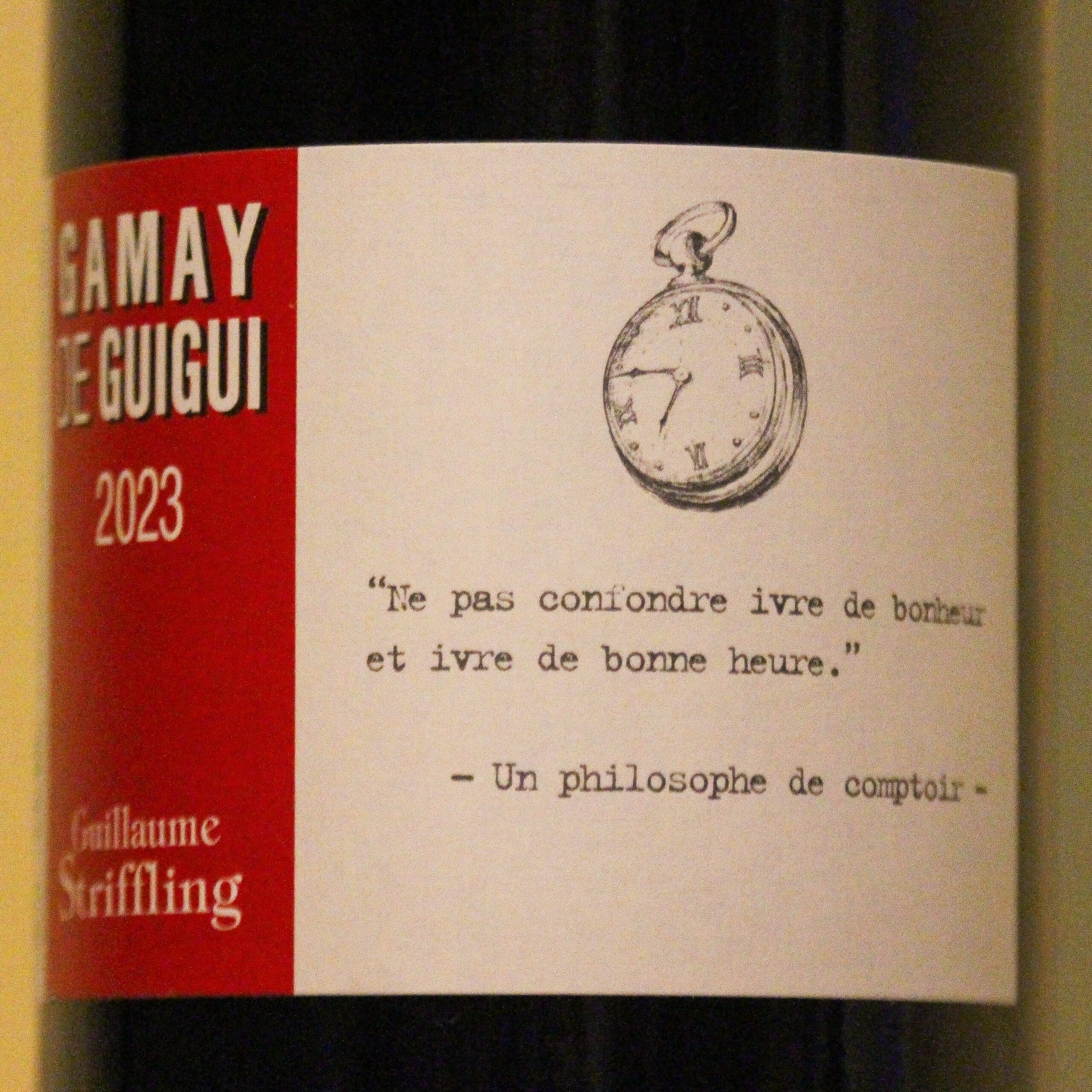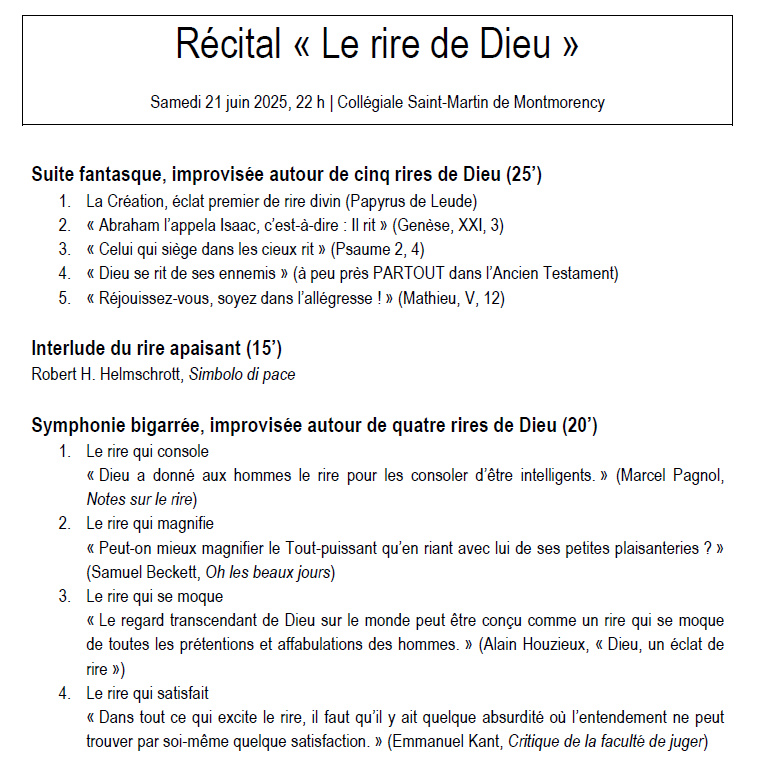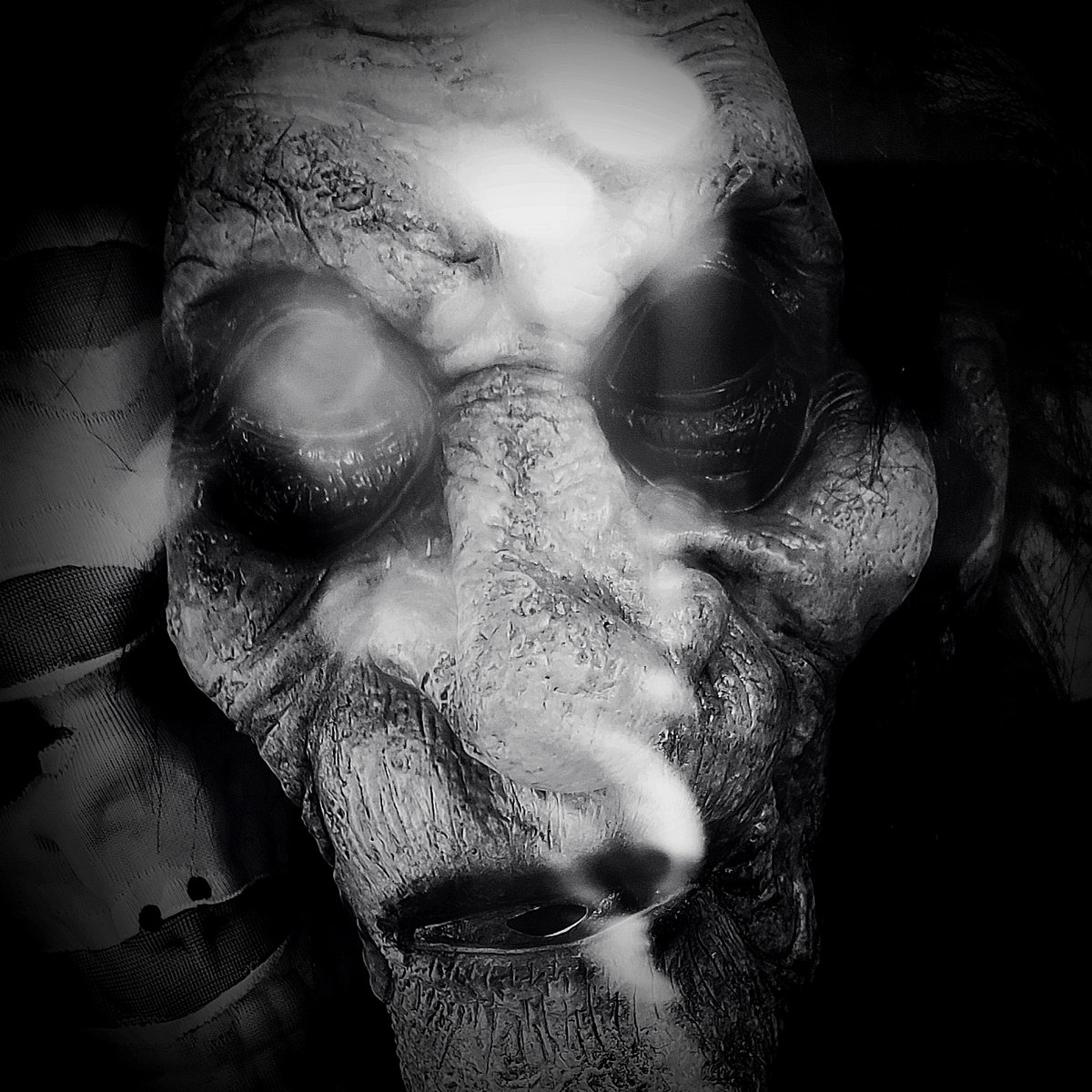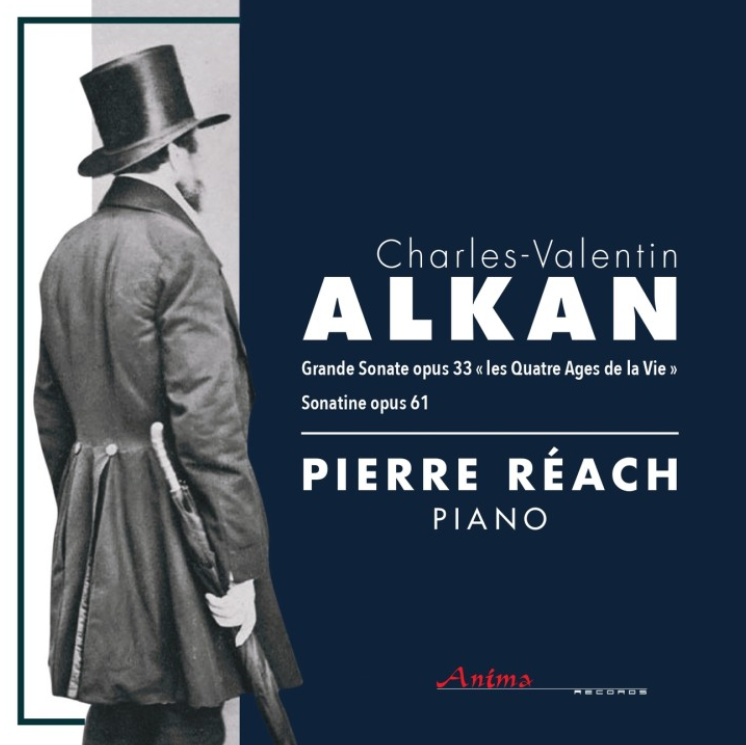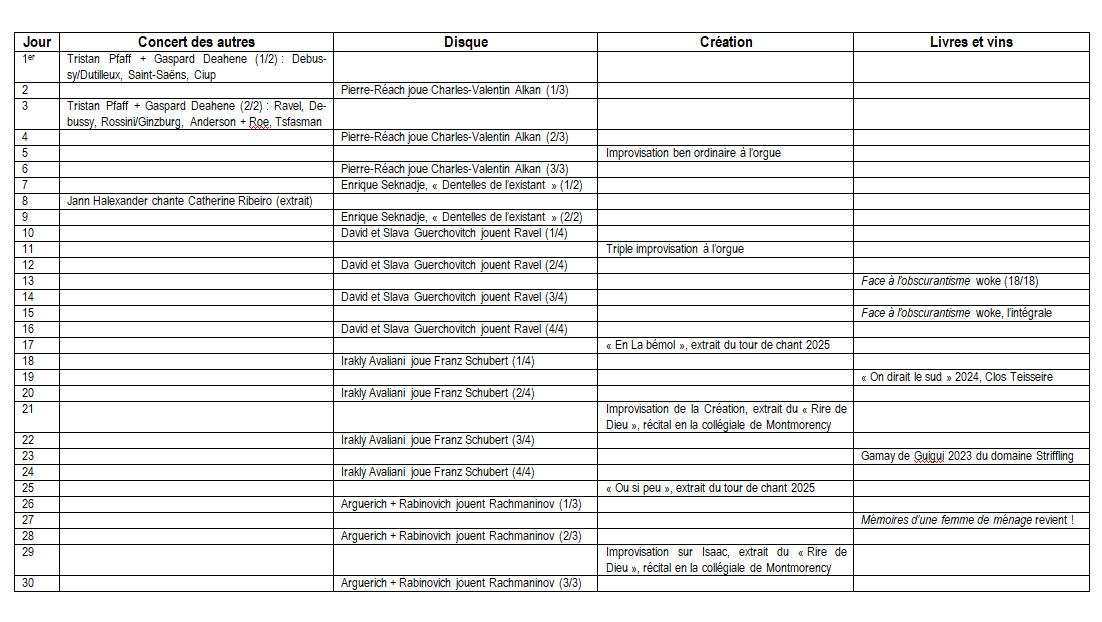Voici qu’advient la deuxième production phonographique d’un trio articulé autour de Romain Watson, la face découverte d’un jeune chanteur-guitariste qui agite cordes de gratte et de vocalité depuis de nombreuses années, comme accompagnateur et comme frontman de divers projets dont le plus pérenne, jusqu’ici, s’appelait Atlantys et rockait ferme la chanson francophone et anglophone, avec l’inénarrable et néanmoins excellent Jacky à la basse.
- Biberonné aux anims et à Jean-Jacques Goldman parmi mille autre influences,
- imbibé par une famille où la chanson française mordait volontiers sur les grands succès anglo-américains,
- influencé par un père qui soignait les corps donc les âmes (et qui grattait, ô surprise, sa guitare pour chanter avec les autres) et une mère qui savait élever au sens allègrement vertical les gamins de tout âge qu’elle accueillait dans son giron plus généreux que celui de la Jeanne à la canne,
le musicien a connu des galères d’intermittent avant, petit à petit, de percer sur les scènes du Ch’Nord et au-delà. Vainqueur d’un radiocrochet qui n’était pas réservé aux minaudeurs souffrant de leur génie entre
- bêlements,
- susurrismes,
- vocoders et
- âneries en plastique débitées sans en rien bitter,
il s’est produit dans de petites et grandes salles, assurant même la première partie du lointain vainqueur de Roland-Garros un temps reconverti dans la vente de slips, et qui continue, de façon assez incompréhensible, à attirer les foules surtout quand la buvette est ouverte et que le play-back est gratuit, bref. Romain Watson a su aussi saisir d’autres chances, comme lorsqu’il a impressionné par sa fusion avec le public au Main Square, le grand festival d’Arras. Résultat, il y revient en force cette année le 6 juillet – un samedi, s’il-vous -plaît, jour vedette s’il en est – pour, nous assure-t-on, « tout déchirer d’un singulier trait de lumière ». Dans ce contexte d’engagement total, rien d’étonnant si, pour ce premier album sous son nouveau nom de scène, le monsieur s’est chargé de tout :
- paroles,
- musiques,
- prise de son,
- mixage,
- mastering et
- production
sont garantis faits maison, même si la qualité du produit fini démontre que, désormais, certaines autoprods, quand elles sont gérées par des qui savent, tiennent le menton aux grosses machines largement soutenues par des subventions publiques, ces vieilles arnaques promptes à puiser dans les caisses destinées aux artistes émergents pour financer les besoins millionnaires des albums dégueulasses des sans-foi-ni-loi comme allumé-le-feu-Johnny et autres Zazie.
Aussi Romain Watson tient-il à poser les choses dès le premier titre où il explore ses « Racines ». La chanson pourrait être une simple ode aux origines, incitant à accepter ce qui, tantôt, « ancre » et, tantôt, « pourrit le crâne ». Or, derrière la litanie hypnotisante, les glissendi de fausses cordes alla Matthieu Chedid soulignent que l’affaire n’est peut-être pas aussi entendue que cela. « Racines » est traité comme un personnage au singulier, gagnant en énigmaticité ce qu’elle perd en gnangnantise consensuelle, alléluia. Romain Watson laisse une belle part aux instrumentaux qu’il dissocie des soli. C’est le signe que, qui en doutait ? tout n’est pas dit dans les mots. Le mystère de la fredonnerie trouve dans la musique une forme
- d’intériorisation,
- de méditation,
- de prolongement
qui permet à l’auditeur de laisser résonner la chanson en lui. Car il y a quelque paradoxe à ce qu’un disque intitulé Comment j’ai disparu commence par chanter les racines et enchaîne avec une chanson appelée « Là, chez moi ».
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=L8tOSJUu9Lc[/embedyt]
Les arrangements de la chanson sont résolument 70’s – ou, si l’on préfère, façon Ginger Accident se frottant à Thomas Fersen comme dans « Donne-moi un petit baiser ». Sous le côté dansant de la tune, Romain Watson
- triture la prosodie,
- ose les enjambements,
- se goberge de rimes approximatives,
- lâche la bride à un phrasé volontiers sursautant,
avant de révéler le vrai titre de sa chanson, qui serait plutôt… « Lâchez-moi ». Derrière le jeu de mots, on entend la singularité schizophrénique de l’artiste, à la fois
- aspiré par ses racines,
- inspiré par ses pulsions artistiques et
- quêtant sa véritable – donc indéfinissable – identité,
partagée entre ce qu’il révèle de lui au public (« là, chez moi ») et ce qu’il garde pour lui (« lâchez-moi »). Signe d’une belle continuité en dépit d’une grande variété de styles, la « Valse de la vie » – héritée de l’excellente série « 1 jour, 1 chanson », manigancée et finalisée par l’artiste – à la fois
- dialogue à sens unique,
- déclaration d’amour et de colère, et
- prosopopée inversée,
confirme les pistes esquissées dans les premiers titres :
- hésitation entre « tu » et « vous » évoquant les racines prises dans leur globalité donc pensées au singulier dans le titre d’ouverture,
- enjambements créant une dynamique quand s’arrête la phrase musicale (« Depuis le temps qu’on s’connaît, vous / permettez qu’on s’tutoie »),
- intimité de la voix captée de très près et désir de flammes qui se manifeste au troisième couplet,
- picorage dans les différents registres de langue, du soutenu métaphorique (« Y a-t-il un plaisir malsain / à nourrir de ton sein / des hommes sans limites ? ») au vieux djeunse (« Je te kiffe, je veux pas qu’on splitte » faisant écho au « j’me décide à checker mon tél » ouï dans « Là, chez moi »)…
Tout se passe comme si la variété des styles explorés par Romain Watson cherchait, à chaque fois, à attraper d’une manière différente la confusion identitaire qui semble posséder le personnage mis en scène par l’artiste. Lui-même semble l’admettre dans le festif « Tête » qu’il attaque – sur le groove bien lourd de Marine Courtin puis avec le soutien du beat idéalement basique de Mélanie – en déclarant : « Faudrait qu’j’arrête de me prendre la tête » (ce qui résonnera avec manière de rétractation dans le titre presque final « Je veux pas qu’ça s’arrête »). En réinvestissant le projet goldmanien de devenir adulte (« Faudrait que j’devienn’ plus sage, que j’sois plus raisonnable à mon âge »), le chanteur le subvertit en osant se « vénère » façon Stromae et en renonçant à trouver une Janine pour éviter le pire. S’esquisse un dialogue avec soi : le « lâchez-moi » du deuxième titre serait alors moins une adresse au public qu’une supplique de Romain à Watson…
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2XuQle9mPc8[/embedyt]
Plus Christophienne dans le travail sur le grain de la voix et les sons de synthé en introduction, la chanson-titre explore à nouveau la quête d’identité de l’artiste dont le « je » reste un jeu (pfff…) aux règles d’autant plus mystérieuses qu’il affirme, cette fois, avoir « disparu ». Brouillé, éclaté, le voici désormais dissout – avec, youpi,
- les soli de guitare,
- le break pianistique et
- le travail de spatialisation sonore
qui vont bien (même si je n’aurais pas dit non à une extended version avec un postlude encore plus long, hélas inenvisageable dans ce format de chanson – mais qui sait, peut-être en live ou dans de futurs previously unrealeased bonus tracks ?). Impossible d’abandonner la chronique sans passer par le disco « Aujourd’hui n’existe pas » pour trois raisons.
- D’abord, le titre confirme notre diagnostic de schizophrénie, puisque non seulement Romain Watson a disparu mais, désormais, il est deux puisque la voix de Sofia lui mange la moitié de son texte avant de s’unissonner (et hop) à lui. C’est toujours un plaisir quand le patient d’un psychiatre sauvage – c’est ça, d’un critique – se soumet à la volonté de l’expert autoproclamé.
- Ensuite, le titre confirme la tension délicieusement intenable entre la déréliction du « je », son omniprésence dans les textes et la contradiction que manifeste la création (quand on n’est personne et rien à la fois, comment chanter ?).
- Enfin, le titre confirme la possibilité d’un après, symbolisé par le tutoiement (« Oublie tout, claque la porte »), puisque le présent a disparu comme le « je », si bien que la seule solution réside dans la musique et le son qu’il faut « MONTER ». Titre taillé pour la scène avec ses épisodes à claps nimbés d’un riff imparable, le titre est aussi pensé pour l’écoute continue du disque ou du streaming grâce au travail de production qui insère d’autres sons (hélas celui de l’accordéon, que j’abhorre mais qui est ici, quoique superfétatoire vu que je déteste cet instrument, traité en complément et non en distributeur à goualantes).
Or, au mitan du parcours, c’est bien la créativité de Romain Watson qui saisit. Spiralant autour d’une même quête d’identité, le chanteur compose une série d’irisations non pas autour de son mal-être qui, dans le cadre d’une prestation artistique, serait, en soi, modérément palpitant, mais autour de la question de l’identité. Pas que de son identité. Dès lors,
- se demander qui est Romain Watson, c’est aussi se demander qui nous sommes, nous qui croyons souvent dans des identités figées, rassurantes, sclérosantes, stimulantes, étouffantes, rutilantes, fantasmées, etc. ;
- écouter Romain Watson, c’est découvrir la multiplicité des possibles de la variété quand elle n’a pas peur – au contraire – de proposer des styles différents ;
- nous connecter à ces différentes esthétiques de chanson, c’est forcément en chercher la colonne vertébrale, c’est-à-dire l’identité.
Les chansons de Romain Watson, loin de former un long thrène nombriliste, rassemblent leurs auditeurs, dans leur diversité interne et externe, pour les faire vibrer avec les outils faussement simples de la variét’ et le plaisir malin d’un questionnement ontologique drapé dans les oripeaux de la pop music. À bientôt pour la seconde partie de ce compte-rendu, feat. le hit du disque dont le clip est déjà disponible ici !
Pour écouter tout le disque gratuitement, c’est par exemple ici.
Pour acheter cette production indépendante de qualité, nous contacter (compter 15 €, port compris).