René Gerber, Musique orchestrale II, VDE-Gallo
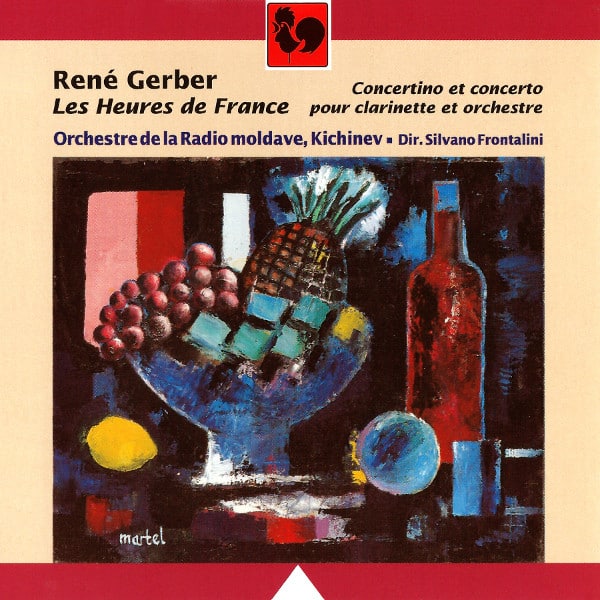
1.
L’apéritif
Que serait la musique occidentale sans les orchestres de l’Est ? Indispensables à l’économie d’une certaine production classique, notamment d’œuvres écrites par des compositeurs moins connus que les superstars du secteur, ces formations ne sont pas sans poser des questions comme, entre autres, celle du bon usage des fonds publics. Ceux-ci ne devraient-ils pas soutenir des projets de mise en valeur locale des patrimoines nationaux autrement, pour parler de la France, qu’en soutenant d’immondes merdasses aussi répugnantes que leurs commanditaires – pensons à la grande sucette d’Anne Hidalgo, pour 650 000 boules, ou à la repeinture en moche, pour plus de 500 000 balluches, de la salle des teufs de Pharaon Ier de la Pensée complexe ? Car, en se trouvant poussés à solliciter des phalanges allogènes, petits et gros producteurs font certes résonner des partitions exclues des salles de concert. Toutefois, ils éloignent aussi le répertoire local des ensembles autochtones, jugés démesurément coûteux. De leur côté, ces mastodontes plus ou moins prestigieux estiment, eux, que jouer des noms inconnus ne sera jamais rentable alors qu’une énième Neuvième de Beethoven, un Boléro de Ravel ou une Cinquième de Chostakovich, dût-on les massacrer, ç’a de bonnes chances de blinder vite fait – remarque en passant, en cette semaine précédant la révélation aux ploucs que nous sommes des programmations majeures des salles parisiennes.
Même VDE-Gallo, dont on connaît l’attachement pour la musique suisse, a dû, afin de jouer René Gerber, solliciter des formations comme l’orchestre de Radio Bucarest, l’orchestre philharmonique de Koszalin et, pour le présent disque, l’Orchestre de la radio moldave de Kichinev, placé sous la direction du récidiviste Silvano Frontalini. Cette délocalisation était une condition sine qua non pour produire une gravure des Heures de France de René Gerber, musicien suisse désormais peut-être moins mal connu des lecteurs – et de l’auteur – de ce site… même si nous sommes trrrrès loin d’avoir parcouru les quelque deux cent cinquante pièces de son répertoire.
2.
Le menu
Au programme aujourd’hui, deux œuvres pour clarinette encadrent Les Heures de France et avivent la mortification d’Olivier Buttex, le patron fondateur du label. En effet, peu avant l’enregistrement, le soliste prévu s’est désisté. En dernier recours, le clarinettiste solo de l’orchestre moldave a accepté de le remplacer… et, au moment de la réédition, le directeur de Gallo n’a pas réussi à retrouver le nom de l’artiste. Pourtant, le virtuose avait du pain sur la planche, d’autant que, quand René Gerber écrit pour un instrument en particulier, c’est toujours en connaissance de cause.
Dans un entretien donné, octogénaire, à Louis de Marval – un nom qui sonnera une cloche aux lecteurs assidus – pour « Archives pour demain », le créateur soulignait que sa formation avait été centrée sur la vie musicale peut-être encore davantage que sur la théorie. Certes, celui qui a aussi sévi comme galeriste a travaillé son art avec des sommités plus ou moins connues, dont Nadia Boulanger ; certes, ce passionné du jeu d’échec a rencontré Stravinski, Dukas et même un Ravel mal en point – avant que le bolériste composât Don Quichotte à Dulcinée –, mais il a surtout suivi les conseils de ses profs sur deux points :
- d’une part, assister au maximum de répétitions d’orchestre ;
- d’autre part, vivre au moins une journée avec un instrumentiste pour comprendre concrètement son instrument – car, explique-t-il, « on apprend la musique en écoutant les musiciens ».
Faisons-lui donc confiance a priori. S’il écrit pour la clarinette, il doit maîtriser son affaire !
3.
L’entrée
Le Concertino pour clarinette et orchestre (13’) est conçu selon un triptyque vif-lent-vif. D’emblée, accompagné de nappes d’orchestre, le soliste parcourt allègrement ses registres en lié comme en détaché. Trompettes, cors et bassons lui répondent, enclenchant une nouvelle phase, quasi jazzy. Le hautbois et les trompettes colorent différemment le motif, que l’écho des cors rend plus orchestral. Le mouvement malaxe alors les différents ingrédients projetés dans son saladier jusque-là. Les souffleurs en profitent pour intervenir à tour de rôle sur un tapis de cordes qui contraste avec les détachés de la clarinette ou le swing des pizzicati. Les flûtes, discrètes jusqu’ici, déclenchent le crescendo qui couronne cette plaisante promenade.
L’adagio, plus bref, commence par une plainte associant clarinette, volontiers à découvert, et cordes. Les brefs flux et le reflux des intensités, parfois pailletées de cuivres ou d’un hautbois, ne dissipent la brume que par intermittences, comme lors de l’étrange dissonance apportée par les cors (2’40-2’44) préparant la fin en fade out. Contraste idéal avec le dernier mouvement, un Presto ternaire au début tonifiant – mouais, quatre épithètes, je le concède, il est temps d’alléger. Clarinette, hautbois et wood-blocks déchaînent une houle. Quand celle-ci se retire, les trompettes aiguillonnent le soliste. D’autres souffleurs les rejoignent bientôt. En rétorsion, les violons valsent sur de gros ploums de contrebasse, surplombés par une clarinette vigilante. Le retour du motif de dix-huit notes (4-4-10), dans la lignée du souffle gerbérien moyen, mesuré précédemment autour de dix-neuf notes, annonce les derniers dialogues qui s’achèvent sur un crescendo serti par les timbales. Interprétation solide et partition plaisante, malgré une fin qui a l’élégance de nous laisser, comme c’est drôle (attendez, vous allez pouffer), sur notre faim – voilà, vous pouvez pouffer.
4.
Le plat
Les Heures de France (22’) sont un curieux assemblage de dix mouvements allant de vingt-cinq secondes à 3’40 pour les neuf premiers, et poussant jusqu’à 7’17 pour l’Allegretto final. Le Prestissimo liminaire, plutôt sage au vu de l’appellation, s’arc-boute sur une mélodie plus folklorique que populaire, que Nana Mouskouri tenta de repopulariser en 1978. René Gerber orchestre avec métier, comme à l’accoutumée. Le Lento propose au cor anglais manière de « Fais dodo, t’auras du lolo », joli projet, que l’orchestre reprend en chœur et abandonne decrescendo. C’est une sorte de « Meunier, tu dors », trompetté sans faux-semblant, qui secoue alors l’Allegretto. L’ambiance martiale est heureusement habillée par une riche harmonisation proposée en alternance par des cordes. Complèteront cette brève esquisse les dissonances des cuivres, la modulation mineure des bois et l’écho des cors sur une pédale d’accompagnement. Tout à fait croquignolesque !
Sur le même modèle, la suite enchaîne les vieux tubes des chansons françaises. Ainsi, la clarinette s’empare du Moderato, en dialogue avec les cordes et le hautbois surplombant, tandis que les trompettes tentent de revenir à la charge. Aux cordes de dialoguer avec le cor anglais dans l’Allegro quasi presto plus développé, où les thèmes rebondissent les uns sur les autres sans se refuser le plaisir de l’accélération ou des sonorités inattendues (piano aux cordes étouffées, xylophone…). L’ironie d’un thème sur deux notes qui se suivent, type « Lundi, mardi, le facteur n’est pas passé », gonfle quand l’orchestre s’empare de ce perturbateur pas endoctrinien. Une pédale de contrebasse conduit les bois à reprendre la main tandis que les flûtes font schisme, tadaaam, en serinant « Dodo, l’enfant do ». Interprétation soignée (au point que, sournois, l’on remarque surtout un décalage, à 3’07, c’est dire si ailleurs Notre Suprême Médisance est déçue de constater une bonne mise en place), et musique délicate pour goûter aux sonorités de presque chaque pupitre de l’orchestre… arrêtant ainsi la blague sur les cors, adaptable aux alti face aux soprani : « Pourquoi les cors sont-ils si forts ? C’est parce qu’ils se nourrissent des larmes des contrebasses qui pleurent quand elles n’ont pas de solo ! »
Le mini Allegro quasi presto semble proposer des bribes de « Ah ! vous dirais-je, maman ? », formant un intermède bienvenu, qui souligne le souhait de René Gerber de construire une suite divertissante. Après quatre mouvements similaires, une section plus longue casse l’habitude d’écoute. En effet, avec cet Allegro s’ouvre une série de quatre mouvements contrastés (0’30/2’30/0’30/2’30) que l’Allegretto final renversera à nouveau. L’Allegro quasi presto, pris sans le vertige de la grande célérité, met en avant les bassons avant que tout l’orchestre, petites flûtes et tubas compris, investisse le thème et le prolonge gentiment jusqu’à la minicoda. Le microPresto qui suit fait ruisseler un motif de pupitre en pupitre, que développe, langoureux sinon lounge, l’Adagio placé après et confié aux seules cordes… avant que les souffleurs ne fassent une apparition in fine contenue par les cordes. Si le thème de l’Allegretto est simple, le scintillement de l’accompagnement ne renie pas une richesse orchestrale aux forts accents debussystes.
Soudain, piano et cuivres pulvérisent cette atmosphère. Bois et caisse claire s’en mêlent, mais un voile apaisé, presque triste, met fin à cette tentation de tension (pfff). Les huit notes du motif dégoulinent de pupitre en pupitre jusqu’aux clarinettes qui, avec le glockenspiel, relancent le scintillement orchestral. Dès lors, le thème entame sa réémergence, en réalité sa diffraction quasi spectrale, wow, dans une large partie de l’orchestre. Et là, pouf, « Une souris verte » fracasse ce sérieux avec toute sa naïveté. L’accompagnement en quartes franches, aux consonances japonisantes, ne laisse pas de chance à la tentative de contrechant que fomente la trompette, obligée de brandir à plein souffle la « Carmagnole » pour se fabriquer une place. Réveillée, la phalange se retrouve pour un tutti avant que la timbale n’annonce puis ne ponctue la coda d’un coup sec.
5.
Le dessert
Le Concerto pour clarinette et orchestre (19’) complète ce disque finement agencé. Harpes et cymbales signalent l’arrivée du soliste. Les cordes, violon solo compris, répondent à cette entrée en matière, commentée par tout l’orchestre dont les flûtes et le piano. Pointera-t-on des violons pas toujours parfaitement justes sur les attaques (1’19) ? Ce serait se focaliser sur le détail au lieu de souligner la capacité des musiciens à suivre le chef pour se répondre de pupitres en pupitres… et pour jouer ensemble, dans un même son. À découvert, le soliste répond à l’orchestre, qui se remet à son service avant de tenter de l’aspirer dans les récurrents tremblements des cordes. Cor anglais et hautbois provoquent la star. Après un temps de discrétion, celle-ci montre qu’elle a parfaitement intégré le discours de ses comparses. À son tour de faire monter la sauce dont cymbales ni harpes ne peuvent contenir long de temps l’envie de blobloter hors de la saucière.
C’est bien à la clarinette que revient la première place de ce mouvement « modéré, puis modérément animé » où le compositeur construit une série de modules, de motifs, de formes d’accompagnement ou de solo qui s’interpénètrent à mesure que la partition se déroule… jusqu’à la très gerbérienne minicoda avec timbales, cymbales, contrebasses grondantes et trait soliste. Le Moderato est amorcé par les cors, auxquels répond la clarinette sur un thème en Sol proche de « Marie, trempe ton pain », repris par les cordes et les cuivres. On retrouve ainsi le métier du René Gerber quasi folkloriste. La lisibilité et la simplicité de cette facette d’écriture feront grincer les passionnés de musique où l’insondable le dispute à l’énigmatique – que le dieu du chic leur viennent en aide, s’il n’a guère mieux pour s’occuper.
Le dernier volet, un Vivo ternaire, met aux prises clarinette bariolante et cordes. Ensuite, les couleurs debussystes habillent la composition, émoustillées par la grâce harmonique d’un compositeur moins à l’aise dans les développements que dans le traitement orchestral des motifs énoncés frontalement. Les bois disputent entre eux ; après quoi, les cordes reprennent leur place, martelée par les ploums de contrebasse. Cuivres et percussions font leur apparition avant qu’un thème évoquant quelque peu le premier mouvement de la Suite n°1 tirée de Peer Gynt ne hante le discours. Le clarinettiste, malgré son évident talent, finit par montrer de discrets signes de faiblesse lors des passages de registre (par ex. le passage au la à 4’59 et le retour au registre supérieur à 5’04) ; c’est aussi que ce mouvement est sollicitant, balayant sa tessiture sur des nuances souvent douces, ce qui ne facilite pas l’exécution. La trompette solo aussi finit par fatiguer (5’19), mettant moins en question le niveau de l’orchestre et des musiciens que les conditions d’enregistrement sans doute tendues. Un dernier break conduit le discours brièvement vers la première danse polovtsienne d’Alexandre Borodine, avant qu’une sorte de valse brisée ne finisse en crescendo vers un microsolo de caisse claire… conduisant à la minicoda attendue.

6.
Le doggy bag
En conclusion, ce disque, réédité en 2002, élargit l’hommage de VDE-Gallo à un compositeur prolifique, grand orchestrateur, passionné de thématiques populaires et fomenteur d’une musique maîtrisée, souvent aussi agréable à entendre qu’intéressante à écouter.
Pour écouter le disque gratuitement, c’est ici.
Pour acheter le disque, c’est là.

