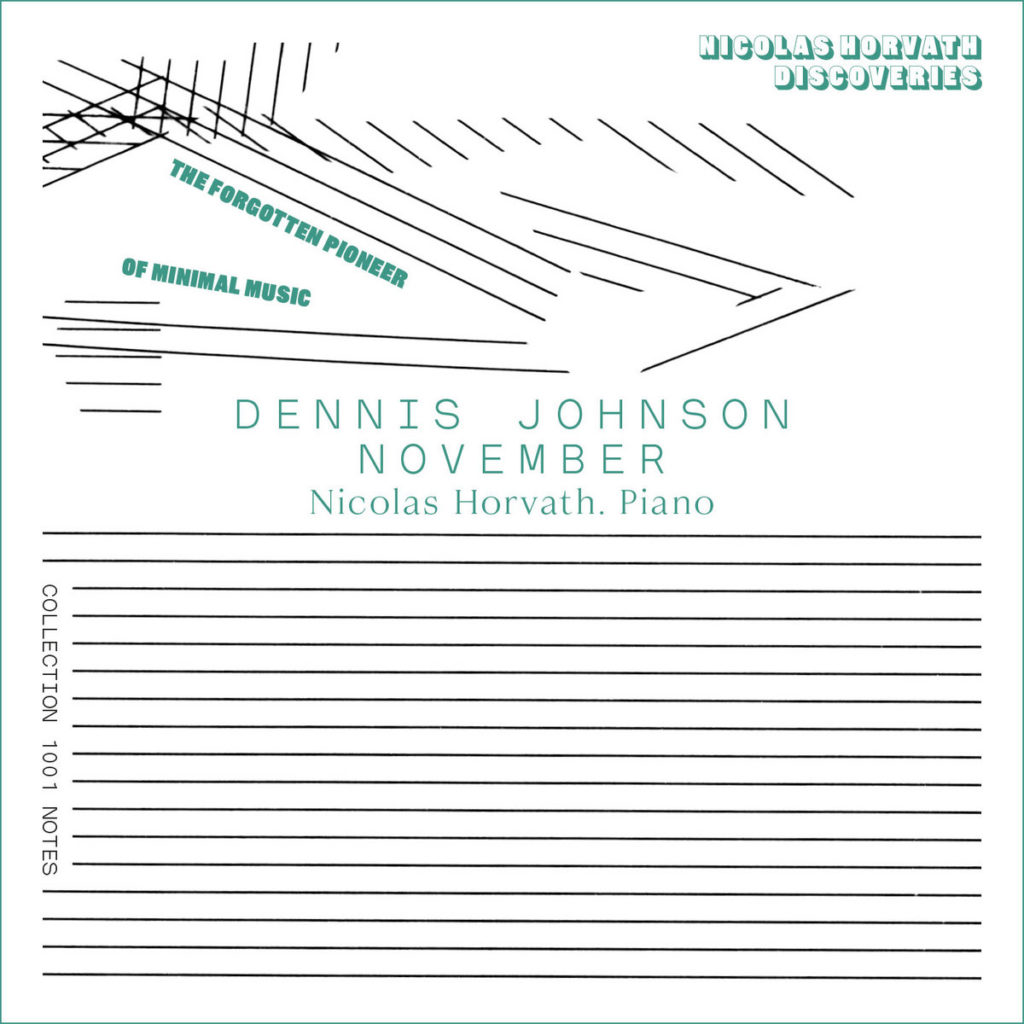Nicolas Horvath joue Dennis Johnson
Ce 20 avril 2022, paraît November, le disque-événement-qui-n’est-pas-vraiment-un-disque pour deux raisons :
- c’est un album digital…
- … construit autour de six disques virtuels, qui rassemblent plus de sept heures de musique.
En revanche, c’est un événement – d’une part grâce aux dimensions hors normes de la pièce, d’autre part grâce à son histoire exceptionnelle et passionnante à découvrir infra. November, considéré comme la première œuvre minimaliste, est une montagne que l’on franchit avec aisance grâce au sherpa finement expérimenté qu’est Nicolas Horvath. Pour accueillir sur son flanc les escaladeurs curieux, voici le livret griffonné par mes soins.
Temps et musique au prisme de November
« Time is on my side, yes it is »
Jerry Ragovoy
Il y a sans doute de nombreuses façons d’écouter November, ce monstre restitué sous forme de plus de sept heures de musique.
L’on peut l’ouïr en entier ou par bribes.
Méthodiquement ou aléatoirement.
En expert ou en curieux.
Au fil des disques ou de façon téléologique, c’est-à-dire en y voyant « l’un des monuments les plus influents de l’Histoire de la musique », selon l’expression de Kyle Gann, son plus intime connaisseur.
Comme de la musique à programme – en cela que l’on peut très bien y entendre une description d’un triste et éternisant mois de novembre – ou comme une composition entre atypique et insaisissable, même si ce terme de « composition » est ambigu.
L’on peut donc tout à fait écouter November comme une composition de de Dennis Johnson, comme une œuvre presque de Nicolas Horvath ou comme la reconstitution absolutiste d’un fantasme.
Et l’on peut aussi écouter November avec la nostalgie que notre époque formatée peut éprouver à l’endroit d’un happening savant quasi formalisé, ou avec le plus grand scepticisme devant l’intérêt intrinsèque d’un pensum pontifiant.
L’on peut.
Et on le peut d’autant plus que, aussi loin que nous sommes concernés, le plus passionnant dans cette multiplicité de possibles, c’est que la plupart des façons d’écouter susmentionnées, sans compter celles que des esprits vifs auront continué de décliner après avoir lu cette liste partielle, sont plus complémentaires que contradictoires.
1.
Historicité du temps
Voilà peut-être l’un des intérêts majeurs de November : se dérober à une approche binaire – sans doute parce que le cœur de son propos est moins la musique que l’appropriation du temps par la musique. Avec November, la question du temps aborde en première intention la question de la datation. Une cassette de cent vingt minutes, dont cent douze de musique « glaciale, calme et méditative », évoque une exécution en 1962 d’une œuvre fomentée – on n’ose écrire « écrite », haha, on verra pourquoi bientôt – en 1959. Si elle fut vraiment formalisée en 1959, précise le musicologue, alors elle inciterait à réécrire l’histoire du minimalisme en faisant peut-être de Johnson, grâce à LaMonte Young, l’un des primes ancêtres voire le prime ancêtre de ce type de musique à la vérité protéiforme.
Au fond, il y a sans doute moins de projet fondateur chez Dennis Johnson que de reconstruction téléologique chez les chercheurs. November n’est pas une pièce programmatique, accompagnée d’un manifeste que d’autres compositeurs auraient été invités à s’approprier. Elle n’acquiert sa valeur iconique qu’a posteriori, en donnant l’impression d’avoir impulsé plus qu’irrigué un courant. Cela n’enlève rien de son intérêt esthétique ni de sa modernité affirmée ; mais cela permet au temps d’être saisi dans sa dimension de flux qui va et non dans une logique strictement hypothético-déductive. En clair ou presque, il semble que November était porteur de marqueurs musicaux qui ont ensuite été mis à profit par d’autres artistes plus connus, au premier rang desquels celui qui a fait sortir l’œuvre de l’oubli – LaMonte Young.
Pourtant, la question de la datation ne se réduit pas à celle de la primauté historique. Elle inclut aussi le temps long lié à la réalisation de la partition. Kyle Gann raconte comment il a reconstitué la chose :
- d’abord, au mitan des années 2000, en transcrivant autant que possible la cassette fatiguée qu’il avait entre les mains ;
- ensuite en obtenant de Dennis Johnson lui-même une copie de son « manuscrit de travail », soit « six pages de cellules mélodiques et de diagrammes expliquant comment les assembler » ;
- enfin, en mêlant dictée musicale et réflexion sur la manière de partition qu’il avait obtenu.
Selon lui, le résultat, quoique tardivement révélé (mais le temps n’est-il pas quelquefois relatif ?), démontre l’intuition qu’avait Dennis Johnson du substrat qui caractérise aujourd’hui une certaine musique minimaliste selon
- le principe du motif simple initial (ici, deux notes),
- celui de la boule de neige (on ajoute petit à petit d’autres notes),
- celui de la modification par contamination (l’ajout d’éléments nouveaux déstabilise peu à peu la cellule précédente et débouche insensiblement sur la création de nouvelles cellules) et
- celui du temps long.
2.
Durée du temps
À la datation et à la généalogie s’ajoute ainsi, essentielle, la question de la durée. En effet, la musique que l’on nomme commodément « minimaliste » est moins une musique de l’épure qu’une musique tenant fermement le principe du pourrissement et de la germination. C’est le ressassement d’une cellule qui l’enterre, en quelque sorte, donc la contraint à mourir à elle-même et à se transformer jusqu’à donner naissance à une autre cellule qui suivra un processus similaire.
Aussi la durée minimaliste est-elle objectivable mais non quantifiable. Elle est objectivable parce que le processus est repérable, descriptible et peut être soumis à toute sorte d’analyses d’une grande profondeur ; mais elle n’est pas quantifiable car le phénomène de pourrissement-germination n’est pas réductible à une durée spécifique. En d’autres termes, le minimalisme selon Johnson travaille sur l’illusion de la permanence. Comme dans toute vie paisible, la mutation doit être quasi insensible. La dégénérescence d’une cellule et sa mutation sont des conséquences quasi programmées dès son apparition. Le processus créatif n’est point fatalité, il est développement intérieur d’une forme fixe et révélation extérieure de possibles.
Dès lors, si November illustre l’appropriation du temps par la musique, c’est que l’œuvre contribue à renverser la hiérarchie coutumière, laquelle place la musique en position supérieure. Le temps mesuré permet d’exprimer une mélodie et un rythme dont il n’est, admettons-le, qu’un outil visant à faire valoir la fantaisie d’un compositeur. Ici, le temps devient consubstantiel à la musique. Celle-ci a besoin du temps pour se déployer au-delà d’un motif de deux notes, et le temps a besoin de la musique pour se manifester à l’auditeur. Ce minimalisme-ci signe l’alliance consubstantielle du temps et de la musique.
En ce sens, la question de la durée d’exécution de November n’est évidemment pas négligeable. S’agit-il de coller à la durée de l’exécution connue (1 h 52’), à la légende d’une œuvre de six heures, ou à la proposition de la brillante proposition de R. Andrew Lee, enregistrée le 24 juillet 2012 pour le label Irritable Hedgehog ? Nicolas Horvath choisit de présenter l’œuvre en six mouvements, représentant plus de sept heures de musique. C’est sa vision d’une œuvre dont Dennis Johnson a pris soin de préciser à Kyle Gann qu’elle n’était pas « destinée à être entièrement fixée ». Le compositeur insiste :
Elle reste en partie improvisée. Les transitions indiquées servant de règles pour l’improvisation. Il n’y a pas de règle quant aux durées de quelque motif que ce soit, ni aux nombres de récurrences et recyclages des motifs.
Autrement dit, ce n’est pas la musique qui impose sa durée au morceau ; c’est à l’exécutant de choisir la musique en fonction de sa durée.
D’autant que, pour ajouter à la richesse de cette complexité, la photocopie de la manière de partition envoyée à Kyle Gann se présente comme un palimpseste, certains passages laissant penser que des annotations ont été apportées au début des année 1970 et même en décembre 1988. Le temps s’inscrit donc dans le corps même de la partition. À la durée de l’exécution s’ajoute la durée de la conception, l’ensemble restant sciemment de l’ordre du spéculatif et presque de l’indécidable. « Presque », car l’interprète est ainsi amené non pas à trancher en proposant une version définitive mais à suggérer une vision de l’œuvre, indissociablement liée à sa durée… laquelle n’est pas qu’affaire de chronomètre ! En témoignent les suspensions laissant penser que le temps imparti est achevé, comme dans la deuxième partie, autour de 32’. Le silence n’est pas la fin de la musique, il peut n’être que le début de son prolongement.
3.
Mesure du temps
Si essentiel soit-elle, la durée n’est qu’un des attributs du temps vécu. En effet, pour un musicien, le temps est généralement ou bien une oscillation partageant le flux entre temps faibles et temps forts, ou bien une rythmique qui pense le temps comme une série de briques, régulières ou non, formant un tout. L’investissement de cette tradition de la mesure par Dennis Johnson a été brillamment saisi par Kyle Gann, lorsqu’il a décrit la manière dont il avait travaillé pour réaliser une restitution possible des six feuillets matriciels.
Le premier moment de la réalisation a consisté à construire une vision d’ensemble de la partition manuscrite, avec ses motifs aux doubles numérotations, romaine et arabe, et avec les notes partielles prises par le compositeur sur son improvisation, notes qui incluent des contradictions, des corrections et des repentirs. Le deuxième moment a conduit Kyle Gann à préparer des mesures de 5/4 avec la noire à 60. C’est ainsi qu’il a retranscrit peu ou prou la cassette de 112’, avant d’invisibiliser les barres de mesure. Le troisième moment l’a poussé à reconstruire ce qui n’était pas sur la cassette mais qui paraissait logique au regard de ce qui précédait et de la partition, charge à l’interprète d’improviser au-delà des motifs spécifiés, « de sorte que l’auditeur ait le sentiment d’être pris dans une même logique sans faille ».
Le temps selon Dennis Johnson se dérobe. Il se présente, au sens créateur formalisé en 1962 par Umberto Eco, comme la possibilité pour l’interprète d’agir « sur la structure même de l’œuvre, de déterminer la durée des notes ou la succession des sons dans un acte d’improvisation créatrice »[1]. Karlheinz Stockhausen et son Klavierstücke XI, Luciano Berio et sa Sequenza pour flûte seule, mais aussi Henri Pousseur et ses Scambi dont l’œuvre constitue « moins un morceau qu’un champ de possibilités » traversent et irriguent November, audace qui travaille le temps et se révèle, à la fois, de son temps – le début des années 1960 – et hors du temps.
Dans sa manière de mesurer le temps tout en refusant de le mesurer, ce qui n’est une contradiction qu’en apparence, November est une composition hypnotique qui remet l’interprète au centre. Et c’est quand même joyeux qu’une partition friable s’en remette à des interprètes de l’aune de Nicolas Horvath, loué pour son glassisme comme pour sa scriabinité, et hop. L’interprète assume ici une proposition structurellement inaccomplie, qui travaille avec force la notion d’œuvre en action qui ne saurait être que provisoire.
In fine, ce travail sur le temps offre une inattendue perspective kantienne qui nous permet de nous orienter dans le monde en nous ouvrant, par ce temps offert, des espaces. Il nous extrait de nos confins, de nos limitations, de nos certitudes. Pour peu que nous acceptions de nous risquer dans ses eaux allègrement troubles, il nous embrase d’un feu qui dévoile des possibles presque infinis ; et nous constatons, ébahis, à bout de souffle, pantelant de stupéfaction que ces domaines – qui ne nous semblaient pas même inaccessibles car nous en ignorions l’existence – ne sont pas si dangereux que promis.
Passée l’immensité des sept heures quinze d’écoute théoriques, consubstantielles au projet radical et sans concession, point de vertige. À peine – on dit bien « à peine » – un absolu, une forme d’apocalypse intérieure, de vent frais – de vent de novembre ? – que le jeu précis et habité de Nicolas Horvath laisse s’engouffrer en nous, puis disparaître après nous avoir dépoussiérés, confirmant l’intuition d’André du Bouchet selon laquelle « l’air qui s’empare des lointains nous laisse vivants derrière lui »[2].
Pour écouter la première partie et acheter l’album numérique, c’est ici.
Pour retrouver quelques-unes de nos critiques de disques horvathiens, c’est là.
- Umberto Eco, L’Œuvre ouverte [1962], trad. Chantal Roux de Bézieux et André Boucourechliev, Le Seuil, 1965, p. 15.
- André du Bouchet, Dans la chaleur vacante [1961], Gallimard, « Poésie » [1991], 2009, p. 101.