Marie-Aude Murail, « En nous, beaucoup d’hommes respirent » (2/2)
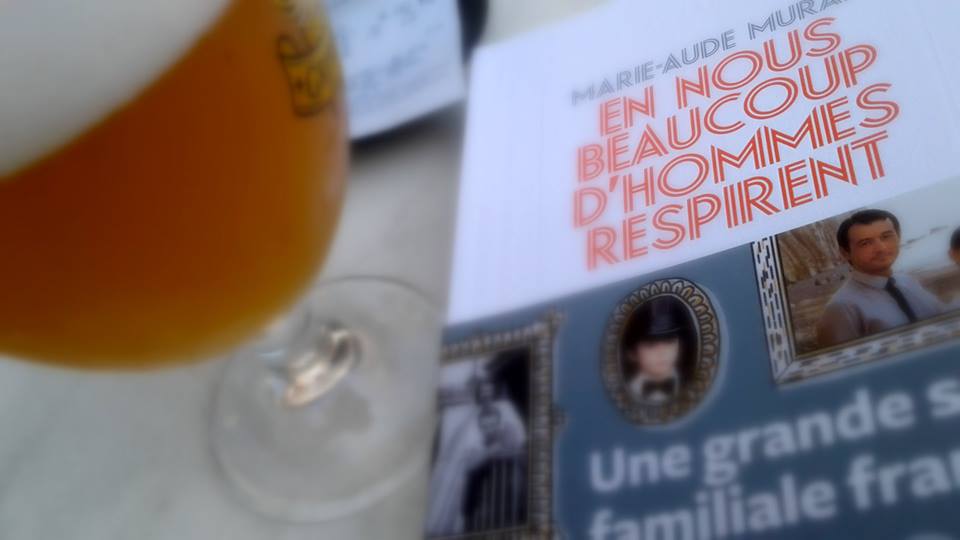
Comme promis ce tantôt, voici une p’tite notulette sur l’autobiographie de Marie-Aude Murail parue chez L’Iconoclaste à la fin août 2018 (430 p., 20 €).
De quoi ça parle ?
D’abord, il y a les morts : Raoul et Cécile. Raoul le dragueur, le ténor, l’artisss, le satisfait de lui, le chougneur, le charismatique, le soldat. Cécile la tacitement juive, Cécile l’effacée, même, car seules les lettres qu’elle a conservées de Raoul racontent leur histoire d’amour huitogénaire ; Cécile qui ne s’en laisse cependant pas conter par les remontrances de son époux ; Cécile dont on retrouvera la version de la rencontre amoureuse, une où l’on a « fait Pâques avant les Rameaux » et même fini par enfanter la maman de Marie-Aude Murail. Il y a donc Marie-Thérèse, la future MAMan élevée dans un catholicisme qui ne rigolait pas, rêvant de devenir « Michèle Brune, comédienne », qu’elle fut aussi ; et Norbert dit « le pauvre surdoué », qui s’emmerde à la guerre et verra son cerveau grignoté par une tumeur, peut-être, et par les chirurgiens, sûrement.
Ensuite, il y a les vivants presque morts et les vivants qu’habitent les morts. C’est moins facile à saisir, au point que Marie-Aude Murail doit délaisser les archives familiales où elle puisait la substantifique moelle de son récit. Objectif : enquêter sur les lieux du crime – en l’espèce, au Havre (pour rien) et auprès des anciens qui ont connu les fantômes du passé, donc qui ne les drapent pas forcément sous les oripeaux attendus. Des souvenirs utiles s’échappent, d’autres remémorations s’imposent (ainsi des gendarmes Cocu, Lecul et Couillard, puissance évocatrice de l’onomastique). Dans un second temps, Marie-Aude plonge dans ses souvenirs d’antan tels que fixés sur son vieux journal intime. On y parle de petits pois (tiens donc), de Méhari verte, de confession, de ponctuation, de peluches donc de prout et de narcisse, de khova, de Winchester à canon scié, de point mousse, de calvitie, de chimio maternelle, de foot dans le couloir, de ce qui nous échappe au cœur des souvenirs – bref, même dans la chronologie, ça confusionne. Aussi l’auteur opte-t-elle pour un « classement thématique », façon pour le sujet de reprendre la main sur la profusion de la mémoire brusquement avivée. Cela nous permet de passer en revue la piscicole Annick Moinet, le sens de la déco literie d’Elvire Murail, les infidélités de Pierre (même si le prénom est hyperpolysémique dans cette « saga », alors que Gérard est plus clair puisqu’il s’appelle Jean, bref).
C’est autour de Gérard qu’une troisième partie du récit se cristallise. Gérard aime les putes, n’a rien contre les pédés, enthousiasme Marie-Thérèse, dite Thérèse et/ou Maïté, dont il tança pourtant « la croupe rustique », et féconde en poète trois écrivains et un prix de Rome. Celle qui nous intéresse ici se révèle très tôt journaliste, ultracatho, plagiaire, buissonniste et sécheuse, gourmande de sexualités diverses, puis détourneuse de futurs prêtres puisque la Murail attire quelque Pierre. On apprend alors, dans une seconde moitié de livre plus personnelle que généalogique, qu’un comportement original peut naître d’une envie de pisser discrètement ; qu’une jeune oie blanche peut rêver de violences sexuelles ; que le cancer est parfois curable mais que l’on meurt toujours ; que la sexualité peut être orgasmique ou hypercasse-couille quand on veut aller se faire foutre sans se faire foutre mais en se faisant foutre quand même (moins d’obscurcissements p. 353) ; qu’une nuit de noces peut se passer sur l’oreiller mais pas avec le susnommé Narcisse ; que la vie coïtale des escargots est très compliquée, même pour un statisticien ; que Cookie Dingler traduit plutôt bien l’amour homosexuel pour les personnes de sexe différent, si, si ; que, si la vie est un Passage, les MST sont de piètres compagnons de traversée ; qu’il ne faut pas dire des choses intelligentes vu que, parfois, on vous croit ; qu’une femme peut avorter parce que ; qu’une trottinette peut dépasser une Volvo ; qu’une maman devient vraiment maman quand son gamin manque de foi ; que Benjamin Murail buvait du thé, oh, et qu’il lui était arrivé de prendre sa mère pour une rame de la RATP ; qu’un Sermon peut parler de masturbation enfantine, et un inédit d’un enfant inédit ; qu’une contraction n’en est pas à une contradiction près ; que le pire, quand on attend 5 h 20, c’est qu’il soit toujours 5 h ; et que Marie-Aude Murail va à Carrefour. Bref, que la vie, même de la plus grande romancière pour la jeunesse, reste la vie, même si, dès lors, elle est mieux racontée que le reste des vies.
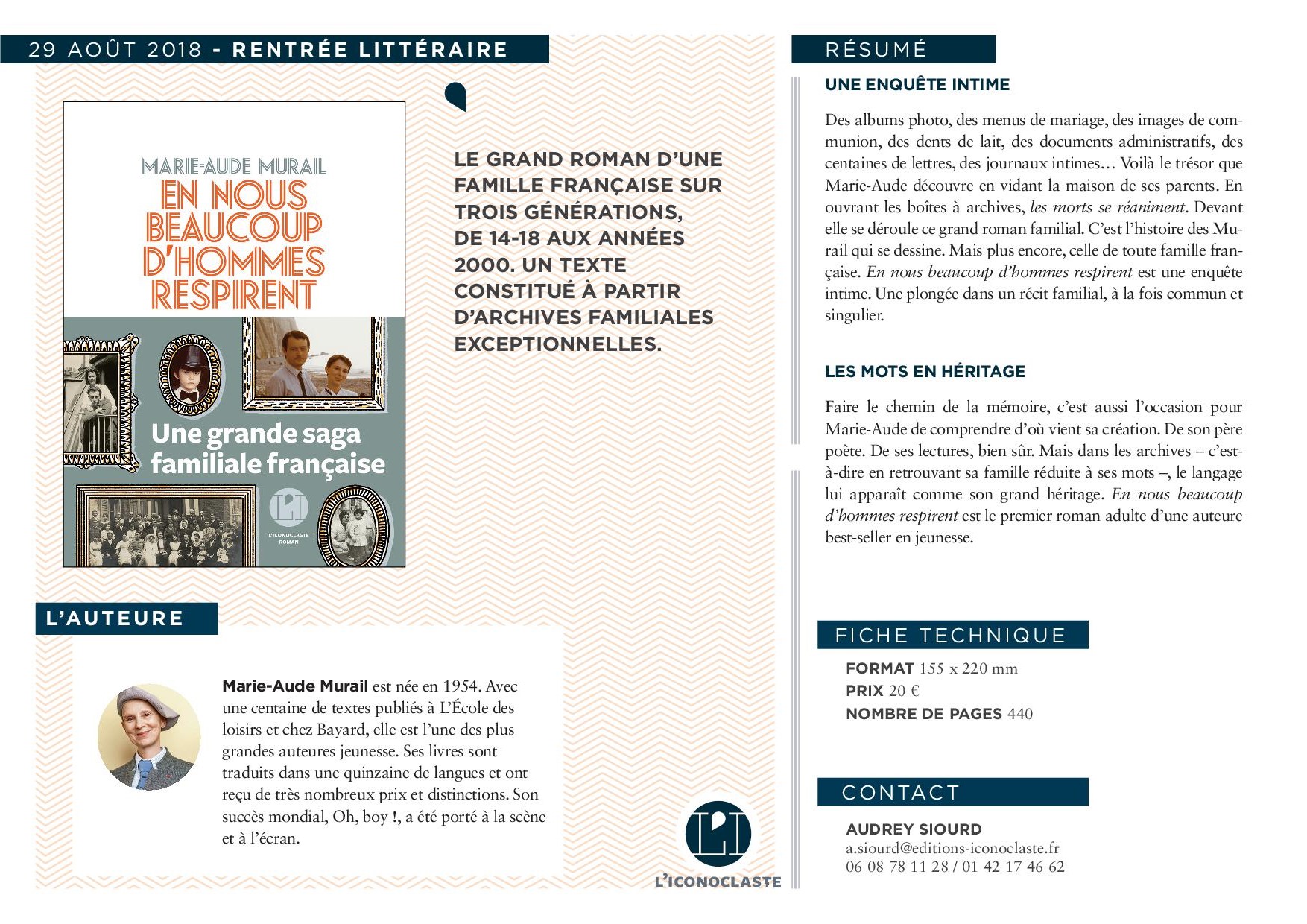 Et sinon, ça ressemble à quoi ?
Et sinon, ça ressemble à quoi ?
Alors que, dès l’argu, l’éditeur, fautif (et encore, on a décidé de ne pas parler de la piètre carte de couverture, abîmée dès la première manipulation), annonce publier « le premier roman pour adultes » de Marie-Aude Murail (c’est bien de Marie-Aude Murail, c’est bien pour adultes, mais ce n’est ni le premier roman pour adultes de l’artiste, ni un roman tout court alors que le terme est martelé trois fois dans le document), on se pourra intéresser ici à l’art de construire, précisément, un genre autobiographique. Non que le livre cherche à révolutionner le projet, mais bien que sa construction du « pacte » passe par l’explicitation du genre. En clair, le projet muraillen n’est pas de dire « toute la vérité » sur sa famille, même si elle ne cherche pas à celer ce qui pourrait paraître moins flatteur aux gens parfaits, eux ; il consiste à dire ce qui permet de dire. Donc : comment le texte se construit-il ? Sur quels matériaux s’appuie-t-il ? Quelles sont ses sources ? Et comment classer le fleuve qu’il devient ?
Il n’est pas lieu, ici, de revenir sur les formes biographiques qui jalonnent déjà l’œuvre de la plus importante romancière française pour la jeunesse du vingtième siècle et du présent siècle. Le sujet n’en serait pas moins palpitant. Il exigerait d’évoquer trois formes principales :
- les mille et une « bio » éditoriales, les resucées de fanatiques, les versions relatées par les pairs comme le texte de Sophie Chérer inscrit dans la collection publicitaire « Mon écrivain préféré », peignant, après sa généalogie évoquée au premier chapitre, « la femme libre, la militante, l’épouse amoureuse, la mère de famille » et « la petite fille » (voire ses ascendants) pour l’école des loisirs (2001, p. 40) ;
- le décodage biographique de ses romans, non seulement pour l’auteur mais aussi par rapport à ses enfants (personnellement, ça ne me passionnerait pas des masses, des masses, mais faut bien bosser, parfois) ;
- le renversement de la problématique – une problématique, c’est comme une jupe : c’est souvent plus palpitant sens dessus dessous – qui conduit à s’intéresser à la biographie des autres que Marie-Aude Murail n’a cessé de dresser : biographie de ses personnages (que raconte-t-elle d’eux ? que tait-elle ? etc.) ; biographie qu’elle a elle-même écrites (Charles Dickens, Jésus « comme un roman »…) ; modes d’emploi biographiques qu’elle a offerts à ses lecteurs dans ses livres « pratiques » publiés dans la collection « Oxygène » chez De La Martinière Jeunesse, en 1996 et 1998 ; autobiographie partielle en écrivain comme ce « journal d’une création » après Le Tueur à la cravate, et…
Mais comme on a dit qu’il n’était pas lieu, ici, de revenir blablabla, soit, on n’y revient pas. Oh, non.
Enfin, on n’y revient pas, mais on doit pointer le fait que la question biographique chez Marie-Aude Murail subsume les catégories. Ce n’est pas : « Je n’ai pas d’inspiration, je vais écrire ma vie », c’est : écrire ma vie, c’est transformer l’existant, l’ayant existé et l’exister-encore en texte. C’est laisser ma vie textuelle envahir ma vie personnelle. C’est contaminer l’une avec l’autre comme quand, « quitte à nuire à la vérité historique, je vais faire les corrections orthographiques qui s’imposent » (317). C’est constater l’aller-retour entre réel et fictionnel, entre vécu et textuel, entre fabriqué (fingere) et encaissé, entre écrits et cris. C’est ce que je fais depuis plus d’une centaine de livres, bordel.
Voilà pourquoi, sans doute, la présente autobiographie est bouffée par les mites, c’est pas une faute d’orthographe, intertextuelles – pour les non-férus d’idiolecte critique, j’appelle intertexte un texte ou un élément culturel (film, chanson, spectacle…) qui interagit avec le texte principal, celui que Marie-Aude Murail écrit ; et j’appelle idiolecte – oh, ça va. Donnons quatre exemples des types d’intertexte qui enrichissent ce récit au moment où « la mémoire fuit de toutes parts » (252) :
- les intertextes officiels, souvent partiels (bulletins de classe), parfois inattendus (numéro de carte de laboratoire, citation d’une fiche de confession…) ;
- les intertextes externes, innombrables, de Dickens à Pergaud en passant, entre autres, par Cocteau, Sartre, Vigny, Corneille, Scouarnec/Akepsimas (texte du cantique E 120 remixé p. 293), Dufresne, Nietzsche, Leblanc, Legrand, Renard, Greg, Barbara, Aragon, Colette, Sade, Shaw, Roussin, sans compter les films aux beaux acteurs (et tarifs spéciaux de la Fnac) ;
- les intertextes internes, qu’ils aient été mis en fiction (tel 3000 façons d’aimer ou Dinky rouge sang que l’on voit se faufiler p. 291), qu’ils assument leur ficticité ou qu’ils revendiquent une authenticité par leur intimité (journal personnel) ou par leur non-extimité (inédit autour de la naissance et des premières années de Benjamin, dont la nature est intéressante car elle associe confession et écriture déjà prête à l’édition) ; et
- les intertextes mixtes regroupant les témoignages personnels d’autrui (pour eux-mêmes via leurs journaux intimes, ou pour d’autres via leur correspondance), ainsi que les témoignages publics (entretien du père avec son beau-fils).
Cette multiplicité ontologique fait résonner la multiplicité de natures (textes, images reproduites, descriptions…) et de modalités d’insertion dans le flux chronologique du récit (en vignette, centré, en cul de chapitre…). Ce qui fut vécu ou écrit questionne toujours ce qui ne l’a pas été. Comme le pose l’auteur finissant sa visite à une aïeule, « je suis en train de laisser passer une occasion, et je ne sais pas de laquelle il s’agit » (109). En ce sens, l’acte biographique en général et autobiographique en particulier se constitue autour de ce qu’elle ne parle pas, de ce dont elle ne fait pas mention, de ce qu’elle omet – le dialogue avec des œuvres allogènes l’inscrit dans la chair du récit. Surtout, par sa richesse, la multiplicité intertextuelle pose la question de la fonction de l’autre texte en autobiographie, bien au-delà des propositions canoniques de Philippe Lejeune. Sans entrer dans un débat universitaro-centré, il est évident que s’actualise ici, d’une manière très singulière, l’art vallésien de couturer le texte, donc de montrer ses béances afin, à la fois, de les masquer en les explicitant ou de les offrir en tant que garanties d’authenticité (l’auteur avoue « avoir des trous » pour certaines années). Tout en mettant en scène et en page son exigence d’authenticité, tout en interrogeant dans de touchants métatextes ce qu’il faut dire et ce qu’il conviendrait de dissimuler, tout en projetant le lecteur dans les méandres de sa vie, de sa mémoire, de son écriture elle-même étalée sur quatre ans, l’autobiographe construit un texte où le divers fait unité. Ce n’est pas divers pour faire vrai, partiel pour surjouer la sincérité, explicité pour garantir la littérarité de l’œuvre : c’est simplement divers parce que le texte est divers, c’est-à-dire que la vie est diverse.
Et concrètement ?
Que le lecteur de ces p’tites lignes ne s’inquiète pas : contrairement à la présente notule, le récit est très clair. Pour preuve, il y a deux parties équitablement volumiques : l’avant-Marie-Aude Murail et la vie de Marie-Aude Murail. Mais ce qui les unifie avant tout, c’est cette diversité, cette spécificité d’écriture qui travaille, malaxe, reprend, revient, conteste, avoue, expose, efface, néglige, corrige, feint d’oublier, floute, zoome, déplace par des autocitations de Passage, sanctionne, critique par la voix du mari, reprend, se moque de l’humour, convoque, disjoint, substitue une logique à une autre qui ne fonctionne plus, renonce, allusionne, juge, déjuge, préjuge, s’absente et s’abandonne. Tout se passe comme si l’auteur avait voulu, dans un même mouvement, gommer les ratures ET les laisser visibles, car « la vie [est] une suite d’objets manquants », ainsi que pense Louise dans Sauveur et fils 3 (l’école des loisirs, 2017, p. 128). Dans cette perspective louisique, raconter sa vie, c’est aussi, c’est surtout, c’est forcément raconter une suite d’objets manquants. Pas juste un sujet sachant ou croyant savoir, ou voulant donner l’illusion de savoir : aussi des objets de récit, des gens dont on ne sait rien, ou dont, pis, on ne sait qu’un peu ; dont on ne donne qu’un prénom (contrairement aux profs, mais sont-ce leurs vrais patronymes ?), qu’une initiale, qu’une partie de l’existence ; des gens, dont l’auteur. Éric Chevillard, louisiste patenté mais presque, pas pu m’en empêcher, ne faisait-il pas dire à un narrateur : « Je veux récupérer ma gomme. Je lui dois beaucoup, tout ce que je ne suis pas » (Du hérisson, Minuit, 2002, p. 57) ? La narration d’une vie est avant tout la mise en scène de cette incomplétude réflexive – ce que j’ignore des autres illustre, en miroir, ce que j’ignore de moi ; aussi ce que je croyais savoir d’eux est-il parfois tout autant faux que ce que je m’obstinais à croire de moi.
Certes, l’on pourrait s’imaginer que l’ensemble de cette notule est une intellectualisation d’une œuvre charnelle (En nous, beaucoup d’hommes respirent raconte « des vies », comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, chanteur que Marie-Aude Murail cite parfois au long de son œuvre), alors que c’est vrai. Mais l’écriture d’une autobiographie est, malgré que l’on en ait (si, là, ça passe, Gérard, même si je combats avec toi ce maudit « par contre »), une forme présentement littéraire d’intellectualisation du vivant et du vécu. L’auteur démontre ainsi sa capacité formidable d’être à la fois dans la trivialité de la vie et dans la sublimation de sa narration. Écrire sa vie, selon Marie-Aude Murail, ce n’est pas, semble-t-il, raconter ce que l’on a fait, c’est raconter ce qui a fait que l’on a fait plutôt que pas fait. On pense à Jules dans Papa et maman sont dans un bateau, que son institutrice tâche d’encourager en marquant « comme acquis exprime ses préférences puisque Jules exprimait quotidiennement son désir de ne rien foutre » (2009, p. 79). Qu’est-ce qui a fait que, malgré notre désir sporadique ou dense de ne rien foutre, nous avons vécu nos vies en sus de les rêver ?
Par-delà les révélations sur lesquelles l’auteur s’interroge au long du texte, l’autobiographie d’un artiste remet au centre une série de quatre questions. Première question, l’identité : certains prénoms sont floutés, négligés, omis. Par respect pour les individus évoqués, certes ; mais aussi dans une sorte de forme-sens. En effet, Marie-Aude, « mondialement connue », a failli ne pas s’appeler Marie-Aude. L’autobiographie est ainsi l’occasion de s’interroger sur son identité propre autant que sur son identité sociale (fille, élève, fiancée, épouse, mère…), sexuelle ou sociétale (auteur, vedette, référence). Est-on construit par la société qui nous case si volontiers, par sa famille dont on ignore souvent beaucoup, par ses parents dont les mystères sont souvent nombreux, par son existence dont les épisodes échappent parfois à celui qui les vit, par ses aspirations qui s’échappent ou s’imposent ou se fracassent et nous fracassent ? Chez un auteur pour la jeunesse, bassiné par les questions sur « comment ça vient, les idées ? et vous avez toujours voulu écrire ? et comment on devient écrivain ? et vous gagnez beaucoup d’argent ? », ces interrogations méritent peut-être une telle mise au point.
La deuxième question est celle de l’attachement. Alors que l’identité centripète, en un mot, met au centre l’individu, l’attachement centrifuge le met en relation avec le monde extérieur. L’auteur montre que cela ne le constitue pas comme acteur pour autant : l’exploration d’une généalogie propose un axe donnant profondeur à des options ultérieures ; la notion de « fratrie d’artistes », propre aux Murail, souligne le mystère des choix et l’interdépendance des options prises consciemment ou non ; les multiples possibles donc interdits sexuels, sentimentaux, mais aussi professionnels, humains, transcendantaux – les rêves, les espoirs, la foi… – ne sont pas que des données ou des choix ou des évidences, ils peuvent être des passages, des passades, des parades et des passerelles.
La troisième question mise en évidence par ce texte est celle de la discontinuité temporelle. En effet, paradoxalement, le flux biographique que nous croyons évident et acquis, est mis à mal par l’autobiographie, avec ses à-coups, ses prolepses, ses analepses, ses ellipses, ses gouffres, ses silences pudiques ou impudiques, ses imprécisions (le souvenir peut se dissoudre ou se tromper). Le temps biographique est un mensonge ; le temps autobiographique est une fiction, interrogeant « comment faire durer le temps » plutôt que le tuer (173). Dinky rouge sang ne disait pas autre chose en s’ouvrant sur la lettre post mortem du héros sempervirens. Ce livre-ci ouvre le travail de mémoire par un verbe choisi : « J’oublie. » Diffraction du savoir. Implosion de l’acquis. Disparition du solide. Pourtant, Marie-Aude Murail précise : « J’oublie mes romans. » Mais est-il plus romanesque que l’autobiographie, avec son lot d’inventions, d’erreurs, de censures (ces « raisons dont je ne parlerai peut-être pas », 99, ne sont-elle pas plus constitutives du soi et de son récit que les plus jolies explications génétiques ou lacaniennes ?), de reconstitutions et d’ignorances ? Est-il plus fabriqué que cette concentration d’un siècle en quatre cents pages, de dizaines de vies en quelques chapitres ? Ce pari, cette illusion assumée exige une rechronologisation que Marie-Aude Murail met en scène à l’aide de va-et-vient entre l’auteur-qui-écrit à partir de documents en train d’être découverts et les personnages-qui-ne-sont-pas-des-personnages mais des personnes ayant existé. Le temps se dissout dans ces échanges transtemporels qui rappellent que non seulement le temps n’est pas une ligne droite, non seulement il n’est pas une logique que l’on pourrait maîtriser, par exemple « en attendant ce moment de la vie, très improbable, que l’on désigne communément par les mots : quand j’aurai le temps » (19), mais il n’est pas davantage une ligne courbe ou ondulée. Il n’est pas, en fait. Véronique Pestel le chante ainsi : « Notre temps, le temps, n’est jamais devant / Le seul temps qui soit passe derrière soi / Notre temps, le temps, n’est jamais devant / Le seul temps qui fut, c’est le temps reçu. » Mais reçu par qui ? Comment ? Et conservé dans quel état ? dans quel étant ? L’un des forts intérêts de ce texte est que Marie-Aude Murail a l’art de rendre sensibles l’espace donc le temps, et réciproquement, soulignant que, oui, « il y a peut-être des lettres qui arrivent à destination quarante ans plus tard ». Seul, peut-être, le travail littéraire peut donner du sens au temps – et, une fois de plus, la posture d’écrivain pour la jeunesse rend la question spécifique : peut-on, par exemple, écrire pour les jeunes alors que le temps a passé et, non seulement, on est vieux mais on vieillit ? Le vieux cliché du « on est resté un petit enfant dans sa tête » résiste-t-il à sa bêtise chichiteuse et à l’opiniâtreté des corps ? Discontinuité temporelle, chaos de la diégèse, écarts de la chronologie : le récit de Marie-Aude Murail met en mots, par la structure propre au livre, la distance entre l’illusion (on tourne des pages, donc « ça » avance) et la réalité (mais ça avance où ? comment ? vers quoi ? la mort pour au moins commencer de finir, soit, mais de quoi parle-t-on ?).
Dès lors, la quatrième question ne peut être que celle de la création. Elle traverse le livre pour trois raisons principales :
- un, chez les Murail au sens large, on crée à tour de bras depuis des générations ;
- deux, l’autobiographie suppose que la vie se crée, se décide, se construit avec volonté en dépit des coups du sort ou grâce aux astuces d’un hypothétique destin téléologique ;
- trois, l’autobiographie est une création.
Or, la force de Marie-Aude Murail est certainement dans cet art du métatexte. En général, le métatexte, c’est le texte qui critique le texte : « Finalement, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment passé comme ça », « quand même, j’en fais trop », etc. Ici, il y a du métatexte de cette eau, et c’est heureux, pour rappeler que l’auteur n’est pas dupe de son jeu – il n’y a pas que le rap qui a droit à son game ; mais il y a aussi du métatexte jouant avec les éléments allogènes (commentant les photos, y faisant allusion ou les commentant) ; il y a aussi du métatexte qui prépare, intègre et met en perspective un texte inséré dans le texte principal ; il y a, surtout, un métatexte qui réfléchit sur lui-même par sa pluralité autant que par le commentaire des choix de chapitrage, par sa construction autant que par sa déconstruction, par ce qu’il ne fut pas autant que par ce qu’il est (l’un des personnages principaux est ce Dragon, flirt de l’artiste – les amateurs de jeux de mots se régalent – que, parfois, l’auteur remise et, souvent, l’autobiographe corrige).
En conclusion
En nous, beaucoup d’hommes respirent (titre auquel l’auteur fait deux allusions explicites, 270 et 425) est un texte qu’il est tout à fait conseillé de lire notamment parce que :
- y a deux super blagues de Toto ;
- y a des expressions comme « il a la pisse au bout du rouleau » ou « il a des exigences de personnage » ;
- y a une excellente critique musicale vachement courte (276) ;
- y a des trucs sur l’importance du prout pour faire passer l’émotion (enfin, ça se dit plutôt : « Tout ce que j’ai écrit, je l’ai corrigé d’un sourire », ce qui est plus meilleur, d’accord, d’accord) ;
- y a de très beaux passages sur les derniers moments et leurs illusions (251) ;
- y a des méditations sur des sujets intéressants comme le goût de l’hostie en général et l’intérêt pâtissier de prier pour les gens (121 et 129) ;
- y a un court cours de pénis très bien raté sur la différence entre fellation et sodomie (308) ;
- juste après – coïncidence ou réalité scientifique ? –, on voit l’auteur qui sent le bouc, c’est ravissant ;
- y a un syntagme pour les fanatiques de Kaamelott! (187) ;
- y a des gros mots, du genre : « Je prends conscience de ma naïveté. De ma connerie, en fait » ;
- y a des phrases du style « Je n’aime pas trop vos recherches de prénom. Il ne faut pas construire des maquettes de bonheur » et ça, ça crache ;
- et, en prime, y a du cul (ben oui, ça couvre plusieurs générations, donc, faut ce qu’il faut).
En somme, cette autobiographie séduit tant par son ambition transgénérationnelle que par son souci de malaxer narration et travail générique. En clair, ça raconte plein d’histoires et c’est quand même intelligent, comme pour répondre à la boutade du deuxième chapitre de 3000 façons de dire je t’aime : « Vous existez souvent ? – Oh non, j’ai autre chose à faire » (l’école des loisirs, 2013, p. 21).
Addendum : la question de Claire E.-G.
(et la réponse qui va bien)


