L’Or du Rhin, La Monnaie, 7 novembre 2023 – 1
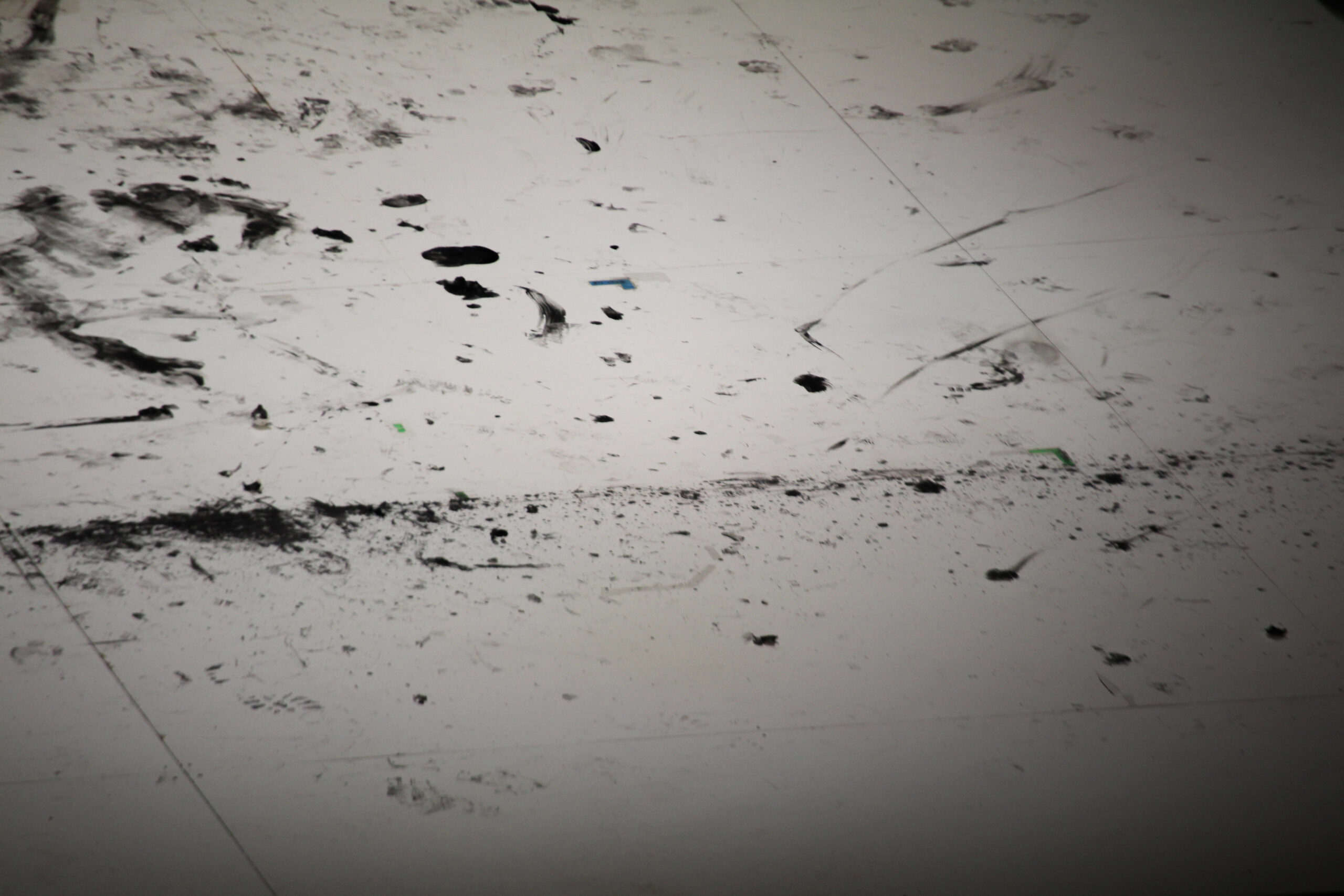
Aperçu du décor final du « Rheingold » à la Monnaie (Bruxelles), le 7 novembre 2023. Photo : Bertrand Ferrier.
Ce n’est pas l’événement à Bruxelles : c’est l’événement worldwide de l’opéra, et ça se passe – non, ni à New York, ni à Vienne – à Bruxelles. Le Ring de Richard Wagner est la tétralogie la plus successfull de tous les opéras du monde entier. Ajoutez-y la fanitude des mélomanes pour Alain Altinoglu, le chef que beaucoup de Parisiens rêvent en nouveau patron de la Grande boutique, et l’effet marque de Romeo Castellucci, le metteur en scène dont les gens cultivés louent l’intelligence et le sens de la provocation et, même en l’absence de gigavedettes côté solistes, vous comprendrez pourquoi les billets se sont arrachés… au point que toutes les représentations étaient trois fois complètes :
- complètes d’abord parce qu’il n’y a plus un billet à vendre ;
- complètes ensuite parce que des passionnés font la queue en espérant contre toute espérance qu’un billet reste à vendre (non) ou qu’une invitation puisse être récupérée si l’invité ne venait pas (encore raté) ; et
- complètes enfin parce que le théâtre est allé jusqu’à rajouter des chaises aux fauteuils pour bourrer au-delà de la gueule l’espace disponible.
Autant dire que l’on imaginait que la Monnaie lâcherait un peu de ronds de carotte pour offrir une distribution aux spectateurs, autant pour informer ses clients que pour saluer les artistes – il n’en sera rien. Tant pis, les dés sont lancés et l’affaire commence par poser la question centrale de la musique, id sunt les
- intersections,
- complémentarités et
- incompatibilités
forcément partielles entre
- le silence,
- le bruit et
- le son organisé.
Aux 2 h 30 d’opéra, Romeo Castellucci ajoute quelques minutes de bruit, en faisant lourdement secouer un grand ring gris sur une scène vide. Après le silence qui accompagne le lever de rideau, du bruit, donc, puis de la musique enveloppée de nuit. Autant que possible, Alain Altinoglu, comme il l’avait annoncé dans sa vidéo de présentation, brillante
- de simplicité,
- de spontanéité travaillée et
- de points de suspension,
donne à voir ce surgissement de 17 h de musique depuis 136 mesures en Mi bémol, non pas comme le passage de l’obscurité à la lumière (ce serait mystique) mais comme le passage du silence à la création (c’est métaphysique, donc c’est musique).
Peut alors se déployer la formidable hypocrisie de la mise en scène opératique : le travail de la nudité. Comme dans le Lohengrin récemment mis en scène par Kirill Serebrennikov, le Rheingold de Romeo Castellucci commence par compenser sa frustration de ne pouvoir exiger des solistes d’être à poil en transférant cette charge sur des doublures. En l’espèce, les filles du Rhin, jadis représentées en sœurs Foufoune grâce à des postiches sur la scène de Bastille, côtoient leurs doublures dénudées, tour à tour pole-danceuses et pratiquantes de natation synchronisée. Pour ne pas brusquer le bourgeois, ces dames sont bientôt recouvertes de peinture dorée, dont le metteur en scène sous-entend l’ambiguïté : c’est à la fois une vision concrète des filles veillant sur le trésor tapi dans le Rhin et une image polémique de la femme, wag ou escort sédentarisée, qu’une vie dorée suffit à fixer autour d’un seul objectif : garder l’or.
L’hypocrisie qui consiste à déléguer le nu à des figurantes, considérées comme des cascadeuses de l’érotisme, doit peut-être être interprétée comme l’exploration de ce que Dana Kaplan et Eva Illouz appellent « le capital sexuel », idée selon laquelle « au-delà de la marchandisation des corps, la liberté sexuelle augmente la valeur économique des individus » (Le Seuil, « Traverse », 2023). Toutefois, cette hypothèse serait flatteuse puisque ce pis-aller est utilisé par tous les metteurs en scène bien en cour, dans des projets culturels très différents. Plus probablement, il s’agit là d’une façon un rien lâche d’émoustiller le bourgeois sous un vernis politico-culturel trop banal pour être convaincant. Surtout, c’est l’illustration d’une exploitation du corps en fonction de l’échelle culturelle (la chanteuse peut refuser de se désaper, la danseuse non, sous peine de louper un contrat) qui n’est rien moins que malaisante, ce qui gâche l’effet réussi de l’or tombant des cintres et recouvrant les ondines.
À la différence d’un Olivier Py, Romeo Castellucci, qui ne rechigne pas à exploiter les corps mignons tout plein des prolétaires de la culture qui s’offrent à lui (il y en aura toujours), travaille davantage la versatilité d’un sol mouvant que la verticalité tridimensionnelle de la scène. Celle-ci s’élève et s’incline – par exemple pour qu’Alberich récupère de l’or, liquide ou non, ou pour donner l’illusion des dimensions officielles des personnages, nains ou, plus tard, géants. Comme l’exige la vulgate actuelle, il s’agit d’évoquer plutôt que de relater. Ainsi, en attendant le burg des dieux, des bas-reliefs et des sculptures habillent l’espèce d’espace. Côté personnage, la scène s’envahit de figurants vêtus d’un slip pour les messieurs et d’un soutif couleur chair en sus pour les dames. Sans sous-titre scénique, l’évocation relève davantage du fantasmatique de chacun : sera-ce que les dieux marchent sur les hommes avec difficulté puisqu’ils ne sont plus si souverains que cela ? Cette idée de dieux très humains puisque cherchant constamment à écraser l’autre, qui ou quel que soit cet autre, correspondrait à l’idée wagnérienne d’un continuum entre humain et divin. La multitude de strates entre dieux, demi-dieux, créatures féériques et humains s’articule dans une théo-mythologie sciemment confuse. En effet, le prologue ne raconte rien, il se cantonne d’insérer lentement, longuement, puissamment,
- la pomme-anneau dans le jardin d’Eden,
- le serpent-or dans l’enclos et
- la finitude-malédiction dans le sublime.
Dès la première scène, le casting semble être à l’écho de ce mélange de fatum et de déréliction. Tous les personnages sont animés par un même moteur psychologique : l’appât de la réussite – moteur qui, ma foi, en vaut bien d’autres. Les filles du Rhin sont fières de garder de l’or ; Alberich aspire à l’or et à la domination du monde ; les dieux se construisent une nouvelle baraque dans le même désir humain ou de retenir le mec volage, ou de crâner aux yeux des autres, et ainsi de suite. Or, l’or, n’est autre que la matérialisation métaphorique de l’insaisissable.
- Il n’est jamais suffisant ;
- on n’est jamais assuré de le conserver ; et
- sa nature n’est jamais stable – tantôt moyen, il devient volontiers fin et donc cause.
Comme chantait Ricet Barrier à propos du bovidé rutilant,
c’est pas l’veau qu’on adore,
c’est son côté sponsor.
Marie-Nicole Lemieux en Fricka (voilée, peut-être parce qu’il s’agit de représenter les principales religions, en l’espèce
- le polythéisme,
- le catholicisme,
- l’islam et
- le bouddhisme,
le judaïsme étant prudemment évité) traduit cette tension. La voix est
- pure,
- solide et
- expressive.
Cependant, elle dédaigne toute forme de hiératisme ou d’emportement. À mille lieues d’une Stephanie Blythe énorme de fulmination, elle transforme sciemment la déesse en une bobonne un peu dég’ que son jules baguenaude et change volontiers de partenaire sexuelle. Que l’on n’attende donc point de l’artiste furie ni rugissement. Sa Fricka concentre sa lutte au niveau terre-à-terre qui est celui des dieux wagnériens – ceux dont on se demande parfois s’ils ne seraient pas moins les miroirs des hommes que les hommes ne seraient leurs miroirs. L’autorité rageuse poindra-t-elle dans La Walkyrie ? Pour ce premier volet, n’en déplaise à Georges Brassens, la Pénélope de Marie-Nicole Lemieux n’a aucune pensée interlope. Son chant a beau être propulsé dans une virtuosité stratosphérique avec l’aisance apparente d’une Marie-Nicole Lemieux en grande forme, il reste planté dans la lèche-frites. Voilà bien la vision radicale d’une déesse sans divinité, qui semble s’être résignée au destin médiocre et illusoire des déesses : contrôler la libido de leur gars en essayant de le conserver chez elle.
Appert ainsi la dualité divine entre fatum et déréliction. La tragédie qui se joue et dont Richard Wagner prend plaisir à mettre d’emblée les ingrédients sur la table comme on étale ses lettres au Scrabble est intimement liée au sentiment d’avoir perdu la grâce. Comme Fricka sait – sans jeu de mots, évidemment, tsss, tsss – qu’elle n’est plus guère qu’une épouse bafouée, dépendante de la chirurgie esthétique des alicaments que sont les pommes d’or pour ne pas dépérir, elle se replie sur son petit foyer où elle aspire à n’être qu’une cigale avec son grillon de Wotan. À l’inverse mais dans une même inclination pragmatique, comme Wotan sait que son pouvoir ne tient plus à grand-chose, il n’aspire qu’à jouir du peu de temps qu’il lui reste,
- sexuellement,
- martialement,
- urgemment.
Ce nonobstant, ce petit jeu révèle l’attrition de sa puissance : le dieu doit fuir sa femme pour avoir l’impression d’exister ; et il a besoin de Loge pour contrecarrer ses anciens alliés qu’il a roulés dans la farine. Romeo Castellucci en profite pour ne pas le présenter borgne, alors que le zozo est censé avoir offert son œil en gage d’union (quelle saga !) à Fricka. Est-ce parce que le metteur en scène veut suggérer que, en réalité, Wotan n’a pas donné cet œil ? Est-ce parce qu’il nous incite à penser que, face à l’envie de Fricka d’interner son époux, Wotan a tâché moyen de devenir aussi glissant qu’une vipère, ne respectant aucun accord, ni avec ses ouvriers, ni avec sa femme, ni avec lui-même ? Le personnage incarné par Gábor Bretz (entendu jadis en paysan schoenberguien) résonne de cette contradiction entre
- sa toute-puissance théorique,
- sa médiocrité pratique et
- sa psyché banale de winner devenu loser.
Comme Marie-Nicole Lemieux, la basse hongroise s’est dépouillée de toute autorité. L’effet d’étrangeté est garanti car sa voix
- ne tremble pas,
- ne se défausse pas devant les difficultés de la partition
- (tessiture,
- tenues et
- endurance, notamment), et
- ne se perd pas dans l’acoustique sèche de la Monnaie.
Ni l’étouffement du son lié à la présence massive du public, ni le danger d’affronter un orchestre rarement pianissimo quand il chante n’effraient l’artiste. C’est donc en conscience et en connivence avec la perspective castelluccienne qu’il renonce
- à l’aura du big boss des dieux,
- au charisme du maître suprême et
- à la sexyness censée accompagner ces qualités.
Poursuivi par sa réputation, son titre, la tradition, ce Wotan-là semble flotter dans un costume trop grand pour Wotan. La macrosituation (le fait que ça sente le roussi pour les dieux) lui échappe comme lui échappent les microsituations (en termes clairs : les emmerdes dans lesquelles il se met tant il manque
- de suivi,
- de gnaque et peut-être
- d’intelligence).
Gábor Bretz se dévoue pour
- effacer le sublime de son rôle,
- désamorcer la transcendance dans sa posture et
- abandonner son rôle métaphysique de dieu omnipotent.
Désormais, les dieux ne sont plus les plus puissants. Le titre du cycle, c’est L’Anneau ; et le titre de l’opéra, c’est L’Or du Rhin. La mise en scène de Romeo Castellucci le martèle :
- la fantasy,
- le féérique et
- l’humain
sont ce qui fait
- rêver,
- trembler et
- mourir les dieux.
À suivre…


