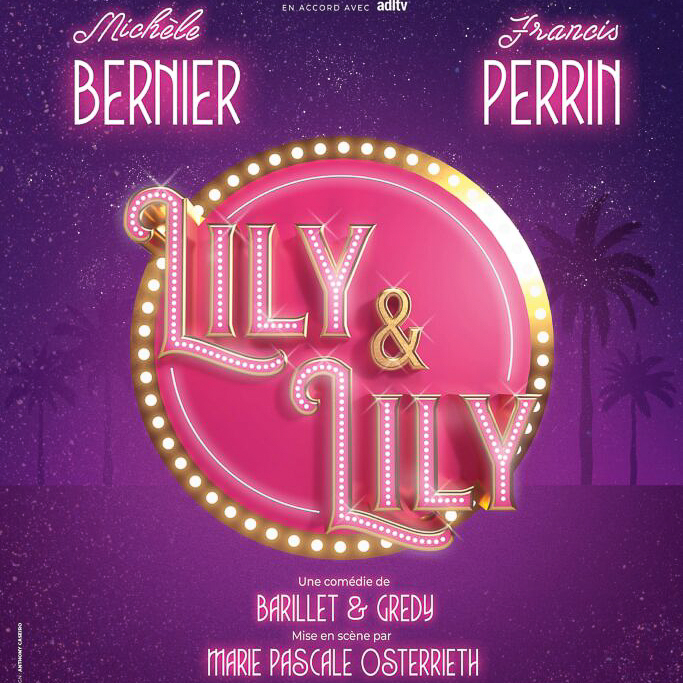Lily et Lily, Théâtre de Paris, 27 mars 2025
Pour qui aime le théâtre de boulevard, Lily et Lily, actuellement présenté au Théâtre de Paris, tient du bonbon et du monument. Lily et Lily est
- bonbon,
- sucrerie et
- douceur
parce que la pièce est définitivement marquée par sa créatrice, Jacqueline Maillan, son évocation charriant aussitôt ses palettes de nostalgie dramatique ! Monument, parce que c’est techniquement l’une des meilleures pièces du genre qui ait été écrite. Aussi phénoménale que les chefs-d’œuvres de Georges Feydeau, elle pousse au maximum le comique
- de situation,
- de mécanique,
- d’invraisemblance,
- d’absurde et même, quoique ce ne soit pas la prime spécialité des auteurs,
- de langage.
L’histoire ? Années 1930. Hollywood. La star du moment s’appelle Lily Da Costa (Michèle Bernier). Puisque vedette, elle est plus que capricieuse : insupportable avec Sam, son imprésario (Francis Perrin) et ses domestiques (Bastien Monier et Morgane Cabot) qui ont reçu mission de l’enlever au profit de la mafia. Indifférente au mécontentement général, elle boit, sniffe et baise à tout-va. Pour sauver son âme, Deborah, sa jumelle (Michèle Bernier itou), débarque du Minnesota. C’est alors que Sam, son imprésario, a une idée : et si Deborah, plus influençable et moins ingérable que sa sœur, prenait la place de Lily ?
Michèle Bernier s’est emparée de la pièce, dont nous voyons la cinquantième représentation dans la mise en scène de Marie-Pascale Osterrieth. Avec la technicienne, l’actrice a remanié le texte de 1984 à la fois légèrement (la structure est conservée) et lourdement. C’est tout le paradoxe de ces « reprises » qui remettent en selle des chevaux parce qu’ils sont fringants dans – voire grâce à – leur vieillesse, mais tentent de les faire presque passer pour de jeunes canassons. La question n’est pas nouvelle, pour le boulevard. En 2013, lors de la réédition d’un florilège de leurs pièces chez Omnibus, Jean-Pierre Gredy et Pierre Barillet avaient eux aussi procédé à des changements « parcimonieux » (les « nègres » avaient disparu et les monnaies s’étaient modernisées), en veillant à ne surtout pas trop actualiser leur travail, confiants qu’ils étaient dans un théâtre qui, en dépit de son succès, a, comme le théââââââtre, « l’ambition d’être intemporel ». Michèle et Pascale ont eu la main autrement lourde. De très nombreuses modifications ont été apportées, le plus souvent de façon inutile. Ainsi,
- Odilon, le domestique, est renommé Gaston ;
- Vladi, le mari slavisant, devient Julio le vaguement hispanique (Cyril Garnier) ;
- la fille de Chico n’est plus évoquée ;
- jadis chassé à coup de « Jingle bells », le zinzin invisible devient un fan (ce qui oblige à une explicitation autour de l’Oasis, clinique psychiatrique, quand il s’agit d’y envoyer Lily) ;
- Dandy Cracker se transforme en Joe le scorpion, etc.
Pourquoi diable ? Adieu aussi le prologue et les cendres de Poopsie (Michèle Bernier ne sniffe pas) ; bonjour, modifications dont l’intérêt échappe totalement ! Parmi moult, évoquons
- le prix du journal intime de la star qui a doublé ;
- les Marx Brothers qui perdent leur décompte ;
- l’entreprise de nettoyage qui se consacre désormais à vider les greniers ;
- Charlène la journaliste qui perd son maître ès pendule ;
- les domestiques qui rêvent désormais d’un bar-tabac rue de Clichy pour y recevoir Maurice Chevalier ;
- la chute de la dernière réplique de l’acte deuxième qui est coupée (dommage !) ;
- Heidi et la petite maison dans la prairie qui font leur apparition ;
- le « fondu enchaîné » qui a fondu quand, pour enchaîner (haha), Lily rembobine sa jeunesse avec son cher Jonathan qui n’attend plus dans la vieille Ford ;
- la versatilité politique du « démocrate ou républicain », quoique rigolote, est coupée, etc.
Au gré des (mauvaises) inspirations des updateuses, on oscille entre explicitation superfétatoire (la bisexualité des chiens) et pudeurs de sainte-nitouche, faisant écho à la suppression de la poudre (ainsi, l’excellente réplique « C’est une maman qu’il vous faut / – Exactement ! Une maman… de dix-sept ans de préférence » est remplacée par un hommage aux femmes « mûres mais pas trop », beaucoup moins savoureux ; désormais, Lily s’enfuit avec un marchand de plumeaux quand elle a presque quinze ans, pas presque quatorze, etc.). Même si l’on apprécie le clin d’œil à Gilles Vigneault dans le rôle du violoneux, les nombreux changements feront évidemment sursauter les aficionados, d’autant que, dans l’ensemble, ils n’apportent rien et sonnent parfois lourdingues, à l’instar de l’hispanisation incomplète de Vladi. Toutefois, yippie ! l’essentiel demeure.

Morgane Cabot (Yvette) , Bastien Monier (Gaston) et Michèle Bernier (Lily et Deborah). Photo : Béatrice Livet pour le théâtre de Paris. Source : site du théâtre.
L’essentiel, c’est le vertige que procure le théâtre de boulevard survitaminé. Chaque soir, et deux fois le samedi, Michèle Bernier joue Lily et Deborah, mais Deborah joue aussi Lily et réciproquement, voire joue Lily qui joue Deborah, et ainsi de suite. Les conventions sont habilement mises en évidence par les auteurs, et tellement extrémisées – et hop – qu’elles craquent et font rire aussi bien de leur mécanique huilée que de leur pétillante invraisemblance. Barillet et Gredy jouent sur
- l’accumulation et l’imbrication de situations cocasses,
- la réversibilité des apparences et la part d’authenticité qu’elles portent, et
- la malice mêlant
- narration échevelée,
- humour débridé, et
- absurde joyeux de l’invraisemblance assumée.
Lily et Lily est un éloge vivifiant de la pacotille et de la mauvaise foi, celles
- des vedettes,
- de l’art,
- de la vie quand elle va bien.
Face à la maîtresse de cérémonie, très convaincante (on avait entendu pis que pendre de Michèle Bernier : nous ne la connaissions pas mais l’estimons, tout court, puis digne et euphorisante dans son rôle), Francis Perrin réussit à sortir son personnage du pleurnichard qu’avait campé Jacques Jouanneau. L’option d’interprétation est validée par
- un dynamisme efficace,
- une épaisseur psychologique étoffée, et
- une présence scénique percutante.
Parmi les seconds rôles, saluons la Yvette de Morgane Cabot, laquelle sait jouer à la fois quand elle est au centre de l’attention et quand elle se tient coite. À Bastien Monier, son partenaire, Bernier & Osterrieth inventent une carrière espérée de chanteur donc insèrent des passages de musical à vocation de respiration, certes, mais qui ne se révèlent guère convaincants. L’acteur semble à l’étroit dans son rôle de victime (il n’en sortira pas à la fin, contrairement à la VO) pour nous ébaubir.
Véronique Boulanger joue la garce avec la même univocité qu’Éric Boucher joue le mari coincé qui redécouvre la devise d’un autre Barrier, Ricet, selon laquelle « chauffe un marron, ça l’fait péter ». Les deux comédiens font montre du métier attendu pour planter ces personnages aux stéréotypes jubilatoires, oui, jubilatoires, et si vous insistez, j’ajoute « ciselés », de sorte qu’il vaut mieux briser là, je le suppute. Entre deux passages au placard (après Alcatraz, le prisonnier en fuite est souvent fourré dans un autre placard, à fourrures, celui-là) ou sous le lit, Riton Liebman tente d’incarner l’improbable Doug avec un savoir-faire guignolesque qui n’exclut pas une palette de caractères, entre
- l’évadé sous tension,
- l’ex d’il y a un quart de siècle,
- l’homme rêvant d’un quickie…
Cyril Garnier, lui, peine à fasciner dans son rôle remixé de parasite hispanique. Sans doute l’acteur est-il handicapé par la réécriture plate qu’il doit parler et dont on aurait aimé qu’il fût fait l’économie. Plus généralement, l’ensemble est porté par une mise en scène fonctionnelle et un décor à l’avenant – avantage du théâtre de boulevard sur l’opéra, en quelque sorte !
Comme attendu et avec justesse, la salle fait un triomphe aux artistes. Michèle Bernier a l’élégance de saluer les techniciens et la production. Le couple d’hommes à mes côtés part rassuré car, bien que nous ayons été très proches de la scène, nous n’avons pas reçu de postillons, contrairement à leurs craintes les plus fofolles. Derrière moi, les deux spectatrices qui n’avaient de cesse de se demander à chaque acte si c’était la fin, ont obtenu la réponse qu’elles attendaient. C’est bel et bien fini, après
- un beau travail,
- un bon moment
- du théâtre populaire qui n’a pas peur de la virtuosité :
bravo et merci, les artistes !