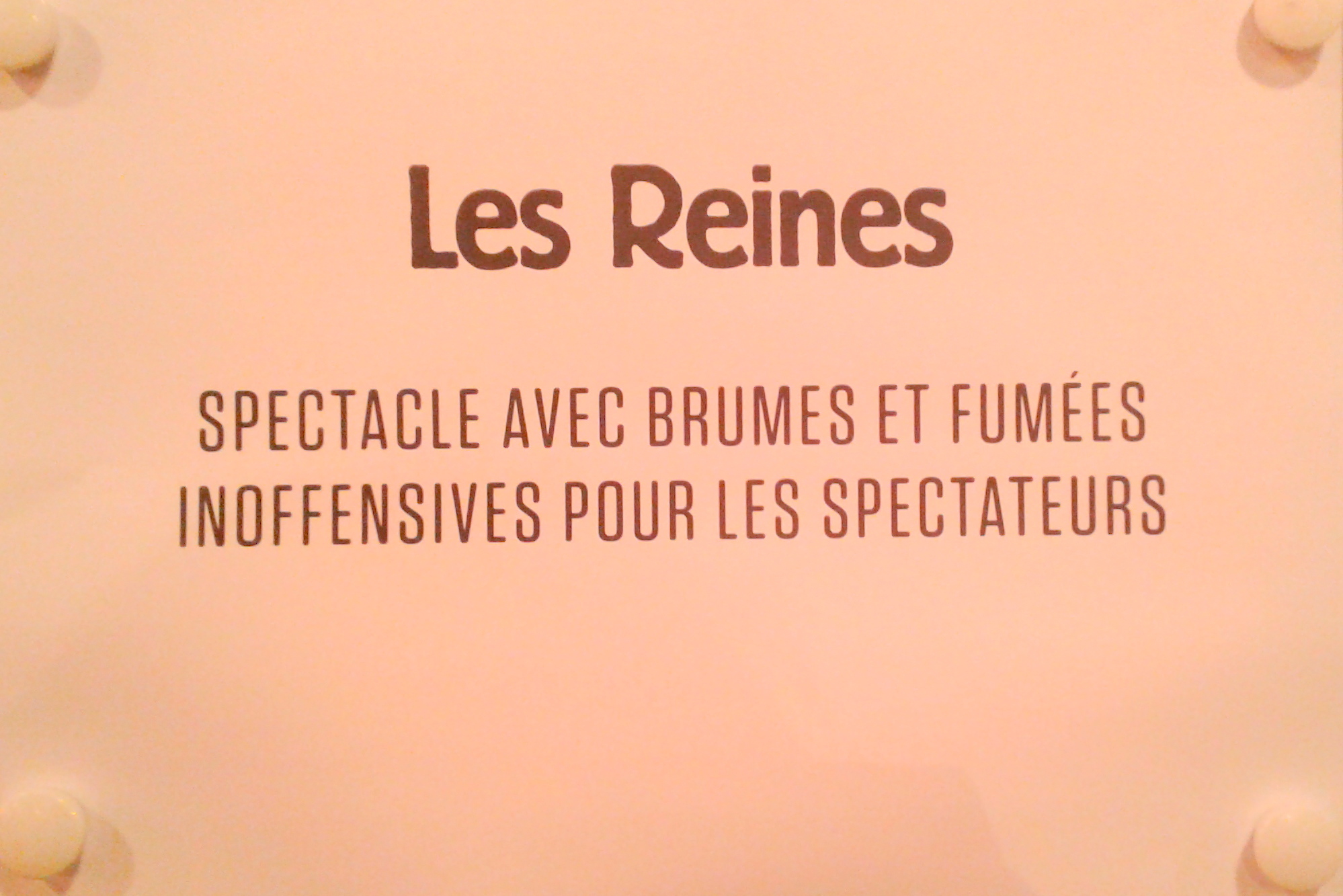« Les Reines », Manufacture des Œillets, 12 janvier 2018
À quoi pensent les femmes ? Normand Chaurette pose la réponse en donnant la parole aux reines qui hantent Richard III de Shakespeare. Celles-ci quittent le rôle d’êtres sans défense, celui que Bill leur aurait attribué (#balancetonporc), pour prendre tout l’espace dans cette sorte d’alternative version narrant la lutte entre Édouard mourant et Richard III, côté cénacle des femmes.

De quoi s’agit-il ? Y a Élisabeth (Anne Le Guernec), la reine, la vraie, qui n’est plus reine que pour quelques heures : son époux le roi agonise. Y a Isabelle et Anne Warwick (jolie Pauline Huruguen et omniprésente Marion Malenfant), clairement là pour prendre le pouvoir en s’appuyant sur leurs mecs, leurs mensonges (« j’ai douze ans ») et leur sens du sacrifice des autres, type bébés ou concurrents – spoilons, avec deux « s », ça réussira à Anne. Y a la duchesse d’York (Sophie Daull), réputée pétée du casque – elle a un bandage sur la tête, c’est dire –, qui impose mutisme à qui elle veut. Y a Marguerite d’Anjou (formidable Laurence Roy), running gag triste, toujours sur le départ et toujours là, qu’elle parte pour la Russie ou la Chine. Et y a Anne Dexter (Bénédicte Choisnet), la sœur, dont on a coupé les mains et qui est réputée muette – si on l’entend, c’est le fruit un peu pourri de notre imagination.
Comment ça se passe ? Dans le nouveau Centre Dramatique National d’Ivry, rénové par l’architecte Paul Ravaux, la grande salle se présente dans une configuration « bifrontale ». En clair, imaginez un catwalk qui tient lieu de scène. De part et d’autre, des rangées de spectateurs. Derrière chaque rangée de spectateurs, une tribune où les acteurs peuvent se mouvoir. Théâtre contemporain oblige, pas de décor hormis un indétrônable siège, des personnages qui circulent parfois en patins à roulettes en dépit de costumes qui n’hésitent pas à « faire d’époque », avec robes souvent décolletées, collerettes réalisées par les lycéennes stagiaires et couronne de Barbie marquant le pouvoir. Quelques accessoires meublent l’espace : ainsi, un globe-coffre encombrant symbolise l’impossibilité du voyage, et deux poupons dans des vases clos représentent les enfants d’Elisabeth.

Marion Malenfant (Anne Warwick), un extrait, avec les patins et les deux bébés en bocal. Photo : Bertrand Ferrier.
Et c’est bien ? Admettons-le, pour encaisser ces cent cinq minutes de spectacle, il faut passer outre les stéréotypes censés faire moderne. Par exemple ? Mix’n’match d’époque, surjeu de certaines actrices, bande-son plus souvent consternante que banale (oh, la chanson liminaire ! oh !), tunnels de référenciation (par ex. on attend la mort du roi comme la venue de Godot ou le décès du Roi qui se meurt), association entre des passages plutôt obscurs et des redondances vaines (trois coups de cloche, et une actrice de dire « tiens, il est trois heures » ; ou « le brouillard a envahi Londres », et pschitt, un coup de machine à fumée). Passer outre est néanmoins une bonne idée car la pièce de Normand Chaurette joue sur l’indécision, ce qui stimule. Cet affrontement navrant de femmes passionnées par le pouvoir, « même pour dix secondes », rappelle-t-il que les femmes sont des hommes comme les hommes, les pauvres créatures, ou que l’égalité des sexes n’est pas un antidote à notre désir, aussi ontologique que sexuel, de pouvoir ? Ces scènes d’émotion (la passation de couronne, les départs impossibles) pointent-elles que l’humain batifole même dans le plus sombre d’entre nous, ou que la mécanique égotiste plaquée sur du vivant l’emporte à tous les coups sur ceux qui montrent de touchantes faiblesses ? Ces lumières au cordeau d’Yves Collet et de Léo Garnier, qui créent l’espace scénique (Dominique Lerminier, le directeur technique, était ému en pensant que toutes les ressources de la régie étaient sollicitées pour cette représentation – « ça fait un très joli schéma sur l’écran », confiait-il, touché comme seul un technicien artiste peut l’être, à l’issue de la première), éclairent-elles la noirceur des âmes ou sont-elles permises par ces desseins obscurs qui nous animent (il faut la nuit pour voir la lumière) ?
En conclusion : oui, il est bon de se laisser bousculer par les clichés qui maculent le spectacle, et de presque-oublier les billevesées aussi creuses que pseudo-poétiques déversées par une actrice dans le dossier de présentation – la langue du dramaturge y est décrite comme « une sorte de venin toxique (sic) qui attaque les chairs, pétrifie le souffle, fermente le vivant dans un jus de lune noire », bon sang, mais ferme-la physiquement et à tout jamais. Si on parvient à ne retenir ces excroissances potentiellement disqualifiantes que comme des défauts bénins car consubstantiels d’un certain théâtre contemporain, on sort des Reines, si l’on peut dire, avec le plaisir d’avoir, précisément, été « sorti de sa zone de confort » pour voir surgir, çà et là, de beaux moments de théâtre et des interrogations qui résonnent longtemps après l’extinction des derniers feux. Non, l’effort à fournir n’est pas mince, car, à notre sens, en dépit de la performance technique des actrices et de la performance artistique de Laurence Roy, certaines caractéristiques de la représentation peuvent, à bon droit, hérisser ; mais tenir (les Reines, ô facétie quand tu nous tiens ! – si, tenir les r… bref,) est, in fine, un exercice bien récompensé.
Rens. : ici.