Les grands entretiens – Nicolas Horvath, l’intégrale
La parution des Dix-sept préludes à la nuit noire qu’il a composés est l’excellent prétexte autour duquel s’est noué un entretien à bâtons rompus avec le pianiste Nicolas Horvath. Quelle vision de la composition électro-acoustique a cet artiste ? Sa technique de création a-t-elle évolué au fil du temps ? Quel rapport (ou quel non-rapport) se noue entre son travail d’interprète et son œuvre de création ?
En cinq épisodes, l’artiste nous invite à plonger sans filet dans les mystères de la musique électro-acoustique en général et de sa musique électro-acoustique en particulier. Bienvenue dans le cerveau vertigineux d’un homme de l’art complexe, singulier et passionnant !
1. Géologie des préludes
Si une composition était l’un des derniers icebergs encore susceptibles de rappeler un navire de croisière à un peu de modestie, les Dix-sept préludes à la lumière noire de Nicolas Horvath n’en seraient que la partie émergée. En écoutant l’œuvre, nous entendons une musique unie, finie, définie aussi. En réalité, cette apparente horizontalité cèle une puissante verticalité, car la musique de Nicolas Horvath se construit lentement, avec obstination, à coups d’essais et retouches. Dans ce premier épisode, le créateur nous guide dans le palimpseste qui se cache derrière les Préludes et, ce faisant, nous en dévoile quelques secrets insoupçonnables…
« Je viens de l’underground »
Bertrand Ferrier – J’avais prévu d’ouvrir notre échange avec des questions d’emblée très profondes, au moins. Hélas, je sens que notre entretien commence mal.
Nicolas Horvath – Pourquoi ?
J’ai vu ton regard : en professionnel du son, tu es choqué de constater que, aujourd’hui encore, des hurluberlus enregistrent des entretiens avec des dictaphones…
Ha, non, aucune chance que je sois choqué par ça ! Il ne faut pas oublier que je viens de l’underground. On faisait notre musique avec deux francs six sous, donc ce n’est pas une question de moyens qui va m’impressionner… D’autant que, tu sais, il y a quelque chose que l’on apprend au conservatoire, quand on est en classe d’électro-acoustique – quelque chose que l’on n’apprend pas en classe de piano : la débrouille. Quand tu es en électro-acoustique, c’est toi qui mets les câbles, c’est toi qui mets les enceintes, c’est toi qui mets la table de mixage, puis c’est toi qui enlèves la table de mixage, c’est toi qui enlèves les enceintes et c’est toi qui enlèves les câbles ; et ça, pour remettre l’ego à sa juste place, c’est génial.
En piano, les habitudes sont différentes. Le pianiste est l’instrumentiste-roi par excellence !
Évidemment, on n’est pas sur le même projet ! Quand tu entres en scène, tout doit être bien, avec ton p’tit rond de serviette placé comme il faut, à sa place, selon ce que tu as exigé. Très vite, on te donne du « maître ». En électro-acoustique, tu redescends direct de quelques étages. Si tu veux que quelque chose se passe, tu fais tout de A à Z, depuis le début.
Sous-entends-tu que les pianistes devraient tous suivre un cursus d’électro-acoustique ?
Haha ! Je vais parler pour moi, ça sera bien suffisant. Pour ma part, suivre ces deux voies m’a bien aidé à garder les pieds sur terre… même si ça m’a aussi apporté de quoi décoller !
Cette double tension entre terre et ciel illustre ta propension au paradoxe voire à l’oxymoron – tes Préludes à la lumière noire le martèleraient si nécessaire. En effet, tu es
- pianiste et compositeur,
- concertiste et roi de l’underground dark ambient,
- virtuose d’une grande précision (ainsi qu’il sied à un virtuose) et passionné d’expérimentations incitant aux
- essais,
- erreurs,
- reprises,
- ravaudages,
- permutations,
- coutures, etc.
Pourtant, cet enregistrement paraît beaucoup plus logique que paradoxal.
Pourquoi diable ?
Ne te présentes-tu pas comme compositeur électro-acoustique avec un premier disque déployant le début par excellence : des préludes ?
Non et oui. Non, parce que ce disque n’est pas mon premier disque en tant que compositeur électro-acoustique. J’ai déjà publié des enregistrements sur un label des pays de l’Est. Mais oui, c’est quand même un peu un début dans la mesure où ces productions ont reçu, disons-le, un écho très discret.
… et c’est aussi un début parce que les amateurs de précision noteront que ta trilogie Lovecraft, que l’on retrouve sur ton site, était signée N. Horvath. Pas encore Nicolas Horvath !
Tu te noies dans les microdétails ! D’autant que Demerara, un label anglais, avait sorti un album en digital du nom d’Acedia – on peut toujours le trouver sur les plateformes de streaming [https://youtu.be/bQmOCBPQve8]. Et puis, il y avait aussi ces pistes que je présentais à l’occasion d’entretiens sur de belles antennes comme France Musique, la RTS ou la BBC. Donc le matériau était là, mais le piano a été tellement chronophage que j’ai un peu mis cette activité en retrait.
« Le pessimisme de Cioran, ça me parle »
Ces Préludes portent la trace d’un travail sur le long terme. La faute au piano, qui était la raison de ta venue à Paris…
En effet, je suis monté de Monaco pour parfaire mes études de piano – et elles m’ont pas mal occupé…
On reviendra sur le choc que cela t’a causé. Néanmoins, même quand tu étais à fond dans le perfectionnement de ta technique, tu n’as jamais abandonné ton projet électro-acoustique ; et, aujourd’hui, it may seem as a new beginning !
Il ne faut pas reconstruire l’histoire. Ces pièces s’appellent « Préludes » parce que j’en ai présenté un certain nombre à la radio, en guise de carte de visite pour ainsi dire, en profitant de leur grand avantage : beaucoup d’entre elles sont courtes. Or, quand tu es invité en tant que pianiste, on veut bien parfois que tu passes ta musique, mais à une condition – qu’elle soit courte. Parmi les Dix-sept préludes à la lumière noire, certains durent quarante secondes, d’autres dix-sept minutes. Cela permet de rassembler un condensé de pas mal de mes expérimentations en faisant un clin d’œil assumé à Chopin, et en profitant du terme « prélude » qui laisse bon nombre de portes ouvertes au niveau de la forme. De plus – je l’ignorais quand j’ai composé ces pièces –, à la base, préluder, c’était improviser ; et cette pratique correspond bien à ma vision de la musique expérimentale.
Tu auras remarqué que cela ne répond pas à ma question qui portait sur ta conception du prélude. Donc je la repose : qu’est-ce qu’un prélude, pour le compositeur Nicolas Horvath ?
Bah, tu dois te douter que si je n’ai pas répondu, c’est peut-être parce que je n’ai pas de réponse ferme et définitive à t’apporter ! Toutefois, je peux te préciser que, quand j’ai entamé ce projet de publication, je voulais commencer par le commencement, c’est-à-dire non pas par les préludes, malgré leur appellation, mais par mes œuvres de jeunesse, celles que j’ai écrites quand j’avais la vingtaine. Au fil de ma réflexion, j’ai pensé que ce serait plus intéressant – pour les mélomanes qui suivent mon travail ou pour les curieux de musique contemporaine – de découvrir en première intention des œuvres plus abouties, puis de descendre le fil et de découvrir le matériau qui a permis la germination de ces pièces. C’est donc manière de hasard si on commence par les Préludes.
À l’origine des origines, ces préludes n’étaient pas non plus le cycle unique qu’ils sont devenus.
Exact, j’avais envisagé d’écrire un binôme où il y aurait eu ces dix-sept préludes et un ensemble nommé Vingt-quatre préludes électro-acoustiques. Je n’ai pas eu le temps de mener ce projet-là à terme.
Seuls sont donc apparus les Dix-sept préludes à la lumière noire…
Ce n’était pas le titre prévu initialement. Le projet vient d’une collaboration interrompue avec un groupe de synth ambient allemand. À l’époque, j’avais façonné cinq préludes à la lumière noire. Ça me correspondait bien. Alors, je lisais beaucoup Cioran. Son pessimisme me parlait profondément. En 2011 ou en 2013, j’ai voulu continuer le cycle mais, en le construisant, j’ai fini par en exclure les pièces que j’avais composées au préalable. De même, à l’origine, j’y avais introduit des pièces composées quand j’étais au conservatoire de Pantin, dans la classe de Christine Groult. En préparant le remastering, fin 2021, je me suis rendu compte que quelques pistes présentaient des défauts, parmi lesquels des saturations. Par conséquent, j’ai été amené à enlever certaines pistes. À l’inverse, d’autres pièces, jamais sorties sous le nom de Dapnom – à l’origine de mes créations électro-acoustiques –, ont été intégrées dans le cycle. Enfin, j’ai revu l’ordre de certaines pièces, de sorte que ce qui sort aujourd’hui est une seconde version des Dix-sept préludes à la lumière noire !
« La narration est essentielle »
En somme, à mesure que tu retravaillais le cycle, tout ou presque a changé, sauf le nombre de dix-sept préludes.
Ce nombre s’est imposé presque seul. Je me souviens que, en allant à une émission de la BBC, j’avais créé le quatorzième numéro ; puis, lors d’un passage à « Tapage nocturne », une émission de France Musique, j’avais apporté le dix-septième prélude, et j’avais annoncé que c’était le dernier du cycle. Or, je n’aime pas revenir sur ma parole. Dès lors, j’avais scellé l’histoire d’un cycle qui, à ce moment-là, ne dépassait guère les cinquante minutes.
Désormais, le cycle pèse soixante-treize minutes. Comment a-t-il enflé de vingt minutes ?
J’ai beaucoup retravaillé certaines structures. C’est quelque chose que j’ai appris grâce à mes montages et à tout le travail effectué depuis plus de dix ans. Mon expérience musicale m’a montré à quel point la narration est essentielle. J’ai aussi appris que ça vaut la peine de remettre en cause le discours que l’on tient musicalement, si l’on s’aperçoit que l’on peut être plus clair, plus efficace ou plus pertinent. Aussi ai-je retravaillé certains matériaux.
Tu cherchais plus de lisibilité – ou d’audibilité ?
Parfois oui, parfois non, au contraire ! Il m’est arrivé de déplacer tel ou tel segment pour renforcer la lisibilité, la cohérence, l’évidence de tel ou tel enchaînement. Cependant, il m’est aussi arrivé de créer des surprises là où se prélassait une logique trop prévisible. En électro-acoustique, le cousu-de-fil-blanc, le figé, le préfabriqué, il faut le fuir à tout prix. C’est ainsi que, à force de retravail sur la structure, j’en suis arrivé à soixante-treize minutes.
Alors que, à l’origine, ton retravail portait essentiellement sur les morceaux, il a affecté en profondeur la structure même du cycle.
En effet, et cela me sied. Je trouve que l’ensemble de l’édifice est plus cohérent. Les préludes s’enchaînent mieux. L’écoute me paraît beaucoup plus agréable, même si « agréable » n’est sans doute pas le terme le plus indiqué ! Aujourd’hui, je crois que l’on peut mieux comprendre ce qui se trame dans mes Préludes, que l’on soit ou non un habitué de la musique électro-acoustique.
Comment positionnes-tu les Dix-sept préludes par rapport aux six Tapes Years, reprenant certains de tes essais électro-acoustiques liminaires – et disponibles à la vente sur ton site ?
Les Préludes sont dans la continuité des Tapes Years. Les Tapes Years témoignent d’expériences de vie que chaque composition nouvelle actualise. Ils forment un socle, un terreau sur lequel a germé mon travail actuel. Mon rapport à la composition n’a pas changé. Autant je peux retravailler certaines pièces à maintes et maintes reprises, autant la substance de mon labeur reste inaltérée.
« L’électro-acoustique a toujours eu un effet cathartique sur moi »
Pourrais-tu essayer de définir ce substrat qui féconde ton œuvre de compositeur ?
Oui, car il ressortit de mon intimité la plus intime ! Pour moi, la musique en général et la musique électro-acoustique a toujours eu une fonction cathartique. J’ai commencé à m’entremettre dans ce type de composition – ou plutôt, j’ai développé cette activité – quand Bruno-Léonardo Gelber est devenu mon maître pour le piano. En gros, il m’a dit : « Écoute, mon p’tit coco, arrête les gros morceaux, arrête les concours, arrête les concerts. » Et il m’a collé avec son assistante pour travailler Les Heures du matin de Carl Czerny et les exercices de Marguerite Long. Tu imagines le choc ?
Tu es passé de jeune premier monégasque à pianiste plus que moyen perdu dans la capitale, c’est ça ?
Mais complètement ! Ma vie s’écroulait. Je croyais que, par le piano, j’allais me sauver, grandir, m’échapper de moi-même. Et là, boum, j’apprends que, en fait, non, je joue pas mal pour un amateur – pour un amateur seulement. Pour un pianiste de métier, faudra repasser, je n’ai pas les bases. Ce n’est pas encore perdu, mais c’est loin d’être gagné.
Quand tu dis que tu voulais t’échapper de toi-même, tu te réfères à tes origines familiales ?
Entre autres, oui. Parfois, certaines personnes disent, avec un sourire entendu : lui, il vient de Monaco, et…
Tu auras du mal à le nier : tu es né Monégasque !
Certes, mais pas au sens où l’entendent les clichés. Ma famille, c’était pas la jet-set, c’était la classe ouvrière. Vraiment. Des ouvriers de chez Ouvrier ! Une génération plus tôt, chez nous, on travaillait dans les champs. Une génération plus tard, on bossait en usine. Face à cette fatalité – qui n’a rien de honteux, mais rien de transcendant non plus, reconnaissons-le –, la musique a toujours été, pour moi, un moyen d’expression pour m’élever, m’accomplir et ne pas rester tanqué là où je suis à l’instant T. Or, voilà que, pour mon bien, on m’interdit de m’exprimer avec la musique tant que je n’aurai pas tout repris à la base !
Dès lors, puisque tu n’avais plus le piano pour t’exprimer, tu t’es réfugié dans l’électro-acoustique…
Il y a de ça. En tant qu’interprète, j’ai vécu des années plus que très dures. Je passais ma vie à pratiquer ma technique à une intensité que tu peinerais à imaginer ! D’accord, les « études » que je montais sans cesse sont indispensables pour pouvoir, ensuite, s’exprimer, mais elles sont et doivent être le degré zéro de l’expression artistique. Partant, pour moi qui croyais que la musique était un moyen d’expression, j’avais abandonné l’idée que le piano serait un médium ad hoc. J’ai dû trouver autre chose.
L’électro-acoustique.
Précisément.
2. Identité du compositeur

Nicolas Horvath à Misy-sur-Yonne et au bout de la nuit, au terme d’une performance de huit heures consacrées à la musique minimaliste. Photo : Bertrand Ferrier.
Au début était Nicolas Horvath, jeune artiste qui pensait s’exprimer par le piano. Ensuite, Nicolas le pianiste a été mis au travail de fond, occupé à se sculpter une technique de fer sous la férule de professeurs sans pitié. S’échappant du musicien qui s’échinait à pilonner des petits marteaux, Horvath l’artiste, aka Dapnom et A.E.P., est devenu une figure de la scène électro-acoustique. Depuis quelques mois, il a relevé son grand défi artistique : réconcilier ses deux amours musicales. Dans ce deuxième épisode, avec lucidité, humour et profondeur, il nous offre une enquête fascinante sur
- l’émergence du compositeur électro-acoustique en lui,
- sa coexistence complexe avec l’interprète de musique classique, et
- la nature – finalement très proche – des enjeux artistiques qui irriguent ses deux pratiques musicales.
« Scriabine est le compositeur pour qui je vibre le plus »
Bertrand Ferrier – Dans la première partie de notre entretien, nous avons vu que ta créativité artistique, tu pensais la consacrer au piano, dans ton activité d’interprète. Las, quand tu « montes à la capitale », ton nouveau prof décèle à la fois ton potentiel et tes fragilités structurelles. Pour te faire passer un cap, il exige que tu te consacres exclusivement au travail technique. Tu trouves un dérivatif à ta pulsion créatrice en te jetant à corps perdu dans l’électro-acoustique. C’est ce que l’on peut entendre sur les Tapes Years (six disques aussi modestes d’apparence que passionnants à l’écoute)…
Nicolas Horvath – Disons que mon investissement du champ électro-acoustique était en fermentation dans les projets des années 2001-2002. À l’époque, ce n’était pas toujours très abouti, je peux bien le reconnaître. Néanmoins, il y avait déjà une énergie, une envie et des pistes qui sont devenues vraiment sérieuses en 2004. Sur le moment, l’exigence de Bruno-Léonardo Gelber m’a laminé mais, à terme, elle m’a doublement sauvé. Pianistiquement, on en parlera peut-être ; artistiquement, elle m’a conduit à développer le personnage de Meldhkwis pour chapeauter ma production électro-acoustique sous un nom de code : Dapnom.
Pourquoi ce double pseudonymat ?
Cela peut surprendre car, depuis cette période lointaine (presque vingt ans ont passé !), les mentalités ont un peu évolué. Mais, en 2004, elles étaient orthonormées, arc-boutées sur une conviction : un pianiste classique ne doit faire que du piano. Impossible de devenir pianiste si on n’est pas que pianiste. Même mes études officielles en électro-acoustique, il était hors de question de les partager dans le monde du piano ! Un pianiste, c’est quelqu’un qui joue du piano tout le temps. Il ne peut faire rien d’autre. Imagine, si l’on apprend en plus qu’il fricote avec la scène expérimentale… un monde qui sent tellement le soufre…
Soyons clair : tu évoques l’iconographie sataniste et le penchant pour les drogues variées que les principaux acteurs de ce business ont érigés en items consubstantiels à ce type de musique.
Oui, c’est une ambiance sulfureuse pour laquelle j’avais une certaine curiosité, mais mon intérêt était biaisé. Il était à la fois alimenté et filtré par Scriabine, dont je suis un admirateur inconditionnel – je pense toujours que c’est le compositeur pour lequel je vibre le plus.
Au passage, pourquoi n’en as-tu pas encore enregistré ?
Je suis Français. Du coup, les maisons de disque avec qui je travaille m’ont toujours dit que ça ne serait pas intéressant, id est que ça ne se vendrait pas.
Soit, en attendant que les sots changent d’avis, comment Scriabine t’a-t-il conduit jusqu’à tes préludes ?
En écoutant, en travaillant, en luttant, en lisant du Helena Blavatsky, j’ai découvert le monde insoupçonné des occultismes qui irriguaient une grande partie de la scène underground, la fameuse scène UG. Donc, incontestablement, même quand, comme moi, on ne touche pas aux drogues et quasiment pas à l’alcool, l’underground, ça sent le soufre.
« Ma part sombre a été très développée »
Il faudrait être grand clerc pour découvrir des pentagrammes inversés dans ta musique.
Plus idiot que grand clerc, à mon avis : les questions alentour m’intéressaient, mais les diableries en elles-mêmes, c’était pas mon kif.
N’aurais-tu pas gagné à te fondre dans les codes satanisto-militaires ?
Si, si, si, mille fois si, bien sûr ! Je suis sûr que mes ventes auraient explosé si je m’étais vautré dans l’une des deux fanges : l’iconographie sataniste et l’iconographie nazi. Par exemple, à cette époque, si tu faisais de la merde en mettant dessous des discours de nazis, tu étais garanti de vendre des milliers de disques. Des milliers ! C’était pas négligeable !
Face à cette possibilité sinon cette tentation, Meldhkwis t’a permis de canaliser à la fois ta pulsion artistique et ton intégrité musicale.
En réalité, ce personnage incarne ma part sombre. Il symbolise la part de doute que j’avais quant à mon avenir de pianiste. En fait, Meldhkwis personnifiait tout le mal-être accumulé depuis mon enfance. Je lui ai donné corps, donc je lui ai donné une réalité, c’est-à-dire une valeur ou, du moins, une ambition artistique, afin de pouvoir regarder – autrement dit : affronter – celui que j’étais.
Les préludes que tu publies aujourd’hui sont-ils une réconciliation entre Nicolas, Horvath et Meldhkwis ?
Tu simplifies tout, mais je reconnais qu’intégrer Meldhkwis a nécessité un vrai parcours de vie.
Reste que la sortie de ces Préludes a une portée autobiographique ?
Les Préludes qui paraissent racontent quelque chose de moi, oui. Ils saluent et mettent à distance ma part sombre, qui a été très développée jadis. Dans les années 2000, j’étais, sous le nom de Dapnom, le premier à faire ce qu’on a appelé du black noise. À l’époque, en France, le dark ambiant n’était carrément pas à la mode. Pire, c’était suranné depuis une dizaine d’années, peut-être ! Moi, j’ai refait ce genre de projet dans la scène underground. L’écho a été important. Dès lors, il y a eu toute une vague opportuniste autour de ça, mais les vrais savaient qui avait amorcé ces sons, chez nous. Je jouissais d’une bonne réputation parmi les pairs. Je travaillais avec beaucoup de groupes dont certains de grande renommée. Dans le même temps, j’étudiais au conservatoire avec Christine Groult et François Bayle, mes pièces avaient été sélectionnées par Bernard Parmegiani pour son quatre-vingtième anniversaire.
Comme le piano était en stand-by, tu pensais recentrer ta carrière artistique sur ce créneau ?
Je ne suis pas sûr de ce qu’est une « carrière », et je ne sais pas si l’électro-acoustique est un créneau ! Néanmoins, oui, pour moi, tous les feux étaient verts, côté électro-acoustique, alors que, côté piano, j’étais en train de refaire mon apprentissage selon les critères de l’École Nationale de Musique. En d’autres termes, en piano, rien ne marchait ; en électro-acoustique, tout marchait. Devine vers quoi je pensais pencher.
« En 2008, on comptait les morts »
Sauf qu’arrivent tes trente ans, âge vénérable pour un pianiste classique, mais âge où tu gagnes tes premiers prix artistiques.
Oui, c’est le moment où le piano a pris le pas sur l’électro-acoustique. Un moment où il y a eu un basculement. Et un moment où ma grand-mère est morte.
Tu étais très proche d’elle, je crois.
Je dirais plus : elle était comme une seconde mère, pour moi. Mes parents ont divorcé très tôt. Ma mère travaillait comme une folle, la semaine et le week-end. Je ne la voyais pratiquement jamais. Pendant les vacances, c’est ma grand-mère qui s’occupait de moi.
Tu m’as laissé entendre qu’elle était « un personnage ».
Oh que oui ! Elle est de ces femmes italiennes qui ont fait la guerre et le maquis. Avec elle, il ne fallait pas être une femmelette. Il ne fallait pas pleurer. Quand elle est morte, je n’avais plus rien à perdre. Je me suis réinscrit à un concours international – en l’espèce, le concours Scriabine. J’étais doublement à la limite : les inscriptions fermaient quinze jours plus tard, et j’avais déjà trente ans, l’âge maximal. J’y suis allé en catharsis. Sans rien espérer.
… et tu as obtenu un Premier prix.
Oui. Je n’y croyais pas. Après ça, j’ai enchaîné plusieurs gros « Premier prix », et j’ai commencé à y croire.
Ç’a dû être une bénédiction pour Nicolas le pianiste et une malédiction pour Horvath le compositeur !
Disons que ma carrière de pianiste a explosé. Ç’a été vraiment génial, d’autant que, au même moment, la scène expérimentale commençait de subir ses premiers revers. En 2008, je me souviens que la première vraie crise du disque était déjà bien engagée. La concurrence de myspace battait son plein. Les premiers échanges en peer to peer n’arrangeaient pas nos affaires. En clair, l’économie de l’underground était en train de s’effondrer. On comptait les morts.
« Tout change quand on te fait écouter Pierre Schaeffer »
Était-ce uniquement lié à la mutation de l’écosystème, ou le petit monde expérimental avait-il sa part de responsabilité dans le cataclysme ?
Les deux, probablement. Moi, j’avais été le premier à développer le genre de musique que je minais, j’avais essuyé les plâtres ; puis l’offre était devenue pléthorique.
Avant ce trop-plein, il y avait le vide et les Objets Audibles Non Identifiés que tu concoctais…
C’est un peu ça. Concrètement, à mon arrivée, ceux qui étaient habitués à une musique plus proche du hard rock, du black metal et tutti quanti, quand ils ont posé mes disques sur leur gramophone, ils n’ont rien capté ! Même sans méchanceté, ils ne comprenaient pas le pourquoi du comment. Limite ils se demandaient : « Ils le vendent, ça ? » Je me souviens de la première critique que j’avais obtenue, et où j’avais été descendu au bazooka sur l’air de : « Réservé à ceux qui aiment les intros qui n’en finissent pas ! » Je comprends que, si on est fan de Marduk, ça doit faire bizarre…
Ton disque n’était pas tombé sur le bon bureau !
Je ne sais pas s’il existait un bon bureau… Le disque, je l’ai envoyé à ceux qui critiquaient à ce moment-là. Donc j’ai défriché le terrain. Littéralement. Et, après, ma musique qui paraissait inécoutable est devenue à la mode. Au début, j’étais trop seul pour être audible ; à l’inverse, après, quand on s’est rendu compte que j’avais des auditeurs, je me suis retrouvé noyé sous des mèmes, pile au moment où j’ai été happé par le piano, donc dans l’incapacité de m’occuper de la scène underground.
Tu avais alors produit un bon nombre de créations, dont tu rappelles les principaux achèvements sur la partie « Discographie » de ton site…
Oui, j’ai publié pas mal de cassettes et de CD qui ont rencontré un succès considérable, à mon échelle. Tout partait, tout était sold out, ça marchait super bien ! Sauf que, en 2006, quand je suis entré au conservatoire en électro-acoustique, mon son a changé. Il était temps. J’avais pressenti que je me heurtais à une sorte de plafond de verre, constitué de facilités, d’habitudes et d’ignorances, qui m’empêchait de m’améliorer. J’ai compris pourquoi en travaillant avec les grands maîtres de l’électro-acoustique. Tu sais, tout change quand on te fait écouter Le Solfège de l’objet sonore de Pierre Schaeffer. Tu deviens un autre quand tu lis le Traité des objets musicaux.
Pourquoi ?
Eh bien, tu commences à mettre de l’ordre dans ta bibliothèque mentale. Tu distingues et tu nommes les sons variés, homogènes, tramés, toniques, complexes, itératifs, avec leurs attaques, leurs grains, leurs corps et leurs chutes, et leurs mises en cellule ou en loop, leur construction, leur accumulation, leur extension, leur allure, leurs rapports, leurs transformations, etc. Tu n’écoutes plus les sons de la même façon. Tu penses à l’appétence, à la structure, aux qualités intrinsèques de ce que tu entends et utilises dans ton travail. Bref, ta musique évolue, et les labels avec qui tu travaillais jusque-là te jettent.
« Je devais être plus cohérent avec moi-même »
J’imagine qu’ils eussent continué de te choyer si tu avais continué de pondre du bon vieux Dapnom sans changer les ingrédients de se recette éprouvée.
Ils savaient ce qu’ils voulaient : les bonnes vieilles cassettes que l’on entend dans les Tapes Years. Ça, ça se vendait. Ce n’était pas qu’une question commerciale, note bien : il y avait derrière l’idée artistique que, pour eux, Dapnom, c’était ça. Pour moi, c’était plus ça.
Tu aurais pu continuer à produire tes musiques à l’ancienne, histoire de…
Je ne voulais ni mentir, ni revenir en arrière.
Tu n’as pas arrêté pour autant.
En effet, d’autres albums sont sortis, comme le Acedia ou le Aceldama (du nom de ma grand-mère), qui est mon album le plus abouti. Et d’autres albums sortiront – le prochain devrait être Soliloques, dont on trouve des moutures dans le dernier disque des Tapes Years. Ensuite, on va remonter le temps, du dernier au premier, pour un total prévu de quatre ou cinq sorties, pas plus.
Tout se passe comme si, après t’être détaché du Dapnom première façon, tu cherchais cette fois à ne pas perdre le public qui te suit en tant que pianiste et, au contraire, à l’ouvrir à d’autres facettes de ta créativité artistique.
Disons que je ne voulais pas commencer par mettre en avant les Tapes Years. Parmi ceux qui ont l’habitude de mon travail d’interprète, certains auraient pu trouver ces propositions obscures ex abrupto. C’est pourquoi j’ai préféré ouvrir la série par un travail abouti, histoire de ne pas créer un choc contreproductif… même si choc il pourra toujours y avoir !
En effet, en dépit de ta prudence, pour ceux qui t’ont suivi dans Liszt, Glass, Satie ou Montgeroult, le dark ambiant, ça risque de secouer ! Néanmoins, on a l’impression – en témoigne l’insertion d’un piano étrange, par exemple dans les quatrième et huitième préludes – que le moment est venu, pour toi, de faire ton coming out et d’assumer les deux facettes du Janus musical que tu es.
Il y a de ça, évidemment. Et ce que je trouve très spécial, c’est que, pendant très longtemps, je n’assumais pas la part électro de mon travail. À force de cloisonner, j’avais dû intégrer l’idée qu’elle était irréconciliable avec mon activité de pianiste. La vie me poussait à le penser : Dapnom est resté en jachère car le piano a mangé mon temps de créativité et de travail disponible. Aujourd’hui, j’aspire à plus d’équilibre. J’ai inséré certaines pièces inédites de Dapnom dans les Préludes parce que j’ai jugé que ça marchait bien et que c’était intéressant.
Paradoxalement, au moment où tu te ré-unis, tu multiplies les collaborations…
Ce n’est pas un paradoxe. Je devais être plus cohérent avec moi-même si je voulais l’être avec les autres – que ces autres soient le public ou d’autres artistes électro ! Ma collaboration avec Lustmord m’a aidé à faire un premier pas dans cette direction. C’est dans cette perspective je travaille avec le label SubRosa. Ça me permet de rendre hommage aux musiques que j’admirais quand j’étais dans la scène underground : le dark ambient avec Lustmord, le noise avec Merzbow, le minimalisme avec La Monte Young – pour lequel j’ai signé quatorze collaborations allant du noise au metal en passant par le dark techno, enfin, des choses parfois très, très, très barrées –, etc.
« J’ai découvert que des gens avaient continué à composer après Albert Roussel »
On y a fait allusion, mais on peut l’expliciter : cette sorte de réconciliation entre les différentes parts de toi-même est illustrée par tes disques mais aussi ton nouveau site.
Il est vrai que, avec mon épouse, nous avions cet objectif en tête depuis longtemps. Le confinement nous a permis, en quelque sorte, de nous y coller ; et, cette fois, j’ai assumé la part électro-acoustique de mon travail. C’est la première fois que j’y fais référence.
Quel déclic t’y a poussé ?
Un événement qui, a priori, n’a rien à voir : je suis devenu père.
En effet, deux salles, deux ambiances. Quel rapport ?
J’ai eu l’impression que, pour être vraiment celui que je devenais, je devais réintégrer aussi cette part de moi qu’était ma vie de compositeur électro-acoustique. Je ne dis pas que le processus qui me poussait à renaître à ce que j’avais été avait des similitudes avec l’enfantement. Toutefois, cette part de moi, je l’ai portée si longtemps de façon souvent dissimulée que j’ai eu le sentiment de ne plus pouvoir la laisser en friche. Aussi ai-je fait mon coming out !
Tu veux dire que ta paternité a bousculé l’image que tu te faisais de toi-même en tant que musicien ?
Réfléchir à ce que signifiait devenir père a incontestablement contribué impacté mon image d’artiste. Assumer Dapnom est aussi une façon d’assumer le musicien que je suis. Sans Dapnom, je suis tronqué. Par exemple, sans Dapnom, je n’aurais jamais découvert la musique contemporaine. Tout ce pan de la création, qui constitue une large part de mon travail d’interprète, je l’ai découvert lors de mes classes d’électro-acoustique à Pantin. Ça va te paraître bête, mais c’est grâce à cette classe que j’ai découvert que les compositeurs n’avaient pas disparu. Il y avait toujours des gens pour écrire des partitions !
À l’École Normale de Musique, j’imagine que les pièces contemporaines n’étaient pas en odeur de sainteté…
Aucun de mes maîtres ne s’y intéressait, ni dans ma formation, ni à Cortot. La musique s’arrêtait à Albert Roussel. J’exagère : Gérard Frémy aimait ça. Il aimait beaucoup en parler, et on avait abondamment échangé sur la musique actuelle – mais je manquais de recul, alors, j’avais dix-huit piges. Dans ce domaine, toute ma culture restait à faire. La Monte Young, par exemple, j’en avais vaguement entendu parler mais, pour moi, c’était un autre monde. Pas le mien. Pourtant, aujourd’hui, je me rends compte que, dans ma musique dark ambiant, germait déjà le mouvement minimaliste qui m’a tellement apporté par la suite.
Le créateur et l’interprète préparaient leur réconciliation à travers l’utilisation de motifs élémentaires qui se répètent et se déforment sans cesse ?
Oui, il y a bien ces deux éléments : ça se répète et ça se déforme, alla Philip Glass, chez qui « c’est » toujours pareil mais jamais pareil. Pour moi aussi, la répétition et la déformation sont essentielles. J’écris par couches. Je conçois plus mon travail en termes de verticalité que d’horizontalité. Je ne me concentre pas sur une strate unique mais sur plusieurs couches qui se développent simultanément, avec des similitudes et des disjonctions. Aussi la réflexion sur la trame – donc sur la répétition – et sur la longueur – donc sur la déformation – est-elle consubstantielle à ma musique et à la musique minimaliste. Imagine ma stupéfaction quand j’ai découvert le minimalisme ! J’ai eu l’impression que je le portais en moi depuis les débuts de Dapnom…
Comment avais-tu pu échapper à ce parallélisme jusqu’alors ?
Très simplement : j’avais dissocié la scène underground et ma vie de pianiste. Les deux mondes étaient séparés.
En 2022, il semble que ces galaxies insuperposables se soient rapprochées… pour toi. Mais qu’en est-il de ton public ?
Il est probable que la dichotomie entre le compositeur que je suis et l’interprète que je suis aussi perdure et perdurera. Est-ce si grave ? Je ne crois pas. Nos curiosités à tous ont des limites, c’est plutôt sain de le reconnaître !
1. Géologie des préludes
2. Identité du compositeur
3. Dissection de la composition
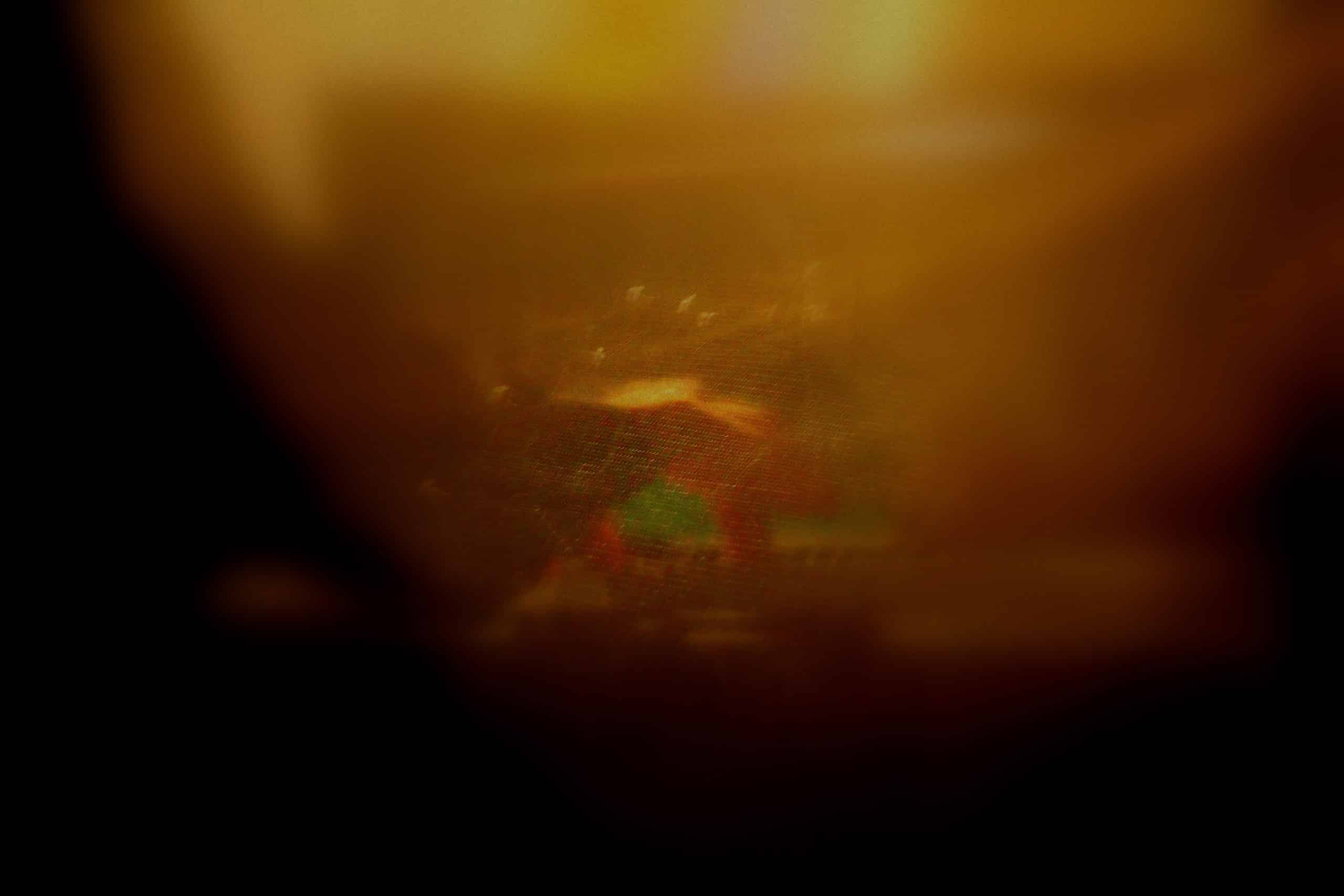
La main droite harsh noise de Nicolas Horvath, lors d’une performance nocturne à Misy-sur-Yonne. Photo : Bertrand Ferrier.
Avec le compositeur, entrons dans les entrailles de la création électro-acoustique. À quoi ressemble une partition de Nicolas Horvath ? Comment se construit une œuvre ? Que révèle de l’artiste le palimpseste final ? Quel regard le créateur porte-t-il sur
- son authenticité (dévoilement autobiographique),
- son accessibilité (capacité à se faire entendre de l’auditeur de bonne volonté) et
- la réception de ses compositions, auprès
- de ses pairs,
- des diffuseurs et
- du mélomane curieux ?
Pour l’entrapercevoir, faufilons-nous donc dans la cuisine où bouillonne le chaudron horvathien…
« La partition, c’est le logiciel »
Bertrand Ferrier – Nicolas, dans la première partie de cet entretien, nous avons évoqué quelques particularités des Dix-sept préludes que tu viens de publier. Dans une deuxième partie, nous avons essayé de reconstituer le puzzle de tes identités artistiques. Dans cette troisième partie, j’aimerais que nous nous arrêtions sur l’acte de composition tel que tu le pratiques. En effet, à l’écoute des Préludes, on ne peut s’empêcher de se demander si la notion de « composition » ne prend pas une dimension presque géographique ! On imagine ton geste aux croisements
- de la conception,
- de l’écriture,
- de l’improvisation,
- de l’exploitation d’accidents,
- du travail sur le son en tant que matériau malléable,
- de l’auto-remix…
Concrètement, à quoi renvoie, chez toi, la notion de « composition » que l’on aimait à imaginer avec une plume d’oie, un encrier et du papier à musique ?
Nicolas Horvath – Haha ! Ce mystère et ce foisonnement, c’est un p’tit peu l’avantage de la musique électro-acoustique.
Mais soyons concrets – tu sais comme je suis têtu… J’ai par exemple noté : à quoi ressemble la partition du neuvième prélude à 2’20 ? En clair, la composition électro-acoustique est-elle pas la fossoyeuse de la notion de « partition » ?
Clairement, y a pas de partition.
Ô blasphème ! Ô trahison !
Pourquoi ? Pour moi, la partition, c’est le logiciel. Donc je n’écrivais pas sur du papier à musique, je travaillais sur – pas sous – ACID.
Tu fais bien de préciser…
Oui, je parle d’Acid Pro, pas des substances. On l’a mentionné mais on peut y revenir, puisque tu insistes. Je n’ai jamais pris de drogues. Je m’en méfiais, et la suite m’a donné raison : j’ai perdu deux amis chers qui se sont suicidés à cause de ces trucs.
Difficile d’imaginer un artiste de la scène UG qui n’ingère ni pilule, ni poudre, ni fumée, ni bibine…
… et pourtant, même l’alcool, j’en ai bu très tard. C’est pour ça que, aujourd’hui encore, j’en bois très peu. Je ne tiens pas cette substance, je le sais, donc j’en ai une consommation raisonnée.
Aussi incroyable que cela semble, tes compositions seraient 100% bio ?
Mieux : je peux confesser que, au début, je recourais à une astuce à laquelle j’ai renoncé – le jeûne.
Tu préférais le manque à l’overdose ?
Oui, au moins durant toute l’époque des Tapes Years. Après, quand les disques sont sortis, je n’ai plus utilisé ce stimulant.
« J’ai travaillé sur le centimétrage d’arrivée des corps célestes »
Tu te privais de tout, quand tu jeûnais ?
Non, que de nourriture, ce qui était déjà pas mal ; et je ne cassais le jeûne que quand la composition était finie.
Tu avais l’impression d’avoir enfin mérité ta nourriture ?
Pas du tout, c’est juste que je n’avais plus besoin de la sensation de manque et de cet état étrange dans lequel elle plonge ton corps – quand la privation est volontaire, bien entendu. C’était mon processus. Il valait ce qu’il valait. Grâce à mes cours en conservatoire, j’en ai appris d’autres ; mais je ne renie pas celui-ci. Il me permettait d’entrer en transe. Tu as déjà pratiqué le jeûne ?
Jeune, j’avais assez de mal avec les régimes ; alors, le jeûne, tu penses…
Ça n’a rien à voir ! Quand tu jeûnes, un phénomène très intéressant intervient au bout d’un certain nombre de jours où tu cesses de t’alimenter : le cerveau ne fonctionne plus d’une manière habituelle. Dans mon souvenir, je dirais qu’il y a une accélération des connexions. Du moins, je le vivais ainsi. Dès lors, je composais beaucoup grâce à ce tremplin. Je vivais dans une manière d’urgence.
Voilà qui marque une rupture, car les Préludes à la lumière noire ont été composés dans le contraire de l’urgence, sur le temps long.
Exact, pour les Préludes, le jeûne ne marchait plus ! J’avais appris d’autres techniques, en cours d’électro-acoustique. Elles étaient beaucoup plus intéressantes car elles permettaient de comprendre toutes les compositions, pas seulement de susciter les siennes. L’objectif était de créer un processus qui rende le travail intéressant. On travaillait sur la surprise, par exemple par l’évitement des structures bateau comme la structure en delta (montée, coupe nette, descente)…
Tout compositeur utilise ce genre de schéma, non ?
C’est vrai que, parfois, j’utilise aussi la structure en Δ, mais j’essaye de la rendre plus intéressante en la secouant un peu.
Delta ou pas delta, tu n’écris pas de partition au sens traditionnel du terme ?
Si, certaines de mes musiques fonctionnent autour de partitions, ou de notations qui ressemblent à des partitions « au sens traditionnel », selon tes mots. C’est le cas des préludes les plus courts. Je les ai développés au conservatoire. J’avais travaillé sur plusieurs processus développés par Scriabine :
- l’addition,
- la division,
- la suppression et
- la fusion.
Et j’avais ajouté à cette conceptualisation une contrainte, à savoir que les éléments sonores arrivaient en fonction de l’ordre cosmique.
Carrément ! Comment as-tu procédé ?
Je ne me souviens plus précisément des modalités mises en œuvre mais, en gros, j’avais pris des planisphères et j’avais calculé à quel moment apparaissaient les étoiles.
Pourquoi diantre ?
Pour faire coïncider les événements sonores avec le centimétrage d’arrivée des corps célestes sur les planisphères. Cela me permettait d’avoir un plan dans le plan, et c’est une technique que j’ai aussi utilisée pour une pièce que nous avons évoquée : Aceldama – la pièce pour laquelle j’ai eu mon prix de composition.
« L’essentiel, c’est l’écoute sous la douche »
Contrairement aux miniatures, les préludes plus longs, tu les as composés et recomposés sur ACID Pro ?
Je ne peux pas te répondre précisément car j’ai pour partie oublié. Leur composition s’est étalée plus de dix ans ! Mais ACID Pro a joué un rôle décisif dans mon travail, c’est une évidence.
Quel est l’apport suprême de ce logiciel ?
L’avantage d’ACID Pro par rapport à Pro Tools, par exemple, c’est que, dans les années 2008, Pro Tools était limité à quatre pistes. Si tu en voulais seize, il fallait le Pro Tools Pro – et, là, pour l’avoir, fallait vendre ton rein et tes deux jambes. Moi, je tenais à l’un et aux autres, donc j’étais coincé. Heureusement, avec ACID, t’avais un nombre illimité de pistes. Partant, ce logiciel était taillé pour moi, car j’ai toujours travaillé sur une centaine de pistes, à peu près. Ces pistes, je les voyais comme des partitions d’orchestre et ACID me permettait de ne pas les optimiser.
… et pour un non-technicien, ça donne quoi ?
Quand tu n’as que quatre pistes, tu es obligé de les optimiser. Résultat, tous les événements sont continus, ce qui est un appauvrissement considérable. Moi, si j’utilisais deux fois un son métallique, la première fois, je pouvais lui laisser son entrée les deux fois. La ligne du son métallique était réservée au son métallique. Avec ce logiciel, j’avais mon diagramme – ma partition, en quelque sorte –, et je pouvais organiser la disposition des événements.
Cette possibilité technique t’a-t-elle conduit à fixer, une fois pour toutes, le style et le son Nicolas Horvath ?
Non, au contraire. Après cette première période, j’ai évolué au niveau du son. Par exemple, contrairement aux pièces qui sont rassemblées dans les Tapes Years, j’ai adopté un autre processus d’écoute, un A.P.E. J’appelais ça l’écoute sous la douche.
Saperlipopette, encore un concept qui mérite quelques explications…
C’est pourtant simple ! Avant, bon, quand le morceau était fini, j’en étais très fier. C’est plutôt sain : t’as composé quelque chose, tu le trouves wow, c’est cool. Puis, quand tu avances, tu te rends compte que tu peux faire mieux. L’écoute sous la douche, c’est un truc que Germaine Devèze, l’assistante de Gelber, m’avait appris pour le piano et que j’ai appliqué à l’électro-acoustique. Il s’agit d’écouter sa musique sous la douche et de ne pas se faire suer. Donc, si tu as écrit une pièce de 15’, tu restes un quart d’heure sous la douche, et c’est parti !
Moi, je pensais plus aux pièces qui durent moins d’une minute : c’est chaud !
Bah, tu peux rester sous la douche après le morceau, c’est pas interdit.
Merci !
Ce qui compte : quand tu t’ennuies en écoutant ton travail pendant que tu te douches, c’est qu’il y a un problème et qu’il faut le corriger. L’écoute sous la douche, c’est ça. Même si tu pratiques une autre activité pendant que ta musique joue, il faut que ça se passe. Ça n’a rien de facile ou de bêtifiant, attention ! En écoutant de la sorte, tu comprends mieux les structures chez Beethoven ou chez Mozart, tout en éloignant des carcans trop stricts de l’harmonie.
« Dans un même geste, je veux développer le multiple »
Tu comprends mieux Beethoven ou Mozart grâce à la douche ?
Oui, aussi bizarre que cela semble. Tu te détaches de la forme simple et, en gros, tu penses plus en termes orchestraux.
J’ai l’impression que, pour toi, l’écran où le son apparaît devient ta partition. Cette partition sous forme logicielle serait une représentation informatique de ce que ta pensée a forgée à partir d’une conception qui peut être amenée à évoluer. La première phase de ton travail consiste à fixer une version ; la seconde, à la retravailler jusqu’à ce que tu sentes qu’elle mérite d’être figée ?
Exactement.
C’est en opposition frontale avec l’image du compositeur qui a pensé son œuvre de façon très pré-structurée. Toi, tu sembles dire : « Je l’ai peut-être pré-structurée dans ma tête, mais cette structure est appelée à évoluer en fonction de mon ressenti. »
Tout à fait.
Donc adieu le fantasme de la partition !
Pour une raison simple : jusqu’à aujourd’hui, on n’est pas arrivé à noter de la musique électro-acoustique. Y a eu des essais, des historiogrames, des trucs qui ont occupé les gens du Groupe de Recherche Musicale (GRM) ou des passionnés comme François Bayle. De toute façon, si on parvenait à tout griffonner sur un papier, on réduirait l’électro-acoustique à de la monophonie. Or, moi, ce qui m’intéresse, dans l’acte de composer de l’électro-acoustique, c’est l’art de développer dans un même geste une multiplicité de séquences, de sources et de possibles.
« Une œuvre qui se dénude le premier soir, c’est pas très funky »
Tu parles souvent de cette caractéristique comme d’une influence de Scriabine ou de Stockhausen…
Et pour cause ! Ce sont ces génies, notamment, qui me poussent à travailler la profusion de cellules de micro-événements qui se développent entre elles, simultanément et de façon imbriquée. J’aime à penser que ma musique se découvre à chaque écoute, dans la mesure où elle est gorgée de petites surprises à dénicher à mesure que l’on croit la connaître. Une fois qu’on l’a entendue « en gros », on peut y revenir et voir surgir des détails, se focaliser sur des petites choses inouïes jusque-là, et s’apercevoir du foisonnement qui se cache derrière l’évidence.
La « lisibilité / audibilité » que l’on évoquait tantôt n’est donc pas contradictoire avec la richesse, ni le plaisir de savoir où « ça » va incompatible avec la gourmandise de l’approfondissement !
Voilà. Toutefois, attention ! quand je te dis ça, je ne suis pas en train de me vanter ! À Pantin, Christine Groult m’avait loué pour cette qualité… et m’avait aussitôt averti que c’était un grave défaut. En 2007, quand j’ai eu mon diplôme, elle m’a balancé, texto : « Le problème que tu auras, c’est que, quand tu auras la chance de passer à la radio, tu ne passeras qu’une fois. Donc tout devra être compréhensible en une fois. »
La radio est-elle l’horizon ultime pour le compositeur électro-acoustique ?
Oui et non. Oui, c’est important de pouvoir partager sa musique et, même si les plateformes de streaming rebattent pour partie les cartes, ce média est un biais de choix pour en présenter quelques aspects. Et non, il ne faut pas que ce soit notre unique horizon, car cela réduirait notre champ d’expérimentation.
Un peu comme François Bayle, que tu citais et qui avait coordonné les recherches sur l’Acousmonium en expliquant aux compositeurs – on le voit dans la vidéo supra : soit vous écrivez pour être écoutés par des individus seuls derrière leur radio ; soit vous écrivez pour être écoutés dans une grande salle, avec un dispositif de haut-parleurs évolutif, et vous ne devez pas écrire la même musique…
Pour ma part, je suis influencé par mon expérience de musicien classique. Une composition est à l’instar de toute œuvre d’art, y compris en littérature ou dans les arts picturaux. Plus tu vas développer une proximité avec l’œuvre, plus tu vas en découvrir des richesses. Sinon, c’est inquiétant pour la qualité et l’intérêt de l’œuvre ! Plus on écoute, plus on analyse, plus on pratique une œuvre de Chopin ou de Beethoven, plus on va être saisi par sa profondeur, ses astuces, ses trouvailles, ses irrégularités qui font avancer l’Histoire de la musique… Ça ne veut pas dire que je me prends pour Chopin ou Beethoven, je sais raison garder ; mais ce genre d’expérience indique une voie à suivre plutôt stimulante, ce me semble ! J’en suis intimement convaincu : une œuvre qui se mettrait à nu dès le premier contact et qui, par la suite, n’aurait plus rien à t’apprendre sur elle ou sur toi, c’est pas très funky.
« Je n’ai pas envie de simplifier mon bouillonnement intérieur »
Près de quinze ans après, la remarque de Christine Groult continue de résonner en toi.
En effet, car, même si je ne suis pas d’accord avec ce qui la sous-tend, elle mérite réflexion. Qu’est-ce que nous espérons quand nous écrivons ? Faut-il séduire l’auditeur pour qu’il ait envie de te réécouter ou s’attacher, au contraire, à lui fournir un produit adapté à l’urgence de notre époque donc saisissable d’emblée, sans regret ni retour – au risque de confondre one-shot et musique jetable ? J’ai beau avoir mon opinion, je comprends aussi les arguments de ma prof. Sans qu’ils m’ébranlent pour autant, ils viennent régulièrement alimenter mes questions et mes doutes, quitte à conforter mes certitudes dans le même temps ! Cela étant, peut-être que, si on se reparle dans dix ans, j’aurai changé d’avis. Pour le moment, je suis certain qu’une œuvre de musique réussie est comme une peinture aboutie.
On gagne peut-être à préciser que tu es un amateur de beaux-arts.
J’adore les expressionnistes abstraits, j’adore Clyfford Still, et j’adore Serge Poliakoff. Leur travail fait résonner ma quête sinon d’absolu, du moins de spirituel. À l’instar des chefs-d’œuvre peints par ces maîtres, la musique est là pour nous permettre d’accéder à un autre état de conscience. Elle participe d’un travail sur soi. Si elle se donne entièrement d’un seul coup d’un seul, elle nous empêche de développer ce travail.
Tu n’as donc jamais été tenté de simplifier ta musique – ne serait-ce qu’un morceau susceptible de devenir ton « tube » ?
Haha ! Non, je n’ai jamais vraiment essayé de suivre cette voie. Peut-être parce que la musique que je propose aux auditeurs est celle qui me représente le mieux. Je ne peux pas la truquer. Elle sort de mes tripes. C’est moi. Je ne peux pas être moins compliqué, plus accessible ou quoi ou qu’est-ce. Je suis ce que je suis, et ma musique est à mon image. Voilà aussi pourquoi j’ai du mal à en parler : je n’ai pas le recul nécessaire pour parler de moi. Heureusement, peut-être.
Pourquoi ?
D’une part parce que, si je l’avais, je passerais du temps, donc trop de temps, à me regarder le nombril en espérant me trouver beau. D’autre part parce que je n’aurais plus besoin de créer ni, sans doute, d’interpréter. Et alors, que deviendrais-je ?
Puisque tu revendiques la dimension autobiographique de tes œuvres électro-acoustiques, puisque tes œuvres sont – disons-le sans barguigner – plus noires que lumineuses, est-ce à dire que, contrairement aux apparences, tu es quelqu’un de sombre ou, et ce n’est pas contradictoire, que la partie la plus créative sinon la plus intéressante d’un artiste est forcément son dark side ?
Hum… Est-ce que l’art vient forcément du côté négatif et vénéneux de notre force ou de notre faiblesse, ou est-ce qu’il dévore cette noirceur pour le transformer en une sorte de beauté – d’où l’idée de lumière noire ? Je ne sais pas. Parfois, ma femme me dit que si, au lieu de remettre sur le métier des pièces écrites jadis, je repartais aujourd’hui d’une tabula rasa, j’écrirais de l’électro-acoustique plus joyeuse. Pourquoi pas ?
Oui, pourquoi pas ?
Parce que je doute que cette opposition soit réaliste. La noirceur est fascinante, mais est-elle toujours aussi empoisonnée quand on l’a transformée en œuvre d’art ? Mystère… La seule évidence, c’est que, ce que j’ai écrit, c’était moi au moment où je l’ai composé, comme si j’étais en connexion directe avec ma psyché. Le retravail vise à optimiser la forme, à être plus pertinent, plus cohérent, à mieux prendre en compte l’enjeu d’être entendu et écouté… Pour autant, je n’ai pas envie de simplifier mon bouillonnement intérieur. Je préfère le rendre intrigant grâce à une musique-monde, où le classique se mêle à l’électro-acoustique, le déjà-connu aux pièces à découvrir, et l’évident au mystérieux. Bref, une musique-monde où l’auditeur pourrait prendre plaisir à se perdre !
1. Géologie des préludes
2. Identité du compositeur
3. Dissection de la composition
4. Architecture de la musique

Nicolas Horvath, Debussy de la Lorette en Cornouailles et des gens, lors d’une performance à Misy-sur-Yonne. Photo : Bertrand Ferrier.
1. Géologie des préludes
2. Identité du compositeur
3. Dissection de la composition
4. Architecture de la musique
Comment se construit un cycle, dans son unité et sa diversité, sa compacité et ses irrégularités, ses sauts et gambades ? Nicolas Horvath décrypte pour nous l’art de manigancer 73′ de musique qui se tiennent sans peser…
« Dans les préludes, mon moi émerge »
Bertrand Ferrier – Après avoir ausculté l’intérieur de ta musique, peut-être est-il temps d’en contempler l’extérieur – j’entends par-là la structure. Ainsi, on a parlé de l’incomplétude des dix-sept préludes au lieu des vingt-quatre attendus ; mais on n’a pas encore évoqué sa trop-complétude : dix-sept préludes, c’est beaucoup et c’est long ! Certes, l’avantage de ce temps long est de permettre à l’auditeur de profiter, notamment
- de l’énigmaticité de la chose,
- de ses nombreux mystères insaisissables lors d’une première écoute,
- de ton goût pour la narrativité et les surprises,
- de ton travail sur la texture des sons et les ruptures de rythme,
- de ton penchant pour les contrastes – de genre, de durée – et
- de la jubilation que tu sembles éprouver à effrayer le chaland…
Pour autant, as-tu pensé l’ensemble – avec tous les cahots que l’on a évoqués : ce que tu n’as pas pu mettre, ce que tu as enlevé, ce que tu as reconfiguré –
- en tant qu’ensemble (en tressant des fils rouges donc en préparant
- des ruptures,
- des discontinuités et
- des effets d’étrangeté voire d’incongruité) ou
- en tant que collage de morceaux aux frictions ou redondances assumées ?
Nicolas Horvath – Au début, clairement, je savais qu’il y aurait plusieurs préludes, mais je n’avais pas une vision définitive de ce que cela deviendrait. Aujourd’hui, à mes yeux et à mes oreilles, les Préludes à la lumière noire forment un ensemble cohérent, surtout depuis que j’ai refait le mastering. À cette occasion, j’ai vraiment réalisé un travail de fond. J’ai aussi revu l’ordre des pistes. J’ai cherché un équilibre structurel entre
- les formes,
- les intensités,
- les moments plus calmes,
- les rappels et
- les différences de construction pour éviter que l’on ait deux plans identiques l’un après l’autre.
J’ai eu une approche quelque peu symphonique de l’écriture, dans la mesure où j’assume
- des développements thématiques,
- des sortes de leitmotivs (si on peut appeler ça ainsi),
- des récurrences de sons, etc., en somme : une cohérence.
Il y a aussi une constance sur laquelle je tiens à revenir, c’est ton plaisir de faire peur à ton auditeur.
Tu trouves ?
Bah quand même ! Comme on ne dit pas en musicologie, dans ta musique, y a des moments hyperflippants !
Pourtant, je ne cherche pas à faire peur. Ce que tu entends, c’est ce que je ressens. Comme je te disais, c’est mon moi qui émerge. Au moment où j’ai composé ce morceau, j’ai écrit ce que j’avais à l’intérieur. Ce sont mes doutes, mes failles, ma détresse et mes joies parfois ; mais je reconnais que l’on peut entendre çà et là mon effroi.
De quoi étais-tu effrayé ?
Artistiquement, de tout. De moi aussi. De mon avenir. De voir que tout ce que j’avais imaginé s’effondrait. Ces musiques, j’en ai composé une première version avant que le piano ne décolle. Il y avait de quoi être effrayé, crois-moi !
D’un point de vue matériel ?
Pire : plutôt d’un point de vue existentiel. Je ne dirais pas que j’ignorais ce que je fichais là, plutôt que j’avais l’impression de ne pas être à ma place. Il faut contextualiser, voir ça avec le regard du petit minot de vingt ans qui a tout à apprendre de la vie. J’ai composé jusqu’à mes trente ans, et j’assume de dire que c’était une période très noire de ma vie. Je ne vois pas pourquoi je le cacherais : j’étais en dépression, au sens clinique du terme ; et cette période extrêmement noire s’est terminée avec la mort de quelqu’un.
« Ma musique n’est pas une thérapie »
On en revient aux paradoxes que l’on évoquait dans le premier épisode de cet entretien comme te caractérisant : si je comprends bien, c’est la mort qui t’a remis sur le chemin de la vie.
Oui, je voyais ça ainsi, quand c’est arrivé.
Ce qui a précédé – et contribué à inspirer tes compositions –, c’est pour partie ton impression d’avoir déchu. Tu étais bien installé à Monaco…
J’étais même une petite star locale. Je jouais pour tout le monde. J’étais de tous les concerts. Je jouais devant tous les princes. Et tu sais quoi ? Je m’étais habitué à être une coqueluche. On s’habitue bien à ce genre de statut. Sauf que, en venant à Paris, je me suis pris une belle claque. Aujourd’hui, je peux dire que c’était bénéfique voire vital. N’empêche, sur le moment, quelle violence ! Quelle humiliation quand tu tombes de ton piédestal !
Avec le recul, tu estimes que cette « belle claque » a sauvé ta vie artistique ?
Oui, elle l’a sauvée doublement. D’une part, elle m’a inspiré ma musique et, d’autre part, elle m’a fait passer un cap indispensable par rapport au piano. Tu sais, dans les petites villes, on peut facilement devenir le roi d’un petit domaine, d’une cour riquiqui. C’est même pas que tu ne veux pas te rendre compte que tu règnes sur un timbre-poste, c’est plus grave : tu ne t’en rends pas compte. Tu n’as pas besoin de vouloir. Tu te berces d’illusions. C’est une chanson douce, lénifiante, hypnotisante, une berceuse très efficace, et je défie quiconque de ne pas aimer qu’on la lui fredonne. Néanmoins, c’est aussi une chanson incroyablement dangereuse. Le réveil est terrible. Quand tu croyais être au sommet et que tu découvres la réalité du niveau mondial, tu te rends compte illico que tu as intérêt de bosser.
Et pourtant, pendant un moment, bosser ne t’a pas suffi.
Malheureusement, j’étais très mal entouré. J’ai fréquenté les mauvaises personnes, du genre qui promettent la Lune et tiennent le caniveau. Bref, du genre qui t’humilie. Ça m’a marqué durablement. Même si ça ne change rien sur le moment, je savais que c’était d’une banalité crasse. On est beaucoup à s’être retrouvés fragilisés, donc à avoir été encore plus fragilisés par des personnes qui flairent ta fragilité et en profitent pour te rabaisser plus bas que terre. On est tous ou presque passés par là !
Comment, toi, t’en es-tu sorti ?
Il m’a fallu du temps. Déjà, j’ai dû accepter de faire un travail sur moi et, pour ça, accepter d’affronter un sentiment de gâchis. Ce n’est pas simple. Après, j’ai dû aussi accepter que j’avais de grandes failles que je devais comprendre. En effet, on ne guérit pas de ses failles, ce serait trop simple ; en revanche, on peut les intégrer pour vivre avec elles… à condition de les avoir comprises. Tant que tu ne les as pas comprises, tu peux partir dans beaucoup de directions, des mauvaises comme des bonnes, mais tu n’avances pas.
« À la longue, le vertige du vide devient rassurant »
Ta musique vise à saisir ce désarroi, cette ligne de crête entre constat de fractures et espérance de cautériser les béances ?
Ma musique n’est pas une thérapie, mais elle est composée à vif. Elle naît dans le contexte que je viens de décrire, donc elle se nourrit d’un moment où rien n’allait.
Pour toi, composer était une manière de faire quelque chose de positif avec un sentiment de vide ?
Non, c’était juste une manière de traduire en musique que rien n’allait. Pourtant, à cette époque, j’avais énormément d’élèves. Une année, j’en avais même quarante-huit – quarante-huit, tu te rends compte ? Quarante-huit élèves en cours particuliers, c’est beaucoup, ça fait des semaines trrrès longues, d’autant que ce n’était pas mon objectif ou ma fierté.
Ce succès pédagogique n’était-il pas satisfaisant ?
Il l’était d’autant moins que, en musique, il est rare que le quantitatif soit un critère valable.
Cette saturation ne t’a pas détourné de la pédagogie…
Non, mais le prof que je suis a retenu la leçon : maintenant, j’ai beaucoup moins d’élèves mais je suis plus heureux dans ma vie. In-com-pa-ra-ble-ment.
Quelle relation entretiens-tu donc, aujourd’hui, avec cette musique des jours sombres ?
Je la perçois comme une photographie sonore de ce qui me parlait à l’époque. Je reviens sur tes propos : ce n’est pas une musique qui cherche à effrayer l’auditeur. En revanche, elle parle de la façon dont je voyais le monde au moment où je l’ai composée.
Tes Préludes seraient une forme d’autofiction, mais sans fiction ?
Ils manifestent une réaction immédiate à ce que je vivais. Immédiate au sens fort : sans médiation. L’électro-acoustique s’y prête car c’est finalement un domaine très proche de l’art brut. Dans un premier temps, il n’y a pas de filtre. Après, le filtre, c’est la composition elle-même, la structuration – voilà ce qui distingue cette musique de l’art brut. Toutefois, le filtre que je pose a posteriori n’ôte rien au geste original ; et celui-ci, non, n’est rien d’autre qu’une mise à nu de mon moi de cette époque-là.
Peut-on rapprocher la récurrence de types de sons (métal, liquide, cloche…), au long des dix-sept préludes, d’un autoportrait en ondes ?
Il est certain que les sons récurrents contribuent à me définir, disons : à inscrire le compositeur dans la composition. Les sons qui reviennent de préludes en préludes sont ceux qui me parlaient le plus, qui étaient le plus en phase avec mes vibrations du moment… et avec celles que j’absorbais en écoutant les collègues. En effet, la scène expérimentale, que j’écoutais énormément, se caractérisait par un usage abondant de sons très stridents mimant l’aspiration vers le noir et le néant. J’étais complètement dans cette mouvance. Foisonnaient alors des projets bizarres, du type musique de Carpenter XXL, en mille fois plus dépressif ! Le danger, quand tu as mis l’oreille là-dedans, c’est l’escalade. Plus tu sens le vide, plus le vide te happe, plus tu crains le plein. Le vertige du vide est destructeur mais bizarrement rassurant et plaisant.
Par conséquent, ta musique n’est pas une astuce pour combler le vide ou ralentir la chute ?
Non, à cette époque, je n’avais aucune intention de m’extirper du puits sans fond. La musique disait ma chute, elle l’accompagnait. Si elle l’éclairait, c’était avec cette lumière noire que revendiquent les préludes. En physique, la lumière noire est celle qui absorbe les rayons lumineux. C’est une anti-lumière.
« Grâce à Glass, j’ai compris les rivières souterraines de l’inspiration »
À défaut de pouvoir voir cette lumière, comment faut-il écouter ta musique : d’un bloc, si on en a le temps, ou par petits bouts ? En définissant puis redéfinissant l’ordre des pièces, as-tu pensé aux deux formes de réception envisageables ?
Clairement – tu vois, tout n’est pas noir ! –, depuis la nouvelle version des Dix-sept préludes, j’ai pensé le tout comme un flux continu. Ça ne veut pas dire qu’il faut les écouter à la file : simplement que l’on peut risquer cette aventure. Normalement, ça ne devrait pas être trop ennuyeux. J’ai essayé d’y bosser. Ce nonobstant, chaque prélude peut s’écouter de façon séparée. D’une part parce que c’est ainsi qu’ils ont été composés : à la base, je n’avais pas un plan d’ensemble figé ; celui-ci s’est construit chemin faisant. D’autre part parce que ceux qui ont bénéficié d’une création radiophonique ont été diffusés seuls. Donc ce n’est pas une hérésie de choisir d’écouter l’un ou l’autre au gré du temps d’oreilles disponible… ou des envies aléatoires !
Certains préludes ont-ils été composés en contraste ou par opposition ?
Hum, les trois-quarts ont été composés de manière indépendante. Après, quand je les ai intégrés dans le cycle, ils ont pu subir quelques modifications pour que l’ensemble gagne en cohérence. Mais la cohérence peut venir non pas d’une volonté a priori (comme quand on compose une pièce en réponse ou en écho à un autre prélude) ou a posteriori (comme quand je retravaille une pièce pour l’insérer mieux dans le cycle) ; elle peut venir, simplement, d’une affinité que j’ai repérée entre deux ou trois œuvres. C’était le cas, par exemple, quand je sentais que des éléments étaient proches entre deux préludes. J’étais même surpris de découvrir ces similitudes car, quand j’étais dans la phase de composition, ça m’échappait à 100 %. Philip Glass a très bien expliqué le phénomène : il appelle ça les rivières souterraines de l’inspiration. C’est une très belle réponse à ceux qui disent avec une ironie pincée que du Philip Glass, ça ressemble beaucoup à du Philip Glass. Incontestablement, certaines pièces sont proches parentes, et le réflexe de nombreux critiques est de dire : « Ça va, il s’est pas trop foulé, sur le coup ! » Philip Glass ne nie pas ces similitudes. Il se contente d’expliquer que son auto-influence est accidentelle.
On parlait tantôt des récurrences sonores ou formelles qui constituent ta patte. Là, tu vas plus loin en suggérant que, comme Philip a pondu du Glass, Nicolas a pu composer du Horvath sans s’en rendre compte. Est-ce quelque chose que tu as été amené à moduler lors de la finalisation du cycle pour éviter la lassitude d’un auditeur vite rasé ?
En réalité, tu poses la question de l’équilibre. Que ces préludes ressortissent d’un même style global, c’est une évidence. Ils racontent la même histoire, ils ont été écrits par le même bonhomme, en proie aux mêmes tourments. Mais ils ne doivent pas la dire avec les mêmes mots. Il faut que les chapitres soient différents. Donc non aux « trucs » systématiques, et oui aux parentés – en constatant la proximité entre certains préludes du cycle et d’autres pièces que je n’avais pas incluses dans le lot, j’ai même décidé d’en intégrer certaines dans le cycle, précisément parce que je constatais qu’elles sonnaient bien ensemble… et qu’elles apportaient un autre éclairage l’une à l’autre. La connexité, la similitude, la proximité, ce n’est pas une question binaire qui affirmerait, d’un côté, que cela permet de définir le style du musicien ou que, de l’autre, c’est moyen parce que ça sent le copié-collé, la redondance, la facilité. Le travail de finalisation d’un cycle ressortit d’une précision, d’une finesse et d’une exigence qui subsument ce distingo sommaire. C’est une partie délicate de la composition, et j’espère ne pas l’avoir trop ratée !
« J’ai aimé composer une musique abstraite »
En somme, dans l’architecture finale de tes Dix-sept préludes, tu as tâché de concilier à la fois une double volonté de cohérence – que, parfois, tu es peut-être le seul à entendre, l’auditeur étant presque libre d’en définir d’autres – et de complémentarité.
Oui ! On ne peut pas présenter trois fois le même plat à l’auditeur. Une fois, c’est cool ; deux fois, t’as compris ; trois fois, woh, ça va bien aller !
C’est cette exigence qui te laisse penser que le cycle peut être abordé dans son intégralité et au détail.
En effet, je pense même qu’une partie de l’intérêt d’un ensemble d’ 1 h 13’ est de permettre cette double lecture, globale ou à l’unité. L’auditeur a le choix. Soit il prend le temps d’écouter les dix-sept pistes, soit il pioche dans le disque à sa guise.
D’ailleurs, autant tes œuvres témoignent d’une réflexion intense sur les différentes formes de narrativité, ainsi que cela a été évoqué, autant ton cycle se dérobe à toute forme de méta-narrativité, au sens où il ne raconte pas une histoire dans une perspective aristotélicienne, avec un début, un milieu et une fin. Par exemple, le début des Préludes n’est pas un début typique (on n’est pas dans le Triptych d’Éliane Radigue, par exemple), et la fin n’a pas la fougue cataclysmique des fins topiques (on n’est pas dans les Four walls full of sound de Phill Niblock que l’Opening Performance Orchestra a récemment publié chez Sub Rosa, avec le crescendo hénaurme qui ne débouche sur rien).
Exact. Pour ce cycle, je ne voulais pas fabriquer une cohérence comme j’en avais créé une pour Acedia ou pour Aceldama. Dans ces deux cas, l’œuvre est construite sur une vraie logique début-fin, avec une narration plus articulée, car j’avais composé ces musiques dans la perspective d’un album. Or, ce que j’aimais bien, tandis que je travaillais sur les Préludes, c’est qu’ils étaient beaucoup plus abstraits. Quand on se dégage des conventions narratives, il est possible que l’effort d’écoute exigé de l’auditeur soit plus important ; et, cependant, on récompense davantage l’écoute car le champ des possibles devient plus large. Pour cette raison aussi, n’écouter qu’un prélude n’est pas iconoclaste. On ne prend pas une phrase au milieu pour l’abandonner avant sa conclusion. Bref, on ne commet pas de crime de lèse-compositeur !
1. Géologie des préludes
2. Identité du compositeur
3. Dissection de la composition
4. Architecture de la musique
5. Éloge de l’écoute

Nicolas Horvath au crépuscule, lors d’un concert-performance à Misy-sur-Yonne. Photo : Bertrand Ferrier.
En conclusion de l’entretien qu’il nous a accordé, Nicolas Horvath s’est, et c’est heureux, refuser à nous donner un guide d’écoute de ses Préludes. En échange, il a accepté de réfléchir à haute voix sur l’art d’écouter sa lumière noire
- en tant que prélude,
- en tant que compositions d’un artiste aussi connu pour être « l’interprète des autres »,
- en tant que pièces insérées dans l’Histoire de la musique,
- en tant qu’objet sonore indéterminé, et
- en tant que lien entre un compositeur vivant et son auditoire.
Une coda tonique et franche, où les mannes de Scriabine, d’Alkan et d’une foultitude de grands compositeurs planent, irradiants et mystérieux !
« J’aimerais fusionner piano et électro-acoustique »
Nicolas, puisque nous abordons le dernier épisode de notre échange, il est temps que je pose la question débile et essentielle : à quoi tes préludes préludent-ils ? Est-ce une invitation à poursuivre le voyage que tu as amorcé, une métaphore indiquant que la musique n’est jamais que prélude au silence donc à la vie, une manière d’interroger avec les outils électro-acoustiques un concept codifié par la musique savante traditionnelle, ou bien…
En fait, non, ce que j’aime avec le terme de « prélude », c’est qu’il n’y a pas de forme prédéfinie. C’est une forme ouverte au sens où Umberto Eco évoquait les œuvres ouvertes. Allemand, j’aurais peut-être appelé ça des stücke. Pour moi, le sens est similaire. Quand je lis Klavierstücke, je lis « Préludes pour piano ». Sans doute parce que je suis un Français qui lit très mal l’allemand et comprends parfois ce qu’il a envie de comprendre – un Français, en somme ! Chopin, qui n’était pas qu’un Français, l’a prouvé : ses préludes, il y en a vingt-quatre, soit, mais ils préludent à quoi ? À rien, si ce n’est à eux-mêmes. Moi, ce que j’aime, dans ses vingt-quatre préludes, c’est qu’il s’agit de pièces indépendantes qui peuvent former un tout. Pourtant, quand t’écoutes les vingt-quatre préludes, d’accord, tu voyages dans les tonalités mais, à l’instar des vingt-quatre préludes de Bach, ce sont des pièces indépendantes qui forment un tout… juste parce qu’on a envie que ça forme un tout.
Le poids de la tradition ?
Oui, et le respect du monument. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose !
Est-ce que c’est aussi pour cela que tu n’en as composé « que » dix-sept, histoire de casser cette obligation ou ce décorum de…
Non, je te l’ai dit au début, dix-sept, c’est un accident. J’aime beaucoup le nombre « 24 ». Simplement, parfois, la vie ne lui correspond pas. Pareil pour Morteza Shirkooi et ses « Arteeman » : j’aurais aimé qu’il en écrive vingt-quatre. Il en a composé quinze. Je l’ai tanné pendant des années pour qu’il en ponde neuf de plus, parce que vingt-quatre, ça fait bien ; et, en 2020, il m’a écrit qu’il ne s’y plierait jamais parce qu’il n’était plus du tout dans le même état d’esprit, donc qu’il serait incapable de composer d’autres pièces à la façon de ses… préludes. J’ai eu du mal à comprendre cela, plus encore à l’accepter ; et je me retrouve aujourd’hui à t’expliquer que, non, j’ai dit que le dix-septième serait le dernier, donc il sera le dernier ! Ironique, non ?
Tu es déjà en train de travailler sur d’autres projets électro-acoustiques ?
J’ai des idées sur ce que j’aimerais faire, mais je préfère ne pas en parler parce que si je ne mène pas la barque à bon port, j’aurais l’air ridicule !
Bah, pourquoi ? Ça peut aussi nourrir la rêverie de ceux qui apprécient ton travail…
Tu crois ? Dans ce cas, je veux bien avouer que les pistes que j’aimerais explorer tournent autour de la fusion entre le piano et l’électro-acoustique. J’ignore si j’aurai le temps, mais il y a une nouveauté dans ma production pianistique depuis le confinement : j’ai osé improviser car on me l’a demandé. J’en ai risqué une première de dix minutes où on peut entendre des relents d’Erik Satie ; et j’en ai fixé une autre, très expérimentale, visait à aller avec le Merzbow car Merzbow ne voulait pas travailler avec l’œuvre d’un compositeur. Ça m’a donné l’occasion de proposer une improvisation assez explosive dont je suis plutôt satisfait.
« La cohérence de ma discographie, c’est moi ! »
Es-tu en train d’apprivoiser une nouvelle voie d’exploration : piano improvisateur avec bande électro-acoustique ?
J’y réfléchis.
Comment as-tu commencé d’imaginer franchir le pas d’une fusion de tes deux activités ?
Par hasard, complètement par hasard ! En 2020, j’ai envoyé des pistes à une amie qui ambitionnait de me servir d’agent, sauf qu’elle ne m’a jamais trouvé un seul concert. Or, quand elle a ouvert les pistes, elle n’a pas prêté attention, elle a lancé à la fois une piste électro et une piste piano, et elle a trouvé que ça donnait très bien.
Ça t’a ouvert tes pistes ?
Je pense à cet accident depuis deux ans. Dans ma création, les projets prennent leur temps. Je me dis que l’idée mérite d’être creusée. D’autant que j’aimerais intégrer la part électro-acoustique dans mes concerts comme je l’ai intégrée dans ma discographie. Le meilleur moyen d’y parvenir est de créer une pièce de piano avec une base électro-acoustique. Je pense que ça peut être intéressant et pour le public, et pour moi. Mais bon, hic et nunc, on a tellement peu de concerts…
Justement, si on se met à la place de quelqu’un qui te connaîtrait en tant que « pianiste classique », on peut imaginer que cette musique risque de le secouer voire de le désarçonner.
C’est plausible !
Bien sûr, en écoutant ta musique, tes habitués qui voudront se rassurer peuvent se dire que composer, pour Beethoven, Scriabine ou Horvath, c’est toujours feindre d’organiser le bruit du monde et nos chaos intérieurs. Néanmoins, ils peuvent aussi rester à la porte de cet autre monde horvathien – de même qu’un amoureux de Dapnom ne verra pas immédiatement le lien entre ses albums préférés et Hélène de Montgeroult, qui vient de recueillir les plus chaleureuses félicitations de Télérama. Comment abordes-tu cette question de la double réception ?
Je ne peux pas répondre pour l’auditeur, alors je vais te répondre pour moi. La question que tu poses se réfère à la cohérence de mes deux formes de production musicale. Du reste, tu aurais pu aller plus loin : tu opposes mes compositions et mes interprétations, mais tu aurais aussi pu opposer mes interprétations entre elles – le rapprochement entre Brillon de Jouy, Hermann, Liszt, Debussy, Cardew, Glass ou Rääts, entre autres, peut voire doit surprendre ! Toutefois, je m’en tiendrai à ta question, et je répondrai que la cohérence entre mes interprétations et mes compositions, sans prétention aucune, c’est moi. C’est moi qui joue, c’est moi qui crée.
Cette posture – qui n’est pas une pose – permet de rappeler le rôle créatif de l’interprète et la fonction concrète du compositeur.
Tu as raison. L’interprète n’est pas un ordinateur qui exécute sans âme une partition ; et l’ordinateur sur lequel je compose n’est, lui, qu’un exécutant de ce que je décide. L’âme que je mets quand je joue des œuvres d’autres compositeurs, la manière dont je les perçois, les choisis, les défends, les mets à disposition du public, c’est moi ; et c’est ce même moi qui compose des œuvres d’électro-acoustique. Ce n’est pas un autre Nicolas Horvath.
« Je ne suis pas allé au tribunal révolutionnaire, heureusement ! »
Néanmoins (j’aurai été têtu jusqu’au bout, désolé…), comment conçois-tu la réaction d’une personne qui te connaît en tant qu’interprète et qui découvre tes compositions ?
Je pense que cette personne pourrait mieux comprendre l’énergie que je mets dans certaines pièces. Un exemple : les mouvements rapides, pathétiques et agités chez Hélène de Montgeroult [pour entendre l’album en intégralité, c’est ici]. Entendre ma musique permet de mieux saisir mon appétence pour le fantastique dans la musique des autres.
Tu soulignes ainsi l’idée que, sans tirer la partition vers ce qu’elle n’est pas, l’interprète y fait sonner plus haut ce qui résonne en lui.
Oui, il ne s’agit pas de trahir mais de vibrer avec une composition et de faire vibrer l’auditeur avec elle. J’adore creuser les compositions des autres pour y saisir des sous-textes pas toujours évidents. Quand je joue Scriabine, par exemple, c’est cet axe particulier du fantastique qui me happe et que l’auditeur peut entendre. Quand j’interprète des pièces denses, pour tirer mon épingle du jeu, j’essaye d’apporter cette posture de l’interprète qui n’hésite pas à fouailler les entrailles des monstres abordés. La densité, le foisonnement, les tempêtes tourmentées, cela forme un univers dans lequel j’ai nagé pendant longtemps. Scriabine n’est pas moi ; mais le type de sentiments qu’il concentre dans ses chefs-d’œuvre, ce maelström de fureurs déchaînées et d’inextinguibles rages, ces secousses qui n’ont pas peur de la désespérance, je les ai beaucoup partagés.
Dès lors, le fait que tu te sentes plus apaisé aujourd’hui impacte-t-il ton travail d’interprète ?
Non, parce que, même si je suis plus posé, je connais ces émotions et ce bouillonnement sur le bout des doigts autant qu’au fond du cœur. Cela étant, je ne gomme pas la spécificité de chaque compositeur. Par exemple, j’ai conscience que, contrairement à Montgeroult, je ne suis pas allé au tribunal révolutionnaire, heureusement pour moi ! Toutefois, le respect de nos particularités n’y peut mais : je me sens connecté à la compositrice à travers une certaine similitude de tremblement intérieur. En tout cas, c’est comme ça que je sens les choses quand je me mets au piano et que j’affronte les chaos des autres en général et d’Hélène de Montgeroult en particulier.
« Pour comprendre le bonheur, il faut passer par Faust et le satanisme »
Si le compositeur Horvath devait partir sur un fichier vierge, que donnerait sa musique si elle ne puisait pas à ses sources bouillonnantes d’antan ? Pourrait-il sortir de ton imaginaire une pièce électro-acoustique calme, épanouie voire lumineuse sans noirceur ?
Haha ! « Sans noirceur », ce serait un défi.
Tant mieux, peut-être : le résultat ne serait-il pas terriblement ennuyeux, comme n’importe quel bonheur béat ?
Hum, peut-être mais pas forcément. Le bonheur peut être ennuyeux à écouter ou à raconter, je pense. C’est pourquoi cela peut être un défi intéressant de l’exprimer en veillant à ne pas ennuyer. Cependant, un tel but ne peut être atteint que si l’auditeur et l’interprète cheminent ensemble à leur rencontre.
Comment cela ?
Pour que l’auditeur saisisse ou apprécie le bonheur, l’interprète doit postuler sa maturité ou sa part de naïveté. Pas le choix. Par exemple, chez Alkan, dans la Sonate des quatre âges, il y a un mouvement qui correspond aux quarante ans et s’appelle : « Un heureux ménage ». Ce n’est pas le passage le plus passionnant musicalement, mais c’est l’un des plus justes. Il est tellement vrai ! J’espère que je n’en viendrai pas à vivre au rythme du « Prométhée enchaîné » conclusif, marqué « extrêmement lent ». Ça ferait un p’tit peu peur. Mais, pour comprendre le bonheur de l’heureux ménage, il faut passer par la fougue de la jeunesse vécue « très vite », et il faut aussi passer à travers le « Quasi-Faust » joué « sataniquement » – sataniquement, quand même, ça rigole pas !
Selon toi, le voyage de l’écoute est interactif. L’interprète n’est pas seul, l’auditeur a aussi son rôle à jouer.
Oui, et pour une raison simple : quelle que soit l’œuvre, la musique est un partage. Il faut qu’elle fasse résonner au même diapason l’interprète et l’auditeur. Qu’importe si l’on a partagé ou non des expériences similaires, du moment qu’il y a un terreau émotionnel fertile sur lequel on parvient à semer ensemble des plantes qui nous parlent.
Malgré tout, puisqu’on a régulièrement parlé de tes paradoxes, au cours de cet entretien, n’y a-t-il pas une contradiction entre « bonheur » et « électro-acoustique », voire entre « électro-acoustique » et cette « naïveté » que tu revendiques ? Même la « Baballe du chienchien à la mémère » de Beatriz Ferreyra grince à souhait !
Ta question est bizarre. Je ne vois pas pourquoi l’électro serait moins capable de rendre le bonheur « pas ennuyeux » que l’acoustique.
Elle ne s’y colle pas souvent.
Tu pourrais émettre ce même genre de jugement à l’emporte-pièce sur des tas de compositeurs acoustiques ; et pourtant… Souviens-toi ! Dans Brillon de Jouy, de nombreux passages évoquent la joie de vivre ; chez Haydn ou Mozart aussi ! Il y en a un p’tit peu moins chez Beethoven – logique, vu le bonhomme… Dans ces moments-là, l’interprète doit développer son jeu afin d’avoir une grande variété de toucher, d’illuminer certaines notes, de donner de la vie et de la vibration à l’émotion que le compositeur a couchée sur le papier.
« Le plus intéressant, dans le bonheur, ce sont ses failles »
Certes, ce même désir de « partager une vibration » s’exprime évidemment dans tes compositions électro-acoustiques ; mais le bonheur y est un tantinet moins audible…
Il ne faut pas avoir une vision binaire des émotions. En tant que compositeur, en tout cas, le travail sur les formes et les choix de sonorités notamment me permet de penser des passages dans un spectre émotionnel qui ne soit pas réducteur. Par exemple, je ne me dis pas : « Tiens, je vais créer un passage joyeux, donc il faut être joyeux du début à la fin », je vais plutôt m’intéresser aux failles qui zèbrent la joie.
Et voilà ! Ce qui t’intéresse dans la joie, ce n’est pas la joie, ce sont ses failles…
Parce qu’il y en a plein, et c’est ça ce qui la rend « pas ennuyeuse » ! La joie est sinusoïdale. On n’a jamais le smile 7/24. En tout cas, pas moi. Par exemple, dans ma vie, je suis heureux : j’aime ma femme, je suis fier de mon enfant, je fais le métier que j’adore, je partage ma musique… mais, hier soir, j’ai pas dormi, donc, au moment où on se parle, je suis plus explosé qu’heureux. Pourtant, quand je vois la photo de mon fils, je sais qu’il est le plus beau bébé du monde, et ça me rend heureux. N’empêche, j’ai passé une sale nuit, donc, etc. Ben voilà, le bonheur, c’est ça, et pas que chez moi, hein : je suis sûr que chez tous les gens heureux, le bonheur et la joie contiennent des tensions, des contradictions, des paradoxes ; et la musique, qu’elle soit acoustique ou électro, en porte forcément trace.
Alors, avant de te libérer pour que tu puisses compenser la nuit sauvage que tu as vécue, une dernière question environ. Dans une réalisation du label Sub Rosa que nous avons évoquée, le compositeur claque un conseil : « Il faut écouter cette musique très FORT. Si les voisins ne viennent pas se plaindre, c’est que vous ne l’écoutez pas assez FORT. » Est-ce aussi le cas quand on écoute du Nicolas Horvath ?
Haha ! Dans ma production, je pense que ça vaut pour la version harsh noise que j’ai faite de Treatise, de Cornelius Cardew. Ça, il faut vraiment le mettre à fond !
Et tes préludes ?
On peut, mais je pense que ce n’est pas nécessaire. Mon conseil est, autant que possible, de ne pas baisser ou augmenter le son en cours d’écoute. Il faut essayer de trouver un juste volume et de s’y tenir car, pour moi, l’évolution dynamique fait partie de l’œuvre. Je connais très bien des personnes – une en particulier, qui vit souvent près de moi – qui montent le son pour l’adagio et le baissent pour le Vivace final. Je déteste ça, c’est tellement antimusical ! Et je déteste aussi quand on coupe un morceau en plein milieu. Pour moi, c’est un scandale, c’est impossible, ça détruit le sens de ce que l’on a écouté auparavant ! En tant que musicien, j’estime que la dynamique fait partie de l’expérience d’écoute. Plus le temps passe, plus j’en suis convaincu.
Sur ce point, tu as évolué.
Oui ! Quand je traînais dans la scène UG, le bon niveau du volume, c’était à fond, et la meilleure façon d’écouter, c’était quand on était collé à l’ampli. Résultat, j’ai récolté un acouphène. Donc, de grâce, quand vous écouterez ma musique, réglez le volume ainsi qu’il vous siéra, mais ne vous infligez pas un acouphène à cause de mes Préludes à la lumière noire !


