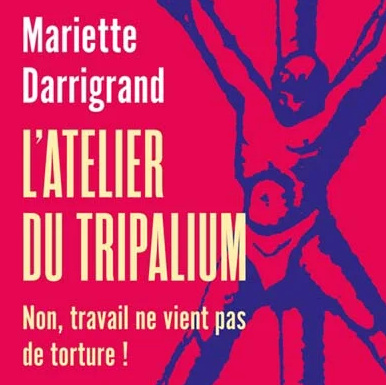« L’Atelier du tripalium », Mariette Darrigrand (Équateurs, 2024) – 6/6
Non, le travail n’est ni torture que seuls apprécient les bourreaux (de travail), ni « punition d’une faute » (135), au contraire : telle est moins la thèse que le clou martelé par Mariette Darrigrand dans L’Atelier du tripalium, son essai paru aux éditions de l’Équateur en 2024 et dont nous terminons, ce jour, la lecture commentée. On le sait, voler, c’est pas beau, mais travailler, c’est pas trop dur car, quand on travaille, « on coupe un morceau de trabs [tronc d’arbre] dans la forêt et, un jour, on se retrouve sur le pont d’un bateau qui prend le large » (137). Quand tu visualises la gueule de la ligne 2 du métro à 8 h du matin, tu te dis décidément qu’il faut en tenir une couche pour oser écrire des âneries semblables mais, apparemment, ça passe.
À travers les séries télévisuelles, on peut suivre les « péripéties du labeur » et se reconnaître dans les archétypes mis en scène en se demandant « qui leade, qui conduit l’histoire ? ». Car le leader, c’est celui qui conduit, qui tient le gouvernail du bateau entreprise avec force mais aussi vulnérabilité, comme l’a montré Delphine Horvilleur, « rabbin qui fait du rab » (143), rappe Mariette avec ses parophonies aussi consternantes que les circonvolutions – pseudo humoristiques ou non – de ses écrits. Chacun est invité à voyager, à prendre « des passerelles, des ponts pour exercer des fonctions transverses (sic) » dans un crew car Mariette, spécialiste des séries télévisuelles et de l’anglais expliquant que team est réservé au sport… ainsi que le savent ceux qui ont subi les affres du team building ou vu les géniaux Black Books, avec leurs personnages plus ou moins mis en appétit par l’idée de former une team. Certes, admet l’auteur, le travail, « parfois, c’est la galère, mais c’est surtout l’occasion de rejoindre un trajet » (147). Oui, « rejoindre un trajet ». Bon, remarquez, on est proche du gros port, donc on n’est plus à ça près.
En effet, voici que point la conclusion. Elle se propose de nous offrir « une boussole pour la route ». L’auteur y assume avoir recherché « la représentativité » et non « l’exhaustivité » en se fondant sur un critère : « La valeur positive des termes que j’oppose au travail-torture » (150) au point de réinvestir la carte de Tendre pour l’adapter au travail en reliant corps et esprit d’une part, ancrage et voyage d’autre part. Le résultat ressortit
- d’un sociolecte,
- d’un verbiage et
- d’une iconographie
adaptés quand on « souhaite se montrer probusiness » comme le gouvernement Bayrou et ses prédécesseurs (in : Le Monde, 23-24 février 2025, p. 8), et effarant pour tout travailleur travaillant vraiment.
Remplacer l’amour par le travail au nom de l’amour du travail (haha ! je crois que je commence à prendre le pli darrigrandesque !) pourrait passer par une ineptie. C’est plutôt un crachat à la face de ceux qui bossent. Faire l’éloge du travail est une chose, car c’est une opinion provocante qui a toute sa place dans le débat ; laisser entendre que, par la grâce des entourloupes du verbe confinant parfois à la logorrhée, on peut en gommer les aspects négatifs voire mortifères est une ignominie. Pourtant, le livre se conclut par « un glossaire du travail » où
- il ne faut pas chercher « souffrance » mais « opulence »,
- le problème de la « santé mentale » est résumé à un « baromètre » de l’Essec (un sondage Ipsos, en fait, cautionné par une école de commerce) pour signaler que « près de six adolescents sur dix se déclarent stressés par les interrogations ou la remise de notes » (ce n’est pas même une façon ridicule d’aborder le problème, c’est pour expliquer que, si de nombreux employés vont mal voire pire, c’est que « la santé mentale se cultive dès l’enfance »), et où
- l’on apprend que l’usine « désigne le lieu où s’usinent les objets », wow.
Ainsi le livre se termine-t-il sur soixante pages de remplissage
- tantôt ennuyeux,
- tantôt hérissant,
- tantôt hors sujet,
Dans cette coda cacophonique voire cacaphonique,
- la rigueur,
- la finesse et
- l’art d’écrire
sont aux abonnés absents. En somme, un finale à la hauteur de ce qui précède, et qui achèvera de décevoir le lecteur curieux d’un essai précis, fouillé, intelligent et piquant sur un sujet palpitant.