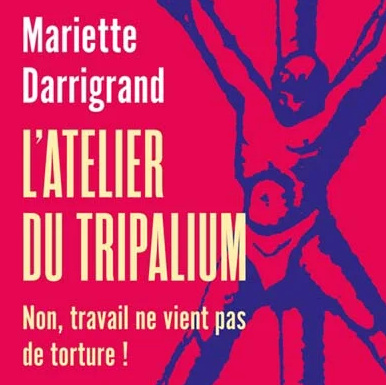« L’Atelier du tripalium », Mariette Darrigrand (Équateurs, 2024) – 5/6
Le précédent épisode s’achevait sur un suspense fouyouyou : travailler, on a une idée de ce que ça veut dire, même si notre propre définition diffère visiblement des convictions de Mariette Darrigrand ; mais à quoi s’occuperait un groupe de salariés amenés, lors d’un workshop, à « travailler sur son purpose » (103) ? Le jargon angliciste désigne la verbalisation du « but que nous nous donnons pour incarner nos valeurs, notre engagement » au boulot. En effet, travailler me paraîtrait insipide s’il ne me donnait pas l’impression de « travailler à quelque chose de supérieur à moi ». De quoi éclabousser la sémiologue de jubilation – ainsi que l’on désigne presque la retraite en castillan – voire de jubilance car, enfin, « comment ne pas se réjouir de voir que, jusque dans les usines à Ketchup, se cherche une transcendance ? » (106)
L’idiolecte religieux devient peu à peu une métaphore filée, laissant imaginer que Mariette croit au travail comme d’autres à Skippy, le grand spécialiste de la totale liberté de conscience vers un nouvel âge réminiscent. Tant pis si certains se demandent dans quelle mesure la foi qu’affiche Mariette n’a pas surtout pour objectif de séduire d’autres patrons susceptibles de l’embaucher pour aider leurs employés à définir un purpose collectif : l’écrit reste, les cris passent.
Pour l’auteur quasi théologienne, le travail est généralement une vocation, un appel – quelle chance que certains aient été appelés aux ors de la République et d’autres au nettoyage de la crasse humaine et inhumaine, la nature fait décidément bien les choses ! Cette foi dans la vocation (si, si) postule que, si le travail a été et est encore parfois conçu comme une torture, c’est à cause de la religion – ça change de la gauche – qui y a vu une façon de gagner son paradis grâce aux larmes et à la sueur. Quand, avec Luther, l’homme s’aperçoit que « Dieu n’est pas un dealer, il ne marchande pas » (Mariette, sérieux, tu connais beaucoup de charbonneurs avec qui tu peux marchander ?), le travail « qui était punition devient élévation », observe Hannah Arendt. En gros, comme t’es obligé de bosser, imagine-toi que ta souffrance, ta peine et ta désespérance sont métaphysiques.
Et l’affaire ne s’arrêterait pas à la chrétienté ! Même les textes sacrés musulmans estiment que l’homme doit « produire des richesses » et non se contenter de « l’usure et l’oisiveté ». Aujourd’hui, les responsables RH et leurs copains de la RSE réinvestissent ce champ religieux pour valoriser le travail comme
- vocation (je suis né pour occuper le poste que j’ai obtenu ou aspire à obtenir),
- devoir (ne pas travailler ou ne pas tout donner au travail est un crime contre l’humanité), et
- mission (ce projet qui cèle les exigences des financiers sous une punchline de communiquants sans inspiration permettant l’invention consternante des « entreprises à mission » parmi lesquelles Danone, c’est dire).
Ainsi, pour les travailleurs qui souffrent, le vocable « vocation » peut être entendu comme un synonyme
- de soumission,
- d’acceptation de l’humiliation et
- de culte de la résignation.
Si tu souffres au travail, ce n’est pas que le travail te fait souffrir, c’est que tu es
- un fainéant,
- un wanna be assisté, bref,
- un immonde petit personnage.
Cette idéologie droitiste décomplexée oublie entre autres d’évoquer, voilà qui est étrange,
- la destruction du Code du travail au nom précisément, de la nécessité du travail,
- le plafonnement des indemnités prud’hommales au nom de la protection des puissants, et
- la détérioration des conditions de travail de nombreux employés, quel que soit leur statut,
qui contribuent à expliquer le manque d’enthousiasme de certains travailleurs au moment d’embaucher. Les patrons aux dents longues et leurs affidés aux appétits pécuniaires tout aussi aiguisés sont en quête perpétuelle pour enfoncer un peu plus
- les petits,
- les gueux et
- les clampins (aka les « collaborateurs »).
Devant ce qui nous attend si nous acceptons sans barguigner certains postes en sachant ce que prévoient telles conventions collectives et ce que vivent les futurs collègues, doit-on s’étonner de la crise des vocations, celle qui a par exemple conduit l’Espagne à instrumentaliser l’immigration en créant une grosse partie des nouveaux postes pour les nouveaux arrivants (« 40 % des 470 000 emplois créés en 2024 ont été occupés par des étrangers », in : Le Monde, 1er février 2025, p. 18). La sinistre méthode est habile pour casser
- les salaires,
- les statuts et
- les conditions d’exercice des travailleurs,
ainsi que pour trouver de la chair fraîche prompte à la docilité. En somme, dans l’imagerie darringrandienne, trois sortes de travailleurs se distinguent :
- les gauchistes, d’abord, qui
- travaillent malgré eux, les ingrats,
- essayent d’en faire le moins possible, les cossards, et
- ne manquent jamais une raison de cracher leur fiel, les terroristes ;
- les bons employés, ensuite, capables de prendre en bouche et de recracher les éléments de langage infligés par la hiérarchie sur
- leur bien-être au travail,
- leur besoin de bosser en équipe, et
- le sens puissant qu’ils trouvent dans leur job, le salaire en devenant presque accessoire ; et
- les doux rêveurs, enfin, rêveurs faisant rêver à l’instar de ce « jeune médecin [qui] répond à la nécessité de soigner des personnes migrantes » alors qu’il pourrait passer en secteur 1 et se faire un max de moulaga.
Dans l’Évangile selon Mariette, il est martelé que
les travaux et les jours nécessaires à la longue marche de l’humanité peuvent posséder une forme de transcendance. (…) La question du travail ne peut plus s’envisager hors cadre aspirationnel (sic) et transcendant. (…) De plus en plus de productions ont l’ambition de se penser comme (sic) réponses à un appel du sens. (118)
Dans cette perspective, la retraite, action qui consiste à se retirer de l’action par essence qu’est le travail, est un non-sens, d’autant que « les salariés ont en moyenne de trente ans à cinquante ans pour agir [c’est-à-dire travailler] alors même que la durée de vie s’allonge » et la durée de la retraite « avoisine trente ans », soit « davantage que la partie intense de la vie professionnelle » (121). Les retraités, ces profiteurs qui ne meurent pas assez vite, auraient-ils oublié à quel point le travail est in-dis-pen-sable à l’homme, n’en eût-il pas la nécessité matérielle ? Il leur faut revenir au concret. Mariette se réjouit ainsi en s’apercevant que « l’avenir sera aux soudeurs et aux soudeuses de plus en plus nombreuses ».
À bien y regarder, nul ne peut dénoncer tout ou partie du travail car tout est travail. La soudure, donc. Ou le voyage. Ou la station horizontale dans un lit pour philosopher (n’en point abuser cependant). Dès lors, il conviendrait de cesser d’opposer travail et loisirs en considérant l’idée d’une « vie vraiment active » qui pourrait se construire en dehors de l’emploi, à condition de servir le travail. C’est d’autant plus important que, selon Mariette, pour « les moins de trente ans actuels », « travailler n’est pas le but de leur vie » (127). Au travail tout court, ils préfèrent le travail sur soi. Avec un danger : que « l’attention portée au travail sur soi » soit « exclusivement sur soi », jusqu’à en oublier le collectif (131), c’est-à-dire moins la société que l’entreprise. Peut-être l’IA, avance la sémiologue, en « libérant des tâches » les hommes pour qu’ils « gagnent en liberté d’agenda », ben voyons, les obligera-t-elle à reconstruire du sens. Ainsi, l’oisiveté deviendra « civilisationnelle et néo-humaniste » en remplaçant le farniente par « tout un taf amusant et sublimant » (134).
Je me souviens d’une directrice éditoriale qui, quand une phrase de mon manuscrit la laissait perplexe, écrivait « gâ ? » dans la marge, voire « gâ ??? » dans les cas graves. Je sais comment tu aurais commenté ce passage de Mariette, Malina Stachurska !
À suivre…