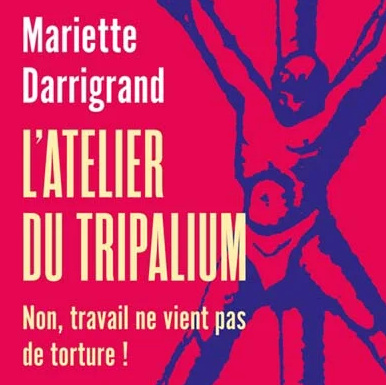« L’Atelier du tripalium », Mariette Darrigrand (Équateurs, 2024) – 4/6
L’éloge du travail de Mariette Darrigrand passe par la remise en cause de ses critiques. Parmi elles, on a crié haro sur les baudets
- politique (la gauche incite à travailler moins sans gagner moins),
- culturel (la paresse a trop infusé dans la tisane mentale des Français) et
- philosophique (le marxisme et ses dérivés poussent une partie des travailleurs à désorganiser, dénigrer et dévaloriser le travail).
Nous voici arrivés au baudet historique qui s’ouvre, avec un trait d’humour selon Mariette, par une citation de Marx, Thierry de son prénom (perso, je préfère Joseph, mais ce n’est pas le sujet). En effet, travail et technique sont consubstantiellement liés ; or, historiquement, la technique « fait l’objet d’une très profonde critique » car elle a contribué aux massacres à grande échelle qui n’ont pas manqué de se déployer au vingtième siècle (79). C’est que la technique se mélange souvent avec la mètis, à la fois
- ingéniosité,
- sagesse et
- ruse.
Pourtant, en soi, la technique est bonne, d’autant que, étymologiquement, elle vient de teknon, « une des façons de désigner l’abri protecteur », ce qui conforte l’idée d’un travail comme dérivation de « trave », la poutre, autrement dit comme colonne vertébrale de l’homme (87). Dans le livre de Mariette, ces hypothèses s’épicent d’une conscience écologique pas toujours simple à suivre, les méandres de l’inspiration faisant souvent onduler le fleuve de la pensée au point de rendre son cours difficilement navigable. Ainsi l’auteur explique-t-il que la technique contribue aussi à couper des matériaux ou de l’ARN mais aussi des sociétés. Or, Mariette constate que, « aux abords de Paris et de toutes les grandes villes occidentales qui réinventent la ville par la végétalisation ou la mobilité électrique (sic) », ce qui serait un progrès, « de plus en plus de cabanes de fortune sont visibles », prolongeant la tradition des migrations – donc des gens qui progressent en cheminant – et des abris que s’invente l’homo viator, l’homme voyageur (90).
Autrement dit, le progrès se vivrait donc à plusieurs échelles, même si la logique technique est peu ou prou toujours la même. Dans tous les cas, la technique « a le grand avantage de poser des cadres aidants (sic) » voire de permettre « d’entrer en douceur dans le monde du travail » à travers l’alternance qui réhabilite, et Mariette s’en réjouit, le mot « maître ». Pour maîtriser son métier donc sa vie, il faut se se soumettre au maître en devenant un sous-maître ; et c’est cette soumission volontaire qui rend fantastique l’esclavage par le travail.
À ce baudet historique ou vaguement épistémologique, succède le baudet théologique. À l’opposé des religions antiques, le monothéisme est intrinsèquement lié à « la croyance en un travail originel » (93) : le monde n’est pas engendré, il est créé. Mariette estime que nous devrions nous en inspirer non pour rendre gloire à Dieu mais pour imiter son art du bara, c’est-à-dire sa capacité à « séparer l’informe pour le recréer sous forme d’objets utiles » (97). Substituer à l’aspiration transcendantale une croyance à la nécessité vitale du travail permettrait sans doute de diviniser les grands patrons à une époque où « les communautés d’internautes essaiment pour critiquer leur environnement dans l’entreprise, demander conseil et s’interroger sur la place de l’emploi dans leur vie », à l’instar du forum « AntiTaff » de Reddit qui s’adresse à
toi qui ne crois pas que le sens de ta vie passera par ton taff, toi qui négocies une rupture conventionnelle, toi qui ne vis pas qu’à travers l’objectif de « faire carrière », toi qui négocies pour cinq heures de télétravail face à l’inflexiilité de ton employeur et toi qui souhaites moins de place de l’emploi dans ta vie, voire l’abolition du travail (in : Le Monde, 16-17 février 2025, p. 17).
Face à ce ras-le-bol des travailleurs, qui n’est pas lié à une « perte de sens » ou à l’inclination à un mélange de procrastination et de fainéantise mais à une exploitation accrue et décomplexée dont ils sont victimes, Mariette milite pour un travail concret et de proximité (exactement ce qu’elle ne pratique pas), où l’artisan serait conscient de « l’expérience-client » grâce aux travaux, haha, de farceurs comme Laetitia Vitaud, bombardés « experts en prospective du travail » ; et, non, je ne proposerai pas une longue liste d’autres titres utiles à la compréhension et à l’amélioration de la société, même si j’imagine, presque malgré moi, des experts
- de la temporalité laborieuse,
- de la gestion du faire collectif,
- de la pratique de la co-création en entreprise (bien distinguer ces deux dernières spécialités),
- de l’optimisation de la positivation managériale,
- du ruissellement de l’esprit de win,
- de l’estimation de soi par les autres, et autres boulechiteries.
De la sorte, la finalité du travail ne serait pas de gagner de quoi survivre mais de se réjouir de « produire du natal, du nouveau, de la vie fraîche, de la genèse » car « tout travail est une façon de recréer le monde », lit-on p. 101 en se demandant comment il est possible d’écrire, d’éditer et de vendre de telles imbécillités. Si la dimension religieuse que décèle l’essayiste dans la fantasmatique du travail doit être laïcisée par une pragmatique du geste et du faire (je simplifie, hein), Mariette ne néglige pas complètement l’aspiration au dépassement de soi mais propose de le loger dans l’impression de participer à un purpose collectif. Oui, « participer à un purpose ». Je nous propose de méditer – mais pas trop – sur ce trope et d’y revenir dans une cinquième notule qui, on le reconnaîtra, s’annonce coquine, peut-être même mutine. D’ici là, au travail, bande de gauchistes paresseux !
Pour retrouver les précédents épisodes, cliquer sur 1, 2 ou 3.