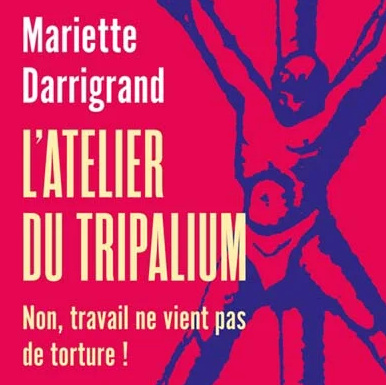« L’Atelier du tripalium », Mariette Darrigrand (Équateurs, 2024) – 3/6
Poursuivie par sa marotte qui semble être de complaire au grand patronat, ainsi que subodoré ici et là, Mariette Darrigrand dénonce d’emblée les implications de la fausse étymologie. Associer travail et tripalium, c’est « mettre le travail sous le signe de la torture » (19), ce qui est typique de « la gauche », première sur « le droit à la paresse » et l’envie de « travailler moins pour gagner plus » (25) quand la droite, par la bouche de Philippe Gosselin, député de la Manche, rêve de « travailler plus sans payer plus ». Autant dire que, sous couvert de sémiologie objective, le livre bascule très vite dans une séparation qui semble répondre à la gêne initiale d’une privilégiée payée à prix d’or pour animer des workshops corporate. L’heure est à la confirmation des confrontations.
- D’un côté, il y a les gentils, ceux qui procurent du travail, ce qui est gentil, mais qui sont encore plus gentils puisqu’on peut leur vendre des conférences d’une copine de Mariette Darrigrand (laquelle invite donc Mariette Darrigrand), une ex-cancérologue qui veut désormais « soigner l’entreprise » et optimiser les « ressources humaines », c’est dire si l’entreprenariat macroniste est un cancer ;
- de l’autre campent les méchants, les flemmards, les revendicatifs – bref, ces salopards « de gauche » qui ont contribué à répandre le lien vicié entre le pale et le taf, utilisant l’étymologie comme « la voie royale des croyances populaires » (29).
En somme, tout se passerait comme si les travailleurs ne se plaignaient pas du travail à cause des conditions dans lesquelles ils l’exercent mais à cause de l’étymologie, qui infuserait dans leur logiciel mental une image faussée de leur servitude épanouissante. Un aveu : on est au bord de la larmichette.
Heureusement, pour l’auteur, mieux vaut considérer que le travail est lié au trabalh, « construction à l’intérieur de laquelle on place le cheval à ferrer ». Ainsi, le travail n’asservit pas le travailleur, tsss, tsss, il se met « au service de l’animal laborans », selon les termes de Hannah Arendt, laquelle doit être une super copine de Mariette – comme nous désignerons l’auteur désormais – puisqu’elle l’appelle « Hannah » (48). Une autre hypothèse relie le travail à la construction de « traves » (en gros : des poutres). Dès lors, travailler, ce serait s’associer à « tout ce qui peut solidifier la vie » (33). Mieux, si on relit Virgile pour dénoncer les gauchistes (chacun ses raisons de « relire » Virgile…), « trave, véritable étymon de travail, est un mot poétique et sacralisant qui fleure bon les bois et les canopées ». D’ailleurs, ne dit-on pas que le bois lui-même travaille (37), hein, ne dit-on pas ?
Le problème est peut-être que Mariette et moi, on n’a pas dû prendre les mêmes limousines pour se rendre au travail. Celles que j’ai coutume d’emprunter pour aller embaucher « fleurent rarement bon », déjà, et fleurent encore moins « les bois et les canopées ». Bah, il y a sans doute plus de pognon à gratter chez les patrons de grosses boîtes que chez les travailleurs, et cela justifie, pour certaine, d’oser des « affirmations positives » qui se situent intellectuellement au carrefour
- des supermarchés,
- de la finesse de pensée d’un Jean-Pierre Raffarin, et
- de l’encéphalogramme artistique de Lorie.
Au reste, la chanson n’est pas loin puisque, emballée par son propre discours, l’auteur s’enflamme et se prend pour une slameuse. Selon elle, yo,
le travail contient tout autant la trave que l’entrave
car « il nous soutient souvent et parfois nous emprisonne ». Superbe chiasme qui aurait cependant gagné à remplacer « parfois » par « presque toujours, donc toujours ». « Arbeit macht frei », on croyait ce genre d’idéologie placée en veilleuse, mais il faut constater que les effarants triomphes macronistes décomplexent certains convaincus.
Pour comprendre pourquoi le travail ne nous emprisonne que parfois, concentrons-nous sur le palimpseste sémiologique qu’esquisse l’essayiste. Mariette rappelle que les mots sont souvent en friction avec d’autres termes proches d’eux par le sens. Ainsi de la concurrence entre travail et labeur (41), finalement écrasée par le premier, même si le verbiage entreprenarial contemporain remet en selle le second, constate l’auteur, à force de fonder et d’animer des labs. De toute façon, « le travail est né avec l’humanité », si bien que « toute souffrance liée à lui est (…) un dévoiement coupable » de notre instinct. Sic.
Le travail étant là « depuis toujours », il nous faut jobber encore et encore sans exiger de gagner davantage mais pour honorer « l’élan vital » de l’homme qui n’est autre que « l’élan travailleur vital » (50-51). C’est cette pulsion vers le travail qui nous donne de l’envergure, le mot « vergue » désignant une « pièce très solide » d’un mât… et semblant connecté au work anglais (54). L’homme qui work est un homme qui fait, un homo faber. Or, pour bien faire, il faut s’organiser, c’est-à-dire poser des actes guidés par l’ergon.
L’ergon est l’art d’organiser le travail comme énergie. En s’organisant pour bien travailler, l’homme applique à son échelle un objectif qui devrait être global : « Aller vers un bon mix énergétique » (65). Parce qu’il mobilise l’énergie renouvelable des travailleurs, le travail les alimente d’une tension saine sans laquelle le courant ne passerait pas dans leurs vies. Voilà pourquoi l’auteur en appelle à une écologie laborieuse qui oppose le travail à la peine, « d’où vient notre pénibilité, si utilisée durant la crise de la réforme des retraites en 2023 » (67).
Faut-il pas en tenir une sacrée couche et vivre dans a bed of roses pour opposer travail et pénibilité, alors que ces réalités sont consubstantielles pour de nombreux travailleurs, à différents degrés ? Faut-il pas être hors sol pour s’étonner que pénibilité et retraite puissent être reliées ? La réponse est dans les questions. Cependant, dopée par le désir de complaire aux exploiteurs qui détiennent la caillasse, Mariette n’en démord pas : pour elle, le travail est le terreau du bonheur. Mieux, c’est ce qui relie l’homme à son essence (sans plomb) et à la terre. À l’en croire, dans une perspective écologique, dont on sait comme elle fait vibrer les patrons français à coups d’excès de normes et de distorsion de la concurrence détruisant des emplois, « les traités actuels de permaculture » rappellent « cette sagesse ancestrale : travailler, c’est souvent savoir attendre » (69).
« Travailler, c’est souvent savoir attendre. » Wow! Sera-ce à force d’écrire n’importe quoi que l’on devient n’importe qui ?
Pour Mariette, point de doute : comme l’ostéopathie vise à redonner de la liberté de mouvement au corps, une bonne organisation au travail permet la fluidité et la mobilité. Des travailleurs « bien organisés » sont « allègrement collaboratifs », donc très loin d’un Paul Lafargue, lié à Karl Marx (« wououououh » crient les grands patrons finançant l’auteur) par son épouse, coupable d’avoir écrit Le Droit à la paresse où « le travail était le grand accusé » (75). Paul Lafargue y dénonce le travail comme élément aliénant. Par cette thèse barbare, il se transforme en « défenseur de la paresse », crime contre
- le patronat,
- les « libéraux », ces aliénateurs et, de façon anticipée,
- la macronie s’il en est.
Là encore, seule une ultra privilégiée recherchant des subsides auprès de ceux qui méprisent les travailleurs dont ils tirent leur richesse peut feindre d’oublier que, oui, structurellement, le travail est une aliénation. On peut même se demander si la sémiologue n’est pas l’exemple même de l’aliénée, pas forcément folle mais obligée de tirer à la ligne afin d’insulter ceux qui souffrent au travail en multipliant
- les louanges de la soumission censée conduire à l’épanouissement,
- les embardées contre ceux qui pensent que « l’amour du travail est une folie », et
- les affirmations inacceptables comme « la paresse est la plus sinistre des maladies du travail » (c’est écrit texto p. 77, et il ne faudrait sans doute pas s’en émouvoir, bordel !).
En réalité, les propos de Mariette, loin d’être une démonstration linguistique stimulante, sont une parfaite illustration de cette aliénation au grand patronat que nous autres clampins vivons mais qui est censée être ici dénoncée. Ha, ha. Dans une prochaine notule,
- nous continuerons donc de nous laisser porter par cet étrange éloge du travail ;
- nous persisterons à enfoncer ces portes ouvertes à une idéologie crissante totalement – et sciemment – déconnectée des réalités
- anthropologiques,
- sociologiques et
- humaines ; bref,
- nous persisterons à serpenter parmi les sornettes énoncées par Mariette.
Taïaut et à suivre !