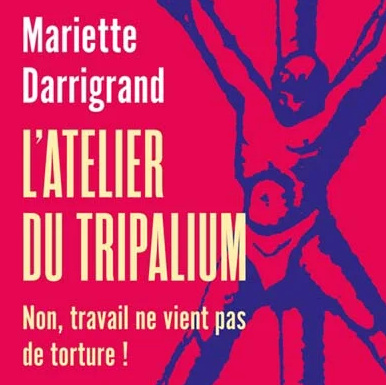« L’Atelier du tripalium », Mariette Darrigrand (Équateurs, 2024) – 1
On la sent un peu gênée aux entournures, Mariette Darrigrand, dans L’Atelier du tripalium. Non, travail ne vient pas de torture ! (Équateurs, « Mots contre maux », 2024, 222 p., 19 €). C’est vrai qu’écrire un livre pour rappeler que, étymologiquement, le travail n’est pas une torture, quand on est « consultante auprès de différentes entreprises et organisations », où l’on anime des workshops pour dédramatiser les mots donc les maux relatifs au travail, ça sent moins l’ouvrage de linguistique que le texte de commande ou, a minima, de circonstance, griffonné pour chanter aux clampins les vertus du boulot en espérant, ainsi, continuer à susciter des sollicitations patronales.
En effet, semblable perspective peut passer pour doublement trouble ou courageuse, selon le point de vue. Que travail ne vienne pas de tripalium (c’est le nœud de l’histoire ici racontée), alléluia ! Mais, d’une part, il reste une marge entre proposer cette rectification – datant de Littré – et tenter de s’en servir pour faire oublier qu’aller au charbon, au turbin ou à la mine contre un salaire souvent merdique et sous la houlette d’un Code du travail non pas détricoté mais pilonné par la macronie (les initiatives de la représentante de Danone n’étaient que la partie émergée de l’iceberg…), c’est bien souvent une gave et quelquefois une fieffée arnaque. D’autre part, que cette chanson soit serinée par le top management et ses sbires pour embringuer les petites mains et réenchanter le rapport à l’entreprise a de quoi faire sursauter. Une récente étude de la Direction général des finances publiques – pas d’Oxfam, hein, de la DGFiP – a montré que « le revenu annuel des 40 700 ménages français les plus riches a plus que doublé » en treize ans ; or, pour eux,
les traitements et salaires [pourtant considérables à l’aune des traitements et salaires des clampins] ne représentent que 35,5 % du total [de leurs revenus]. L’essentiel de leurs ressources provient plutôt des dividendes et des plus-values tirés des capitaux dont ils sont propriétaires (47 %), des bénéfices des entreprises qu’ils détiennent (10,5 %) et de leur patrimoine foncier (3 %). (…) Pour le reste des contribuables (…), les traitements et salaires se taillent la part du lion (63 %) [in : Le Monde, 31 janvier 2025, p. 6].
Ce constat, qui corrobore notre lecture du livre de Gilbert Cette contre le SMIC et les allocs (chronique lisible ici et là), peut inspirer deux conclusions rapides. Primo, si des zozos connaissent la valeur du travail et y sont, par nécessité, attachés, ce sont plutôt les grouillots en bas de l’échelle que les donneurs de leçons pérorant autour de la valeur travail sur BFM Business. Pas la peine de recourir à l’étymologie pour ça – laquelle étymologie a peu de chance de leur redonner le smile car les gars de tout sexe savent bien ce qu’ils vivent au quotidien – on gagne peu, parfois moins que si on n’était qu’aux allocs, ce qui ne prouve pas qu’on est des flemmards, juste que les salaires de merde et, souvent, le temps partiel imposé transforment les travailleurs en « morts qui marchent », comme le chantait Félix Leclerc en évoquant les chômeurs. Secundo, si, à en croire la posture adoptée par Mariette Darrigrand, de nombreux travailleurs jugent, à des degrés divers et sauf dans leurs lettres de motivation ou leurs entretiens annuels, que le travail les emprisonne et les épuise, c’est parce les faits sont là : pour eux, le travail est une nécessité, pas un loisir presque dispensable.
Certes, la dichotomie entre très riches et travailleurs de l’ombre, forcément de l’ombre, est un chouïa caricaturale, même si les études laissent entendre qu’elle contient une forte part de réalité, n’en déplaise aux privilégiés. Ce nonobstant, elle permet de dessiner une posture partagée entre, d’un côté, ceux qui expliquent que le travail est une bénédiction mais n’en ont quasi pas besoin pour vivre, et ceux qu’il s’agirait de convaincre que le travail est une libération, un accomplissement, peut-être même un aboutissement, alors que ledit travail, avec ou sans triple pale, est plus souvent un abrutissement qu’un aboutissement.
Dans cette perspective, la bascule proposée par la sémiologue est suspecte. Retirer une étymologie erronée au travail est une idée défendable ; pour autant, elle n’exonère pas le travail de ce que les donneurs d’ordres font subir aux travailleurs. Si le travail contemporain en France n’a pas toujours la violence sanglante de la torture, il existe de nombreux outils patronaux pour susciter moult souffrances, qu’elles soient ronronnantes voire refoulées ou qu’elles soient patentes, insupportables, proprement invivables tant elles sont aiguës. Dès lors, proposer aux travailleurs, cossus ou bas-de-l’échellistes, des ateliers pour qu’ils se réapproprient la joie d’embaucher sous prétexte d’étymologie peut paraître un peu léger quand on sait combien, concrètement, les conditions de travail se sont dégradées, ne serait-ce qu’au regard du statut desdits travailleurs.
Ainsi, des enquêtes récentes ont montré comment le recours à la microentreprise avait pris le pas sur le salariat et l’intérim dans un nombre hallucinant de secteurs, dont certains inattendus comme le BTP. De manière flagrante, dans les hôtels et restaurants, « le nombre de microentreprises actives a bondi avec, à la clef, un risque de précarité et de moindre protection », obligeant Thierry Marx, patron de l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie à reconnaître que « l’autoentreprise est un outil très libéral qui détricote le code du travail » [in : Le Monde, 30 janvier 2025, p. 16], code déjà abîmé, on l’a dit, par les coups de boutoir macronistes. Or, l’arnaque de la microentreprise n’a pas fini de prendre de l’ampleur !
Utilisée d’abord par commodité, la prestation en freelance est devenue tellement courante que, dans certaines entreprises, le coût des achats que représente leur facturation est supérieur à celui de la masse salariale [in : Le Monde, 30 janvier 2025, p. 19].
En clair, on salarie moins qu’on n’externalise. Les conséquences pour les travailleurs sont connues :
- instabilité (qui, à un certain niveau de revenus, peut avoir son charme mais, le plus souvent, est subie),
- précarité (le manque de visibilité lié aux contrats courts peut accentuer le phénomène en s’accompagnant de dérogations consenties par le travailleur au droit et aux usages afin de conserver un client prompt à jouer au maître-chanteur), et
- perte de droits en termes de protection sociale, notamment au regard des droits à la retraite, ce qui n’est peut-être pas tout à fait innocent (peut-être, hein).
Dès lors, ce qui précède est le contraire d’un hors sujet. En effet, pour rendre compte de L’Atelier du tripalium…, il faut avoir en tête sa raison d’être : les travailleurs n’idéalisent pas leur travail car, souvent, les conditions de celui-ci sont non seulement mauvaises mais en voie incessante de dégradation. Dans ce contexte, marteler que l’étymologie du travail n’est pas tripalium suffira-t-il à combler les chief happiness managers et à remettre des paillettes dans le regard de leurs ouailles – à défaut de subsides sur leur compte en banque – au moment où sonne le réveil, les petits matins
- froids,
- gris et
- pluvieux,
réveil qui indique qu’il faut aller prendre un transport en commun bondé, puant, cher et rare, avec de moins en moins de places assises pour, peut-être, attendrir la viande selon l’expression poétique des agents de la maréchaussée, et, en tout cas, entasser plus de clients dans un même espace au lieu d’augmenter le cadençage ? En d’autres termes, Mariette Darrigrand a-t-elle écrit un parallélépipède feuillu visant à réenchanter le travail pour satisfaire les patrons en général et les commanditaires de causeries positives en particulier, ou un ouvrage interrogeant les représentations dudit travail à travers une analyse sociosémiotique rigoureuse ? C’est ce que nous examinerons dans une prochaine notule dans laquelle, ô miracle ! nous ouvrirons enfin l’ouvrage.