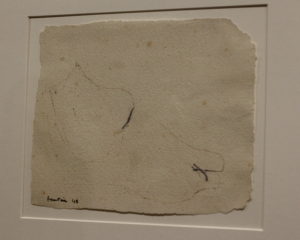Jean Fautrier, Musée d’Art moderne, 19 mai 2018
Certains veulent s’en souvenir : d’autres, comme Jean Fautrier, préféraient se libérer des belles choses. Les trois mots comptent :
- « des », car Fautrier n’a eu de cesse d’interroger la singularité vs la reproductibilité des œuvres (tirages multiples, variations, séries, déclinaison d’une même thématique) ;
- « belles », car le peintre n’a jamais considéré la notion de beau comme acquise, convoquant tant les traditionnelles natures mortes florales que des écorchés animaux, des objets (une bobine industrielle, par ex.), une autopsie humaine ou des situations tragiques via sa série des otages ;
- « choses », car l’artiste, au long de ses mutations esthétiques, a tâché de se déprendre de l’illusion réaliste, produite par le créateur, en privilégiant une manière d’abstrait néanmoins quasi toujours relié au réel, par ex. via le titre, qui oblige le visiteur à investir la forme pour la rapprocher du réel tel que suggéré par l’artiste.
Voici, semble-t-il, le propos qui sourdait de la troisième rétrospective au musée d’Art moderne de Paris organisée en quelque cinquante ans, depuis que Jean Fautrier a légué une grande partie de son fonds à l’institution. (Pour découvrir ce qu’en dit le teaser, c’est ici ; pour lire la présentation presse, filez çà ; et pour disposer de plus de « visuels », cliquez là.) Le parcours de l’exposition qui vient de s’achever était globalement chronologique. Il suivait les évolutions d’un mutant des arts graphiques, associant peinture, gravure et sculpture dans un geste cohérent mais non sédimenté dans un projet artistique figé.
Entre 1922 et 1930, Jean Fautrier pimente un classicisme de genre (nus, portraits, natures mortes, paysages…) avec ses touches personnelles : un certain goût pour la noirceur (tant dans les sujets d’écorchés que dans les teintes dignes d’un Flamand dépressif), une propension à l’érotisme dont Andrée Pierson touche les premiers fruits… et qui ne se démentira pas au long du temps, et un refus de considérer la réalité comme un fait. Les couleurs tressautent : les vieilles dames, conchierches ou non, deviennent vertes ; la couleur fait figure (verdeur des poires) ; la non-couleur aspire la lumière autant qu’elle la suscite (fascination pour le noir). Quoi qu’il soit réputé excellent dessinateur, Jean Fautrier semble, rétrospectivement, se débattre d’emblée avec ce talent. Sous ses pinceaux, la forme se rebelle de plusieurs manières : dystrophie de certaines parties ; juxtaposition au sein d’un même tableau de différents degrés de réalisme (précisions, approximations, évocations, estompes…) ; souci de voir dans le corps ouvert au couteau plutôt que de voir ce corps… et invention de ce qui est masqué à notre vue (intestin fantaisiste renvoyant l’humanité à sa tuyauterie intérieure [voir « L’homme ouvert » dans la galerie en fin de notule], qui est ce qu’il restera de nous quand nous aurons, comme Gabriel, péri).
Entre 1930 et 1940, Jean Fautrier encaisse un coup du sort important : la crise de 1929 démonétise la valeur de son travail. Personne n’achète plus ses toiles. Il devient moniteur de ski et hôtelier. Cela ne l’empêche pas de dessiner, notamment pour illustrer Dante et Bataille. Cette fois, la révolte contre toute forme de réalisme s’est cristallisée. La peinture, elle, bataille encore avec la notion de représentation. Les motifs peuvent être reconnaissables mais à peine suggérés ; les fonds, quoi que posés grossièrement, structurent encore le tableau ; les compositions prolongent des thématiques ou des genres récurrents : natures mortes, paysages et corps de femme sont plus réinvestis par l’artiste qu’ils ne visent à re-présenter des formes re-connaissables.
Entre 1940 et 1955, l’artiste passe un cap tant pictural que technique. Alors que, en sculpture, il décline des bronzes féminins où le détail l’emporte sur l’ensemble (« Jeune fille au grand front », 1940), on nous apprend que, en peinture, il renouvelle son artisanat. Désormais, il commence par apposer de l’enduit blanc à même la toile, fixée à plat sur une table. Ensuite, il jette des pigments sur cette base. Pour autant, il ne renonce pas à un certain degré de réalisme : les titres revendiquent toujours un lien traditionnel à la représentation (paysages, végétaux, nus, natures mortes – refrain connu) ; et les « otages » qu’il peint en rafales sont connotés tant par le titre que par une vague forme qui figure le visage. Il s’agit moins d’une peinture abstraite que d’une peinture qui cherche à s’abstraire et de la peinture et d’un certain réel.
Rien de révolutionnaire, pour l’artiste : la « Tête de femme » de 1928 était, elle aussi, moins esquissée que schématisée et floutée dans un fond hypnotisant. Toutefois, dorénavant, le titre des œuvres est le dernier lien qui rattache les tableaux d’une évocation détachée du réel : ainsi, une composition comme « Forêt (les Marronniers) », peinte en 1943, témoigne, par son souci d’intitulation spécifique, du désir de l’artiste de confronter le réel à l’art. Le tableau, en lui-même, est constitué d’un quadrilatère blanc et bleu, entouré d’un fond vert turquoise ; à l’intérieur du quadrilatère, quelques courbes marron bouillonnantes d’énergie. Sans le titre, aurait-on vu le fond comme un hypothétique sous-bois profus, et les gribouillis zébrant le bleuté comme des marronniers ? Tout se passe comme si, après s’être petit à petit libéré du dessin strict, l’artiste revenait au réel non par le tableau mais par le titre, demandant au visiteur : « Qu’est-ce qui provoque l’illusion du réel ? Qu’est-ce qui fait que, à un moment, on croit reconnaître ? Et en quoi cette reconnaissance est-elle valeur… ou preuve que le réel n’est, précisément, qu’illusion ? »
Entre 1955 et 1963, le peintre, tant pis pour l’éventuelle supputation téléologique, semble synthétiser ses mutations. Il accentue son travail sur les séries. Il semble que, en multipliant des œuvres similaires, ainsi qu’il l’avait fait pour les otages, il donne à voir les multiples possibles d’un tableau, d’ordinaire figé dans une représentation unique. Simultanément, il associe à ses thèmes fondamentaux (nus et paysages) une épure de plus en plus radicale. Sa peinture a dissous le sacro-saint réalisme d’antan dans (non, pas « d’entendant », fripons) l’acide d’une longue pratique picturale jamais satisfaite. Plus radical, l’artiste oppose l’urgence du geste et la profondeur de sa maturation, la précision du titre et l’ambiguïté du tableau (ainsi des objets comme « L’encrier », 1948, à tête d’appareil photo), le potentiel d’évocation d’un titre et l’imprécision libre du trait. De la sorte, Jean Fautrier paraît poser, enfin, au centre de son travail l’acte de peindre : non plus représenter ou non le réel, mais interroger le rapport que le peintre, son art et celui qui voit le tableau entretiennent avec lui.
- « Nature morte » (1925). Photo : Rozenn Douerin.
- « L’homme ouvert (L’autopsie) » (1928). Photo : Rozenn Douerin.
- « Les arbres » (1928). Photo : Rozenn Douerin.
- « Tête d’otage n°20 » (1944). Photo : Rozenn Douerin.
- « Nu » (1943). Photo : Rozenn Douerin.
- « Wa Da Da » (1956). Photo : Rozenn Douerin.
Avant de conclure, notons d’abord que le musée d’Art moderne est un bel endroit pour folâtrer. Grand et lumineux, il accueille un fonds et des expositions souvent passionnants. Il autorise aussi les visiteurs de photographier les pièces exposées, ce qui permet de mieux reconstituer le parcours a posteriori, donc de mieux apprécier ce qui fut vu. Les visiteurs s’en réjouissent et, en retour, respectent les œuvres en n’utilisant pas de flashs – d’autant que, devant des murs blancs, ce serait inutile. Bien sûr, ce genre de notation paraît encore plus triviale que pragmatique, mais il n’en est rien : de belles conditions d’accueil sont indispensables pour goûter au mieux une visite muséale ; quand elles sont réunies, il convient, for that matters, de les saluer.
En conclusion, il paraît difficile de s’enthousiasmer ou, pas si simplement que cela, d’être ému par l’ensemble des tableaux, surtout lorsque l’on prétend, en quelques heures, cerner quarante ans d’un travail protéiforme. Ce nonobstant, on ne peut que s’intéresser à la capacité de l’artiste à moduler son travail ainsi qu’à explorer d’autres façons d’appréhender tant le rapport au réel que l’acte même de peindre. Si certaines pièces sont susceptibles, disons, de désarçonner des incultes de la trempe de moi-même-je, partant, de susciter un scepticisme ironique comme l’art contemporain sait en susciter, leur exposition valide aussi le choix d’une « grande rétrospective » : c’est sans doute dans la globalité de l’œuvre que la singularité de la démarche de Jean Fautrier apparaît – et mérite, assurément, à tout le moins un beau fragment d’après-midi à baguenauder entre ses glaciers curieux, ses paysages, ses corps nus, ses tableaux jazz et son plaisir à pigmenter, par-delà la mort, la vie.