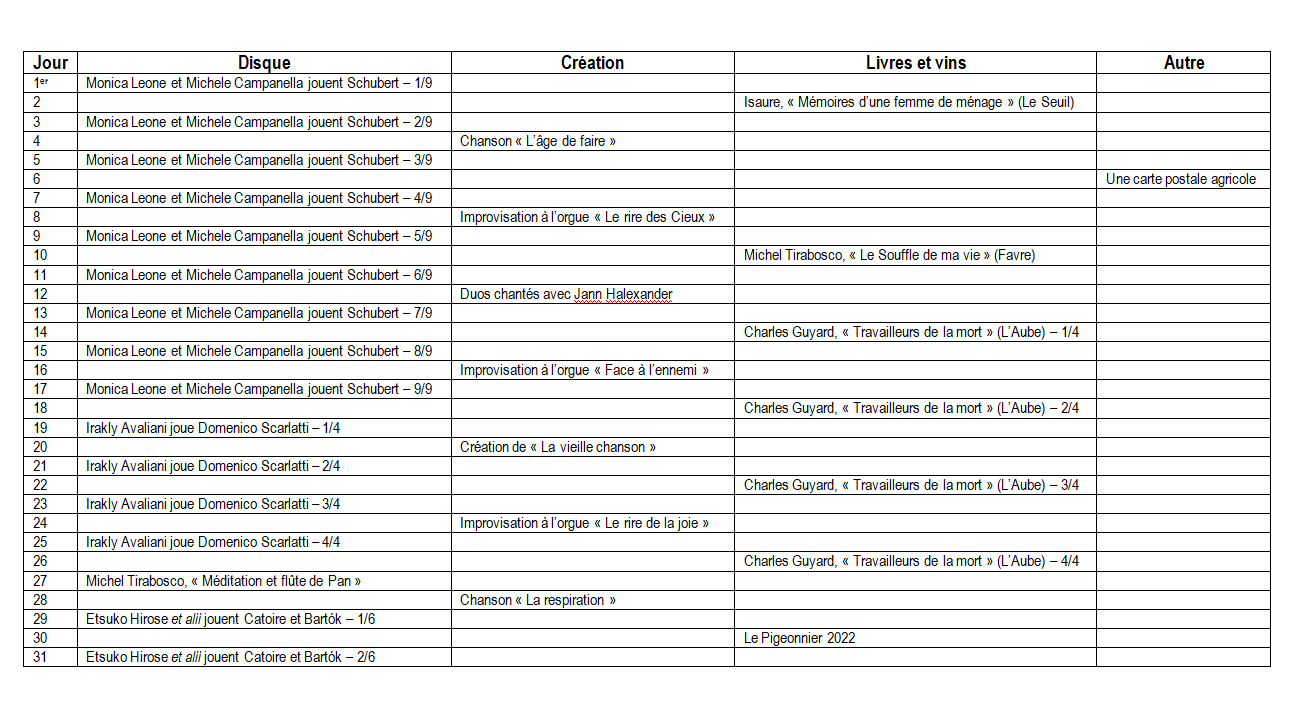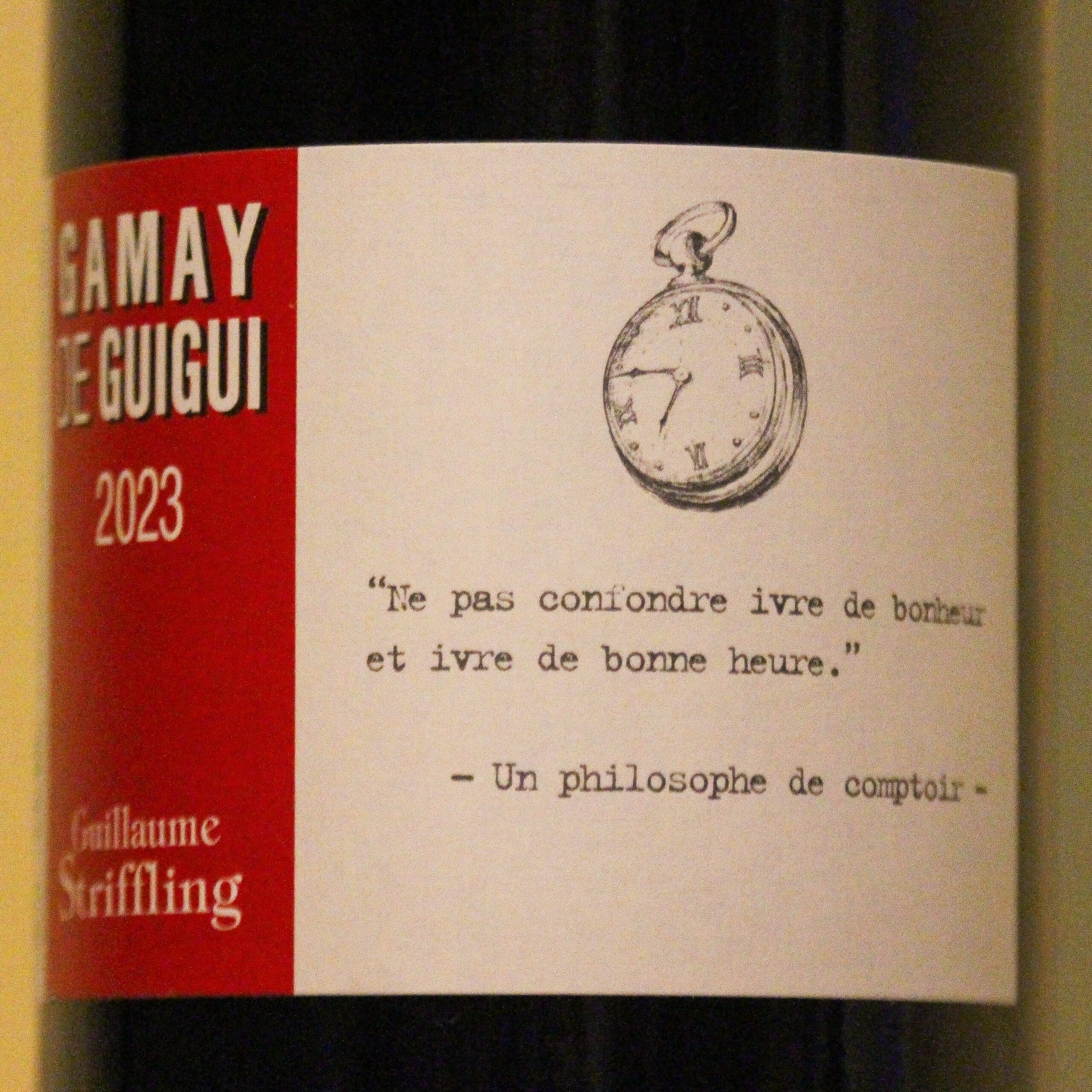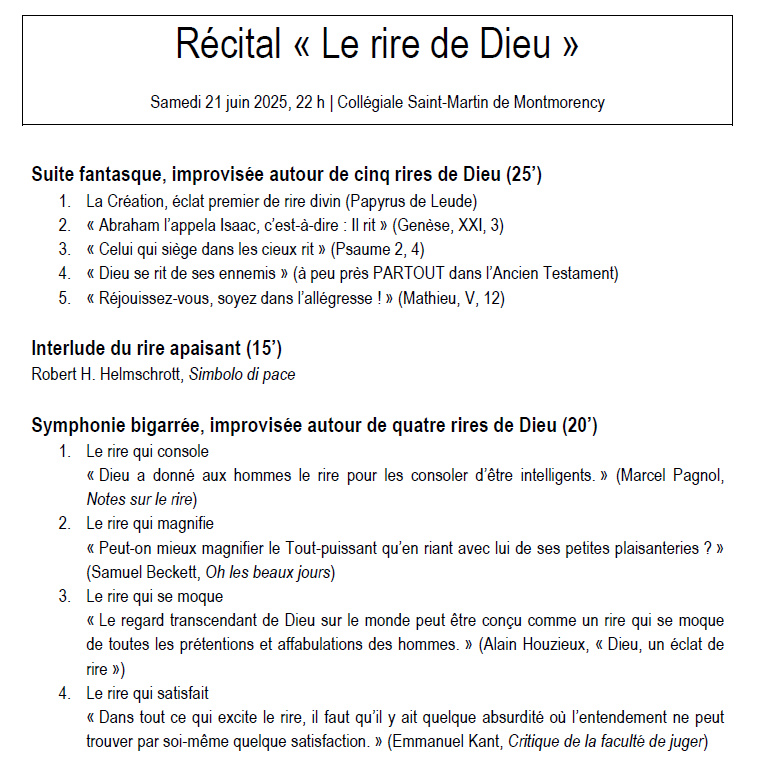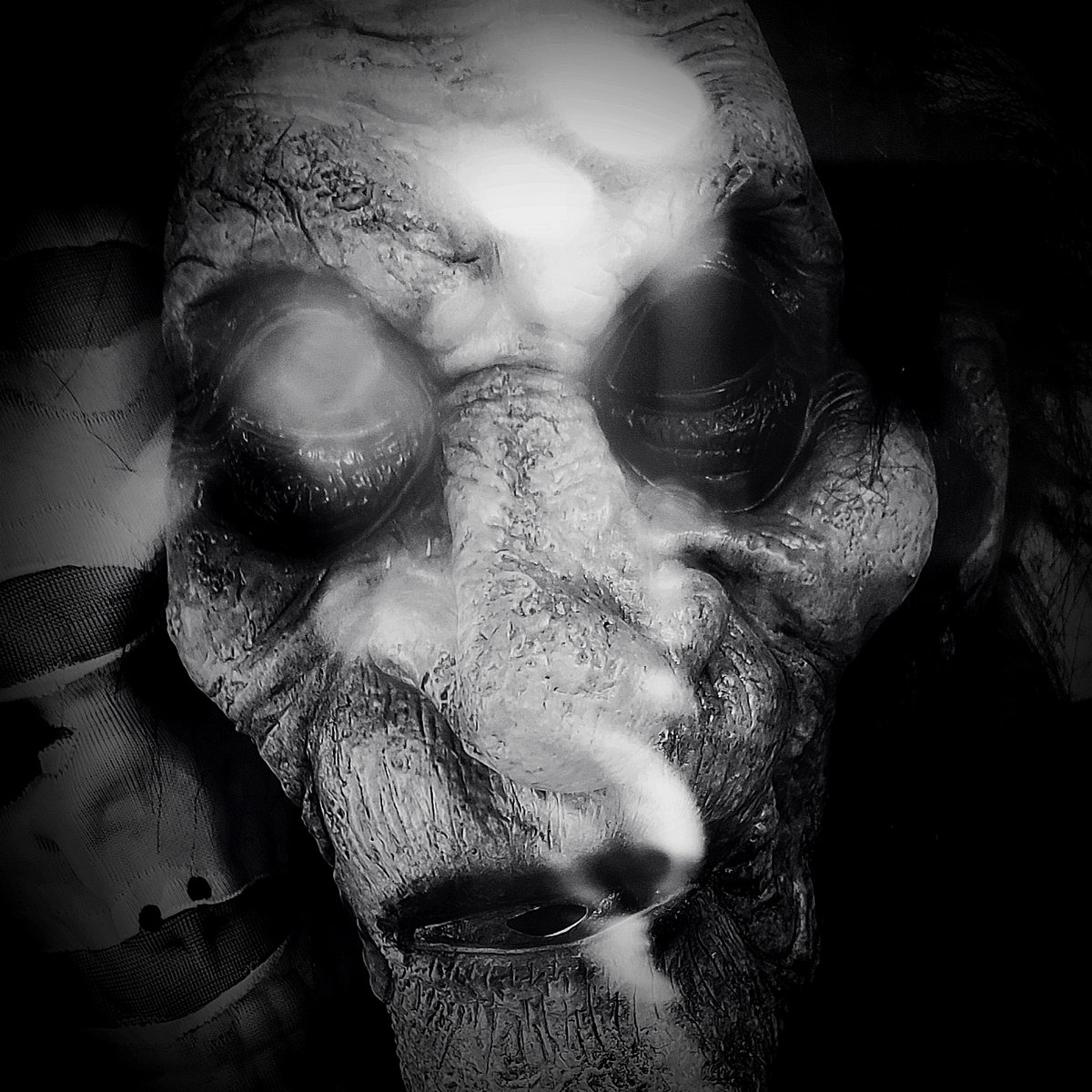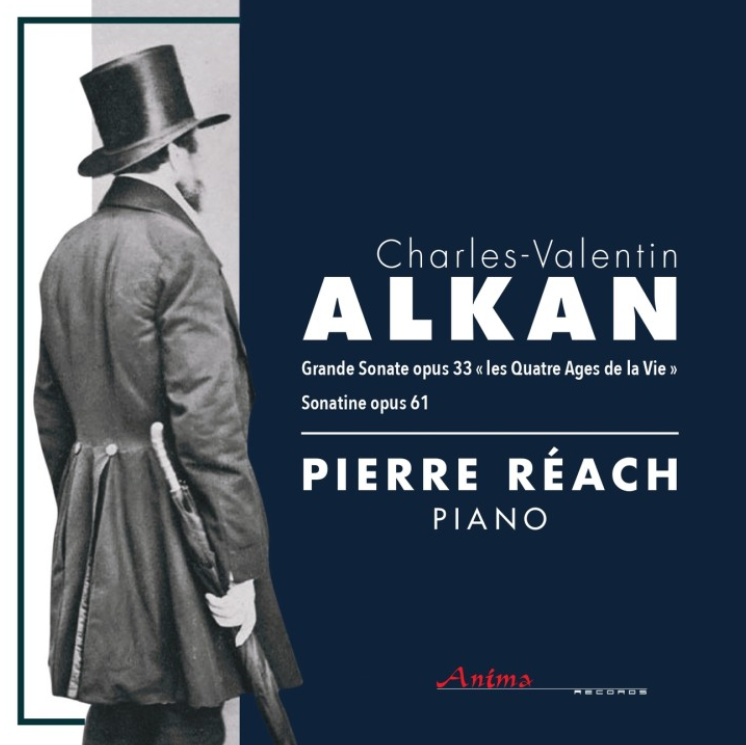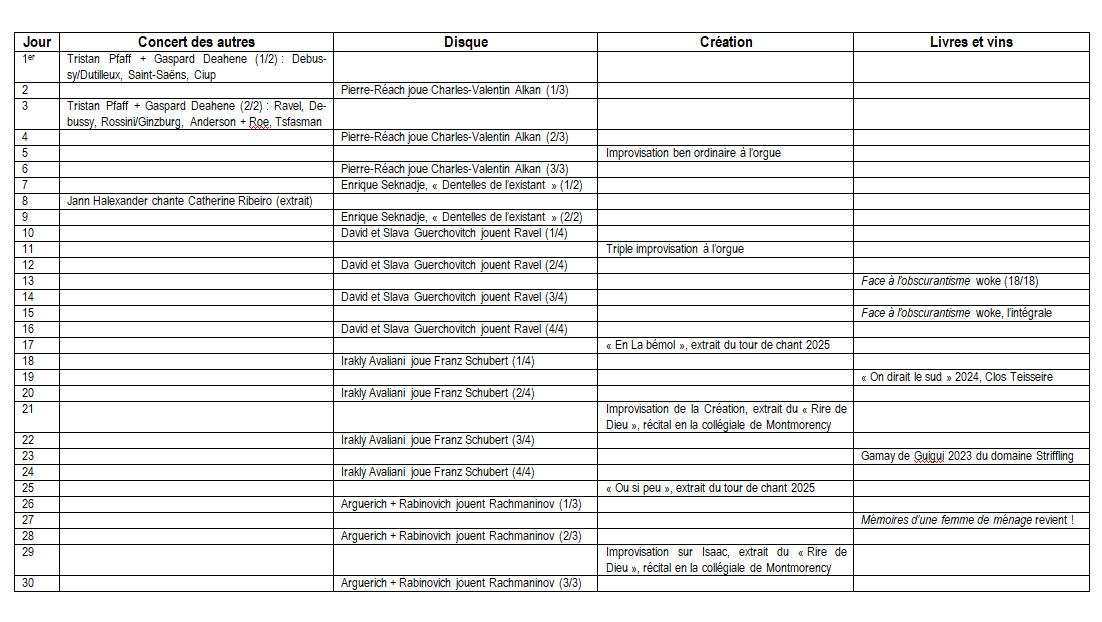Ambitieuse, la huitième symphonie d’Enjott Schneider, intitulée « La cloche – Pont vers l’infini », l’est par sa durée (45′) et son instrumentarium (orchestre, chœur, soliste). Inspirée par un livre évoquant l’histoire de la cloche, elle est ponctuée par quatre poèmes bêtement non traduits ne serait-ce qu’en anglais, alors qu’il y avait typographiquement largement la place. Quelle faute du label ! Quand le compositeur est capable de produire un disque aussi ample, ne pas lui suggérer de traduire les textes de sa symphonie paraît aussi intelligent que de parler de démocratie en évoquant la nomination de Michel Barnier à Matignon ou de musique en parlant d’Aya Nakamura. Devant ce faux pas éditorial, nous renonçons à traduire ligne à ligne grâce à quelque moteur de recherche ce que nous entendrons ; aussi négligerons-nous le sens des mots pour nous concentrer sur l’agencement des notes. Ce sera le même tarif pour les mouvements dont les titres sont réservés aux germanophones, ce qui adresse pas mal de mélomanes, certes, mais exclut davantage encore de curieux.
Pour le dire tout rond : franchement, c’est concon.
« Urklang us dem Reich des Morgens » est le premier et le plus long des six mouvements (plus de 10’40). Commençant dans les limbes de percussions sifflantes, sur une pédale de cordes qu’ornementent les bois, il associe
- accents,
- souffles et
- irisations
aux sonorités sinisantes qu’un chœur cristallise dans des glissendi fortissimi s’inspirant d’un poème de Zhang Ji pour lequel la soprano Julia Sophie Wagner ne va point tarder à les rejoindre.
- Suspensions,
- pointillés de la harpe,
- tenues vocales et instrumentales,
- exotisme des intervalles et des tuilages entre les notes
distillent une vision de la musique chinoise à l’occidentale à la fois
- efficace,
- évocatrice et, il faut bien l’admettre,
- convenue donc proche d’un exercice de style qui peine à nous saisir.
La jolie énigmaticité de la fin du mouvement, plus personnelle, ne nous permet pas de revenir entièrement sur nos préventions, alors même que le projet du compositeur est clair : explorer l’imaginaire de la cloche à travers plusieurs aires culturelles (en avoir conscience n’empêche pas le froncement de sourcils, hélas). « Duft der Glöcken-Karawanen, Tanz und Rosen » nous embarquera-t-elle davantage dans la geste schneiderienne ? Elle s’inscrit cette fois dans une esthétique arabisante. En dépit de l’aspect disneyique de la chose, l’on doit saluer
- la richesse,
- l’habileté et
- la réussite
de l’orchestration. Gabriel Venzago veille à rendre claire une métrique à la fois stable et rebelle. Techniquement, on ne peut qu’applaudir la veine très américaine qui surgit soudain :
- percussions nettes,
- profondeur des graves,
- explosion itérative des cuivres
rappellent le savoir-faire cinématographique d’Enjott Schneider, et cette remarque n’est évidemment pas une dépréciation snob. En termes musicologiques d’expert, on aurait même ajouté : « C’est vachement hyperbien fait », mais il ne s’agit pas de perdre notre lectorat avec un idiolecte aussi pointu qu’un turlututu. Attentive, la Bodensee Philharmonie
- contraste,
- nuance et
- suspend
pour préparer l’entrée de la soprano chantant le poème de Dschalaluddin Rumi dans sa version allemande de Friedrich Rückert. Le projet se transforme soudain en lied straussien, dévoilant un autre versant de l’artisanat brillant du compositeur, capable de se couler dans moult moules… même si la doublure de la soprano par les cors rabat le résultat davantage vers d’habiles topoï cinématographiques que vers une écriture personnelle.
Le troisième mouvement, « Klang der Götter – Schrecken der Dämonen » est le plus bref.
- Percussions toniques,
- cordes graves,
- cuivres inquiétants et
- contretemps déséquilibrants
lancent une cavalcade menaçante que le ternaire rend sporadiquement encore plus énergique.
- Dominante assumée,
- changements de couleurs,
- tintements de cloches tubulaires,
- ruptures dramatisantes
esquissent un intermède qui n’a pas besoin d’images vidéo pour stimuler l’imaginaire des auditeurs.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=SXQFh7a03r4[/embedyt]
Le quatrième mouvement s’intitule « The Bells – Eine Hommage an William Byrd (1540-1623) » et est constitué d’une sage orchestration de l’original pour clavecin. On y retrouve le métier du compositeur à défaut de se goberger d’une créativité que l’on redoute
- gainée,
- calcifiée voire
- étrangement calcinée
par
- la maîtrise théorique et pratique de l’orchestration,
- la connaissance des astuces catchy et
- le souci de profiter au mieux des différents pupitres d’un orchestre attentif.
Une fois de plus, ce patchwork de sonorités propres à chaque mouvement est la particularité de cette symphonie. Partant, d’autres auditeurs s’ébaubiront devant les métamorphoses orchestrales que réussit Enjott Schneider. Ils auront amplement raison et, cependant, devant une telle maestria, nous ne pouvons nous empêcher de regretter que la virtuosité technique nous paraisse l’emporter sur la singularité de l’écriture. À nos esgourdes, tout se passe comme si, parce qu’il sait si bien écrire, le compositeur oubliait d’écrire sa musique… et cela nous frustre car, à coup sûr, il saurait parfaitement l’écrire, ainsi que l’ont montré maints passages des deux concerti proposés en brillante ouverture de programme.
Le cinquième mouvement, « Sehnsucht – Gedicht von Otto Julius Bierbaum (1856-1910) ». L’introduction dramatique des cordes graves teinte de gravité le désir vu par ledit Otto Julius, un écrivain qui, avant Enjott Schneider, a aussi été musiqué par Strauss, excusez du peu. On sent la belle vision opératique du compositeur qui introduit la voix par des deux en deux inspirants. Le chœur
- fait écho,
- dialogue, et
- habille par son silence le propos de la soliste.
Si la puissance grave de l’orchestre, rythmée par les cloches, frise parfois l’excès de stabylotage, il faut s’incliner devant
- l’expressivité de l’orchestrateur,
- la richesse de l’utilisation du chœur dans ses différents registres,
- la justesse de Julia Sophie Wagner,
- l’efficacité de la direction donc de l’orchestre (dont la harpe et la clarinette basse, très importantes !),
- et la cohérence de l’atmosphère ainsi créée.
Le dernier mouvement, « « Finale : dona nobis pacem », inclut un poème de Friedrich Schiller.
- Coup de timbale,
- glissendo de cuivre,
- grands accents des cordes portés par les cloches et
- insertion d’un rythme trépidant
augurent d’un moment palpitant. Enjott Schneider excelle dans l’installation d’une atmosphère qu’il modifie ensuite avec un talent qui force l’admiration, façon dessin animé d’antan légèrement pimpé d’incongruités catchy
- (harmonie surprenante,
- grincement inattendu,
- entrée du chœur pour le « Dona nobis pacem » d’où émerge Julia Sophie Wagner en duo avec les cloches).
Dans cette symphonie composite, les mutations d’atmosphère ne manquent jamais de cachet. Certes, le combo fortissimi de l’orchestre puis rétractation pour l’arrivée du chant finit par ne plus surprendre ; reste que séduisent notamment
- la maîtrise des transitions,
- la qualité de chaque caractérisation,
- l’art du dialogue entre orchestre et soprano qui porte le poème de Friedrich Schiller, ainsi que
- l’investissement de la cantatrice (piani sur les notes suraiguës de « schwebt »).
Le finale du finale confirme le choix d’une forme en arche (retour du « Dona nobis pacem »), qui se termine par un piano du chœur avec clarinette et l’inévitable crescendo montant au tutti jusqu’aux deux coups de timbale conclusifs. De sorte que, s’il est parfois difficile de distinguer la voix personnelle d’Enjott Schneider derrière les conventions d’une écriture spectaculaire très balisée, l’écoute de cette partition monumentale est néanmoins enflammée par
- l’artisanat du compositeur,
- l’art du musicien et
- l’ambition de la réalisation.
Dans un monde artistique qui joue souvent petits bras, voilà un pavé dans la mare du fatalisme gnangnan, pavé sous lequel apparaît une plage
- de volonté,
- de désir et
- d’envie
de partager les joies de la musique bien troussée où l’auditeur ne peut qu’avoir plaisir à se prélasser !