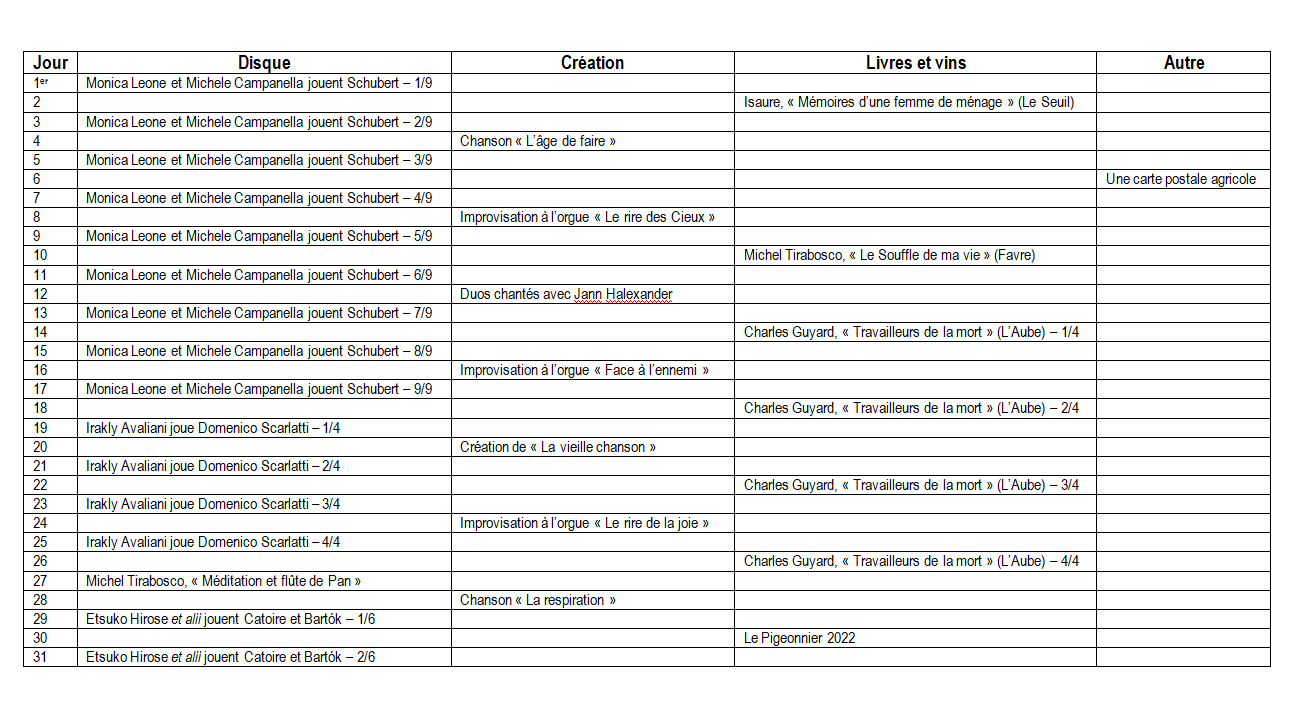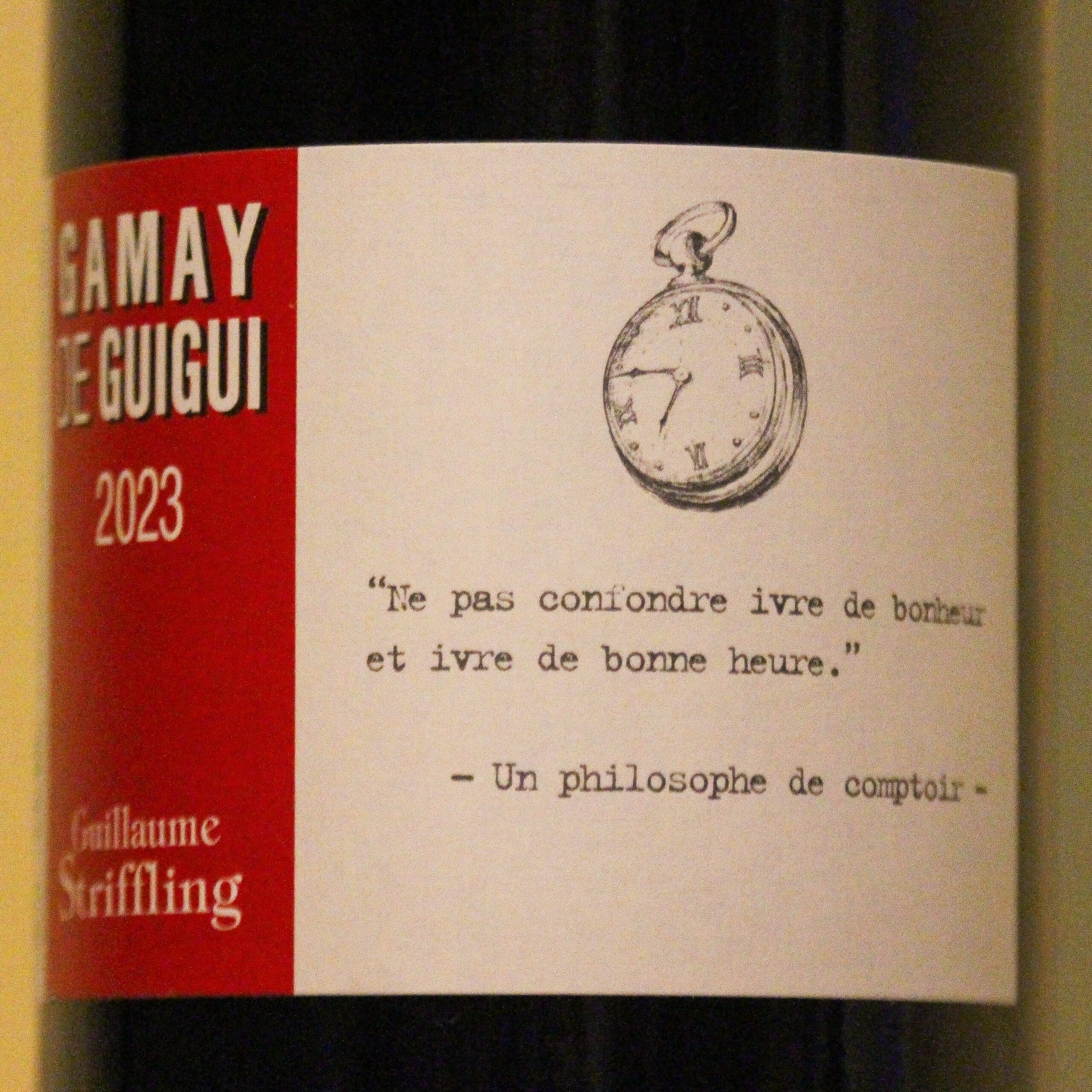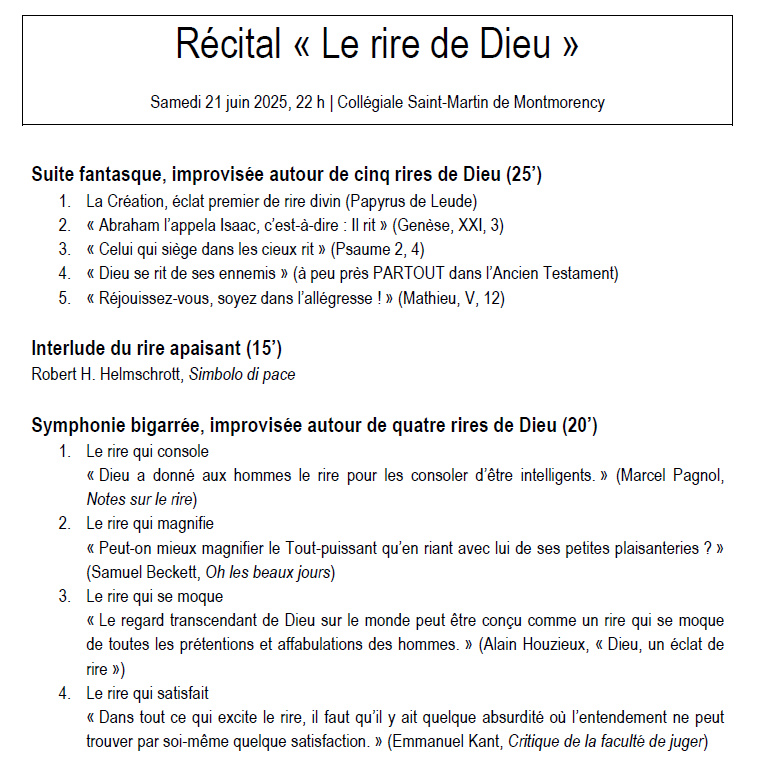Peut-être reportée au 21 février 2025, selon certains sites, fixée à l’automne 2024 selon la cyberfaçade du compositeur (en allemand uniquement), le nouveau disque d’Enjott Schneider, produit par le compositeur, n’en intrigue pas moins par son ambition : trois œuvres orchestrales (deux concerti et une symphonie de quelque trois-quarts d’heure), dont l’une intègre un chœur, se répartissant 81′ de musique, cela témoigne d’une ambition certaine – même si l’on regrette, que, une fois de plus, seuls les acheteurs anglophones et germanophones puissent profiter du livret – pour celui qui affiche à son compteur
- dix opéras,
- moult musiques pour le cinéma,
- une prédilection pour l’oratorio,
- seize symphonies avec orgue (!) et
- un goût pour l’éclectisme stylistique associant époques et espaces.
La première œuvre à tourner sur notre platine, captée par Karsten Zimmermann et Johannes Philipp Müller, est un concerto pour violon. Le soliste est ici accompagné par un orchestre de chambre philharmonique incluant quatre percussionnistes (on en découvrira infra une version très différente, tant sur le contenu musical que sur l’instrumentarium, mais qui présente des similarités évidentes dans la construction et l’imaginaire avec le concerto pour violon), commandé pour le cinquantième anniversaire de la mort de Pablo Casals et donc partiellement inspiré par son encore favori, « El cant des ocells » (le chant des oiseaux).
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WQaqKdZuk9o[/embedyt]
Son titre associe
- les oiseaux,
- la sagesse et
- la magie,
et sa construction articule cinq mouvements. Le premier, « Naissance de l’univers depuis une spirale et un œuf d’oiseau », plonge dans
- les abysses d’un big bang alchimique,
- la fragmentation du discours,
- l’évocation ornithologique d’un oiseau affolé ainsi que
- le travail sur les limites donc les grandeurs de la ligne mélodique défiée notamment par
- la percussion des archets,
- la mutation de registres,
- la friction des différents pupitres,
- l’aspiration sporadique vers le silence,
- l’écrasement harmonique offert par l’unisson et
- la confrontation des modes où les écarts arabisants ont toute leur place.
Partition de l’évocation sciemment énigmatique, ce que laissait subodorer le titre mystérieux du mouvement, ce concerto pour violon s’engage sur un langage onirique plus riche que complexe. On y goûte par exemple
- l’écho entre les différentes familles d’instruments (cordes versus bois),
- le recours à différentes percussions instrumentales
- (bruitisme des archets tressautants ou des flûtes réduites au souffle et au cliquetis des clefs,
- claquements des cordes graves,
- synchronisation très accentuée des accords rassembleurs),
- le recours abondant au mix’n’match
- d’échos,
- de styles,
- d’intensités, donc
- le dialogue entre fragmentation du discours et fusions éphémères.
Le second mouvement s’intitule « Corbeau et corneille – La noirceur nigredo » (le nigredo étant le premier moment dans la création de la pierre philosophale, celui de la calcination). Une séquence rythmique coordonne
- pulsations,
- contretemps et
- cycles moins dansants que vigoureux du violon soliste.
Le développement de cette cellule, loin d’être uniforme, secoue l’auditeur qui, par-delà les séquences où grognent, imperturbables, les cordes les plus graves, se retrouve projeté dans un espace sonore contradictoire, marqué par l’oscillation entre
- la pulsion vers la trépidance,
- l’attraction pour la méditation profonde et
- l’attrait pour
- le surgissement,
- le jaillissement et
- l’explosivité rebondissante.
Enjott Schneider se fait un plaisir d’alterner
- les couleurs et les techniques,
- les ingrédients orchestraux et les codes musicaux,
- les passages évidents – presque apprentisorciéiques – et une construction qui retient l’attention par ses aspects
- labyrinthiques,
- lacunaires et
- morcelés.
La référence alchimique embrase aussi le troisième mouvement, intitulé « Le cygne – Le blanc albédo », l’albédo (que symbolise le cygne) étant la phase postérieure au nigredo, acoquinant la distillation chimique et la libération de l’âme. Il s’ouvre par une envolée lyrique du violon qui, sur un tapis de cordes tressé pour l’occasion, se perd dans des pépiements suraigus. Le retour de l’âme autour du corps souligne que la libération n’est pas encore parfaite.
- Tantôt, cette redescente est marquée par le rythme brièvement impulsé par les woodblocks ;
- tantôt, elle s’enivre d’une intervention flûtée imitant un chant d’un oiseau plus pépiant que le cygne ;
- tantôt, elle s’abreuve aux multiples facettes de la harpe, entre glissendi rêveurs et intervalles légers ponctuant le discours.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=GOkztfL-e4g[/embedyt]
Enjott Schneider tâche de profiter au mieux de l’ensemble à sa disposition, y compris des percussions qu’il a convoquées pour ce premier enregistrement laissant tinter çà une cymbale légèrement frappée, là babiller un xylophone dont le son boisé peut évoquer la découverte de nouveaux possibles par l’âme du violon. Après la tonicité du deuxième mouvement, le troisième, qui confirme la technique savante d’orchestration maîtrisée par le compositeur, se goberge d’une manière d’apaisement interrogatif aspirant
- à la paix intérieure,
- à la joie blanche et
- à la liberté sereine,
même si ces impulsions, convoquant explicitement le « chant des oiseaux » cher à Pablo Casals, restent
- fragiles,
- souvent perturbées, partant,
- presque illusoires, comme en témoigne la fin du mouvement.
Le quatrième mouvement, « Le paon – l’étourdissant monde astral », est de loin le plus concentré. Si le violon solo semble mener la danse par des interventions tranchantes et tendues, l’orchestre, placé sous ladirection de Gabriel Venzago, lui tient la dragée haute. Il
- accompagne,
- commente et
- interrompt volontiers
les embardées de Friedemann Eichhorn. Enjott Schneider fait rutiler la polychromie du petit orchestre en s’attachant à précipiter, comme dans un alambic inquiétant,
- mystère et continuité,
- allant et suspensions,
- refus du développement et souci d’une narrativité joyeusement énigmatique.
Le cinquième mouvement, « La danse de la grue – rituel et voyage astral », est le plus long. Il se déploie sur un rythme presque tribal par les percussions que rejoignent le soliste puis l’orchestre dans une forme d’ostinato. Se multiplient
- contrastes efficaces,
- jeux rythmiques et
- itérations roboratives
jusqu’à ce que le violon change le cours du récit pour le diriger vers une méditation au calme inquiet. Tout se passe comme si le compositeur proposait une synthèse fulgurante de son concerto à travers
- le retour d’intervalles arabisants,
- la volonté d’entremêler différents langages et
- la place laissée à une traditionnelle coda virtuose (poursuivant l’interrogation structurelle sur les rapports entre soliste et orchestre qui semble être un sous-jacent fort de l’œuvre),
avant de glisser un finale qui refuse de finir
- en profitant d’un tutti orchestral,
- en s’abîmant dans une trop attendue forme en arc type ABA, ou
- en se complaisant dans une explosion pyrotechnique que l’on imaginerait en contradiction avec le programme du voyage astral.
Il préfère s’évaporer sur une tenue suraiguë du soliste, témoignant de
- de la cohérence,
- de la maîtrise et
- de la vue d’ensemble
dont vibre cette proposition. Le prochain opus au programme, le concerto pour alto et cordes, nous propulsera-t-il sur les ailes du rêve et de l’émotion – un oiseau que l’on aime plutôt pas mal, lorsque l’on écoute quelque disque ? La réponse est à découvrir dans une prochaine notule sur le sujet !
À suivre…







































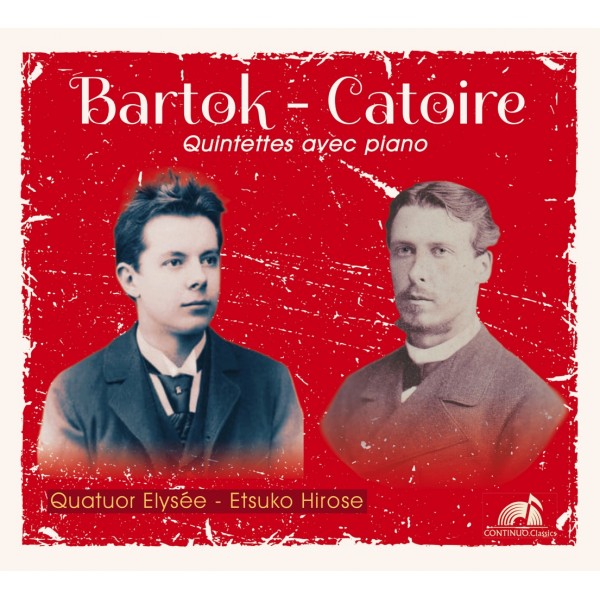

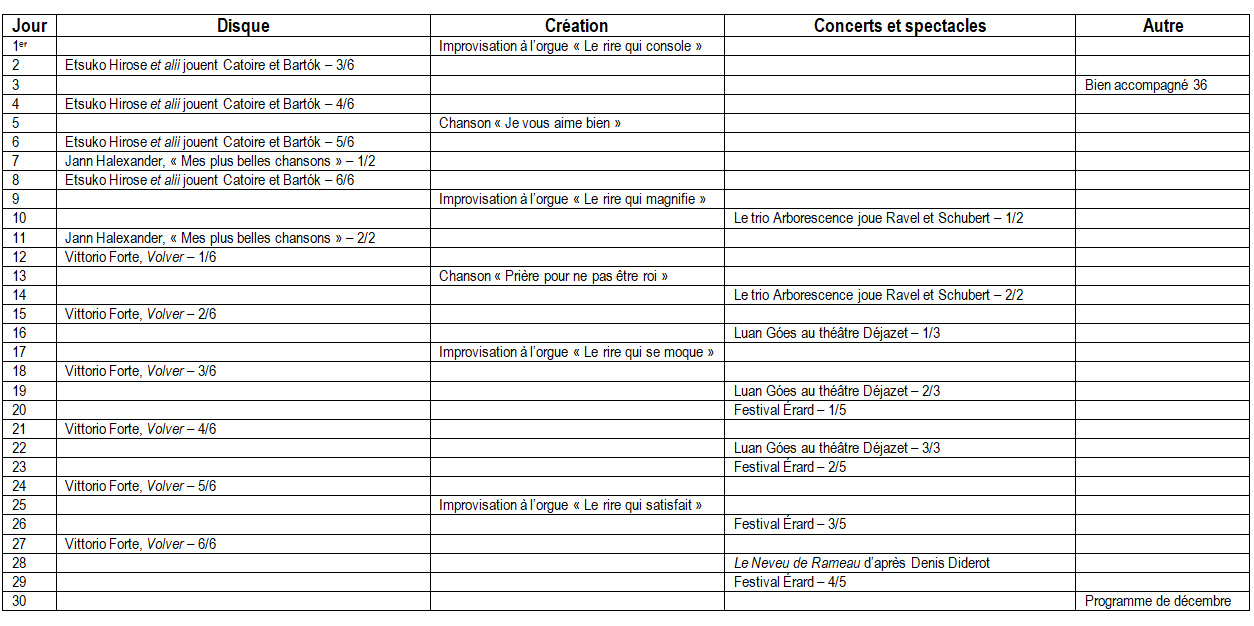

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)