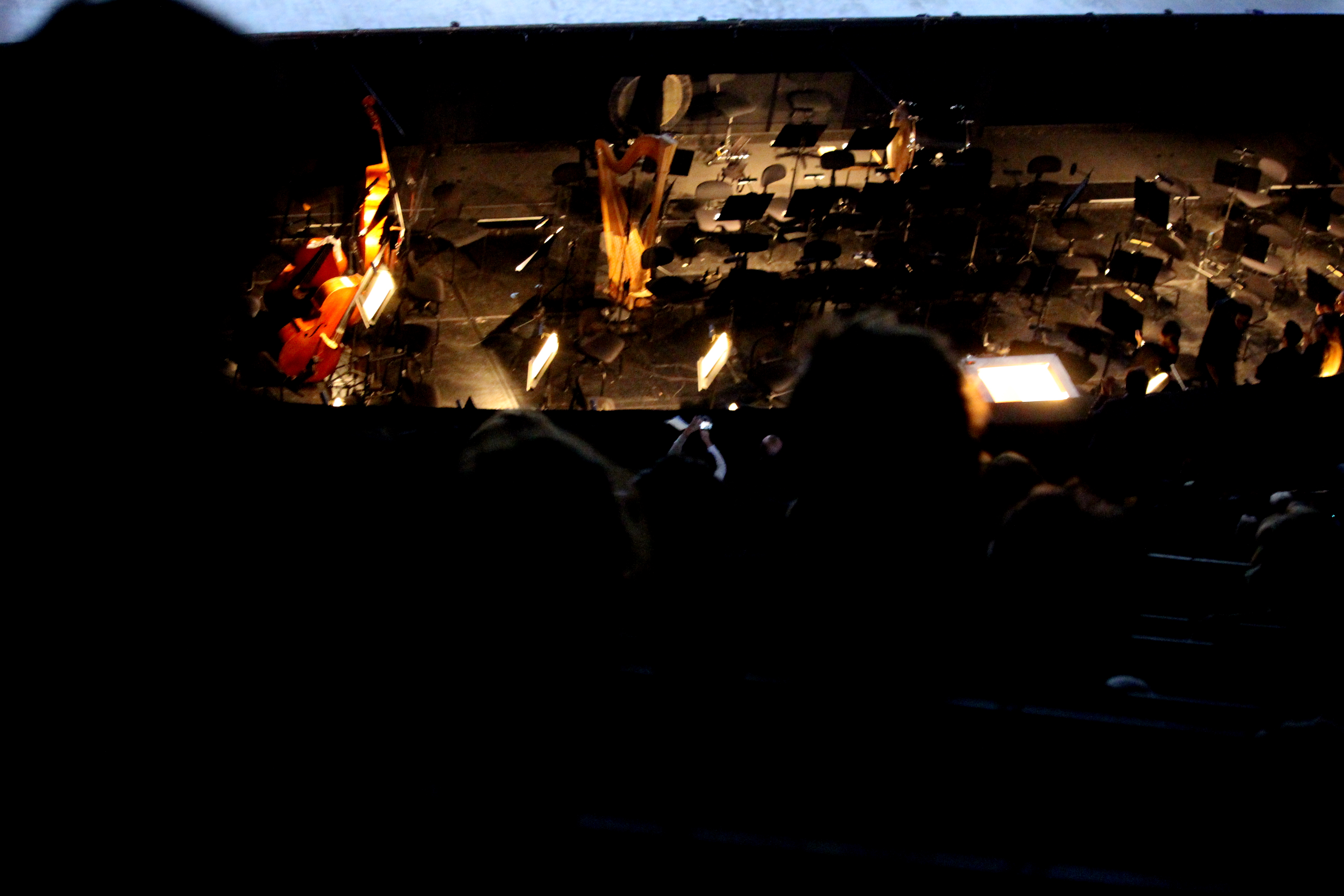Don Carlos, Opéra Bastille, 31 octobre 2017
L’histoire : l’infant Carlos (Pavel Černoch) rencontre Élisabeth (Hibla Gerzmava) dans la forêt. Les deux ont un big coup de cœur. Tant mieux car ils doivent tantôt se marier. Pas de bol, le roi Philippe II (Ildar Abdrazakov) préempte Zabeth au nez et à la barbichette de son fiston. Donc l’ex-future femme de Carlos devient sa marâtre (acte I). Rodrigue, marquis de Posa (Ludovic Tézier), BFF de Carlos et homme de confiance de Philippe, plaide la cause des Flamands. Philippe est plutôt inquiet de voir son fils fricoter avec sa nouvelle épouse, d’autant que le Grand Inquisiteur (Dmitry Belosselskiy) veille au grain (II). Un entracte salue cette tension après 1 h 40 de son. Lors du mariage qui marque la reprise du show, la princesse Eboli (Ekaterina Gubanova), comme n’importe qui allant à un mariage, espère lever quelqu’un, en l’espèce Carlos. Repoussée par le désintéressé, elle le menace de révéler son kif pour la reine. En attendant, alors que l’on s’apprête à continuer la fête en cramant des hérétiques, les députés flamands demandent au roi un coup de main. Il les fait arrêter. Carlos pique une gueulante ; il est itou embastillé, et c’est la fin du III. Entracte après 40’ de musique.
- Décor de « Don Carlos » : le début
- Un autre décor de « Don Carlos »
- Décor de « Don Carlos » : la fin, avec le futur lit de mort de Rodrigue, dont Ludovic Tézier s’extraira en catimini
Pour les 90 dernières minutes, ça commence mal. Philippe est triste au début du IV. Le Grand Inquisiteur lui demande de tuer et son fils et Rodrigue. Pour ne rien arranger, les manigances d’Eboli entraînent son départ pour le couvent et des remontrances contre Élisabeth. Dans la prison, Rodrigue annonce à Carlos qu’il est mal car on a découvert des pièces compromettantes chez lui… mais c’est pas si grave puisqu’il se prend un coup d’arquebuse et meurt. Le roi décide de libérer son fils, qui lui manifeste son ire. Carlos est pourtant toujours accusé de trahison des Flamands. Après avoir dit adieu à sa marâtre adorée au début du V, afin de rejoindre la Flandre, il est sur le point d’être déféré, voire pire, pour trahison quand un moine mystérieux, récurrent dans l’opéra, entraîne Carlos. Personne n’ose rien dire car l’homme de Dieu ressemble à feu Charles Quint. Et voilà.

De gauche à droite : Silga Tiruma (la Voix d’en haut, deuxième rang à jardin), Ludovic Tézier (Rodrigue), Ekaterina Gubanova (la princesse Eboli), Pavel Černoch (don Carlos), Philippe Jordan (directeur musical) et José Luis Basso (chef des chœurs)
Le scandale : oui, Ludovic Tézier, Ève-Maud Hubeaux, François Piolino (pour une pige), Philippe Madrange et Florent Mbia ; mais, surtout, Ildar Abdrazakov, Pavel Černoch, Dmitry Belosselskiy, Hibla Gerzmava, Ekaterina Gubanova, Krzysztif Bączyk, Silga Tiruma, Tiago Matos, Michał Partyka, Mikhail Timoshenko le récurrent, Tomasz Kumięga, Andrei Filonczyk, Vadim Artamonov, Fabio Bellenghi, Enzo Coro, Constantin Ghircau, Andrea Nelli, Pierpaolo Palloni, Hyun-Jong Roh, Daniel Giulianini, Krzysztof Warlikowski, Philippe Jordan, Felice Ross, Małgorzata Szczęśniak… Alors, Bastille un Opéra national ? Peut-être, mais de quelle nation, en fait ? Si, la question se pose. Quand tu passes moins de temps à écrire ton article qu’à tâcher d’insérer des caractères bizarres ou à compter le nombre de consonnes avant la prochaine voyelle, c’est que quelque chose cloche dans ce bel opéra de France. Et non, ce n’est pas racisto-fasciste d’estimer qu’un théâtre aussi chèrement soutenu par la France devrait, sans doute en priorité, du moins en grande partie, soutenir des artistes français, et non engager quasi exclusivement des artistes venus de contrées à la fiscalité plus « douce ».
Le spectacle : y en a pas. Bien sûr, l’espace est essentiellement plein de vide, même si l’on reconnaît au I le principe des lices déjà chères au Roi Arthus, et même si l’indispensable brassage des époques conduit brièvement le roi à vivre dans un foyer type années 1950. Bien sûr, rien n’a de sens (des figurants inutiles ont été choisis racialement parce que leur faciès sino-japonais « évoque les conditions misérables des travailleurs en Orient », selon l’inepte décoratrice-costumière Małgorzata Szczęśniak), le défilé de chanteurs mêlant déguisements de militaires avec casquettes de commandants de bord aux tenues d’escrimeur, casque compris, et aux costards-cravates éventuellement éclairés par le port, avec un « t », de lunettes de soleil.
La mise en scène de Krzysztof Warlikowski se contente de… de rien, en fait. Les artistes, tout de noir vêtus, vaguent vaguement sur la scène ; grandes vedettes de l’œuvre, le chœur et les groupes de solistes, parfois bigarrés façon troupe paroissiale chantant Michel Fugain, entrent en rangs d’oignon tantôt dans une scène vide, tantôt dans des gradins en amphithéâtre, tantôt dans un gymnase à espaliers où l’on pratique l’escrime (avec bruits de lames s’entrechoquant pour bien gâcher la musique), bref, ne sont appelés à représenter, par leur diversité, leur mouvement, leur énergie ou leur soumission, ni le destin des masses, ni l’opposition des héros ou des victimes, ni la tension entre fatalité et illusion de contre-pouvoir – il s’agit à peine d’un blob dont le soi-disant metteur en scène ne sait que faire. Ainsi représentée, l’ensemble de cette œuvre ne parle plus de rien. Elle se retrouve figée dans une sorte de récitation squelettique et plate, excluant toute dimension historique, mythique, poétique ou symbolique – ce à quoi contribue l’utilisation de vidéos ridicules signées Denis Guéguin (surimpressions de taches façon super 8 ou projection de flammes pour faire barbecue quand on crame des gens). Et ce n’est pas uniquement que, peut-être, on n’a rien compris : c’est surtout que c’est creux, nul, triste. Un gâchis.
- Ekaterina Gubanova (la princesse Eboli)
- Pavel Černoch (Don Carlos)
- Hibla Gerzmava (Élisabeth de Valois)
- Dmitry Belosselskiy (le Grand Inquisiteur)
L’interprétation : ce 31 octobre est soir de première pour les remplaçants des jeunes premiers. Pavel Černoch, Hibla Gerzmava et Ekaterina Gubalova remplacent Jonas Kaufmann, Sonya Yoncheva et Elīna Garanča, trois vedettes bien françaises selon les critères de Bastille. Certes, le plateau est dès lors moins chic, mais il est aussi un peu moins cher pour le spectateur, alors bon.
L’ensemble de la distribution fait plutôt montre de jolies voix. En princesse Eboli, Ekaterina Gubalova est celle qui, à nos oreilles et à nos yeux, tire le mieux son souffle du jeu : on apprécie la puissance du timbre et la présence scénique nécessaire à son personnage retors. Pavel Černoch et Hibla Gerzmava vont d’abord charmer avant de paraître craquer, façon sportifs ayant présumé de leurs forces. La dernière partie est, ce soir-là, de trop pour eux. Les piani de l’acte IV ne sont pas des effets de style : il semble que les gosiers ont présumé de leurs forces. Certes, la baisse dramaturgique et la non-mise en scène ne les aident pas ; mais, de toute évidence, les voix n’ont pas l’endurance, au moins pour cette semi-première, nécessaire pour rendre l’accablement et le paroxysme du drame qui s’abattent sur les protagonistes. Quasi tout ce plateau parle, après quelques airs ou d’emblée, selon le niveau, un français qu’un euphémisme taxerait d’approximatif mais qui, en réalité, n’est qu’un baragouin par moments proche du lalala, laisse penser par instants que le texte est à peine su et encore moins compris ; et cela joue aussi sur la déception de certains spectateurs.
Pourtant, l’orchestre, bien préparé, profite de la baguette précise de Philippe Jordan pour se mettre au service des chanteurs. Cela ne suffit pas toujours. Si Ludovic Tézier fait preuve de constance jusque dans son dernier grand air, le manque de profondeur des basses Ildar Abdrazakov, toujours aussi peu francophone, et surtout Dmitry Belosselskiy, il est vrai ridiculisé par un costume et une gestuelle attristants, peineront à combler les spectateurs venus applaudir un drame mystérieux… auquel les metteur en scène – scénographe – dramaturge inventent une nouvelle fin, feat. un pistolet (puisque, en sus de n’avoir aucune idée, il se confirmerait que ces parasites fussent des goujats fiers de leurs sornettes, tellement supérieures au récit mis en musique par Giuseppe Verdi).
Le bilan : une belle musique, impressionnante et ambitieuse ; un orchestre attentif mais que l’on aurait parfois aimé plus énergique ; de jolies voix dans l’ensemble, hélas peut-être pas toutes à la hauteur des défis à relever ; une non-mise en scène du niveau moyen de l’Opéra national de Paris depuis quelques années – un bilan mitigé, donc, avec la satisfaction toutefois, de constater que, même en milieu de second balcon, à jardin, on entend et voit bien. Du coup, on entend et on voit rien aussi, sporadiquement, mais c’est pas la faute de l’architecture, pour une fois.