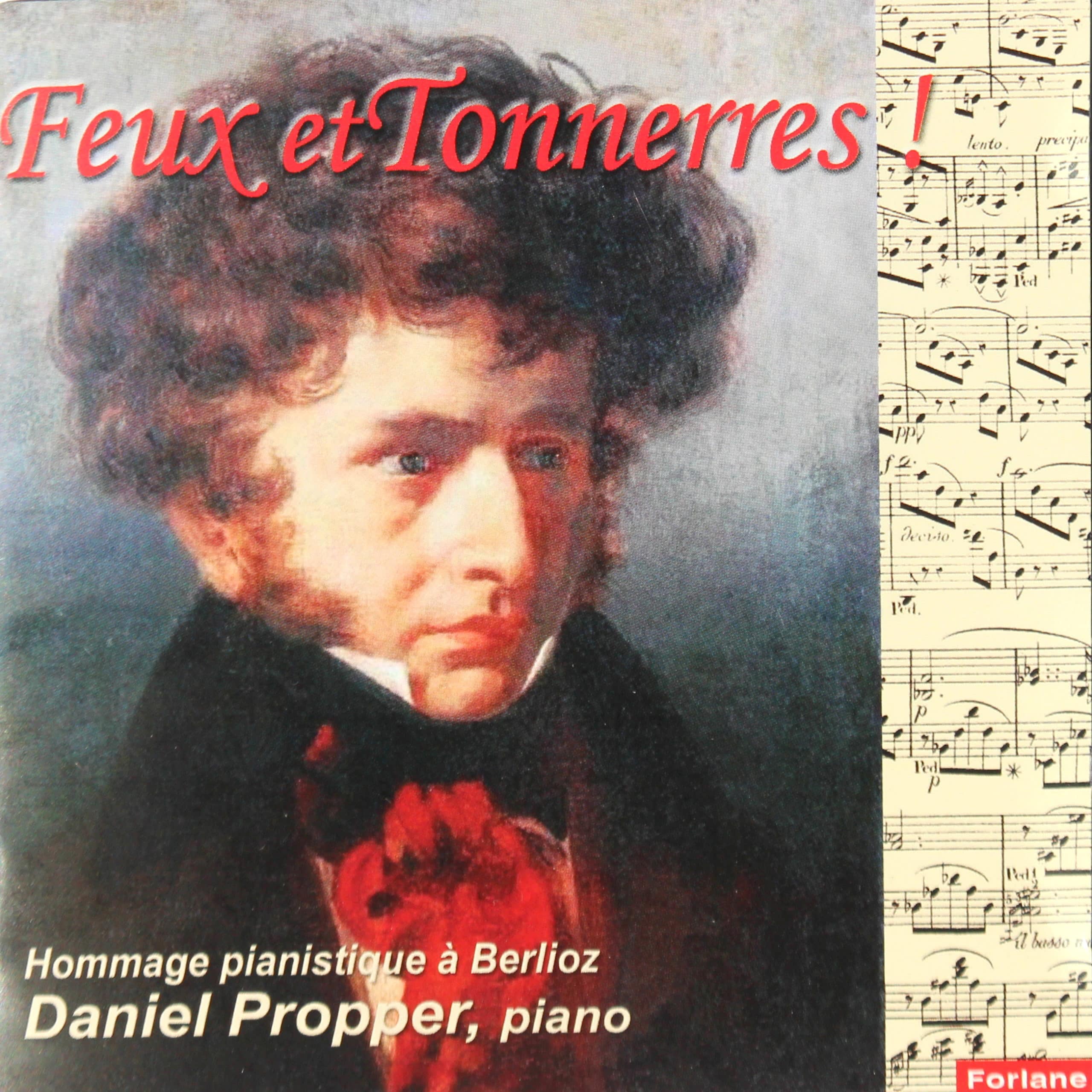Daniel Propper, “Feux et tonnerres !”, Forlane (2/2)
Dans une première partie, la monographie polymorphe de Daniel Propper nous a conduit des bras parisiens de Camille Moke au fantôme détecté par un éditeur de musique. Ouvrons la seconde mi-temps avec Berthold Damcke, co-exécuteur testamentaire d’Hector Berlioz, et son nocturne intitulé « Nuit d’été », extrait des « Quatre pièces caractéristiques » op. 30 intitulées Les Saisons.
L’Andante con moto en Sol bémol et 6/8 a des airs de barcarolle. Daniel Propper l’interprète avec son art coutumier : une rigueur presque clinique d’où sourd l’émotion quand elle évite les effets chichiteux aussi proches du romantisme qu’un parfum synthétique de brise marine est proche des senteurs océanes. Par chance et conviction, l’interprète prend au sérieux chaque partition sans se sentir obligé de la stabyloter pour indiquer à l’auditeur les endroits où son petit cœur sensible doit se serrer, sa gorge se nouer et sa chair le rapprocher en surface des gallinacées. Évidemment, cela n’empêche pas – au contraire – le pianiste d’investir le texte (ainsi de la dilatation entre le la bémol et le sol bémol, par ex., à 3’12, ou de l’effet d’attente sur la dernière note, qui semble retenir la nuit), et cela ôte un filtre parfois gênant entre la musique et celui qui l’écoute. Confiance dans la composition et dans l’écoute, donc..
… et il en faut, de la confiance, pour se risquer dans le second gros morceau du programme, intelligemment situé au deuxième tiers pour faire écho au premier, placé au premier tiers. Il s’agit de la traduction en musique du « Reflet perdu », neuvième conte fantastique de Hoffmann que Juliette Dillon a dédié à Berlioz sans que la vedette n’en ait, semble-t-il, eu grand-chose à se tampiponner. Le conte, pompé à Aldebert von Chamisso, narre ce qu’il advient d’une plante très rare après la mort du botaniste qui l’a cultivée… obligeant un jeune botaniste curieux à épouser la veuve défraîchie pour accéder à la belle plante. La musique s’ouvre avec solennité avant de sombrer promptement dans le drame puis l’agitation. L’écriture accole des segments vifs et tendus rendant raison d’une visée programmatique, la compositrice revendiquât-elle de ne point « imiter servilement » le texte.
La concaténation et le frottement de caractères différents entre eux saisissent l’auditeur et ne le lâchent plus. Si la main gauche joue en général les utilités, son dialogue avec la main droite
- (accompagnement,
- soutien,
- impulsion,
- rythmique)
ne manque pas d’efficacité. La capacité de Juliette Dillon à raconter une histoire à rebondissements en musique est tout à fait gouleyante. Avant une fin hélas un tantinet décevante, on goûte, notamment,
- les nombreux breaks,
- la savante alternance de récurrences rythmiques ou mélodiques et de nouveautés (le simili fugato vers 9’45, avec dissonances trente secondes plus tard !) et
- l’interprétation soignée (ha ! la petite respiration à 8’29 avant de relancer !).
Bref, voici une très sapide découverte, à laquelle succède la Danse des fées opus 41 d’Émile Prudent.
Cette danse – parfois éditée comme un éveil des fées, sans doute à cause de sa construction en deux temps, manière de quête ou d’adieu à Morphée précédant le batifolage – débute Allegretto tranquillo, en fa mineur et 3/8. Balancement tranquille et légèreté n’empêchent pas la basse d’exiger du swing. Celui-ci se poursuit entre grave et médium par un passage détaché précédant la reprise du thème et l’arrivée, en majeur, d’une nouvelle section. Tentée par un certain lyrisme, cette mutation semble chercher son thème puis y renoncer staccato, comme la section précédente.
Une dernière et très vaste section, d’abord en mineur et 2/4 (en fait plutôt en 12/16), est insérée à ce moment et marquée Presto e leggiero. Elle répond à l’emportement grandioso glissé juste avant. La rigueur du pianiste rend raison d’un passage associant énergie et statisme, le second poussant la première à bouillonner. Un motif majeur développe cette cavalcade où le ternaire des doubles croches affronte la rusticité binaire de l’accompagnement, selon le même principe que le début de la section mais avec, en prime, les paillettes scintillantes du suraigu. L’oreille croque à plein tuyau dans
- la variété des attaques,
- la régularité des doubles et
- l’indépendance des voix traçant les différentes voies.
La partition ne se prétend pas renverser la table des attendus – chic ; elle n’en est pas moins réalisée à la perfection et, musicalement, fort divertissante, dernier arpège poppérien inclus.
De Théodore Ritter, transcripteur de Berlioz qui voyait en lui un fin beethovénien, Daniel Propper propose la marche funèbre opus 83 écrite à la mémoire dudit Hector. À un grand crescendo, accompagné de son piano subito (et d’un souci de respiration allant jusqu’à l’étrangeté – écouter à 1’08), succède un autre crescendo suivi d’un decrescendo. Un second motif, précédé d’un interlude lent et trouble, semble symboliser le chagrin après le choc. L’écriture hésite entre grandiloquence et impuissance d’avancer. Le retour du motif A aux deux tiers de la marche remet un peu de rythme, mais
- la répétition,
- les effets de crescendo – piano et
- la réduction de la mélodie à un rythme pointé qui claudique de tristesse
rendent cette avancée stérile. De la mort (d’un artiste ou d’un zozo quelconque), il n’y aurait donc rien à dire, sinon qu’il n’y a rien à dire.
De cette déploration sérieuse et, logiquement, convenue, Daniel Propper tire le maximum de musicalité en ciselant
- nuances,
- rythmes,
- tensions et
- contrastes.
Il ne nous convainc pas du génie de Ritter – ni de sa dimension wagnérienne évoquée sans coup férir par Olivier Feignier dans le livret ? Bah, tant mieux, c’est pas le but. L’objectif du disque paraît double :
- illustrer la musique pour piano d’une époque en rassemblant autour d’une thématique commune des compositeurs désormais inconnus ; et
- dessiner l’aura d’Hector Berlioz à travers l’instrument qui lui a échappé.
Aussi curieux que cela semble, la nécessité du génial à tout crin est tout à fait superfétatoire. L’association entre la variété des découvertes et leur cohérence thématique revendiquée est beaucoup plus importante, surtout à notre époque où toute musique est censée être à la fois
- « terriblement d’actualité »,
- « incroyablement géniale » et
- « sublime, forcément sublime ».
Pourtant, un compositeur connu s’est faufilé dans la set-list : Franz Liszt clôt le bal en improvisant sur le leitmotiv de la Symphonie fantastique. L’idée fixe – Andante amoroso d’après une mélodie de Berlioz qu’il connaît bien pour avoir transcrit auparavant l’intégralité de la symphonie. Un prélude capricieux s’articule autour d’arpèges (de La, de fa# mineur, de Ré puis de ré mineur avant de préparer le retour La par un bon Mi7 des familles). Le thème apparaît alors avec cette délicatesse una corda où excelle l’interprète, donnant l’impression contradictoire que tout est égal (ce qui est le cas) alors que les trois voix
- (mélodie au soprano,
- bariolage ternaire à gauche et
- ponctuation harmonique dans le médium)
sont clairement différenciées. En d’autres termes, les trois voix sont stables mais bien caractérisées. C’est la magie proppérienne d’arriver à une simplicité d’exécution qui fait résonner la musique en lui évitant toute emphase.
Un poco agitato emballe l’affaire, s’acoquine d’un passage più appassionato puis détend l’atmosphère avec expressivité, en exigeant du musicien donc de l’auditeur qu’il s’abandonne.
- Lyrisme,
- exploitation des trouvailles harmoniques,
- changements de rythme (sextolets de doubles à droite quand le thème revient au ténor),
- passages a tempo et même
- silences
profitent à plein de la science lisztienne et de l’excellence proppérienne. On vibre aux atmosphères exigées par le compositeur. Le « perdendo » se mêle nébuleusement au « dolce calmato » et au « religiosamente »…
Cette coda du récital, intérieurement brillante, s’achève sur un triple piano qui amène à se demander si ce parcours péri-berliozien n’est pas, à sa façon, un autoportrait de Daniel Propper en musicien capable de déclencher « feux et tonnerres » non pas comme le juron chéri d’Hector Berlioz qu’il était, mais comme cette nécessité profonde sans laquelle la musique, fût-elle parée des atours de la Culture Savante et Supérieure, n’est qu’une source d’ennui confite dans des conventions poussiéreuses dégageant d’inquiétants relents rances.
- En construisant un récital pensé et puisé dans un répertoire original,
- en offrant à ses auditeurs curiosités et découvertes émoustillantes,
- en privilégiant la confiance dans la partition sur la nécessité de rutiler,
Daniel Propper signe un nouveau disque passionnant. Ha ! comme il serait dommage que les curieux passent leur chemin à cause d’une couverture, disons-le avec la suffisance du pseudo critique, super moche (construction, typo, titraille, équilibre, lisibilité, etc.) : l’excellence est à l’intérieur !
Pour écouter le disque en intégrale avec le son moche mais pratique de YouTube, c’est ici.
Pour l’acheter, c’est là.
Pour écouter l’artiste en concert à Paris, rendez-vous le 10 septembre à l’église suédoise.
Pour l’entendre ailleurs : voir sur le site de l’artiste.