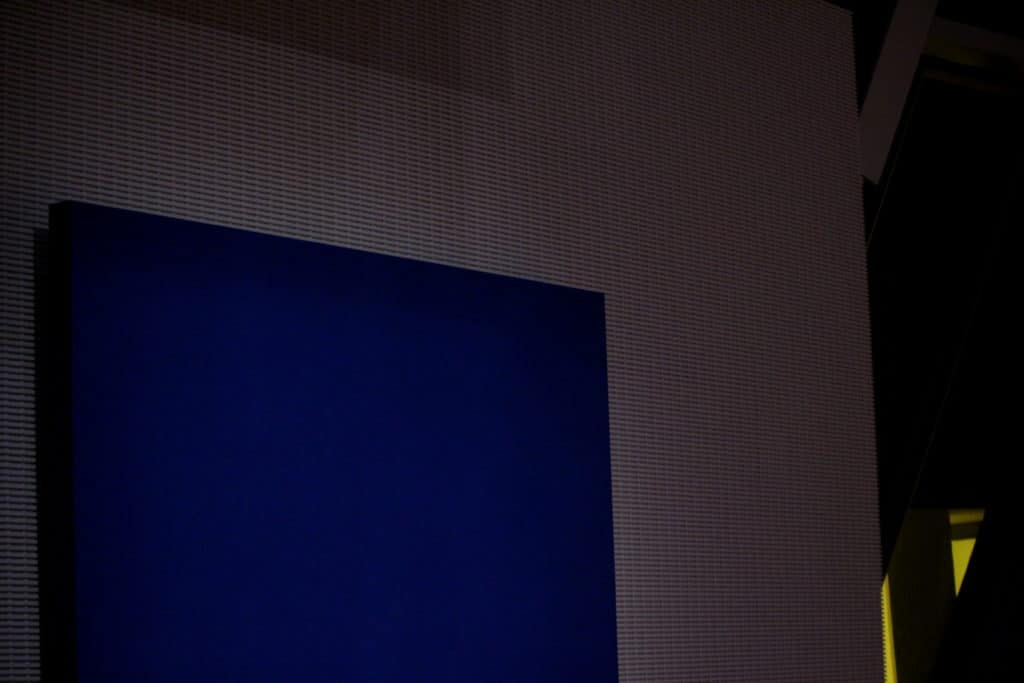Cyprien Katsaris, Fondation Louis Vuitton, 10 janvier 2020
C’est acté : les habitués de ce site savent que j’aime beaucoup Cyprien Katsaris. D’abord parce que ça envoie, ça rebondit et ça n’a cure des bienséances de pacotille qui cloisonnent le business de la « musique savante ». Ensuite parce que c’est un homme de parole, ce n’est pas rien. En outre, je crains avec joie que l’on ne soit d’accord sur à peu près rien, ce qui est toujours bon signe pour l’autre. Enfin, je ne suis pas peu fier d’être capable d’écrire du bien d’un artiste coupable de traiter Emmanuel Macron de « jeune homme très brillant » et de lui rendre hommage en musique à plusieurs reprises – allons, peut-être la proximité de l’élection de Pharaon Ier de la Pensée complexe permet-elle de passer sur cette déclaration flattant le cornichon criminel qui casse la société française pour la plier aux diktats éhontés des banques et du grand patronat. D’où la joie d’aller applaudir le zozo comme un voyageur sans métro, un soir d’hiver.
Ce soir d’hiver, donc, dès l’entame de match, Cyprien Katsaris prend le micro – comme il aime à faire – pour prévenir ceux qui seraient venus ici par hasard : ce concert sera « particulier ». Mensonge ! Ce récital sera moins particulier que, carrément, privé. Le pianiste semble nous recevoir comme dans son salon. Trois indices.
- Il fait fi du lieu de prestige où il se trouve – quoi que l’on pense du patron de LVMH et de l’inaugurateur qu’en fut François Hollande –, même s’il y est quasi chez lui puisqu’il a joué dans cet auditorium, pour son ami et ses invités, avant même son inauguration publique.
- Il se soucie comme de colin-tampon de respecter l’ensemble des codes qui fondent le récital de piano contemporain.
- Il n’a cure du grand nombre de spectateurs remplissant l’auditorium en dépit
- des grèves de transport,
- de la situation excentrée de la « Fondation »… et
- du prix élevé des places (40 € en placement libre).
Ce qui importe au zozo, c’est de jouer la musique qu’il aime au moment où il la joue. Le vrai contrat est là : l’on vient autant pour entendre le phénomène sempervirens que pour goûter à cette audace dé-chaînée. Pas étonnant que, à la sortie, les spectateurs donnent plus volontiers du « Cyprien » au Chypriote que du « Maître » au magistral musicien. Il y a chez le feu follet une rafraîchissante manière de mijoter des plats musicaux selon ses goûts mais avec une envie de partage, justement parce que cette envie de partage fonde la liberté. Certains grands artistes jetteraient un piano dans un lac pour exprimer leur ras-le-bol des conventions. Cyprien Katsaris, lui, jette aux orties la partie des conventions qui l’emperruqueraient, et continue de jouer. Le reste ? Des balabalas.
La set-list initiale, jadis, annonçait deux transcriptions : les septième et neuvième symphonies de Beethoven. Le projet a complètement été revu pour offrir un track record à l’image de l’artiste. En effet, dans la réalité, Cyprien va jouer quatre types d’œuvres :
- des improvisations et des transcriptions en première partie ;
- des compositions pour piano et des créations entre écrites et improvisées dans la seconde mi-temps.
Surtout, le musicien prévient qu’il décidera de son programme au fur et à mesure. Ainsi du premier morceau, longue et brillante improvisation sous forme de mix’n’match. Elle est guidée par la « tradition d’improvisation, vivace au dix-neuvième siècle, et que j’ai ressuscitée de nos jours », assume l’artiste, évoquant une époque où, appuyés « sur une culture bien différente », les interprètes aimaient à baguenauder autour d’airs de symphonie et d’opéra « tout en y ajoutant des thèmes créés sur le tas ».
De fait, fut un temps où ces airs sonnaient une cloche à un cercle beaucoup plus large d’olibrius que les passionnés de montres de luxe, de MEDEF et de Rolando Villazón écoutant alternativement les obscènes insanités de BFM Business et les mièvreries hérissantes de Radio Classique. L’ambitieuse rhapsodie tissée par Cyprien Katsaris s’amuse donc des deux contraintes du genre :
- un côté quizz avec ses références à des tubes,
- un côté circassien porté par une esthétique néo-lisztienne avec ses palanquées de notes, de sprints digitaux, d’arpèges et d’octaves spectaculaires.
Pourtant, l’intérêt de l’exercice est de constater comment le musicien transforme ces conventions vivifiantes en matériau stimulant. Cette transsubstantiation, et hop, de la musique de genre en musique tout court, n’ôte rien à la dimension d’entertainment, incluse dans le package, qui oblige le spectateur à être souvent soufflé par la maîtrise du gredin. Toutefois, elle permet à l’auditeur d’aller au-delà du wow technique (« mais comment il fait ? et combien il a de mains ? », etc.) grâce à un savoir-faire impressionnant étayé sur une palette d’astuces, parmi lesquelles :
- le mélange de thèmes,
- l’insertion de modulations finement pensées et
- la qualité de l’exécution (différenciation des types d’attaques, des nuances et des registres allant du grave grondant aux gouttelettes suraiguës).
Si l’on regrette – et l’on regrette – qu’un photographe se déplace dans la salle pendant cette séquence, perturbant l’attention, on apprécie la gourmandise du ploum-ploumiste qui permet d’enchaîner golden hit sur golden hit, tout en mixant, par exemple, Wagner avec Big Ben et Big Ben avec Mozart. La caractérisation des morceaux de ce patchwork forme un tissu bigarré où l’alternance de tempi et de caractères permet une promenade sinueuse dans la psyché de l’interprète, creusant, au cœur de la mine de sa culture, une veine résolument néo-romantique, brillante et maligne.
Pour assumer en partie le programme initial, Cyprien Katsaris s’en remet ensuite à Jean de La Fontaine, coupable d’avoir transcrit Ésope. Comme les fabulistes se remixaient entre eux, les pianistes du dix-neuvième siècle s’adonnaient à la manie de la transcription. Logique : « Lorsqu’une idée est géniale, on peut et on doit la transcrire sous d’autres formes », assène-t-il. Se faufile ainsi l’adagio de la Neuvième par Richard Wagner, « une rareté tant la partition est difficile à trouver », précise le pianiste, dont une exécution est incluse dans le coffret de six disques à paraître le 17 janvier. La pièce donne à l’interprète l’occasion de faire ressortir à la fois la cohérence de l’harmonisation et le lead du soprano. Aux parties virtuoses succèdent des moments associant légèreté et discrétion jusqu’au retour – bref – d’une écriture martiale. La distinction des voix chantant dans ce mouvement lent installe, peu à peu, un envoûtement paisible, respiration idéale après les trépidations de l’improvisation.
Roué, Cyprien Katsaris termine la première partie par un tube, l’Allegretto de la Septième dans la savante transcription de Franz Liszt. Il l’attaque réellement allegretto, loin d’une vision funèbre de la pièce. Sur son Bechstein du soir, l’artiste brille par
- sa capacité à étager et détacher les instruments à l’œuvre,
- sa science du piano d’accompagnement,
- la réalisation de pianissimi généralisés proprement incroyables et
- son art à créer des couleurs propres à chaque segment.
Sans doute aucun, c’est, à parts presque égales, du Beethoven, du Liszt et du Katsaris. Le retour du thème l’illustre en montrant comment l’on peut surligner la ligne mélodique tout en jouant hyperdoux ; et le fugato final, très précis, ne dépare pas face à l’exécution élégante de cette transcription.
Pour la seconde partie, le concertiste propose un pas de côté, y compris par rapport au programme de salle annonçant « improvisations et transcriptions » autour de Bellini, Saint-Saëns, Tchaïkovski et Rachmaninov. Libre et fier de l’être, il opte pour une sonate viennoise de Josef Haydn, la Hob XVI:35 (« je vais vous interpréter une sonate de Haydn, mais je ne me rappelle pas son numéro, elles sont trop nombreuses », stipule l’artiste), jouée par cœur comme les compositions suivantes, contrairement aux transcriptions beethovéniennes. L’Allegro initial, en Ut, ne manque certes pas d’allant, sans pour autant négliger
- les respirations,
- les ritendi ni
- les nuances, entre contrastes et crescendi, qui rendent écoutable cette musique mimi mais un peu poudrée à notre goût.
L’Adagio en Fa, joliet quoique peu pétillant, est pimpé par l’artiste dont l’appétit rend raison des fioritures émaillant l’exécution, appogiatures et trilles en tête, effet d’attente avant la résolution en queue. Retour en Ut pour le finale à trois temps, construit en ABA avec, au centre, une partie mineure pour faire respirer cette sage partition. L’attention portée aux détails permet de capter l’esgourde de l’auditeur en dépit d’une écriture poussiéreuse : l’art de nuancer les reprises, par exemple, donne chair à cette viennoiserie singulière dans le programme, donc précieuse.
Le balancement inquiet du toujours viennois Klavierstücke D946 n° 2, magnifique impromptu posthume de Franz Schubert, refuse d’en rajouter dans la mignardise susceptible de transformer en farce démonstrative les tensions entre thèmes – sobres ou sombres – et modes – majeur ou mineur… ou les deux ! L’exécution en concert permet toutefois de donner toute sa verve au bouillonnement et sa spécificité oscillante au thème liminaire. D’autant que l’artiste, en confiance, n’hésite plus à commenter son travail à s’adressant oculairement au public, au cours de sa promenade ABACA, jusqu’à la conclusion apaisée. En somme, là où un Brendel préférait une unité élégante, Katsaris ose l’incarnation réfléchie, avec ses justes embardées et ses volutes suspendues.
La Polonaise héroïque op. 53 de Frédéric Chopin renoue avec le propos partiellement tubesque de cette séance. Là où d’autres artistes se figeraient dans une posture doloriste ou hypermaniérée, Cyprien Katsaris chevauche sa monture avec ce mélange de familiarité liée à une longue pratique de la Bête et d’enthousiasme devant une partition difficile mais puissante. La marche harmonique initiale est enlevée avec la rage qui sied. L’avalanche de notes et d’octaves n’empêche pas l’interprète de réussir des nuances aussi bien menées que bien amenées… ni de clin-d’œiller le public comme pour mieux partager la joie et l’émotion que suscite cette composition.
La Marseillaise version Liszt / Katsaris enveloppe ce golden hit dans un torrent de notes qui n’exclut pas le contraste entre partie martiale et partie centrale – brève – plus apaisée. Bien que cet hymne révolutionnaire sonne singulièrement dans ce temple à l’arnaque des privilèges qu’est LVMH, on y goûte l’association entre
- virtuosité transcendante (torrent de notes, tombereaux d’accords enchaînés, rapidité des réflexes…),
- musicalité (tonicité, contrastes et nuances) et
- qualité de l’écriture travaillant sur l’ensemble de l’étendue du piano.
Après cette pièce, c’est fini, on ne tient plus l’artiste. Le voici qui se met tout nu devant nous – ou, plutôt, qui déclare : « Je vais vous dévoiler un coin secret de mon jardin secret. J’aime improviser en pensant à des films. Je sais que c’est très mal vu, mais j’aurai soixante-dix ans dans un an et demi, alors pensez si je m’en fiche ! Voici donc une musique pour un film imaginaire, à la Hitchcock, avec un paroxysme puissant. » Ainsi est présenté Appassionnato, premier mouvement… que précède une précaution de politesse : la vérification de l’heure sur le téléphone portable « car il faut que l’on quitte l’endroit à 23 h, 23 h 3 ou 4 au plus tard. » Puis vient une autre précision : il s’agira d’une première européenne après les improvisations à Tokyo, en 2011, et au Lincoln Center, en 2014.
La réalisation de ce thème « construit mais pas écrit » est à la hauteur de la promesse. Il y a des doigts, bien sûr, mais aussi quatre caractéristiques appréciables :
- de l’émotion frémissante,
- du cliché expressif – indispensable pour une musique de film,
- des idiolectes néo-lisztiens – consubstantiels aux improvisations katzarissiennes, et, par-delà la rhétorique rhapsodique,
- une volonté de présenter un discours immédiatement intelligible, porté par une ligne mélodique identifiable – ce qui permet de se plonger sans barguigner dans les sortilèges cinématographiques s’échappant du piano.
Dans l’assemblée, au parterre, des iPhone filment tandis que des pétasses checkent leurs messages – la vulgarité de nous autres, sans-dent, n’a d’égale que la grasse grossièreté des gens de bien. Toutefois, il est vrai que l’heure avance. Même l’artiste le reconnaît, à l’issue de ce premier mouvement : « Je sais bien qu’il faut arrêter, mais bon… » Mais bon, voici le deuxième mouvement de cette sonate fantasmée. Ainsi, au milieu de l’hiver, dans ce décor éthéré, apparaît une « Jolie Cubaine », rythmique et tonique, qui déploie un même thème en boucle, comme pour mieux signifier la fascination du musicien pour cette créature de rêve fort bien balancée, avec la pointe de Gottschalk qui va bien.
Pourtant, ce n’est pas à elle que reviendra l’honneur de conclure la session. Pour « la der des ders », Cyprien tient absolument à jouer « Coup de foudre », laissant supposer que le film qu’il se fait s’achève de façon tout à fait caliente avec l’héroïne, ruisselante de paillettes inspirées quand le suraigu s’attarde dans un tableau très évocateur, entre nostalgie et magie. Sous un déluge d’applaudissements, le récital doit donc s’achever, même si l’artiste revendique d’avoir joué « en Floride, de 19 h à 7 h » sans s’arrêter.
Ce projet de douze heures, fondé sur une anecdote tout à fait vraisemblable quand on connaît l’après-concert offert à Saint-André par l’artisteview, nous rappelle une expérience horvarthique qui, elle-même, nous évoquait Cyprien Katsaris. Les boucles se bouclent. Espérons que d’autres boucles se déboucleront pour nous redonner prochainement l’occasion de réentendre ce phénomène sur une scène parisienne… même si des projets avec orchestre l’accaparent ces prochaines semaines, confie-t-il à la sortie. En attendant, on repart regonflés du concert, démonstration s’il en est de ce que l’art, le savoir-faire et le talent peuvent produire quand ils associent les codes de la musique savante à un anticonformisme de bon aloi. Impressionnant, oui mais, surtout, roboratif.
Retrouver Cyprien Katsaris sur ce site : un florilège
- Le grand entretien polémique est ici.
- Le concert orgue et piano avec Esther Assuied est, entre autres, là et là pour le son (ne ratez pas la proposition finale du pianiste !).
- La notule sur le concert à quatre pianos est là.
- La chronique du disque avec Christophe Prégardien est là.
- La chronique du disque Moniuszko est là.
- La chronique du disque Theodorakis / Katsaris est là.
- La chronique du disque Penson est là.
- Les deux premiers graffitis sur le coffret Beethoven sont là et là.