Christian Chamorel, Mozart: Piano Works, Calliope

Il est vrai que je ne suis pas souvent d’accord avec les réponses, mais j’aime bien être d’accord avec les questions que posent les artistes, les vrais – sous-entendu, par ex., pas les metteurs en scène engagés à Bastille. En l’espèce, je suis complètement d’accord avec la question de Christian Chamorel, ouï jadis en duo puis en solo : Mozart est-il gnangnan, industriel du bariolage, asphyxié sous la poudre de sa livrée, voire overrated, ce qui reste malgré tout plus chic que d’être surcoté ?
Pour y répondre, son disque, qui promet de montrer un Mozart « pionnier », ne joue pas la révolution d’emblée. En effet, la Sonate en Fa K 533/494 (23′) avance une proposition qui aère la polémique. La pièce est jouée avec des doigts toniques, agrémentés d’une pédale souvent sobre et enveloppée dans une palanquée de nuances superbement amenées et réalisées. L’allegro est une force qui va, ce qui évite de s’attarder sur les grosses ficelles du développement (modulations, répétitions, échos, longs arpèges…). Dès lors, on redoute le long andante, que l’instrumentiste ne cherche pas à prendre plus vite que de raison : andante n’est pas courante. Il faut donc, pour neuf minutes, faire crédit à l’artiste de son projet et écouter « pour de bon ». La sonorité, les multiples touchers, la capacité à rendre évidente la logique des phrases, le métier qui permet de faire goûter la polyphonie, l’énergie qui concilie puissance et mouvement lent, et surtout le sens de la respiration (silence, léger rubato, retard ne dépassant pas les bornes de l’élégance) suscitent l’intérêt pour l’interprétation plus que pour l’œuvre… en dépit de jolies dissonances qui titillent agréablement l’oreille (piste 2, vers 6′). Bref, le rondo arrive à point pour secouer la torpeur dans laquelle nous menacions de sombrer en dépit des qualités de l’exécution. Le thème liminaire sonnerait d’une banalité furieuse si Christian Chamorel ne sauvait le jour par les détachés opportuns, les contrastes et intensités qui vont bien… et dont rendent justice autant (1) le superbe Steinway préparé par Corinne Wieland que (2) l’acoustique de « L’Heure bleue » à La Chaux-de-Fonds et (3) la prise de son d’Ines Kammann. Certaines variations, plus harmonieuses ou délicates que d’autres, happent l’attention jusqu’à cette étrange fin grave d’un mouvement que l’interprète décrit comme une pièce rapportée, petite facilité pré-composée que Mozart agrégea aux deux premiers éléments pour offrir « un final plus léger ».
Le Rondo en la mineur K 511 (9′) impose d’emblée son chromatisme pré-chopinien, que Christian Chamorel veille à ne pas surjouer de façon anachronique. Deux couplets pivotent autour du thème imbibé de mélancolie. L’ornementation, rigoureuse, anime cette forme sans surprise, que les modulations, l’usage abondant du demi-ton, le toucher précis et le rythme pertinent du pianiste contribuent à rendre appréciable en dépit des redites qui ne semblent pas toujours indispensables à l’économie générale de la pièce… telle qu’un auditeur snob de 2018 eût pu, sottement, imaginer judicieux de la redessiner.
Les Dix variations sur « Unser dummer Pöbel meint » (13′) est la partition idéale pour Christian Chamorel. Dès le thème liminaire, non-mozartien, elle lui permet de valoriser son incroyable talent pour la schizophrénie, cette capacité à aller boire une bonne grosse chope avec des Munichois en fin de soirée et, la mesure d’après, siroter quelques bulles millésimées avec la marquise de Louis-Vuitton. Les variations, d’une virtuosité imparable – pas de celle qui fait du bruit sur tout le clavier, de celle qui, si tu décales seulement une double, tu pourris la prise et chacun se gausse – lui siéent itou à la perfection. D’abord parce que c’est pas parce qu’il joue du Mozart qu’il ne sait pas secouer ses saucisses. Ensuite parce que nous ne connaissons aucun pianiste capable de faire autant de musique avec des notes fonctionnelles – jusque dans les ornements malins ajoutés comme il convient à la reprise de la première section de la dixième variation. Enfin parce qu’il se sert de cet exercice très codifié pour prolonger son propos sur la verdeur, l’originalité et la grandeur de Mozart. Les pinailleurs pointeront ainsi ce do aigu, à la troisième mesure de la huitième variation (ben quoi ? faut montrer que, quand on m’offre un disque, je fais hyperbien semblant de l’écouter, quand même), qui semble tarder à venir et, pourtant, tombe dans le bon temps. Cette capacité à subdiviser une microseconde pour valoriser une note provisoirement sommitale placée sur un temps faible, c’est aussi ce genre d’indice qui trahit un grand interprète – lequel, roué, refait le même coup dans la seconde partie de la variation, comme pour bien montrer que c’est un choix interprétatif qui consiste à créer de l’inattendu dans du convenu parce que, peut-être, le convenu est moins dans le formalisme d’une pièce que dans une exécution routinière… ou la certitude préalable de l’auditeur.
Dès lors, la Sonate en Mi bémol K 282 (12′) sonne comme un choix curieux pour un artiste qui se propose de mettre en avant le génie de Mozart. Écrite à dix-huit ans, l’œuvre ressortit a priori du pensum. Sauf que Christian Chamorel, l’insolent, affirme que, loin d’être un sage parangon classique, elle serait un jalon du préromantisme, au moins grâce à son premier mouvement. Acceptons-en l’augure et, cependant, néanmoins, quoi que, ce nonobstant, pourtant, though, although, however, nevertheless et tutti quanti, admettons l’inadmissible : oui, l’on apprécie le soin mis dans l’interprétation, l’ajout plein de grâces d’ornement à la reprise de la première section (voir le changement de note sur la première croche de la septième mesure, tadaaam) et donc d’emblée dans la seconde ; or, malgré cet atout inestimable, il nous paraît audacieux de chercher, dans cette sonate, autre chose que de la musique mignonnette, voilà, c’est dit. Aussi, embarqué dans une telle verve sans faute d’orthographe, craint-on le pire ennui, au moins, pour la suite, puisque les deux derniers mouvements sont annoncés comme moins inventifs. En réalité, il est difficile de s’ennuyer avec un tel pianiste. En revanche, cette fois, il serait vain de chercher à le contredire : les menuets du deuxième mouvement sont charmants et longuets comme sont charmantes et longuettes les roulades d’une jeune première de Labiche balbutiant du Lalo (quand ladite jeune première est charmante, bien entendu, et que le comique de situation nous fait rire en enviant ces riches bourgeois). Les doigts s’agitent dans l’allegro pris, heureusement, quasi presto – encore une fois, le rendu est parfait, l’attention est attirée avec justesse sur la mélodie où qu’elle se trouve, la percussion des accords n’est jamais vulgaire, les respirations aèrent avec finesse la pâte sonore : on admire donc l’exécution, mais la sonate nous paraît ensuquée dans une esthétique qui peine à nous émouvoir bien qu’elle mette en valeur les incroyables vertus d’interprète de l’olibrius derrière le clavier – son final piano achève de mériter des brava en dépit de son vain défi de nous convaincre du génie mozartien.
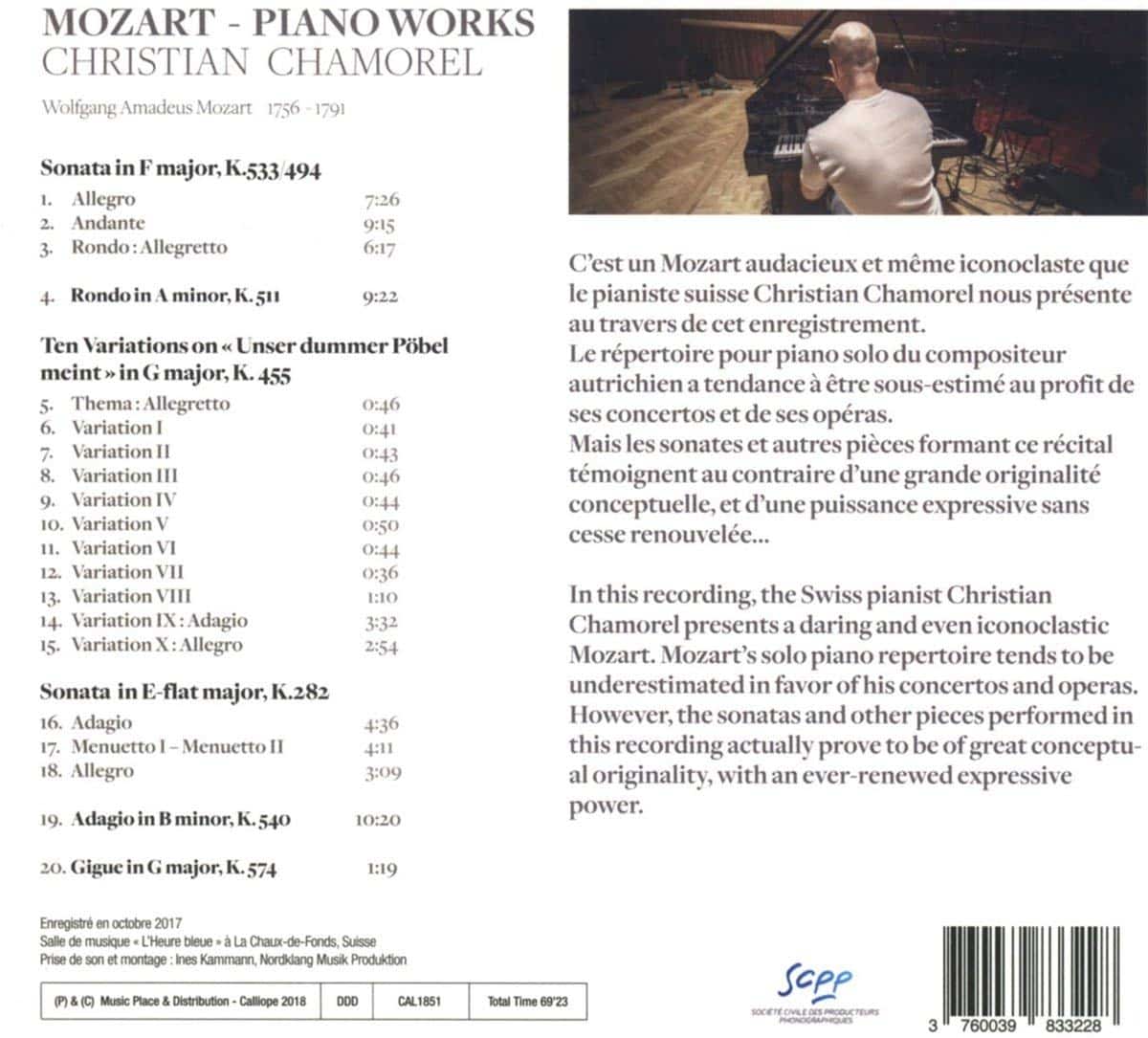
Cela dit, attention, la démonstration n’est pas terminée ! Il reste un gros Adagio en si mineur K 540 (10′) pour nous bluffer. Le caractère un brin décousu de la pièce, offrant différents caractères, désamorce une partie des chansonnettes sur le « systématisme » de Mozart – d’où la déception quand les reprises rentabilisent ce qui nous plaisait et « systématise » ce qui pouvait être plus ravaudé voire, in a way, rhapsodique que cousu de corde blanche. D’autant que la seconde partie reproduit largement les systèmes de mains croisées et d’accompagnement proposés lors des cinq premières minutes. Hormis le final majeur, on peinerait à prétendre être bouleversé ou surpris par cette composition un peu empesée à notre goût de snob qui n’arrive guère à décentrer ses penchants les plus avouables, sans doute les pires. Heureusement, domine la formidable capacité de Christian Chamorel à capter l’oreille par un son, un accent, une nuance, une respiration, une dilatation du soupir ou de la tenue (piste 19, 7’55) de sorte que l’on applaudit, stupéfait et hypocrite dans la mesure où un autre interprète nous aurait permis de piquer un somme ce qui n’est presque jamais désagréable. Tantôt cristallin, tantôt tank, toujours très personnel, le piano semble se soumettre aux moindres désirs musicologiques et musicaux, l’un n’allant pas toujours avec l’autre chez tant d’experts, de l’interprète.
Cela méritait bien un bis, en l’espèce la Gigue en Sol K 574, exécutée avec brio, et qui a le mérite singulier de marquer le côté « récital » du disque : pas une simple liste de tubes de Mozart, mais un vrai projet réfléchi et joué avec un talent époustouflant par le mec qui l’a pensé. Tu vois, Momo, si tu as au moins réussi à stabyloter pour quelques clampins de ma trempe à quel point Christian Chamorel est un grand pianiste, tes bluettes et tes trucs pour marquis (2’12) n’étaient point inutiles ! Quant aux curieux soucieux d’acquérir un disque aussi superbement joué que talentueusement enregistré, ils auront grande joie à profiter de cette jolie musique si supérieurement exécutée… ainsi que des notes de livret de l’interprète en personne, que nous avons évité de citer en long ici afin que chaque acheteur puisse profiter de la parole du vrai connaisseur comme en avant-première.

