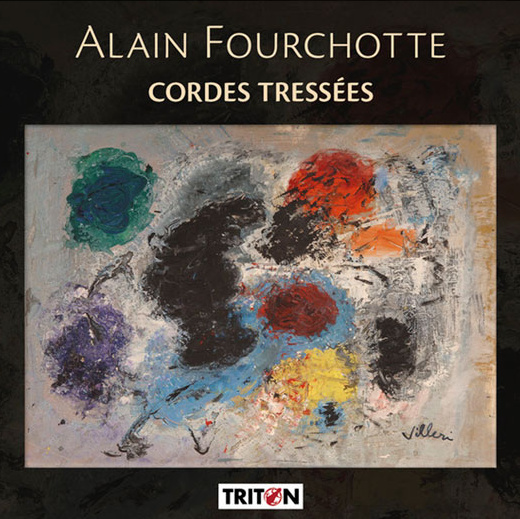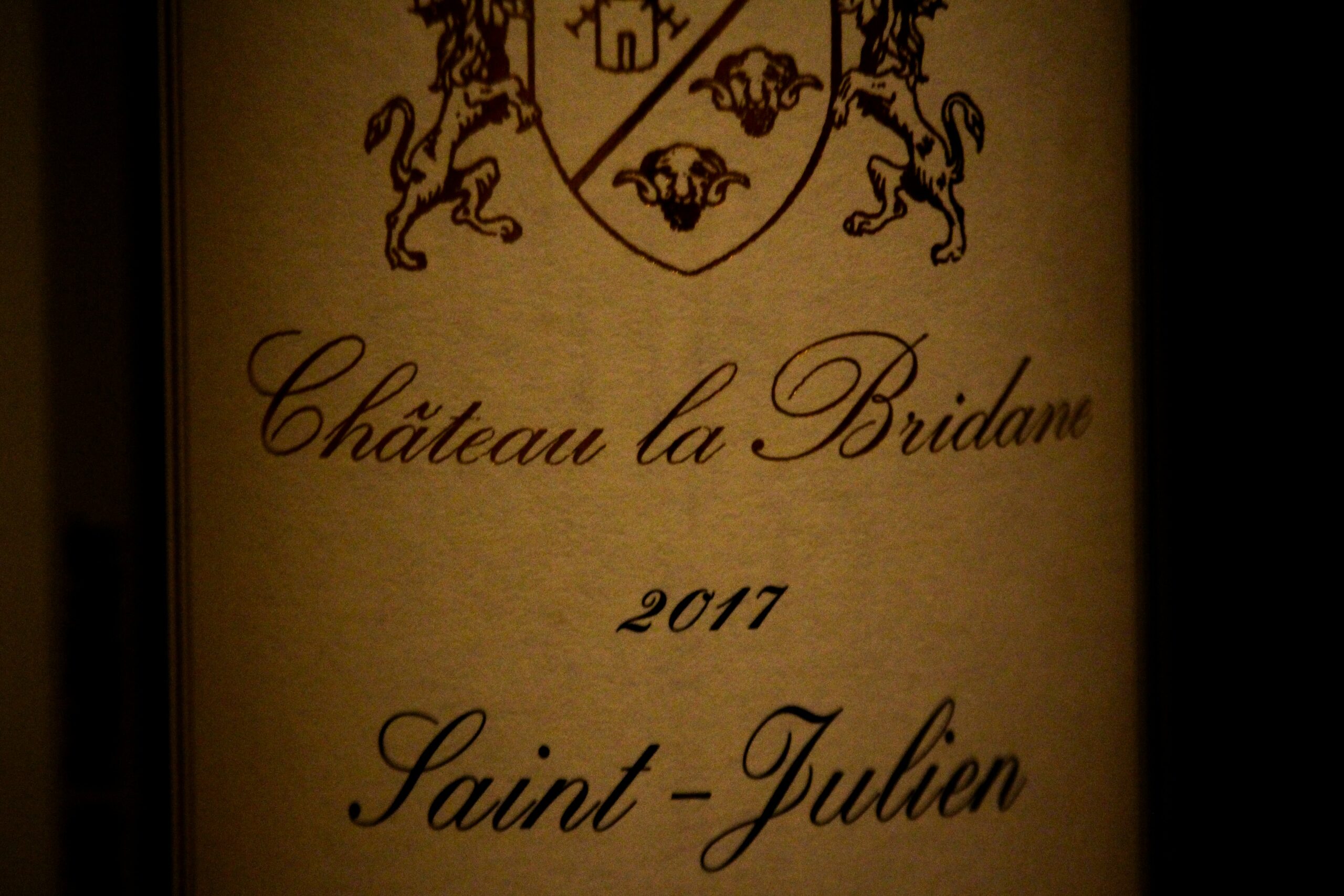L’art de Sylvie Carbonel (Skarbo) – 22/24
Hétéroclite et stimulante : la dernière partie du neuvième disque inclus dans le best of Sylvie Carbonel associe Georges Hugon (1904-1980) et Alain Louvier (né en 1945) sous les doigts de la pianiste. Visiblement, de ce volet, l’éditeur n’a en partie cure, oubliant de mentionner sur le dos de couverture supra l’année d’enregistrement des Études pour agresseurs (1978) dont le compositeur estime pourtant sur son site qu’elles ont fait un max pour sa notoriété (au passage, « Études » avec un « é » cap, c’est mieux – comme j’aurais dit à mes étudiants en édition, « c’est pas parce qu’Élisabeth Borne et Éric Woerth sont élus qu’il faut appeler l’ASSEMBLÉE NATIONALE la CHAMBRE DES DEPUTES », bien).
Avant cela, voici les Eaux-Fortes de Georges Hugon, des œuvres programmatiques au sens où chacune est précédée par un texte introductif. Le livret consternant et frappé de coupes affligeantes (Olivier Messiaen « l’a chaleureusement félicitée pour la beauté de son inteMessiaen qui était aussi un grand ornithologue », par ex.), n’évoque ni les deux extraits joués par l’artiste, ni même le compositeur. Plutôt que de lire, ce qui est entre insultant et condescendant, que Bizet « n’a pas écrit que Carmen”, précision essentielle pour celui qui achèterait le florilège en dix volumes de Sylvie Carbonel, on eût préféré être instruit de l’inspiration du compositeur.
Pas de quoi nous empêcher de partir à l’assaut d’« Ariel », auréolé du son vintage d’il y a soixante ans.
- Virtuosité digitale,
- variété du toucher,
- souplesse d’un piano nuancé et capable d’exploser
rendent raison d’une partition
- harmoniquement captivante,
- narrativement mystérieuse et
- intérieurement parcourue de pulsions palpitantes.
« L’innocent » sautille à deux voix.
- Légèreté des marteaux,
- liberté brillante,
- mutations de couleurs presque permanente
- (suspensions pédalisées,
- accents,
- enrichissements harmoniques,
- variations rythmiques)
exigent plus que beaucoup de l’interprète mais ravissent l’auditeur tant ces pages se révèlent
- inventives dans le traitement du motif liminaire moins mélodique que tonique,
- astucieuses dans le développement à rebondissement, et
- captivantes dans leur écriture faussement dégingandée et jazzy.
Changement de projet avec les trois Études pour agresseurs d’Alain Louvier enregistrées par Sylvie Carbonel en 1978. Le compositeur s’en explique dans une partition laissée ici même à la libre disposition
- des curieux,
- des mélomanes et
- des pianistes.
Ces études ont été conçues pour aguerrir le pianiste aux nouvelles techniques d’attaque (« d’agression ») du clavier. Le but recherché n’est pas la violence gratuite mais une plus grande plénitude sonore de l’instrument. L’exécutant devra plus se soucier des effets de résonnance et des différents phrasés et touchers que du rythme (…). Il recherchera l’effet dynamique et les contrastes par l’emploi systématiques des pédales.
La partition de la deuxième étude est en quadichromie :
- doigts en noir,
- paumes en bleu,
- poings en rouge,
- avant-bras en vert.
En sus,
- les indications de nuances et de phrasé sont en orange,
- les annotations en brun et
- la pédalisation en rose (pour
- mettre la pédale,
- l’enlever à moitié,
- la relever
- d’un coup ou
- par paliers).
Le pianiste peut être invité à jouer
- avec la paume à plat ou agitée,
- avec le bras
- parallèle au clavier,
- en travers ou
- glissant des touches noires sur les blanches, et
- avec le poing
- à plat ou
- à l’envers (« avec l’os »).
Bref, cette étude lâche sur le clavier treize agresseurs, en sus des petons :
- dix doigts,
- deux bras,
- une paume,
ça fait bien treize, pas de stress, j’ai recompté avec ma calculette. Dans la pièce,
- la note perd sa valeur pour devenir son,
- la ligne se floute pour devenir suggestion trempée dans les différents registres de l’instrument,
- la percussion est moins violence qu’éclatement quasi jubilatoire,
- bref, la musique moins musique que questionnement de la musique.
Plutôt que nous offrir une étude de cas (centrée sur une technique d’approche du clavier) ou un exposé démonstratif voire didactique de méthodes pour jouer du piano, le compositeur semble nous inviter
- dans les coulisses de l’interprétation,
- dans le garage du musicien et
- dans les entrailles de la fabrication du son.
La cinquième étude convoque douze agresseurs :
- les chipolatas,
- le poing (qui pourra être vif mais non violent) et
- la paume.
La magie de l’exploratrice Carbonel fonctionne et envoie la capsule du testeur de Louvier sur orbite.
- L’exploration des registres aigus et médiums,
- le malaxage du son
- (attaques,
- résonances,
- récurrences,
- contrastes),
- le surgissement de séquences ébouriffantes,
- le soin apporté à l’exécution (dont témoigne par ex. la durée, supérieure d’1′ à celle indiquée par le compositeur peut-être
- pour revendiquer une part de liberté d’interprétation dans une partition presque aussi réglementée que la fiscalité française ou les tutoriels susceptibles d’aider à ouvrir le blister d’un disque de François Valéry sans devoir aller chercher un couteau pointu à la cuisine alors que l’on était bien installé dans le vieux fauteuil jouxtant le gramophone et son frère le lecteur laser,
- pour valoriser les saisissants contrastes entre passages virtuoses et passages intériorisés,
- pour ne pas galvauder l’expectative dans laquelle se trouve l’auditeur devant une pièce qu’il est invité à appréhender dans l’instant, sans pouvoir prédire ce qui va advenir la seconde suivante, ou
- pour rendre au mieux la multiplicité des effets suggérés sans sombrer dans l’embrouillamini de la précipitation) et
- l’imprévisibilité pour le moins coquette du propos
permettent à l’interprète de faire passer l’œuvre du statut de « musique pour musicien » à celui de musique.
C’est bien ce dont il semble s’agir ici : non pas
- proposer une musique expérimentale,
- bidouiller des processus pour remplir le vide sonore ou
- fabriquer une légitimité à la création en l’enduisant d’un onguent technique, pragmatique et verbeux.
Plus simplement et de manière plus intéressante, le défi d’Alain Louvier paraît être
- d’étudier des possibles,
- de rejeter l’évidence (on joue du clavier avec les doigts, point à la ligne),
- de repousser les limites (on ne frappe pas les touches, on ne mélange pas les techniques, on ne laisse pas la manière de jouer primer sur la mélodie ou l’harmonie),
- d’interroger les non-dits (sait-on ce qui serait susceptible d’advenir musicalement si l’on se risquait à chambouler les conventions ?).
La septième étude pousse le vice exploratoire à double titre. D’une part, comme la quatrième, elle nécessite
l’emploi de gants, de peau, si possible, permettant le glissando avec le poignet et protégeant les poings dans les attaques ++.
D’autre part, spécifiquement cette fois, le compositeur est formel : « Les doigts ne doivent pas toucher le piano avec leurs extrémités. » Dès lors, les agresseurs sont moins nombreux. Pour la dernière étude, seuls six s’attaquent au clavier :
- deux paumes,
- deux poings,
- deux bras.
L’interprète
- plonge dans les abysses des graves,
- souffle et pétarade dans les aigus, et
- travaille les intervalles où les sons se dérobent, s’étoffent, se floutent, se transforment, s’évadent
- (glissendi aller-retour,
- claquements de pédale visant parfois à faire résonner les cordes,
- clusters pédalisés sur des temps « extrêmement longs », etc.).
En chemin, elle pose une question qui va au-delà de la technique : celle de l’événement en musique. D’ordinaire, la composition d’une composition (ha, ha) associe
- un flux
- (mélodique,
- rythmique et
- harmonique),
- des silences ou, a minima, des respirations, et
- des événements permettant l’évolution du propos
- (modulation tonale,
- changement de mode,
- break…).
Ici, tout se passe comme si, en interrogeant la manière de jouer, Alain Louvier et sa porte-voix interrogeaient aussi notre manière d’écouter. En effet, écouter une des Études pour agresseurs, c’est ne jamais savoir ce qui va se passer, ni en matière de logique musicale, ni en matière de technique de jeu. En d’autres termes, c’est réapprendre le goût de la musique qui n’est pas seulement la dégustation de friandises mille fois savourées par le passé, mais la découverte d’un art d’arranger le son pour nous émouvoir.
- Esquisser d’autres possibles,
- fracturer un instant le mur du convenu que nous reboucherons bientôt pour nous rassurer,
- ouvrir l’horizon presque malgré nous,
cela contribue aussi à
- nous ouvrir,
- nous réapproprier la musique, qu’elle soit Radioclassicisante ou ircamique), et
- réenchanter quelque peu cette musique que nous finissons, nous mélomanes revendiqués, sans nous en rendre compte, par trouver banal, normal, habituel.
Dès lors, le mix’n’match du coffret Sylvie Carbonel, s’il rend de facto hommage au large répertoire de l’artiste (qui est autant une performance qu’une volonté, même si l’on imagine que certaines explorations ont été dictées par les obligations estudiantines au temps du Conservatoire, lesquelles ne doivent pas toutes être mauvaises puisqu’elles peuvent parfois révéler des champs que les programmateurs ne donneront jamais l’occasion de labourer), a aussi cette puissante faculté de nous remettre en question non pas en plus de nous séduire mais parce qu’il nous séduit. Heureusement, il reste un dernier disque pour prolonger notre enthousiasme !
Pour acheter le coffret (env. 35 €), c’est par exemple çà.
Pour écouter le disque en intégrale et gratuitement, c’est par exemple là.
Pour retrouver les critiques précédentes du coffret
Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 1
Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 2
Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgsky
Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 1
Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 2
Le Cahier de musique de Jacques Desbrière
Franz Liszt – Totentanz
Franz Liszt – Sonate en si mineur
Franz Liszt – Deux harmonies poétiques et religieuses
De Bach à Granados – Un récital imaginaire
Ludwig van Beethoven – La Waldstein et plus
Carl Maria von Weber – Sonate pour flûte et piano
Wolfgang Amadeus Mozart – Troisième trio K.502 et plus
Frédéric Chopin – Trio en sol mineur
Johannes Brahms – Trio en Si
Robert Schumann – Humoreske op. 20
Johannes Brahms – Trio op. 114
Arnold Schönberg – Drei Klavierstücke op. 11
Charles-Valentin Alkan – Deux Motifs et +
Bizet et Debussy
Olivier Messiaen
À suivre !
“Paris 1850”, Le Palais Royal, Salle Gaveau, 6 février 2024 – 2/3
Après l’interminable blabla évoqué tantôt (on nous souffle qu’il a été vivement suggéré par les sponsors, la culture étant soumise plus ou moins en catimini aux grandes entreprises et aux gros riches), surprise : l’heure de la musique est enfin venue. La révolution n’a pas dû déplaire aux sponsors s’ils sont incultes, mais le schéma organisationnel préférait le pratique à la tradition. L’usage ? Une ouverture, un concerto, une symphonie. Probablement pour ne pas harasser la régie, l’ouverture est positionnée après le concerto, ce qui lui ôte le côté apéritif qui lui sied, et l’on passe presque directement au vif du sujet, en l’espèce le quatrième concerto pour piano de Camille Saint-Saëns avec Orlando Bass au Pleyel.
Le soliste est l’homme idéal dans le momentum idéal. Après avoir raflé tous les prix ou presque au dernier concours international auquel il a participé, le pianiste également claveciniste (et compositeur, on en a parlé et on en reparlera) est un vieux partenaire de l’orchestre du Palais royal où Jean-Philippe Sarcos, le chef, lui a fait confiance à de multiples reprises.
Articulé en deux parties d’une douzaine de minutes chacune, le concerto s’ouvre sur un dialogue potentiellement énergisant entre orchestre et piano. Ceux qui ne connaissaient pas les conséquences non mentionnées au préalable des instruments d’époque les découvrent : la justesse est souvent injuste. Cela donne du corps au son, certes, mais il faut du temps et de l’envie pour trouver du charme à la proposition. Quand le piano entame
- ses traits,
- ses rondades et
- ses envies d’octaves,
l’orchestre se libère de ses piani et de sa retenue liminaire. Sans presser, le soliste joue sur les tensions et les mutations, son jeu délié sachant être
- plus concentré que brillant,
- plus habité que bruyant,
- plus diversifié que contradictoire.
Orlando Bass est à son affaire. Il travaille
- la poésie de la résonance,
- la musicalité de la virtuosité,
- la beauté de la retenue.
Quoique valorisante et maîtrisée, la partition n’est sans doute pas la plus
- émouvante,
- fine et
- inattendue
du répertoire, mais
- l’allant du chef,
- l’attention de l’orchestre et
- l’aisance investie du pianiste
réjouissent l’auditeur. La petite demi-heure séduit aussi grâce au travail collectif.
- L’énergie des attaques pianistiques,
- la coloration des différents registres d’un Pleyel 1905,
- la multiplicité des
- traits,
- breaks,
- unissons et
- relances de l’orchestre
font pétiller l’écoute et vibrer l’auditeur. Sans forcer le trait, fidèle à son apparente retenue qui reste toute britannique, Orlando Bass éblouit triplement :
- par sa technique qu’ébouriffe une invraisemblable cadence,
- par son piano caméléon allant de la mélancolie à la jubilation en passant par la colère furibonde, et
- par sa musicalité dont témoigne sa capacité à relancer l’écoute par un toucher spécifique ou une saute d’intensité fascinante.
Belle ouvrage qu’il s’agira de parachever avec une ouverture et une symphonie sur lesquelles une prochaine notule reviendra.
À suivre !
Jean Guillou, Ombres et lumières (Augure) – 1/2
C’est l’histoire d’un mec, l’un des plus célèbres organistes de son temps, qui meurt en laissant des tonnes d’archives. C’est aussi l’histoire d’une association qui, sous la houlette de Giampiero del Nero et l’impulsion du duo Frédéric Brun – Vincent Crosnier, collecte, évalue, trie, hiérarchise, investigue, analyse, édite et publie presque régulièrement les plus marquantes desdites affiches. Et c’est une troisième histoire, celle du succès phonographique qui a accompagné la publication des Charpentes de Saint-Eustache, une série de huit improvisations à l’orgue autour d’œuvres du graveur Félix Schivo, dont nous avions rendu compte ici. Tout cela mélangé donne une quatrième histoire.
Alors que reparaît Les Charpentes de Saint-Eustache en version remastérisée, une nouveauté – nouvelle, elle – pointe le bout de sa galette : huit nouvelles improvisations sur des œuvres de Félix Schivo, dont deux pièces déjà commentées par l’orgue de Saint-Eustache, mais cette fois au piano. Les experts supputent qu’elles ont sans doute été fomentées pour et dans la maison de campagne de feu le galeriste Claude Bernard. Musique de salon, alors, craindront les snobs ? Ce serait méconnaître l’unicité de Jean Guillou, pas spécialement réputé pour écrire ou jouer des trucs mignons tout pleins afin de flatter brushings épars et violettes permanentes.
« Le marchand de masques » ouvre la fête avec tonicité. La percussivité du piano est multiple :
- rugueuse,
- feutrée,
- progressive
- contrastante.
Elle ouvre au musicien un champ de possibles encore
- plus vaste,
- plus efficient et
- plus malléable
que l’orgue pour y tirer à notes réelles avec l’une de ses armes favorites – la répétition d’accords furibonds. Certes, l’artiste semble bien essayer de se débarrasser de cette inclination idiolectique (je tente…) en fomentant une échappée presque guillerette en dépit de son aspect plus mécanique que circassien ; las, le sparadrap de l’itération
- compulsive,
- rythmique et
- motorique
retombe sur le nez de l’improvisateur. Ainsi fomente-t-il une atmosphère
- grave,
- lourde et
- inquiétante car pas prête de se dissiper.
La dichotomie est béante mais insuffisante pour protéger l’échappée belle qui s’immisce parfois de la solide fureur des graves qui la submerge toujours. Ce premier hommage au mime Marceau – personnage qui a rendu Félix Schivo si prolixe – claudique ainsi sur deux jambes inégales que le musicien fait moins avancer que se battre l’une contre l’autre, suscitant une vive émotion musicale.
« La main et le papillon » développe l’inspiration mimique de Félix Schivo. Dans les aigus, un battement d’ailes assume la dimension programmatique du titre.
- La pédalisation,
- les brisures harmoniques et
- les ruptures du discours
installent manière de suspense que l’usage de graves caverneux rend presque dramatique. Jean Guillou travaille ainsi la tension entre
- la pulsion de liberté qui s’exprime dans les aigus,
- une forme de fatalité malveillante qui ensuque les hommes non-ailés sur la terre, et
- l’impossibilité de fusionner par le simple contact de la main avec la légèreté du papillon.
« La main et le papillon » pourrait être compris comme une astuce musicale et métaphorique pour penser voire rendre presque palpables les limites de l’homme mais aussi ses fantasmes aériens à la fois
- douloureux (ils ne peuvent être réellement assouvis),
- heureux (ils nous permettent de nous évader un instant, comme semble le suggérer la dernière pirouette de la main droite) et
- d’autant plus douloureux qu’ils sont aussi heureux !
« La cage », troisième hommage schivien à Marceau prolonge le désir d’évasion que semble manifester l’improvisateur depuis le début. Cette fois, c’est dans les graves que cela se joue, avec une main gauche prise par la danse de saint Guy. La digitalité prodigieuse paraissant exprimer cette quête suffocante d’air se heurte
- contre les barreaux des accords et des notes répétées,
- contre le flou d’une pédalisation amplifiante où
- le vif devient vain,
- l’énergique s’étouffe et
- la dynamique noie sa propre vitalité, et
- contre les vapeurs des résonances que contrôlent des accents parfois octaviés pour plus de rudesse.
Le rush a beau parcourir l’ensemble du clavier, tout ramène l’espoir de fuite
- à son point de départ,
- à ses frontières sonores et
- à sa rageuse inutilité
jusqu’à la violence de l’épuisement et de la renonciation. « Aubépine-arnica » s’aventure alors dans l’herbier du plasticien. Médiums et aigus contrastent avec la virulence de l’improvisation précédente. Ici, l’harmonie cherche
- la plante dans la note,
- le végétal dans l’audible,
- le vivant dans le martelé.
Rien de compassé pour autant. Jean Guillou travaille à découvrir et son sujet et ce qu’il en peut exprimer. Une impression
- de lâcher-prise,
- de respiration,
- de questionnement,
- de construction en cours
se fait jour. Elle
- dénarrativise l’improvisation,
- l’aide à se déprendre de schèmes préfabriqués, et
- paraît déconstruire l’intellectualisation systématique et parfois limitante
qui guide souvent l’improvisateur moyen, plus soucieux de proposer une cohérence évidente, cousue de fil blanc donc facile à décrypter par l’auditeur, que de jubiler de sa liberté – la liberté semble donc bien être un fil rouge réunissant les créations spontanées ici rassemblées.
Ce mix’n’match d’improvisations
- jaillissantes,
- méditatives ou
- programmatiques,
associé à la concision des pistes (entre deux et six minutes) contribue, à mi-parcours, à rendre l’écoute passionnante… bien que l’on regrette qu’Augure n’ait pas mis sinon l’intégralité du moins une improvisation ou deux sur YouTube afin de permettre à chacun de se faire une idée de ce programme puissamment stimulant. Nous évoquerons la seconde partie de la set-list dans une prochaine notule – et ceux qui seraient impatients d’écouter avec leurs oreilles plutôt qu’avec leurs yeux peuvent satisfaire leur fringale en commandant un exemplaire ici pour quinze euros.
À suivre !
L’art de Sylvie Carbonel (Skarbo) – 21/24
Onzième des Vingt regards sur l’enfant Jésus, la « Première communion de la Vierge » d’Olivier Messiaen considère que, « après l’annonciation, Marie adore Jésus en elle » en ces termes :
Mon Dieu, mon fils, mon Magnificat ! Mon amour sans bruit de paroles…
Les indications ne manquent pas pour accompagner le « thème de Dieu » : « Très lent » (mais avec des quadruples croches par paquets de douze), « intérieur » et « tendre ». Sylvie Carbonel y ajoute une once de délicatesse qui voisine avec l’imprévisibilité abondante de l’oiseau pimpant la récurrence du « thème de Dieu ».
- Gravité profonde,
- méticulosité nuancée et
- grâce déliée des traits ascendants comme descendants
précèdent la percussivité du magnificat.
- Tonicité variée des attaques,
- souplesse maîtrisée du tempo,
- capacité à prendre son temps sans déliter le propos et
- art de rendre presque tangible le mystère
quand bat « le cœur de l’enfant » et que le discours se suspend jusqu’au retour du thème liminaire tintent délicieusement à nos esgourdes.
Dans le troisième volume du Catalogue d’oiseaux se tapit « la chouette hulotte » aka strix aluco par les connaisseurs et les prétentieux. Son cri est
tantôt lugubre et douloureux, tantôt vague et inquiétant (…), tantôt vociféré dans l’épouvante comme un cri d’enfant assassiné.
Le choix de cette pièce est donc cohérent, même si la « Première communion » a été enregistrée en 1980 et les oiseaux en 1979 : si l’oiseau chantait dans le cœur de la Vierge, l’enfant assassiné qu’est le Christ chante dans le cri de la chouette. Pour nous rendre sensible cette circularité où l’oiseau, animal terrestre, symbolise schématiquement la tentation de l’homme de s’élever vers Dieu (tentation censée nous grandir mais pas nous empêcher de toujours nous poser sur notre branche…), Olivier Messiaen installe la nuit – une nuit
- fracassante,
- distordue,
- menaçante comme une gargouille.
Le son de casserole que rend le piano contribue curieusement à installer l’atmosphère pesante
- des ténèbres frappant en empoisonnant la forêt,
- de cris déchiquetant le silence,
- de ces moments étranges où l’on ne sait plus si l’on préfère le fracas flippant à l’absence terrifiante de bruits.
Comme l’aurait analysé Ricet Barrier, « ben c’est vachement pas gai ! » Les rapaces s’en mêlent – officiellement un hibou moyen-duc, une chouette chevêche et la fameuse chouette hulotte.
- À-coups du tempo,
- multiples formes de percussion,
- pédale incitant l’imaginaire à se repaître de longues et lugubres harmoniques
secouent une partition
- énergique,
- grondante et
- déchiquetée à souhait
où les jappements retentissants des oiseaux ajoutent à l’étrangeté « vague et terrifiante » que la virtuosité rythmique et digitale de Sylvie Carbonel rend néanmoins fort sapide. Tant mieux car, avec « l’alouette Lulu », qui succède à la chouette dans le Catalogue, on reste ensuqué dans la lenteur de la nuit. Cependant, cette fois, c’est le calme qui domine, avec un oiseau qui, « invisible, se rapproche, s’éloigne » et chante « deux en deux » des « descentes chromatiques et liquides ». Alentour, des arbres, des champs, du noir, la minuit. La pianiste
- travaille les accords nocturnes en insistant sur les octaves, comme pour mieux engoncer l’auditeur dans l’obscurité où il percevra mieux les cris de l’alouette,
- n’hésite pas à associer les charmes de la pédalisation floutante exigée par le compositeur et, quand la partition semble enfin sortir de sa léthargie, les contrastes ménagés par la partition
- (pulsation,
- attaque,
- intensité…) ;
- forge ses propres sonorités à partir
- des notes écrites et indubitables,
- des indications parfois satiesques (« comme un clavecin mêlé de gong ») invitant à une forme d’onirisme et
- des effets qu’elle obtient de son instrument, nonobstant le timbre disgracieux dont fait montre la bête soumise à ses volontés.
Un double dialogue se noue :
- un dialogue cosmique entre les motifs de la nuit et les interventions des oiseaux, et
- un dialogue ornithologique entre alouette et rossignol.
Cette démultiplication des échanges peut nourrir l’intérêt à une condition : que l’auditeur se déprenne de toute perspective narrative. Ici, les chants d’oiseaux viennent du silence et y retournent. Il n’y a pas d’histoire ou, plutôt, l’histoire racontée est qu’il n’y a pas d’histoire, tout juste de l’éphémère que la musique aspire à rendre persistant, pérenne voire transcendant. La pièce adopte donc une forme en arche qui laisse imaginer la cyclicité de la vie. Nous le savons bien que nous nous dépatouillions souvent pour l’oublier, nous
- naissons,
- nous ébattons,
- disparaissons.
Les chants d’oiseaux,
- attendus mais aléatoires,
- beaux mais difficilement déchiffrables,
- transposables au piano mais jamais vraisemblables,
méditent à leur manière terrestre et aérienne ce que médite la religion quand elle imagine que mettre au monde le Christ, c’est communier. Avec
- solennité,
- cahots et
- vitalité,
Sylvie Carbonel laisse poindre ici une compréhension
- intime,
- investie et
- personnelle
de ces pièces. Cet engagement
- intellectuel,
- artistique et
- sensible
touche en dépit de la rugosité des partitions mises sur le pupitre !
Pour acheter le coffret (env. 35 €), c’est par exemple çà.
Pour écouter le disque en intégrale et gratuitement, c’est par exemple là.
Pour retrouver les critiques précédentes du coffret
Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 1
Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 2
Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgsky
Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 1
Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 2
Le Cahier de musique de Jacques Desbrière
Franz Liszt – Totentanz
Franz Liszt – Sonate en si mineur
Franz Liszt – Deux harmonies poétiques et religieuses
De Bach à Granados – Un récital imaginaire
Ludwig van Beethoven – La Waldstein et plus
Carl Maria von Weber – Sonate pour flûte et piano
Wolfgang Amadeus Mozart – Troisième trio K.502 et plus
Frédéric Chopin – Trio en sol mineur
Johannes Brahms – Trio en Si
Robert Schumann – Humoreske op. 20
Johannes Brahms – Trio op. 114
Arnold Schönberg – Drei Klavierstücke op. 11
Charles-Valentin Alkan – Deux Motifs et +
Bizet et Debussy
À suivre !
Beatrice di Tenda, Opéra Bastille, 9 février 2024 – 1/2
Curieusement présenté comme un opéra féministe dans le narratif promotionnel, Beatrice di Tenda de Vincenzo Bellini, d’après un livret de Felice Romani adapté de Carlo Tedaldi-Fores, ressemble surtout à un échec commercial : le soir de la première, il reste des places dans toutes les catégories, ce qui est rarissime. Pourtant, le projet est prometteur : de gros airs, du chœur sous toutes ses formes et un bel orchestre – hé, what else?
L’histoire
Début du quinzième siècle. Après la mort de son héros d’époux, Beatrice s’est remariée avec Filippo Visconti. Le mec est devenu un bon tyran des familles, mais il a un double problème : il est jaloux de cette femme et il veut convoler avec une autre minette, Agnese. Un quadrilatère de la mort se dessine :
- Filippo veut coucher avec Agnese ;
- Agnese veut coucher avec Orombello, chef des grognons rebelles ;
- Orombello veut coucher avec Beatrice ; et
- Beatrice ne veut coucher avec personne, soucieuse de préserver sa relative pureté et son honneur, sa grande obsession.
Quand Orombello met un râteau à Agnese en lui disant qu’il préfère Beatrice, la rejetée se venge en montrant au boss qu’Orombello fricote avec Beatrice. Ceux-ci sont séance tenante condamnés à mort (première partie, 1 h 25). Après que les deux zozos ont été torturés, un long procès est censé formaliser leur condamnation. Las, Orombello revient sur ses aveux, arguant qu’ils lui ont été arrachés sous la torture. Mauvaise pioche : dans une décision dont l’intelligence rappelle la pertinence de notre justice actuelle, les deux supposés amants sont renvoyés à la question. Comme attendu, ils sont condamnés, et le tyran doit signer leur mise à mort. Après une ultime hésitation, malgré les supplications d’Agnese, repentante, il s’y résout, et voilà (seconde partie, 1 h 5).
La représentation – Première partie
Tout commence très mal. L’ouvreuse me regarde avec insistance puis finit par me demander ce qui la turlupine : « Vous êtes le médecin ? » La représentation étant sur le point de débuter, je n’ai pas le cœur à jouer. Aussitôt, elle panique et glisse dans son talkie : « Le médecin de salle n’est pas avec moi. Je répète : le médecin de salle n’est pas avec moi. Qu’est-ce qu’on fait ? » Les lumières s’éteignant, je n’aurai pas le fin mot de l’histoire.
Sur scène, on finit d’installer le décor de George Tsypin, un espace très vert plus qu’un espace vert. Deux grands arbres schématiquement esquissés encadrent une sorte de jardin où les massifs labyrinthiques ressemblent à des cadeaux bien emballés. À cour, en hauteur, une sorte de promontoire où les protagonistes féminins font une apparition. Beatrice di Tenda (Tamara Wilson) baguenaude sur scène puis sort, laissant la place à Filippo (Quinn Kelsey), furax. ses premiers mots aux fayots qui le suivent, sont : « M’è importuna… Io la detesto. »
La voix d’Agnese (Theresa Kronthaler), curieusement accompagnée par un faux guitariste sur scène, en rajoute une louche car le duc est croque d’elle mais tenu par les liens sacrés de son hyménée. Pour ses débuts à Bastille, Theresa Kronthaler prend ses marques. Certaines attaques semblent-elles floues lors de son premier couplet ? Ce serait le signe que la cantatrice est humaine et consciente de l’enjeu. Plutôt rassurant ! D’autant que, peu à peu, l’artiste dévoile
- la clarté de son timbre,
- la sérénité de respirations joliment suivies par la harpe en fosse et
- la solidité d’un souffle convaincant.
Quinn Kesley est gâté : après un air de colère, il se voit attribuer un air d’amour. Vincenzo Bellini multiplie
- les dispositifs (chœur, solo homme, solo femme, duo…),
- les orchestrations (solo harpe, ensemble, violons en pizz jouant les luths…) et
- les couleurs demandées aux chanteurs.
Cela rehausse un livret cousu de corde blanche et prompt à dégainer des scènes conventionnelles un rien balourdes, tel que ce quiproquo entre Agnese et Orombello (Pene Pati), où le gars pas très futé avoue qu’il fond pour Beatrice alors qu’Agnese s’apprêtait à lui déclarer sa flamme. Excité par son désir d’Agnese, le duc fait une scène à Beatrice. Quinn Kesley incarne avec métier le mélange très particulier de
- colère,
- mauvaise foi et
- mépris
qui anime son personnage à ce moment précis avant que seule la haine ne l’emporte. La mise en scène de Peter Sellars tend pourtant à contraindre les acteurs dans de petits périmètres, comme pour matérialiser la thématique de l’étouffement et de l’enfermement à la fois
- intime (le mariage enferme),
- social (la bienséance empêche) et
- politique (le pouvoir isole – et la fin l’illustrera en obligeant le duc à se barricader dans son palais quand la révolte grondera).
On aurait pu rêver d’une direction d’acteurs plus fine voire plus affirmée : le niveau de jeu moyen dépasse à peine celui d’une MJC, même avant Rachida Dati. Heureusement, les artistes ne lâchent pas l’affaire musicalement. Ainsi, dans le duo où il révèle à Beatrice que, non, tout le monde ne l’a pas abandonné, Pene Pati brille par
- la tenue,
- l’incarnation vocale et
- un précieux souci de nuancer (superbes decrescendi).
Tamara Wilson, dont on ne compte pas les airs pyrotechniques, ne lui cède en rien.
- Attaques,
- legati,
- vocalises spectaculaires,
- musicalité,
- agogique,
tout est
- impressionnant,
- efficace,
- fin, donc, parfois, malgré un scénario étique,
- émouvant.
La direction de Mark Wigglesworth séduit elle aussi tant elle paraît
- contrastée,
- précise et
- attentive aux chanteurs.
Pendant ce temps, tapie derrière un sapin en plastique, Agnese épie son ex futur mec qui drague la duchesse. Elle le dénonce à celui qui la drague. La confrontation avec Filippo permet à Tamara Wilson d’aller au-delà de son rôle de brave nana trahie.
- Ire,
- stupeur et
- incompréhension
l’habitent quand elle évoque le « duolo d’un cor piagato ». En sus des suraigus faciles, la soprano démontre qu’elle a du médium et du grave à volonté – on comprend presque mieux comment la dame peut chanter à peu près tout de Haendel à Wagner.
- Expressivité,
- ténacité,
- variations
ravissent, tandis que Quinn Kesley creuse brillamment – si une lumière noire brille – la veine de la colère rentrée propre à la jalousie. Comme de nos jours, la confrontation érotico-politique oscille entre
- tendresse plus ou moins calculée,
- fureurs toujours sincères, et
- promesses de dupes
tandis que le compositeur drape ce slow mortifère d’une musique mignonnette d’une virulence d’autant plus dramatique qu’elle est celée. L’orchestre donne son meilleur :
- sûreté,
- tonicité,
- suavité et
- réactivité
émanent de la fosse. On regrette d’autant plus le niveau consternant de la mise en scène, avec choriste masquée, GIGN avec FAMAS, types en hoodie, en costard-cravate ou en Perfecto, bref, costumes passe-partout de Camille Assaf. Le chœur se promène, les femmes sortent, tout cela manque de sens, d’énergie, d’ambition. Heureusement, il y a la partition. Après les déchirements, les confrontations en duo puis trio, voici les hommes de l’Opéra qui s’imposent. Pour le reste, on ne comprend rien : le duc passe, Beatrice apparaît au balcon à cour, le chœur déambule (pour mimer l’indécision du duc ?), on essaye de croire que l’espoir d’un autre monde n’est pas inaccessible.
Mais la paresse – ô euphémisme – de la mise en scène à Bastille, c’est quelque chose ! Quand Beatrice revient, elle mate son cellulaire. Quand on crie à un personnage « Relève-toi », il n’est pas à terre. Des jardiniers taillent les massifs en plastique. C’est fffatigant et, plus spécifiquement, désobligeant. Pas étonnant si Agnese semble parfois peiner dans ses départs : la partition est d’une profusion passionnante, et la direction scénique n’a rien à raconter (ha ! les décors en transparence dont, sans décodeur, on ne peut rien comprendre ! ha ! la fausse bataille entre Filippo et Orombello empêchée par le GIGN ! ha ! etc.). Restent
- le talent de Vincenzo Bellini,
- l’engagement des artistes et
- la dynamique que paraît impulser le chef.
Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas tout non plus.
À suivre !
Alain Fourchotte, “Cordes tressées” (Triton) – 3/4
Après un trio puis un duo, voici venu le temps d’un quatuor : la monographie d’Alain Fouchotte joue la carte de la diversité. En témoigne cette pièce en cinq actes, composée en 2009. Le premier mouvement s’engage sur des terres mouvementées et dramatiques entre
- attaques et tremblements,
- grave et suraigu,
- permanences et mutations de motifs reconnaissables.
Le compositeur triture l’atmosphère tendue qu’il a installée d’emblée. Il coalise les deux violons, les confronte au violoncelle, les envoie chercher une échappatoire dans les cimes du son et paraît prendre plaisir à observer ce qui sourd de ses manigances.
- Striures sonores,
- explosions rageuses et
- suspensions inquiétantes
habitent un espace sonore encore plus agité qu’intranquille. Le deuxième mouvement part sur des bases plus contemplatives sans lâcher la propension au suraigu des violons de Saskia Lethiec et Pierre-Olivier Queyras, comme une quête d’impossible toujours inachevée (et hop). La suspension du chaos se suspend à son tour et va quérir un nouveau souffle sous les archets de Vinciane Béranger et David Louwerse. Promptement, l’appel des hauteurs élève le débat. Le troisième tiers du mouvement synthétise à quatre voix les deux tentations de la gravité et de l’élévation jusqu’à manière d’apaisement.
Le troisième mouvement laisse libre cours à une cavalcade collective ponctuée de claques cinglantes.
- L’usage multiple de l’archet,
- les variations d’intensité puissamment mises en valeur par les interprètes,
- les ruptures de propos,
- le recours à la percussion des pizzicati,
- l’exploration de motifs obsédants qui finissent par se mélanger et
- la judicieuse concision du mouvement
attisent l’intérêt. Le quatrième mouvement s’ouvre sur les suraigus en nappe qu’enrichit sporadiquement la voix flûtée de l’alto.
- Énoncés planants puis contrastés,
- confrontation entre temps long et ruptures sèches,
- emballements progressifs paraissant rechigner à aboutir
captent efficacement l’attention – la prise de son de Philippe Malidin contribue à la réussite narrative de cet épisode. Le cinquième mouvement, avec ses glissendi, diffuse une esthétique presque dansante où la gaieté et l’inquiétude semblent inséparables. Les interprètes font rutiler une partition qui malaxe autant la pâte du quatuor que la pâte du son
- (précis,
- fuyant,
- percuté,
- frotté,
- trillé…).
Au dernier tiers, l’inquiétude l’emporte sur l’ivresse de la joie. Sans renoncer totalement aux formules liminaires, le récit devient davantage saccadé, interrogatif, hésitant, comme si la dynamique
- du questionnement,
- de l’itération et
- de l’énigmatique
se révélait être une caractéristique esthétique essentielle de la musique d’Alain Fourchotte. Nous aurons l’occasion de le vérifier à l’occasion de la prochaine notule qui évoquera le Freundlich Trio du compositeur, dernière pièce de son disque Cordes tressées.
À suivre !
L’art de Sylvie Carbonel (Skarbo) – 20/24
Des lieder sans parole, même en 1866, ça n’a rien de bien nouveau ! Felix Mendelssohn-Bartholdy a bouclé ses huit recueils en 1845. Pourtant, Les Chants du Rhin ont leur petite originalité : ce sont des chants sans paroles mais avec du texte puisque Joseph Méry a écrit des stances spécialement pour inspirer le compositeur. Je vous parle d’un temps où il était encore de bon ton de se laisser aller à des rêveries germanophiles. Quatre ans plus tard, la guerre allait couper court à ces fantasmes.
Parmi les six chants louant ce Rhin qui « créa Gluck, Weber, Beethoven et Mozart », Sylvie Carbonel en a choisi deux qui complètent le récital de musique française reconstitué par Skarbo dans son florilège. « L’aurore » décrit « l »heure première » donc les « concerts de l’aurore, / de la brise du fleuve et du chant des oiseaux ». L’andantino espressivo et legatissimo associe les ondulations de doubles croches en 3/8 à l’irisation de la mélodie confiée au soprano.
- Tempo décidé,
- tonicité des attaques et
- rigueur métronomique à peine troublée par quelques effets de détente ou de tension
dessinent un Georges Bizet à mille lieues du sentimentalisme souvent de mise dans ce répertoire. Sylvie Carbonel peint la vie qui part à l’assaut du quotidien plus que la poésie de circonstance avec les doigts de fée de l’aurore, le souffle du vent et la bleuisation diurne de l’obscurité.
« Les rêves », second extrait choisi, sont ceux des « jeunes bûcherons » voguant « sans péril » dans leur « barque oisive » et voyant – privilège du songe – soudain « rajeunir le vieux peuple germain ». Si l’on reste en ternaire (9/8 après 3/4), l’on avance un chouïa dans la gamme puisque, à l’Ut liminaire, répond ici le Ré bémol. L’andante ma non troppo se faufile sur un moteur de croches qui suit une mélodie langoureuse.
- Délicatesse du toucher,
- finesse du rendu polyphonique avec ses contrechants,
- sens des contrastes (l’on entend bien tonner le retour de vigueur germain !)
font délicatement balancer la valse de la barque. Après le fleuve, l’île ; l’inspiration littéraire, voici que la musique puise sa source dans la peinture. « Le Pèlerinage à l’île de Cythère » d’Antoine Watteau aurait déclenché l’écriture de « L’Isle joyeuse » par Claude Debussy, passage obligé de tout étudiant pianiste – la version proposée date de 1964, quand miss Carbonel travaillait sous la férule d’Yvonne Lefébure au Conservatoire de Paris. Le prologue marqué « quasi una cadenza » fuse avec autorité et énergie vers un « tempo modéré et très souple » aux accents hispaniques assumés.
- Profondeur des graves,
- effet roboratif des triolets de doubles croches,
- souffle des crescendi,
- tension du contraste entre ternaire et binaire,
- art de la respiration contrastant avec la fougue indifférente aux difficultés techniques et musicales,
- placidité des modulations,
- clarté des aigus et
- maîtrise des différents registres
dépassent les qualités attendues telles que
- le brio,
- la cohérence et
- la largeur du spectre sonore
pour les habiller d’une étoffe musicale perpétuellement tendue dont l’éclat laisse entrevoir la cohérence d’une interprète depuis ses débuts radiophoniques jusqu’à ses derniers enregistrements.
Décidément, il ne faut pas compter sur Sylvie Carbonel pour
- le mignard,
- le sentimentalisme facile ou
- les petits arrangements avec le texte qui simplifient pourtant grandement la vie.
La musicienne n’a pas besoin de
- de truquer,
- de feindre la larmichette pratique ou
- d’utiliser les stratagèmes marketing
qui permettent à de jeunes dames plus aguicheuses que techniquement bien achalandées de parader sur les plus grandes scènes du monde en tenues olé-olé en dépit d’un niveau et d’une ambition artistique médiocres à l’aune de l’excellence en général requise à ces cimes. Sylvie Carbonel ne fabrique pas, ne plaisante pas, croit à la musique qu’elle joue et envoie le bois qui va bien. De quoi mettre en appétit pour les trois extraits d’Olivier Messiaen que nous évoquerons à l’occasion de la prochaine notule !
Pour acheter le coffret (env. 35 €), c’est par exemple çà.
Pour écouter le disque en intégrale et gratuitement, c’est par exemple là.
Pour retrouver les critiques précédentes du coffret
Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 1
Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 2
Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgsky
Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 1
Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 2
Le Cahier de musique de Jacques Desbrière
Franz Liszt – Totentanz
Franz Liszt – Sonate en si mineur
Franz Liszt – Deux harmonies poétiques et religieuses
De Bach à Granados – Un récital imaginaire
Ludwig van Beethoven – La Waldstein et plus
Carl Maria von Weber – Sonate pour flûte et piano
Wolfgang Amadeus Mozart – Troisième trio K.502 et plus
Frédéric Chopin – Trio en sol mineur
Johannes Brahms – Trio en Si
Robert Schumann – Humoreske op. 20
Johannes Brahms – Trio op. 114
Arnold Schönberg – Drei Klavierstücke op. 11
Charles-Valentin Alkan – Deux Motifs et +
À suivre !
Tristan Pfaff & friends, Salle Gaveau, 7 février 2024 – 1/4
« Dans la musique, j’aime deux choses, expliquait feu Dio, chanteur de metal de son état : la musique et la camaraderie. » Sans doute Tristan Pfaff n’aurait-il point expliqué autrement son désir de transformer son récital à Gaveau par une scène partagée avec la soprano Erminie Blondel, la mezzo Marie Gautrot, le baryton Laurent Arcaro, le violoniste Alexis Cardenas et la violoncelliste Julie Sevilla-Fraysse. Après un passage triomphal dans la salle pour célébrer ses trente ans (une aventure à rebondissements qu’il raconte ici), le voici de retour pour un programme copieux mêlant Chopin et Messager, Saint-Saëns et Szymanowki, Schubert/Liszt et Offenbach, etc. Sur la set-list, vingt titres, autant de façons d’être sur scène et de jouer du piano.
Néanmoins, soyons sérieux, l’affaire commence comme elle se doit par un double solo claquant d’emblée deux tubes de Franz (Schubert) remixés par Franz (Liszt). Ce pourrait être une astuce visant à se mettre le public dans sa poche, et pourquoi pas ? C’est ça, et c’est plus que ça. En quelques minutes, pas les plus ouvertement spectaculaires du répertoire, l’artiste happe le public dans son piano. Il y a un truc : il a trouvé le moyen de faire ressortir la mélodie par le toucher plus que par l’intensité du son. Autour de nous, les pauvres à 25 €, pas de programme (payant), donc les dames modernes s’affairent pour shazamer la Sérénade puis – si, si – l’Ave Maria (« je le savais », prétend la menteuse à sa copine). Pendant qu’elles s’affairent, l’interprète déploie trois autres capacités qui contribuent à forger sa patte :
- la capacité à faire sonner le clavier non comme un collectif de marteaux mais comme une palette de possibles ;
- la capacité à caractériser chaque registre avec une différenciation polyphonique saisissante ; et
- la capacité de rendre vibrant tel passage en particulier grâce à la magie cumulable
- du toucher,
- du phrasé et
- de l’agogique.
L’Ave Maria revêt une gravité particulière que l’interprète dédramatise et déploie simultanément en associant la rigueur motorique de l’accompagnement et la souplesse sporadique de tempo qui permet de faire respirer la musique – sans respiration, la musique n’est pas la musique, elle n’est qu’une série de notes. Pour un peu, l’on en oublierait presque que l’on est en terrain connu ; car, oubliant presque le savoir-faire nécessaire pour que sonne cette transcription, on se laisse porter par
- l’évidence de l’excellente technique,
- l’habileté des nuances piano et
- l’investissement du pianiste
qui, sans mimique, sans torsion du buste, sans effet de manche, bref, sans visibilisation de sa vie intérieure nous convainc que, par-delà la rengaine, se trame ici une histoire importante. Erminie Blondel et Marie Gautrot le rejoignent pour « Pleurs d’or » que Gabriel Fauré a tirés (à sa façon) de « Larmes » d’Albert Samain. Cette fois, le piano se coule dans le flot ternaire de croches qui enveloppe les larmes
- de la nature,
- du temps qui passe,
- de l’espoir un rien désespéré qui s’appelle foi,
- du cosmos allant du jour à la nuit et
- des amours, ces délices d’humains.
Une troisième vocaliste apparaît pour « Après un rêve » : voici Julie Sevilla-Fraysse et son violoncelle pour cet earworm un rien sali par Gautier Capuçon venu le jouer (sans bande-son enregistrée ni sponsoring de la Société générale, pour une fois) afin de fêter le cramage de Notre-Dame par un mythique mégot en s’assurant une petite promo des familles – tu parles d’un rêve… La mélodie originelle reprenait un texte de Romain Bussine où le narrateur ne peut que regretter les mensonges de la nuit. Julie Sevilla-Fraysse se débarrasse des mots avec brio, armée d’un vibrato sans pathos et d’un piano tant attentif que délicat dans les entrelacements ménagés par la partition.
De Jocelyn de Benjamin Godard, ne subsiste guère que la « Berceuse » dont le texte prolonge subtilement celui qui avait suscité « Après un rêve » (« Oh, ne t’éveille pas encor / Pour qu’un bel ange de ton rêve / (…) permette qu’il s’achève). Au duo violoncelle et piano s’associe donc Marie Gautrot. Certes, du fond et des hauteurs de la salle, les intentions se perçoivent davantage que ne se distinguent les mots. Toutefois, l’on devine une voix
- souple,
- ferme dans les graves et
- déliée dans l’aigu.
Quant à la reprise instrumentale au violoncelle, elle fait assaut de poésie non-verbale :
- attaques,
- vibrato et
- phrasé
sont tenus, pensés et pertinents.
Premier des Mythes op. 30, « La fontaine d’Aréthuse » de Karol Szymanowski se réfère aux Métamorphoses d’Ovide où le fleuve Alphée tombe croque dingue d’Aréthuse après qu’elle s’est baignée dans ses eaux – enough said, nous ne sommes pas ici pour jauger l’état mental des auteurs antiques, ce me semble. Signe d’un programme à la fois varié dans les formations requises et très cohérent dans sa conception, le rêve évoqué lors des précédents morceaux persiste et mute. Le voici mythe, désormais, et porté par une partition aussi redoutable que magnifique, avec
- rythme chaloupé,
- évidences troubles et
- magnétisme immédiat.
Le chromatisme, semblant mimer le désir qu’a Alphée d’agripper Aréthuse (pourquoi diable l’auditeur n’aurait-il point le droit à quelque fantasme érotique ?), structure un discours à la fois intense et vaporeux, mêlant
- le mystère des triples croches du piano,
- les perpétuelles mutations rythmiques
- (mesures,
- tempi,
- accents,
- mouvements contradictoires…) , et
- l’onirisme du violon d’Alexis Cardenas,
- mystique dans les suraigus,
- songeur dans les glissendi,
- ambigu dans les doubles cordes, et
- imprévisible dans ses attaques.
Sans être réductible au programme qu’elle assume cependant, la musique mime avec gourmandise l’insaisissabilité de la déesse par l’eau
- en faisant froufrouter le clapotis des trilles,
- en pêle-mêlant synchronisations puissantes et décalages subtils, et
- en se gobergeant des à-coups aléatoires de l’eau.
S’associent
- virtuosité,
- musicalité et
- complicité des deux partenaires.
Palpitant et délicieux.
À suivre !
Fruits de la vigne – Château La Bridane 2017
Les appellations prestigieuses justifient-elles leur pricing power ? En parallèle de notre série sur « Que boire à Paris pour 10 € or something”, cette question traverse la présente rubrique et s’intéresse cette fois à un Saint-Julien vendu 22 € aux Galeries Lafayette et pas forcément moins cher sur Internet, au contraire.
La robe affiche un très joli rouge soutenu aux accents sombres. Il y a de la volonté, de la tonicité, de la friction, et c’est évidemment prometteur – sauf si on préfère le rosé sans alcool à goût de rose, évidemment.
Le nez hésite à s’affirmer. À force de le taquiner, il nous confie quelques sentiments tirant – ce n’était pas prévu – vers l’agrume, spécifiquement vers le pamplemousse.
La bouche est légère (cabernet sauvignon et merlot pour l’essentiel), et parée d’une savoureuse amertume qui retourne dans les naseaux après dégustation. Les cépages y préparent, mais mieux vaut prévenir : point de rondeur à attendre, ce qui n’ôte pas une possibilité de come-back pour ceux qui savent attendre.
Le mariage chic associant la quille aux pâtes fraîches aux girolles et au foie gras est pertinent. Le vin n’y gagne pas une aura du reste inattendue, mais sa discrète solidité remplit le job pour lequel il fut engagé. Si le résultat paraît un rien frustrant , comme l’eût écrit Armand Robin,
j’aurai pour m’apaiser toute la terre consolée
(Armand Robin, in : Le Monde d’une voix [1963], in : Mon beau navire ô ma mémoire. Un siècle de poésie française chez Gallimard, Gallimard, « Poésie », 2011, p. 164)
L’art de Sylvie Carbonel (Skarbo) – 19/24
Second récital imaginaire proposé par le coffret Sylvie Carbonel que vient de mettre en vente Skarbo, enregistré en 1963 et 1980, le programme de musique française – cité en gros dans l’image supra – met plus qu’en appétit. En effet,
- cacher le composite sous l’unité peut donner un guide d’écoute, fût-il techniquement artificiel ;
- associer une série de quinze pièces pour la plupart peu connues offre une variété d’écoute stimulante ; et
- donner l’occasion, selon une astuce bien connue des programmateurs les plus audacieux, de découvrir des compositeurs moins joués que la superstar Debussy tout en rassurant l’auditeur avec des repères qu’il a, contribue à inciter à une écoute gourmande, confortable et sapide.
Ajoutons que parcourir dix-sept ans d’enregistrement devrait nous aider à appréhender non pas l’évolution d’un style (les compositeurs sont présentés par date de naissance, à l’exception de Messiaen, placé avant Georges Hugon alors qu’il est né quatre ans plus tard, les dates d’enregistrement s’en trouvant mélangées) mais différentes facettes d’une même interprète. Et l’affaire commence par de plaisantes miniatures tirées des 48 motifs ou esquisses op. 63 de Charles-Valentin Alkan, compositeur qui nous intéressera dans la présente notule. Le recueil associe
- le fonctionnel (l’essentiel des pièces vise à faire progresser le bon pianiste amateur, légion à l’époque, sur diverses techniques),
- le salonnard, sans « p », car les titres des morceaux sont tous évocateurs d’une plaisante musique programmatique, de la « Petite marche villageoise » à la « Pseudo-naïveté », et
- le ravissant tant Alkan, qu’il compose de grandes œuvres ou de rapides aquarelles, savait y faire, comme qu’on disait jadis et naguère.
Il est joyeux que de grands interprètes réhabilitent, fût-ce fugacement, ces traces d’une époque révolue dont les charmes tintinnabulent pourtant si bien à nos esgourdes encrassées
- de bruit,
- de pompe et
- d’emphase,
comme si le plaisir des mélomanes se devait limiter aux véritables chefffffffs-d’œuvre définitivement épinglés par Ceux Qui Savent À Notre Place. Contre toute évidence se faufile donc « Morituri te salutant » avec ses cinq dièses à la clef pour ce salut des futurs défunts en Si.
- La marche chromatique des triolets,
- la vibration des ultragraves,
- les jeux harmoniques,
- les changements de registre et
- la terrible régularité égrenée par des notes isolées ou lestées d’accords amplifiant la marche
dessinent l’inéluctabilité du destin que, fidèle à la manière esquissée par les huit disques précédents, Sylvie Carbonel rend sans pathos ni effets visant à dramatiser ce qui est déjà bien assez dramatique. « Innocenzia » répond aux cinq dièses par les cinq bémols de la tonalité de Ré bémol. Bien que la pièce soit bardée d’indications (« assez doucement », « amabilmente », « dolce e legato »), elle ne pèse que deux systèmes et se résume à soixante-quinze secondes de musique.
- Le balancement du 6/8,
- les rythmes pointés,
- les appogiatures et
- la délicatesse de l’interprétation
ne manquent pas de charme à la fois suranné et efficace, les deux épithètes se complétant plus que se frictionnant. Que diable ! serait-il pas plus que triste de ne limiter nos écoutes qu’aux plus sombres sonates noires tissant l’obscurité d’Alexandre Scriabine ?
La réponse est dans la question que pose la « Barcarolle » en sol mineur non pas la plus connue, extraite du Troisième recueil de chants op. 65, mais celle incluse dans l’op. 67.
- La précision de l’accompagnement,
- la clarté de la main droite et
- la qualité de la pédalisation auréolante mais non flouteuse (je tente)
rendent justice de l’inventivité de cette petite pièce
- (chromatismes,
- passage au mode majeur,
- savoureuses étrangetés harmoniques,
- effets dramatiques…)
et nourrissent l’intérêt jusqu’à l’inattendue tierce picarde conclusive. Et puis, voilà, vient le moment où, se gobergeât-on de délicatesse, de finesse et d’élégance, l’on n’y peut mais : l’on attend quand même de la pianiste qu’elle dégaine un truc un peu spectaculaire qui nous rappelle pourquoi, en dépit des apparences, elle n’est pas tout à fait humaine. Extrait des Douze études sur tous les tons mineurs op. 39, le Scherzo diabolico en sol mineur est là pour ça. Pas que, sans doute, mais aussi, très probablement. À ce jour, c’est d’ailleurs la vidéo du disque la plus regardée sur YouTube. Hasard ou réalité scientifique ?
La pièce est
- brillante,
- mutante,
- chantante autant que percussive et réciproquement.
Au long de ses moins de cinq minutes,
- notes tenues,
- bariolages opposés,
- ruptures haletantes et
- récurrences à suspense
alimentent l’effet wow de la célérité. Cette sensation est d’autant plus vive que l’interprète, apparemment insensible à la difficulté de gigoter les chipolatas, joue de toute sa palette instrumentale.
- Attaques,
- legato,
- tenue de la note ou effacement soudain,
- fondus de motifs ou opposition frontale
font d’une partition électrique un moment musical si sémillant que même les micros de Radio France choisissent d’accepter la saturation quand un triple forte marque le passage en majeur. Tant mieux. Ce côté entre punk et grunge sied à la partition. Il y a
- de la rage,
- du swing,
- de l’inattendu,
- du plaisamment répétitif, bref,
- de la vie et même, ce qui ne va pas de soi,
- de l’espoir manifesté par le retour in extremis du majeur (le mode, pas le doigt),
le tout supérieurement sublimé, derrière l’exercice de style, par le compositeur et sa porte-voix qui le prend amoureusement au sérieux.
Pour acheter le coffret (env. 35 €), c’est par exemple çà.
Pour écouter le disque en intégrale et gratuitement, c’est par exemple là.
Pour retrouver les critiques précédentes du coffret
Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 1
Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 2
Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgsky
Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 1
Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 2
Le Cahier de musique de Jacques Desbrière
Franz Liszt – Totentanz
Franz Liszt – Sonate en si mineur
Franz Liszt – Deux harmonies poétiques et religieuses
De Bach à Granados – Un récital imaginaire
Ludwig van Beethoven – La Waldstein et plus
Carl Maria von Weber – Sonate pour flûte et piano
Wolfgang Amadeus Mozart – Troisième trio K.502 et plus
Frédéric Chopin – Trio en sol mineur
Johannes Brahms – Trio en Si
Robert Schumann – Humoreske op. 20
Johannes Brahms – Trio op.114
Arnold Schönberg – Drei Klavierstücke op. 11
À suivre !
Prochaine notule : Bizet + Debussy.