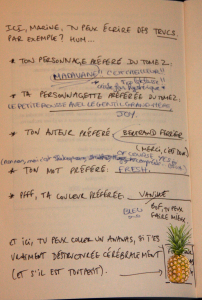Salle Pleyel, 5 novembre 2012
 Le Pittsburgh Symphony Orchestra, dirigé par Manfred Honeck, se fait payer une tournée en Europe. Le 5 novembre, elle passait, chic, par Paris. Au programme : du tube et une petite originalité locale.
Le Pittsburgh Symphony Orchestra, dirigé par Manfred Honeck, se fait payer une tournée en Europe. Le 5 novembre, elle passait, chic, par Paris. Au programme : du tube et une petite originalité locale.
L’originalité ouvre le concert : nous avons sans doute entendu la création française de Silent Spring. Avec cette pièce d’une vingtaine de minutes, Steven Stucky, né en 1949, met en musique l’oeuvre écolo de Rachel Carson (dont la fondation co-finançait la compo). L’oeuvre s’ouvre sur des accents vaguement – ah, ah, on parle de mer – debussystes, puis, plutôt contemplative, alterne entre longues plages – hou, hou – et contrastes mettant en valeur le grand orchestre. Dans sa note d’intention, le compositeur revendique de travailler dans le domaine de la vie « émotionnelle », qui est « tout sauf spécifique, sémantique ou représentative ». En clair, le résultat, faisant montre d’un métier certain, est consonant, plutôt mignon sans être excessivement cucul. On regrette toutefois la pointe d’épices ou le style personnel qui donnerait envie d’en savoir plus sur ce compositeur dont on ignorait tout. Ce manque apparent de mordant s’expliquera-t-il par la nécessité de contenter les commanditaires ?
C’est en tout cas la tradition qui, après cette ouverture locale, exige un gros morceau avec soliste. Sur le grill ce soir-là, le Concerto pour violon en ré mineur de Jean Sibelius. L’archet est tenu par Nikolaj Znaider, qui présente la particularité d’avoir aussi été le chef de l’orchestre. L’oeuvre est techniquement redoutable : on raconte qu’elle permettait au compositeur de se venger des violonistes, lui-même ayant été recalé à une audition du Philharmonique de Vienne. Pourtant, rien de bien sorcier pour Nikolaj Znajder. Il est l’homme de la situation, faisant preuve d’une solidité tant physique que sonore et scénique (parfois, ça fait zizir de voir un virtuose qui semble heureux d’être sur scène et de jouer pour un public !). Le musicien dialogue avec l’orchestre quand il le souhaite, puis laisse les manettes à Manfred Honeck lors des passages où les contretemps dissocient le soliste de ses accompagnateurs. Malgré quelques passages où des décalages semblent perceptibles, et en dépit de cordes du Guarnerius – sponsorisé par les fenêtres Velux, lumineux – qui paraissent peiner à garder leur justesse (l’accord avant le dernier mouvement est un soulagement), le résultat palpite… du moins pour l’interprétation de Znaider. L’orchestre, lui, sonne atone. On craint donc le pire pour ce qui se passera après la pause…
En effet, un douiche et un coup de houblon plus tard, l’orchestre s’attaque au tube symphonique que la programmation polie impose. En l’occurrence, c’est parti pour la Neuvième symphonie en mi mineur de Dvorak, comme on dit quand on n’a pas d’accent à son clavier. Une surprise attend le public, et elle est de taille ! D’emblée, l’orchestre paraît métamorphosé. Le chef dirige par coeur et se transforme en un acteur de muet. Le voici extraverti, bondissant, moulinant, balayant l’orchestre de larges gestes, dansant sur son estrade comme un petit pois mexicain entre les fesses d’une ample dondon. Les zicosses pittsburghiens (?) le suivent d’emblée dans des tempi extrêmes, tour à tour échevelés puis redoutablement dilatés. L’auditeur est saisi par l’engagement requis et la vision spectaculaire de la pièce. Ces signes distinctifs sont-ils personnels – Manfred Honeck affirme faire de cette pièce « un enjeu personnel » dans le programme distribué au public ? ou signalent-ils une interprétation à l’américaine, via cette tendance à tout surligner voire à en faire des caisses, entre musicologie (le chef préférant mettre en avant le tchèque sound au détriment du « Nouveau monde » évoqué par l’exilé), délires (« Dvorak aurait certainement été ravi d’apprendre qu’Aldrin écoutait, semble-t-il, sa symphonie durant son vol vers la Lune ») et, disons-le, soupçons de mauvais goût. Reconnaissons que cette version n’hésite pas à associer délicatesse sporadique, souffle tempétueux et contrastes poussés au plus haut. Dès lors, il faut apprécier les décalages apparents et les fausses notes patentes à l’aune de cette originalité…
D’ailleurs, as far as we are concerned, c’est bien cela qui prédomine, avant les deux bis caricaturaux (la fanfare et le ploumploum pour faire pleurer les grands-mères) offerts comme il se doit par l’orchestre en tournée : le plaisir d’une interprétation, certes imparfaitement maîtrisée, loin du « beau son », excessive donc emportée, d’un pilier du répertoire symphonique, dont nous avions entendu une lecture tristounette tantôt. Même si la précision manque, cette version clinquante, improbable, exotique, séduit l’auditeur venu, après tout, pour ouïr un orchestre américain dans sa spécificité allogène. Vivent, donc, les bizarreries joyeuses !
Concert presque bien dans deux jours !
Vendredi. 20 h 30. Harmonie Café. Concert. Plein de chansons. Dont des inédites et des inattendues. Des nouveautés et des classiques.
L’ignoriez-vous ? Pour les minuscules chanteurs de mon acabit, tout spectateur en sus est une source de pomme-pet-deup. Donc si vous êtes là, ce sera bien. Ou, à la rigueur, presque bien (voir infra).
Entrée gratuite. Ambiance bar. 35, boulevard Magenta. 75010. Infos, plan d’accès et détails ici.
Mes idées débiles, 07
– Faut pas craquer… C’est dans la tête… Faut pas craquer !
– Tiens, une pistache qui parle. Bonjour, pistache !
Chanson légère
Si toi aussi tu crois au couple, this song is for you. Et en plus, elle est light. Le foot intégral.
Gilles Barraqué est « Au Ventre du Monde »
 C’est quelque part, environ jadis, dans une manière d’îles Marquises. Il y a un grand-père, une petite-fille, une communauté, l’eau, le destin. Et donc un roman, Au Ventre du Monde (280 p., 15,2 €, soit cinq centimes la page), le premier texte que Gilles Barraqué publie à l’école des loisirs.
C’est quelque part, environ jadis, dans une manière d’îles Marquises. Il y a un grand-père, une petite-fille, une communauté, l’eau, le destin. Et donc un roman, Au Ventre du Monde (280 p., 15,2 €, soit cinq centimes la page), le premier texte que Gilles Barraqué publie à l’école des loisirs.
L’histoire
Comme l’exigent les clichés des livres pour la jeunesse promis non-sexistes, Paohétama a beau être une fille, elle refuse la soumission des damoiselles. Quand son grand-père pêcheur obtient qu’elle devienne son apprentie, elle doit – c’est la première partie – se garçonniser en se rasant la tête et en jouant avec les petits mâles, ce qui est autorisé car, est-il martelé, elle n’a pas eu « ses premiers sangs ». Voici alors la fille-garçon à l’école de la pêche, entre poissons dangereux, maîtrise de l’hybris, connaissance des coquillages, art du tissage de fil, respect des équilibres écologiques et croyances aux dieux des éléments. Lesquels, un jour où son père avait osé attaquer un thon et un requin, ont exigé la disparition d’une victime expiatoire supplémentaire : la mère de la narratrice. Or, Paohétama, une fois formée (j’ai pas fini) au sacerdoce de la pêche, alors que s’éteint son grand-père, démoralisé par la disparition de son grigris flottant, Paohétama, donc, décide d’aller régler (ha, ha) ses comptes avec les divinités.
Pour cette seconde partie, elle se rend au Ventre du Monde, loin du rivage, récupérer une perle dans un coquillage géant. Elle échoue sur une île réputée être l’Autre Monde, où elle rencontre le beau Mani, marcheur solitaire dont elle voudrait bien un gros, gros câlin (« reprends-moi dans tes bras, espèce de garçon », 203). Quand elle ne conte pas fleurette, elle apprend que : un, pour les gens de l’Autre Monde, l’Autre Monde, c’est son pays à elle, ce qui implique d’accepter la différence, la diversité, l’autre, gnagnagna ; deux, sa mère a « fait souche » ici lors de sa « disparition » ; et trois, munie de sa perle, elle, Paohétama, deviendra reine de l’Autre Monde même si, est-il maintes fois répété, elle a « besoin de temps » pour se trouver elle-même au niveau de la compréhension introspective de ce qui s’est passé, gnagnagna. Bref, grâce à elle, les deux Mondes qui s’ignorent pourront vivre en harmonie, réunifiés par sa personne exceptionnelle.
L’épilogue heureux, et pourquoi pas, renoue avec le topos attendu de la narratrice à la veille de sa mort, qui rrrrrefait le point sur les heureux événements survenus au cours des décennies passées, dont, pouvait-il en être autrement ? point, son mariage avec désormais feu Mani. Femme moderne, oui, mais n’abusons pas, n’a-bu-sons-pas.
L’avis
D’emblée, l’auteur assume nombre d’archétypes du roman pour la jeunesse. La narration est assurée par une fille, indépendante-mais-respectueuse, un peu sauvage mais soucieuse d’hygiène (par opposition au sorcier-qui-pue), prête à se soumettre aux enseignements d’une figure sapientale écolo avant la lettre. Elle a un trauma familial et un destin exceptionnel alla Harry Potter ; et elle est quand même sensible à l’amûûûr – les passages que nous préférâmes furent ainsi les pages, certes un peu appuyées mais bon, narrant sa rencontre avec Mani. Ces codes posés, acceptés, il est cependant difficile de se laisser séduire par ces bons sauvages modernes et par le cadre pourtant préservé de l’archipel supposé paradisiaque. Et ce, pour deux grandes raisons.
Première raison de la déception, les effets de pédagogie pédante, manifestés par l’insertion de mots indigènes traduits par de pénibles notes de bas de page. Non seulement ce côté infotainment du « j’apprends en m’amusant » m’escagasse, mais il pose deux problèmes : d’une part, cela casse l’effet romanesque (qui annote, puisque ce n’est pas la narratrice ?) ; d’autre part, cela enlève toute cohérence au propos. En effet, plus rien n’est littérairement cohérent : déjà, que le roman se présente comme un récit de Paohétama, alors que tout est structuré façon roman contemporain pour la jeunesse (parties, chapitrage, découpage…), bon ; mais pourquoi cette narratrice qui parle correctement le français n’a-t-elle pas incorporé les grumeaux linguistiques qui surnagent ? Soyons clairs : les tapu, mana, tiki, kava, faé, etc., auraient pu se glisser incognito dans le flux du récit. Au contraire, ils sont mis en valeur à l’instar de ces impatientants mein Herr dans les récits featuring des Allemands, comme si quelques mots archétypaux garantissaient l’authenticité d’une narration, ou comme si, pour un Allemand, mein Herr n’était pas de l’allemand et donc devait être traduit dans une langue étrangère. Nan, dans ce livre, y a pas d’Allemand, mais vous voyez l’idée. Certes, ici, la double finalité didactique et exotisante est claire. Mais elle nous paraît, et c’est notre liberté de lecteur d’en rendre compte, superflue voire dommageable, sauf, sans doute, si l’on souhaite s’immiscer dans les ordres d’achat du gros marché scolaire.
Seconde raison de la déception, la lourdeur des questionnements intérieurs empèse le roman – serait-ce, sans surprise pour l’école des loisirs, le marché des prescripteurs soucieux d’intelligibilité explicitée qui constituerait l’horizon de réception visé ? Littérairement du moins, ces questionnements ont trois fonctions : la fonction Stabylo, la fonction Tadaaam, et la fonction Google. La fonction Stabylo vise à souligner qu’il va se passer quelque chose d’important et qu’il convient donc de bien lire ce passage du récit, le questionnement de la narratrice guidant celui de la lectrice (« Drôle de cérémonie où je vais aller sans être apprêtée… Ou bien était-ce seulement lui, grand-père, qui avait une visite importante à faire ? »). La fonction Tadaam vise à créer un suspense en tuilant l’annonce d’un événement et le moment où il va se produire, de façon à donner de l’intensité à ce délai chronologique – ce qui s’opposerait à une ellipse postulant que la lectrice est assez intelligente pour créer son suspense elle-même (« mais pourquoi, alors, m’avoir demandé de l’accompagner ? J’aurais pu l’attendre au faé »). La fonction Google vise à sous-titrer le propos, selon la technique de « la reprise enrichie par une incise » bien connue des profs (« – On va chez Aiki. Il nous attend. / Chez Aiki, notre chef ? Dans son propre faé ? »). Entendons-nous à peu près bien : ces trois fonctions se retrouvent probablement dans à peu près tous les romans pour djeunses. Mais de l’habileté de leur maniement, de leur dosage, de leur camouflage aussi, peut dépendre une partie du plaisir de lecture. Et nous devons admettre que, hic et nunc, nous fûmes un brin déçus, d’autant que la fonction Gnagnagna peut s’ajouter aux trois principales, comme dans : « Je ne veux pas donner de leçon. Qui suis-je, au fond, pour prétendre le faire ? De quelle hauteur est-ce que je parle ? Qui suis-je pour démêler dans le cours du destin les intentions des dieux et la volonté propre des hommes ? Qui suis-je aussi pour juger la façon de penser, la façon d’être de grand-père, cet homme sage et simple ? » (124), pfff, sur quoi peuvent se greffer en sus d’autres fonctions principales, comme la fonction Badaboum (« Ce qui s’est passé (…) a bouleversé nos destins. Un fait qui, par tout ce qui allait entraîner, changerait même le fondement du monde », 125), aveu d’impuissance de l’auteur à appâter son lecteur par sa seule science du style et du scénario.
Le résultat des courses
Si l’on ajoute aux griefs mentionnés que le style du roman aurait parfois, à notre goût, gagné à être plus personnel, moins pataud (expressions perfectibles comme « le fait de faire », banalités comme « le passé avait évidemment son poids », récurrences abusives des « déjà », « bien sûr », « bien », « maintenant », « un peu », le tadaaamique « bientôt »…), voire moins fautif (mélange inapproprié de passé composé et de passé simple, redondant « pouffer de rire », etc.), on pourrait oublier les quelques trouvailles plaisantes qui laissent espérer en Gilles Barraqué, artiste multicartes que l’on a hâte de lire dès qu’il se sera libéré des sages carcans ici en tout point respectés. Allez, un exemple d’idée pomme-pet-deup avant de boucler ? Au premier tiers du livre, le grand-père plonge pour visiter un énorme mérou. Commentaire : « On s’entend très bien. Je regrette seulement qu’il ne fume pas la pipe. » (102) C’est pas rigolo, ça ? Moi, je like, et j’espère bien que je likerai plus largement la prochaine variation de cet auteur, même s’il est actuellement trop sage et propret pour me soulever d’enthousiasme.
Yes, we can!
Impossible de comprendre l’élection du président des États-Unis sans l’ouvrage fondamental de Dan Gutman sur le sujet. En plus, il est super pratique si vous voulez devenir maître du monde. Pour le commander de toute urgence, ça s’passe ici.
Le jazz, nouveau mode d’emploi
Aime bien les chansons pédagogiques. Celles qui apprennent des trucs. Par exemple, le jazz. Illustration.
Le journal d’un dégonflé, cinquième épi-zob
 Paris à l’air livre m’a envoyé, c’est quand même bien aimable, le cinquième tome du Journal d’un dégonflé, la série à succès et à films de Jeff Kinney. Voici donc un p’tit aperçu du volume, tiré d’emblée à 60 000 exemplaires en février (Livres Hebdo n°899, 2 mars 2012, p. 53), ça rigole pas.
Paris à l’air livre m’a envoyé, c’est quand même bien aimable, le cinquième tome du Journal d’un dégonflé, la série à succès et à films de Jeff Kinney. Voici donc un p’tit aperçu du volume, tiré d’emblée à 60 000 exemplaires en février (Livres Hebdo n°899, 2 mars 2012, p. 53), ça rigole pas.
Enfin, si, ça rigole, puisque La Vérité toute moche est un récit humoristique illustré, écrit sous forme de journal intime alla Georgia Nicolson version garçon. Il narre voire marre les affres de Greg qui, dans cet épisode, veut devenir modèle, échapper aux enseignements sur la puberté mais suivre des cours de sexe intitulés « éducation à la santé », ne pas assister au nouveau mariage de son oncle et éventuellement renouer avec son copain Robert (quoique, faut voir). La traduction de Nathalie Zimmermann est plutôt discrète, ce qui est présentement une qualité, malgré quelques anglicismes évitables (« ni rien de ce genre » ; le récurrent et agaçant « gosse » alors que « gamin », sporadiquement, semblerait plus approprié ; « je ne suis pas jaloux ni rien », etc.). Pour emporter l’enthousiasme, le résultat manque de scènes vraiment hilarantes et d’une vraie tension narrative (le coup du « vais-je renouer avec Robert, mon copain lourdaud » est un brin bâclé), mais on apprécie que soient enfin posées, dans un ouvrage pour la jeunesse des questions fondamentales, parmi lesquelles nous avons sélectionné les dix plus cruciales, voire curciales, comme souhaitait l’écrire mon clavier.
- Avoir de l’acné quand on dort avec des peluches, sera-ce un oxymoron ?
- Quel intérêt de savoir lire quand on met encore des couches ?
- Lors des mariages, comment choisir les textes bibliques sinon pour rigoler quand le lecteur essayera de prononcer des prénoms débiles genre Ézéchiel ?
- A-t-on le droit de tuer :
- sa grand-mère si la conne colle tous les Lego en un bloc « pour qu’il n’y ait plus de petite brique qui traîne »,
- son petit frère quand on s’aperçoit qu’il a léché toutes les chips saveur barbecue avant de les remettre dans le paquet, ou
- la bonne quand on retrouve une de ses chaussettes dans son lit (son lit à pas-la-bonne, hein, sinon ça n’a pas d’sens) ?
- Comment sanctionner un adulte qui confond une photo de coude avec une photo de cul ?
- Doit-on se suicider si on n’est pas choisi au casting de « Coup de pêche, la glace qui donne la pêche » ?
- Péter avec un tuba déclenche-t-il automatiquement la clim ?
- Si on protège un oeuf comme s’il était son enfant et que la prof jette le wanna-be poussin, estimera-t-on (laveur) que cette salope a pratiqué un avortement ?
- (Petit) peut-on ne pas s’essuyer avec des lingettes antibactériennes (ou un rideau) après qu’un oncle ou une tante vous a fait un bisou, éventuellement sur la BOUCHE ?
- Mettre un Post-it avec son prénom sur le meuble d’une aïeule, est-ce une marque de propriété reconnue par le notaire quand il faut partager l’héritage ?
En fait, il n’y a que deux seules questions qui aient une réponse à peu près définitive. La première seule question, c’est : « Quelle est la capitale de la Russie dont le nom rime avec Noscou ? » (Réponse page 69.) L’autre seule question à réponse est : « Maman peut-elle reprendre ses études, quand il y a tant de ménage et de cuisine à faire ? » Et la réponse est : non. Même dans un livre humoristique, faut pas exagérer.
Salle Pleyel, 24 octobre 2012
 Il paraît que la salle Pleyel diffusera bientôt de la « musique du monde ». Spooky. En attendant cette connerie, je suis r’tourné dans cette salle le 24 octobre pour entendre l’Orchestre de Paris qui jouait Tchaï et Chos. Souvenirs.
Il paraît que la salle Pleyel diffusera bientôt de la « musique du monde ». Spooky. En attendant cette connerie, je suis r’tourné dans cette salle le 24 octobre pour entendre l’Orchestre de Paris qui jouait Tchaï et Chos. Souvenirs.
Le show s’ouvrait par la Fantaisie pour piano et orchestre de Tchaïkovski, jamais jouée jusque-là par l’orchestre. Deux mouvements au programme (le second porte bien son nom de « Contrastes » : c’est le plus palpitant du lot) pour une demi-heure de musique portée par Viktoria Postnikova, dont le jeu n’a pas trop l’occasion de faire dans la subtilité car beaucoup de notes l’attendent. C’est une agréable mise en bouche, d’autant que la pianiste revient pour un petit bis tout en douceurs et nuances, dévoilant un pan de son savoir-faire qui nourrit l’envie de l’entendre dans des pièces où elle aurait peut-être plus l’occaz de s’exprimer.
La seconde partie du concert met la Quatrième symphonie de Chostakovitch sur le grill. Sous la direction du créateur occidental de l’oeuvre, Guennadi Rozhdestvensky (ne me félicitez pas, j’ai une antisèche), l’Orchestre déroule cette partition d’une heure en trois mouvements (25′, 8′, 25′), qui pose dès le premier bloc les bases de l’identité du compositeur, bien qu’il ait à peine trente ans à l’époque : unissons, petits blocs d’instruments qui se répondent, soli caractérisés. Le deuxième mouvement entretient le suspense. Le troisième ennuie (ben oui, on peut le dire, non ?). C’est trop long, trop pédagogique – nombreux soli qui permettent d’entendre la plupart des vedettes de l’orchestre, notamment le violoncelliste et le tromboniste, furieusement mis en valeur -, mais ça se termine sur un piano de plusieurs minutes magnifique. Du coup, on oublierait presque que c’était trop long tellement l’Orchestre réussit ce final.
La salle, comble, semble comblée, et, mis à part les grossiers gros cons qui se barrent dès la dernière note, prodigue des applaudissements foufous. As far as we are concerned, on reste mitigés, même s’il est toujours stimulant de se perdre dans les méandres d’une symphonie, peut-être bancale, dont on dira pour complaire aux fanatiques que l’ambition dépasse sans doute notre intelligence.