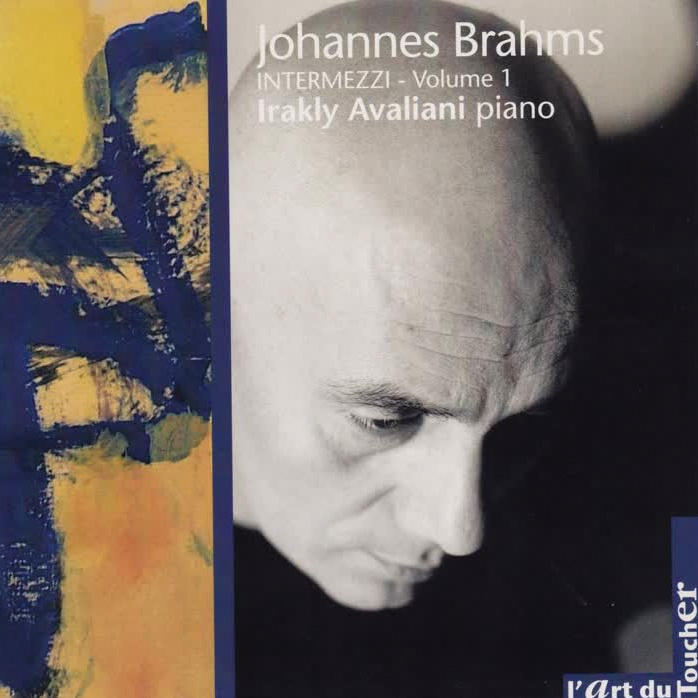Irakly Avaliani, Intégrale Brahms volume 1, L’art du toucher – 8/10
Un dernier binôme pour clore l’opus 76 de Johannes Brahms : un intermède et un caprice. Le premier nommé n’est certes pas une mince affaire à jouer puisqu’il est « moderato » et « semplice ». A priori,
- peu de virtuosité surhumaine à attendre,
- peu d’effets wow soufflants à craindre pour les permanentes violettes des mamies de cinquante ans émues car elles viennent d’apprendre que l’adjointe à la culture et aux finances de madame la maire est elle aussi présente dans la salle des fêtes du casino (si, c’est celle qui nous a serré la main, l’autre jour,
- peu de traits mitraillettes qui font s’entreregarder les spectateurs sur l’air du « mazette ! le zigue l’a bien descendu ».
Même la tonalité de la mineur est accessible au premier amateur de lignes de gling et de glang, c’est dire… Pour capter les brava du mélomane, il va donc falloir chercher ailleurs, respectant ainsi la division schématique du recueil entre intermèdes plutôt paisibles et caprices potentiellement survoltés. Le prélude annonce un esprit balancé
- (demi-mesure pour commencer qui lance le propos,
- rythme pointé,
- contre-temps)
que ne contredit pas le premier motif, tout en lui ajoutant une autre caractéristique : la répétition entêtante. La tentation d’un écart
- (modulation,
- marche chromatique descendante,
- dilatation de la mesure qui passe de C barré à 3/2)
fait presque trembler le bourgeois à lorgnon qui sommeille en nous et se réveille parfois, mais il peut retourner ronfler car force reste à l’ordre qui se rétablit – la reprise est donc moins inquiétante pour les amateurs
- de la rigueur,
- des rangs d’oignon et
- de la paix des ménages.
Irakly Avaliani parvient néanmoins à captiver l’oreille en sachant éclairer l’intermède avec
- un phrasé subtil,
- une note légèrement plus sonore,
- une respiration sciemment un rien trop longue
que compense une parfaite maîtrise du tempo par ailleurs. La coda confirme le charme d’une œuvre associant
- plaisir presque lascif du swing,
- gourmandise régressive de la répétition et
- gracilité juvénile des nuances médianes
au pays desquelles l’interprète a sans doute été promu citoyen d’honneur.
« Grazioso ed un poco vivace », le caprice final risque une mesure à 6/4 et une écriture opposant deux débiteuses de croches : la main gauche et la main droite. Johannes Brahms s’empare du ternaire non point pour bercer l’auditeur mais pour le secouer.
- Suspensions,
- relances pointées,
- accents sur les temps faibles et
- escamotage des premiers temps grâce aux notes liées
figurent manière de halètement et permettent à l’interprète de nous saisir dans ses rets avec une efficacité digne d’un pêcheur de haute volée.
- Mélodie en pointillés,
- riche instabilité harmonique et
- contrastes d’intensité
construisent le mystère captivant de cette course-poursuite moins vertigineuse que vaguement inquiétante.
- L’élargissement des registres convoqués,
- les accélérations
- (densification du nombre de notes par mesure,
- accords de dm7 traversant le clavier vers le grave,
- tempo hâté sous l’effet d’un moment « appassionato »…) et
- les choix de nuances, portés par de grands crescendi et decrescendi et par des piani subito
font bouillonner le clavier. Néanmoins, le petit plus avalianique pourrait bien résider dans sa capacité à être chou et chèvre presque simultanément. Son jeu sait être incandescent puis, comme si de rien n’était, s’apaiser et n’être plus qu’un peu de vent sur un voile de tulle légèrement froissé, à l’instar de ce caprice censé être en Ut-mais-c’est-plus-compliqué. De même, on s’ébaubit devant le mélange entre
- respect du texte,
- liberté et
- musicalité,
qui sont sans doute trois synonymes ou presque au top niveau de la musique. C’est du moins ce que semble subodorer Irakly Avaliani qui nous propose pour conclure son premier volume Brahms intégral les deux rhapsodies opus 79. Oh surprise, elles feront l’objet des prochaines chroniques sur le sujet.
Pour écouter Brahms par Avaliani en vrac mais gratuitement, c’est par exemple ici.
Pour acheter le disque, difficile, sauf si l’on est prêt à dépenser 70 € hors frais de port sur Amazon.
Tristan Pfaff et Gaspard Dehaene, Showroom Kawai, 30 avril 2024 – 2/2

Tristan Pfaff et Gaspard Dehaene au Showroom Kawai (Paris 10), le 30 avril 2024. Photo : Rozenn Douerin.
Les concerts à deux pianos, c’est presque comme un double au tennis : il y a toujours la crainte que les joueurs qui se produisent en double soient des losers incapables de briller en simple ou des joueurs de simple cherchant un complément de revenu sans s’investir vraiment dans le projet. Une inquiétude prise au sérieux mais sans doute mal traitée par l’ATP, à en croire les réactions suscitées par les nouvelles règles testées au tournoi de Madrid. Ce jour-là, sur le court du Showroom Kawai, on est tranquilles !
- Deux Shigeru Kawai de belle facture,
- deux virtuoses investis et connectés,
- un public à l’écoute,
- un Carnaval des animaux qui a passionné avec ce petit plus d’un récitant malicieux et roué…
Pas de doute, à ce concert de Tristan Pfaff et Gaspard Dehaene, y a d’la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Pourtant, le pire nous attend. La mort, la mort, la mort toujours recommencée nous attend au coin du dance-floor. Pour fêter l’arrivée de la Danse macabre de Camille Saint-Saëns, Tristan Pfaff tombe la veste. La Faucheuse n’a qu’à bien se mouvoir. L’arrangement pour deux pianos de la chanson parolée par Henri Cazalis saisit dès les premières notes.
- Picturalité de l’introduction,
- efficacité des échanges entre
- confrontation,
- encouragements réciproques et
- défis mutuels,
- changements brusques ou tuilés d’éclairage et d’atmosphère,
tout contribue à l’efficacité d’une musique associant
- le populaire
- (mélodie reconnaissable,
- itération jubilatoire,
- programme carnavalesque de la transgression) et
- le savant
- (harmonie,
- variations,
- construction).
Portés par une énergie commune, les artistes n’ont peur
- ni du pianissimo, ni du fortissimo,
- ni du stacatissimo, ni du sforzendissimo,
- ni du trivial, ni du poétique.
Percussivité et finesse se contente fleurette dans une discrète débauche de moyens extrêmes – et hop, un chiasme et un faux oxymoron d’un coup, ça ratatatata à mégadonf, on se croirait à la soirée miss T-shirt suggestif à la Chunga de Palavas, un 15 août mémorable. La fusion formidable des deux motifs principaux et la péroraison qui l’accompagne sont exécutés avec une vigueur mortelle, ce qui contraste avec le finale magnifiquement apaisé puis craché avec une sobriété parfaite en hommage à la belle nuit du pauvre monde…
Spectaculaire sans oser la vulgarité, le dernier morceau annoncé est tiré du succès d’Anderson & Roe, la Carmen Fantasy pour laquelle Tristan Pfaff et Gaspard Dehaene échangent leurs instruments. À Gaspard d’énoncer le premier thème, à Tristan de se glisser dans les pas du zozo en tripotant l’ultra-aigu. Quand les petites saucisses se lancent à l’assaut du deuxième thème, on pourrait se contenter de profiter d’une virtuosité de bon aloi n’eût été le travail sur
- les touchers,
- les accents et
- les couleurs
qui rappelle qu’un musicien n’est pas qu’un type jouant des notes : c’est – ou ce devrait être – d’abord un type qui fait de la musique. Le premier vrai tube de l’opéra de Georges Bizet est l’occasion d’un dialogue entre les pianistes, avec
- des effets d’écho,
- des parallélismes impressionnants et
- une exigence dans la précision et les nuances qui désamorce toute réductibilité de l’exercice à une virtuosité show-off.
Le deuxième mouvement s’ouvre sur une noirceur éclairant de façon nouvelle le duo. Gaspard Dehaene secoue ses chipolatas comme pour rappeler que l’obscurité n’est pas l’ennui, puis la rhapsodie s’appuie sur des notes graves répétées pour clore l’épisode avec une magistrale synchronisation des silences car être sinon vivre ensemble, c’est
- dialoguer,
- s’écouter et aussi
- savoir se taire ensemble.
Dans le troisième mouvement, les aigus scintillent avant de se laisser aspirer par les médiums et les graves. Gaspard Dehaene jazzifie cet arrangement bon enfant tandis que Tristan Pfaff prépare presque discrètement le surgissement de « L’amour est un oiseau rebelle », second vrai tube de l’opéra.
- Rythmicité rigoureuse,
- brio digital et
- jointure des nuances, du crescendo spectaculaire au mezzo forte subito,
emportent, c’est leur travail, l’enthousiasme du public lequel vaut bien un bis, en l’espèce la « Fête des cloches », extrait de la Première suite de Sergueï Rachmaninoff. Après le Carnaval et la Danse macabre, c’est donc le retour de la musique à programme ! En effet, on entend
- tinter les cloches,
- sonner les vantaux et
- vibrer les harmoniques
dans une transe hypnotique où, en dépit d’une acoustique sèche, Tristan Pfaff et Gaspard Dehaene usent de leur virtuosité et de leur art du son pour que
- la résonance,
- l’itération et ses minidifférences, ainsi que
- la spatialisation propre au jeu de deux pianos
construisent une cathédrale éphémère
- à la musique,
- à la fête et
- au partage.
Bref, un concert
- brillant,
- roboratif et
- solaire jusque dans la mort.
Kate Brown, « Plutopia », Actes Sud
Voilà un livre passionnant, peut-être pas tant par son sujet, pourtant captivant, que par l’art qu’a son auteur de le traiter – écho à une questions structurelle : un livre est-il puissant en soi ou en ce qu’il suscite de réflexions collatérales chez son lecteur ?
- Publié en anglais il y a plus de dix ans,
- un peu remanié pour l’occasion,
- efficacement traduit par Cédric Weis chez Actes Sud (2024, 450 p.) en dépit de pulsions sporadiques mais grotesques poussant le passeur vers une écriture inclusive du plus vilain effet,
l’ouvrage raconte en parallèle la construction de deux villes chargées d’absorber les travailleurs envoyés à la mort pour transformer le plutonium en bombe atomique – des villes nouvelles, associant plutonium et utopie : des plutopies. Sur le grill, une ville aux États-Unis où l’on invente le mécanisme ; et une ville en URSS où on copie le projet comme le processus. On pressent à présent le génie du projet brownien…
Le lecteur mal formé regrette-t-il de se perdre parfois faute d’une présentation simple de la progression scientifique et industrielle conduisant de l’atome à la bombe ? Peut-être, mais l’essentiel de ce qui nous a happé n’est pas là. Le plus ébouriffant est double et se situe,
- d’une part, dans la description du traitement des travailleurs que, inconsciemment d’abord, très vite consciemment, les puissants exposent à des doses de poison encore plus redoutables qu’une phrase d’Aya Nakamura tombant dans l’esgourde d’un être sensé (si, c’est possible) ;
- d’autre part, dans le rapport qu’entretiennent gouvernants et simples humains, il faut bien distinguer ces deux castes,
- à la liberté personnelle,
- à l’efficience individuelle,
- aux collectivités
- (recluses,
- communautaires,
- bientôt choisies puisque subies) et
- au sens de la vie.
Sans souci
- de fictionniser,
- de jouer du trémolo ou
- de mettre en scène ses récits alla Hollywood,
Kate Brown nous plonge dans l’horreur de l’URSS,
- ses semi-goulags,
- ses hivers,
- sa misère, et
- son immonde cruauté ;
et elle nous stupéfie itou en décrivant les turpitudes des États-Unis davantage au nom du business que de la nation, ce prétexte à dollars, via
- le contrôle des populations,
- la ségrégation sans fard,
- le mépris de classe,
- la puissance des profiteurs privés et
- le sacrifice des ouvriers (mais pas que) par les institutions politiques, militaires et entreprenariales – difficile de cloisonner ces trois grouillements de profiteurs sans scrupule.
Le saisissement éprouvé à la lecture pourrait s’arrêter là. Pourtant, tout en s’en tenant à des faits sourcés de manière têtue, l’auteur va plus loin : elle compare et s’étonne. Elle s’étonne notamment
- de la relative souplesse initiale de l’expérience soviétique – relevant davantage, on s’en doute, de la maladresse, aussi improbable que cela semble, et, surtout, du manque de moyens que de la coolitude – versus la rigueur impitoyable des États-Unis ;
- de la capacité de l’humain à troquer un travail pénible et délétère contre « un logement et des saucisses » ;
- de la défense sans conscience – par des démocrates américains affirmés – de la « dictature bienveillante » en vigueur à Richland ;
- de la tendance ironique de la middle class à enfoncer les « autres » (surtout les noirs, boucs de l’époque), fussent-ils indispensables, au prétexte de former communauté – une communauté vouée à s’enfoncer dans une contamination dramatique avant de la répandre sur d’autres, mais une communauté ;
- de la tentative soviétique, par l’intermédiaire de Beria, de promouvoir une méritocratie sonnante et trébuchante tandis que, aux États-Unis, en contrepartie d’une vie reconstruite dans un trou perdu, les habitants de Richland aspiraient, eux, à l’uniformité sociale (du moment qu’elle les plaçait au-dessus des autres, quand même, faut pas déconner).
Bref, l’auteur s’étonne
- de l’horreur instantanée (l’exposition de milliers de salariés à une substance mortelle), commune aux deux régimes,
- de l’horreur programmée (l’histoire ne peut pas bien finir,
- ni pour les travailleurs,
- ni pour les victimes des essais atomiques,
- ni pour le monde où prolifère cette cochonnerie) et
- de l’horreur conscientisée (la souffrance des autres est une donnée assumée par l’État en URSS et, aux USA, avec l’aval de l’État par les grandes entreprises aux bénéfices que les tensions internationales ne cessent de doper).
In fine, Kate Brown nous secoue en nous démontrant, sans jamais forcer le trait, que nous vivons tous dans manière de plutopies pouvant combiner les caractéristiques des deux modèles opposés et complémentaires. En somme, ce qui nous a étonné dans son livre, par ex. la capacité des puissants de duper et des glandus comme nous de se laisser tendrement duper, nous étonne des autres mais ne nous étonne pas de nous. La spécularité du propos fait de Plutopia. Une histoire des premières villes atomiques un volume
- ambitieux par l’information rassemblée,
- magistral par le sérieux de la synthèse, et
- vertigineux grâce à la clarté de l’exposé…
même si être exposé aux radiations, bref. Cette secousse-ci est
- accessible à tous,
- stimulante pour chacun, et
- d’une spécularité qui nous renvoie, par-delà une double expérience historique exceptionnelle, à nos propres
- compromissions,
- lâchetés et
- aveuglements.
À nous, en somme.
Orlando Bass, “Préludes et fugues”, Indésens – 4/8
Jusqu’ici, le disque d’Orlando Bass autour des préludes-et-fugues modernes nous a époustouflé tant par l’interprétation que par le choix de pièces rares et précieuses chacune à sa façon. Voici qu’il met sur son pupitre un diptyque d’Alfred Schnittke dont on croit savoir qu’il apprécie l’œuvre, en compositeur, pour
- sa polymorphie,
- sa science harmonique et
- sa capacité à exprimer l’émotion dans des langages fort différents.
L’improvisation (écrite) liminaire contribue à repousser les limites du genre prélude-et-fugue non pas en trichant sur le concept mais en élargissant la sémantique. En effet, en sus des prélude-et-fugues pur jus, Orlando Bass a collecté
- un prélude-récitatif-et-fugue ouï ce tantôt,
- une passacaille-et-fugue et
- une passacaille-intermezzo-et-fugue.
La subversion terminologique consistant à remplacer « prélude » par « improvisation » n’est certes pas une révolution : l’on sait par exemple que les préludes de Chopin sont réputés avoir été finalisés à partir d’improvisations ; et l’essence même du prélude-et-fugue est d’opposer une partie censément plus libre à la partie censément très corsetée de la fugue. Aussi Alfred Schnittke ne se prive-t-il pas de proposer un prélude à la fois
- libre
- (tenues,
- silence comme si l’inspiration attendait de jaillir,
- travail sur la résonance avec ou sans pédale) et
- structuré
- (principe dodécaphonique,
- mesures de trois temps imperceptibles mais respectées,
- grande précision dans les annotations).
C’est là que l’interprétation prend toute son importance. Son défi, passée la virtuosité que l’on finirait presque par banaliser tant elle est dégainée sans ostentation par le pianiste, consiste à respecter une lettre minutieuse et un esprit free, ce qui n’est pas sans faire résonner la réalité des compositeurs à l’ère soviétique (on pourrait se demander si ce n’est pas aussi le cas hic et nunc, quoique en moins dramatique) : libres d’écrire, mais avec un Komité derrière le dos pour juger de la compatibilité entre la production et la Doktrine. Alfred Schnittke s’attache donc à concilier
- la liberté de l’improvisation,
- la strictitude, et hop, du dodécaphonisme et
- l’anticipation du râlage politique.
Pour rendre cette tension captivante, Orlando Bass s’attache à
- sculpter l’harmonie grâce à une pédalisation (ou non) soignée,
- varier les touchers d’intensité variée,
- penser les nuances, oscillant parfois en quelques secondes entre
- piano,
- pianissimo et
- mezzo piano (id sunt des intensités très proches) et
- à incarner dans le clavier la quête de liberté joyeuse qu’expriment notamment
- les brutales sautes de registre et d’intervalles,
- les contrastes entre
- traits,
- notes répétées et
- grondements graves soutenus,
- les répétitions différenciées (en clair : c’est pareil mais pas tout à fait), ainsi que
- la dissociation entre rythme théorique et réel
- (triolet incluant un silence,
- septolets,
- points d’orgue,
- appogiatures…).
La fugue s’élance en reprenant l’énoncé des douze notes fondamentales. L’interprète passionne et impressionne par
- son sens du groove,
- sa tonicité digitale et
- sa capacité à rendre les mutations du mouvement grâce, par exemple
- aux accents,
- à la clarté des nuances engagées et
- à sa capacité à penser la musique non comme une mélodie harmonisée mais comme une globalité incluant
- attaque,
- intervalles,
- densité,
- rythme et
- son.
C’est
- techniquement magistral,
- artistiquement accompli,
- musicalement séduisant
et, surtout, ça rend magnifiquement raison d’une partition destinée, fût-ce malgré elle, à faire headbanguer son auditoire – sur ce site, on aime le metal, on ne va pas s’en cacher .
- Les contrastes,
- les fusées de notes,
- les accents
poussent à la jubilation tout en clarifiant un propos a priori plus que complexe, saperlipopette ! Le finale officiellement « maestoso »
- n’hésite pas à solliciter des super fortissimi (« ffff » versus « fff » !),
- associe
- séquences de doubles croches virtuoses,
- suspension mystérieuse et
- tentation du cluster, puis
- se laisse absorber par le désir de silence passant du triple piano à un quadruple piano irradié par l’indicible des suraigus.
Un diptyque
- charnel,
- vibrant,
- émouvant.
De quoi donner plus qu’envie de découvrir le prochain combo choisi par Orlando Bass : une passacaille et fugue de Michel Merlet jamais enregistrée auparavant…
Pour acheter le disque, c’est par exemple ici.
Pour l’écouter gracieusement, c’est par exemple là.
Pascal Vigneron – Le grand entretien – 3/7
Moins tête d’affiche que fomenteur d’affiches, Pascal Vigneron dénote, étonne et détonne dans le petit Landerneau de l’orgue. Musicien poly-instrumentiste, homme de réseaux mais pas de coteries, fidèle en amitiés artistiques mais pas monogame, estimé par quelques-uns des grands noms du métier au premier rang desquels Éric Lebrun, l’un des rares interprètes-compositeurs-pédagogues sur qui même les connaisseurs les plus vipérins (les connaisseurs, donc) de l’orgue peinent à postillonner leur venin, l’énergumène rassemble et divise à la fois. Sujets inflammables, convictions intimes, petits secrets, rencontres marquantes et brillantes réussites sont au programme de ce grand entretien où seront évoqués
- le musicien,
- l’organiste,
- l’organologue,
- l’organier numérique,
- l’organisateur et
- le studioman
que sont les mille et un pascalvignerons cachés derrière Pascal Vigneron.
Déjà paru
1. Devenir musicien
2. Penser l’orgue
Épisode troisième
Faire bouger l’orgue
L’orgue de Toul, cette Grosse Bête dont tu as chapeauté la restauration-reconstruction, illustre ta volonté de penser l’instrument comme un outil synthétique et non pas, comme ce peut être le cas çà et là dans telle ou telle église, dans telle époque voire telle région géographique.
Toul n’était pas fait pour avoir un orgue spécialisé. Le Schwenkedel était un orgue néobaroque. C’était le premier orgue de cathédrale construit après-guerre. Je le précise parce que l’époque est trrrès importante pour comprendre ce qu’était cet instrument mécanique de quatre claviers.
Il ne reste plus grand-chose de l’original…
Tu rigoles ? Nous avons gardé l’essentiel, le plus beau, le meilleur, tout simplement, et nous l’avons mis en valeur. Écoute, on vient de finir l’électrification de tous les claviers. Je peux te dire que, avant, quand tu jouais les quatre claviers accouplés sans l’électrification, fallait se mettre debout ! Tous les organistes qui sont passés depuis quinze ans disent pareil. En quoi cette modification invisible transforme-t-elle l’orgue ? Je vais te le dire : elle conserve l’identité de l’instrument et change la vie de l’organiste !
« À toutes les époques de la musique donc de la facture d’orgue,
on commet des erreurs »
L’orgue de Toul a donc gagné en répertoire ce qu’il a perdu en spécificité…
D’où sors-tu cela ? On n’a rien perdu, enfin ! Simplement, aujourd’hui, on peut tout jouer, tout, de Buxtehude à Messiaen. Tu parles d’un crime musical ! Et ces modifications ont toutes été pensée par rapport à l’existant, pas par rapport à nos petites convictions ou notre envie de nous faire plaisir ! Par exemple, avec Yves Koenig on a repris les noyaux d’anche : trop petits. De même, on a repris les mixtures, issues de l’époque Litaize donc très acides. Elles étaient trop petites ! Un autre exemple ? Au positif de dos (oui, je connais l’orgue par cœur…), une fourniture commençait comme Dom Bedos, c’était super… sauf que, à la deuxième octave, la cymbale sautait ; et, ça, c’était pas possible ! Donc on a recomposé la cymbale. Ce n’est plus comme avant, mais on fait mieux sonner ce qui était là avant. Imagine ce que ça donne : comme, au grand orgue, on a un Dom Bedos de cinq à sept rangs, avec la bonne cymbale, les quatre pleins jeux dégagent un sentiment de plénitude peu commun. Franchement, si ça, ça revient à dénaturer l’orgue aux oreilles des puristes, je souhaite à beaucoup d’instruments d’être dénaturés de la sorte.
Estimes-tu avoir déjoué toutes les chausse-trappes qui guettent des restaurations de cette envergure ?
Bien entendu, à toutes les époques de la musique donc de la facture, on commet des erreurs. Même si le résultat me paraît peu contestable, nous en avons donc peut-être commis.
Pourquoi ?
S’occuper de facture amène à aller dans un sens ou dans un autre. Or, personne n’a totalement raison et peut-être que personne n’a totalement tort. À Toul, l’ouverture de la voix céleste est formidable, parce que c’est une céleste assez douce, un peu comme une unda maris. Avec ça, on peut enregistrer l’intégrale de Messiaen, on l’a prouvé, mais pas que ! David Cassan va bientôt jouer la Troisième symphonie de Louis Vierne sur cet instrument, ça va être incroyable… d’autant qu’on va jouer le troisième mouvement, l’adagio, à deux orgues, en partant de la version pour orgue et orchestre que j’ai enregistrée avec orchestre d’harmonie. Je jouerai le départ en bas, ça va être dingue.
« Qui joue Elsa Barraine aujourd’hui ? »
Moralité ?
La restauration de l’orgue de Toul prouve une fois de plus que la facture d’orgue ne doit pas être une théorie ou une pratique bloquée. Par exemple, je sais où se trouve l’orgue de la salle Pleyel. L’instrument est incroyable ! La pression est monumentale car l’orgue était placé au-dessus de l’orchestre. Les sommiers étaient en okoumé, donc ils peuvent tenir deux siècles. Ce sont des sommiers à membrane…
Précisons deux choses. Un, dans l’orgue, un moteur produit de l’air, on le stocke dans un réservoir (c’est la différence avec un harmonium où l’air non utilisé est perdu), puis les sommiers gèrent l’envoi de l’air dans les tuyaux afin d’émettre le son demandé par le musicien… quand tout se passe bien. Deux, il existe trois types de sommiers : à registres (le plus fréquent, c’est une soupape qui libère l’air ou le maintient fermée), à ressorts (plus compliqué, une seconde soupape, actionnée par un ressort, contrôle le mécanisme) et à membranes.
Quand le sommier est à membranes, on n’a pas une laye avec une soupape mais on a un moteur électrique sous chaque tuyau. L’orgue de la salle Pleyel était composé avec les octaves graves et les octaves aigus réelles. Ça signifie que, au lieu d’avoir soixante-dix jeux, on en a trois fois plus. C’était fait exprès parce que l’instrument était mal placé, avec une clairevoie…
… donc derrière une barrière ajourée…
… de sorte qu’on ne l’entendait pas bien. Ces stratégies inventives ont été inventées pour lui donner sa personnalité et sa sonorité malgré tout, sous l’égide de Marcel Dupré. C’était une évolution formidable pour les salles de concert. En sus, cet instrument est le dernier Cavaillé-Coll. Son jument était l’orgue de Verdun. La console était identique – sauf que là, c’était Rambervilliers qui a complété. Bernard Dargassies, alors chez Danion, a démonté l’instrument de Pleyel, donc il le connaît à fond. Depuis quelque temps, je cherche un endroit où le réinstaller, mais il faut des sous – tu penses, soixante-dix jeux, une console mobile, c’est beau mais c’est cher !
On en revient au paradoxe apparent signalé au début : en fait, quand on parle d’instrument, on parle bien de projet musical car, malgré qu’on en ait, on ne peut pas tout jouer sur tous les orgues.
En effet, parler de l’orgue en tant qu’instrument, c’est parler de projet et, j’insiste, d’ouverture. À l’époque de Maurice Duruflé, les programmes des récitals, c’était pas que du Bach ou que du Clérambault !
Que du Clérambault, pour un récital d’orgue, c’est rare…
On le fait de temps en temps, mais pas toute l’année, merci ! Alors, si on veut donner un concert ouvert sur le public, donc avec un peu de musique ancienne, préromantique, romantique et moderne, il faut l’instrument qui va avec. Sinon, on se retrouve avec des compositeurs qu’on ne joue plus. Qui joue Elsa Barraine, aujourd’hui ? Qui joue du Jean-Jacques Grunenwald ? Tu entends souvent du Grunenwald ? Pourtant, il écrivait très, très bien. Il a composé aussi de la musique de film. Je l’ai connu à Saint-Sulpice. Je me souviens d’une fois où il discutait de son futur concert avec programmateur du festival de Masbourg. Il lui lance : « Je pense jouer du Clérambault… » Ç’avait du sens car Clérambault, comme Grunenwald, avait été organiste à Saint-Sulpice – sur le Cliquot, lui. Le type est un peu embêté parce qu’il sait que ce répertoire n’est pas la spécialité de l’artiste. Il balbutie : « Mais, maître, on a en a déjà joué l’an dernier, alors… » Et Grunenwald de se tourner vers son fils et, avec sa diction très vieille France : « Note : pas de Cléramabault à Masbourg ! »
« J’aime pas les esclaves »
Saint-Sulpice, voilà un orgue qui ne devrait pas être transformé de sitôt…
Non, on n’y touchera pas parce qu’il est dans son jus mais, même si peu l’admettront en public, rien n’empêcherait, en procédant avec beaucoup d’intelligence, de libérer les deux esclaves qui t’entourent quand tu donnes un concert, en installant un combinateur. Moi, j’aime pas les esclaves. Je préfère donner des récitals sans personne à côté de moi [pour tirer les jeux, NDLR], sauf éventuellement un assistant pour tourner les pages dans les longues pièces compliquées.
Le grand tabou de Saint-Sulpice, c’est le combinateur.
Je respecte infiniment cet orgue merveilleux mais, quitte à choquer, je ne vois pas pourquoi on n’oserait pas ouvrir publiquement la réflexion sur la création d’un tiroir sous les registres, à droite, que personne ne verrait. On y glisserait le combinateur. On ne toucherait surtout pas au magnifique système pneumatique ; sauf que, derrière les tirants de registre, où on a énormément de place, on mettrait un moteur derrière chaque tirant. Si bien que, à chaque changement de registration, ton assistant se contenterait d’appuyer sur le séquenceur. Ça n’abîmerait pas le moins du monde le patrimoine, et ça irait dans le sens de Louis Vierne qui disait : « Le véritable élément de vie, dans l’art, réside dans l’évolution. Ne renonçons à aucune conquête d’aucun temps, mais utilisons-la à l’exclusion de tout autres système préconçu. » Tu sais pourquoi il disait ça ?
Non.
Parce qu’il était allé aux États-Unis. Il faut toujours s’ouvrir l’esprit et ne pas être obnubilé par sa vérité. Je me souviens de Jacques Amade, un organiste extraordinaire que le mari de Marie-Claire Alain n’aimait pas pour des raisons qui le regardent. À un moment, le mari de Marie-Claire se tourne vers elle et s’offusque de l’interprétation – je le dis en termes mesurés. À quoi Marie-Claire répond cette phrase : « Mais laisse-le, si ça lui fait du bien ! » Magique, non ?
À suivre !
Irakly Avaliani, Intégrale Brahms volume 1, L’art du toucher – 7/10
Voici le troisième épisode sur les quatre prévus pour évoquer les Huit pièces pour piano opus 76 de Johannes Brahms par Irakly Avaliani. Après quatre pièces bien rangées (les caprices d’un côté, les intermèdes de l’autre), tout s’mélange pour la seconde mi-temps du match : d’abord un caprice, puis deux intermèdes, et enfin un dernier caprice.
Le caprice en do dièse majeur et en 6/8 (à l’heure où nous écrivons ces lignes, la pièce n’est pas disponible sur la play-list YouTube reprenant le disque) est indiqué « agitato, ma non troppo presto ». En effet, c’est bien l’agitation qu’en traduit le pianiste en distinguant
- le rythme des noires qui guident la ligne mélodique,
- le motorisme des croches au grondement chromatique,
- le groove des basses opposant au ternaire de la main droite le binaire de la main gauche (trois noires à dextre, deux appuis à senestre) et
- l’aspect tourmenté de la musicalité
- (minicrescendi-decrescendi,
- concentration des registres dans le médium grave renforçant l’efficacité des notes plus aiguës,
- surgissement des contretemps « sostenuto » puis des doubles croches à l’alto…).
Tout cela est à la fois
- très net et pas clair,
- précis et remuant,
- cadré et débordant,
bref, agité.
- La colère des octaves graves,
- le ressassement et la répétition, ainsi que
- la confrontation des mesures binaires et ternaires
conduisent le morceau à développer vraiment un caractère capricieux qui fait tour à tour
- tonner,
- murmurer,
- tanguer,
- hésiter,
- s’ébrouer,
- s’emporter puis
- exploser (chose rare chez ce musicien !)
le piano. Dans cette atmosphère orageuse, Irakly Avaliani fait valoir
- son intériorité musicale aux piani caractéristiques,
- son intégrité interprétative privilégiant la lettre de la partition à sa réinterprétation sous couvert d’émotion artistique, et
- la solidité de sa vision musicale qui lui permet de dessiner une continuité derrière la rhapsodie sans écraser les contrastes.
L’intermezzo en La, « andante con moto » comme la quatrième ballade, est affiché à 2/4 mais prolonge la tension précédente entre trois temps et deux fois un temps et demi. Cette fois, Johannes Brahms associe
- le 6/8 des triolets au 4/8 de la basse, puis
- le 3/4 de la main droite au 2/4 de la main gauche, et enfin
- un peu des deux modèles ensemble, sinon, c’eût été trop simple.
Les reprises permettent de se goberger
- de l’étrange balancement,
- du rythme volontiers dissocié,
- de l’association entre clarté de l’articulation et onctuosité de la pédalisation, ainsi que
- du spectre des nuances allant du piano au mezzo forte.
La modulation en fa dièse mineur poursuit cette association entre binaire et ternaire jusqu’à ce que la reprise sans transition du motif liminaire nous ramène
- au soleil du majeur,
- aux irisations du chromatisme grave et
- aux mystères d’un apaisement sous forme de résolution que l’on doit appeler sérénité…
et que la coda et sa fin brève ne sous-titreront pas. Dans une prochaine notule, suite et fin du voyage en miroir avec l’intermède et le caprice qui concluront notre parcours de l’opus 76.
Pour écouter Brahms par Avaliani en vrac mais gratuitement, c’est par exemple ici.
Pour acheter le disque, difficile, sauf si l’on est prêt à dépenser 70 € hors frais de port sur Amazon.
Tristan Pfaff et Gaspard Dehaene, Showroom Kawai, 30 avril 2024 – 1/2
Il flotte un air de fête, cette veille de 1er mai. Il fait à la fois frais et chaud. Aux marges d’un quartier peu réputé pour sa convivialité alla francese, les terrasses des bistros débordent pourtant. Au fond du presque discret magasin de démonstration des pianos Kawai, deux pianos de concert Shigeru Kawai ont été presque emboîtés pour présider à un récital. Plutôt que de se terrer dans leur loge, Tristan Pfaff et Gaspard Dehaene procèdent aux derniers préparatifs scéniques et saluent le public comme si les artistes, avant un concert, étaient des gens normaux. Air de fête, vous dit-on.
Même topo pour le programme de trois quarts d’heure théoriques qui s’avance, en préparation du festival de La Roche-sur-Yon où les deux hurluberlus joueront ce samedi, et s’ouvre par le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, avec récitant claquant les textes de Francis Blanche, s’il-vous-plaît – le transcripteur n’est pas mentionné, sera-ce Ralph Berkowitz, le plus célèbre ? Camille Saint-Saëns, comme tout compositeur barbu de musique classique du dix-neuvième siècle (un genre particulier), n’était pas spécialement réputé pour ses talents comiques. Quand, en 1886, il ose proposer cette « grande fantaisie zoologique », il ne tarde pas à s’en mordre les doigts. En effet, cette suite de quatorze épisodes ne manque pas d’humours efficaces qui ne peuvent que déstabiliser les notables s’étant assis sur un balai et constatant malgré qu’ils en aient, les maudits hères, que peuvent faire fort bon ménage
- facétie,
- savoir-écrire et
- talent.
Après que Bertrand Périer, en dépit de ses tics peut-être trop séducteurs d’avocat
- prestigieux,
- expérimenté et
- top level (Conseil d’État et cour de cassation, ça rigole plus),
pédagogue in vivo et ex libris de « l’art oratoire » pris dans ses astuces efficaces
- (silences appuyés,
- regards portés,
- respirations Stabylo),
a convaincu, en une prise de parole (on pense aux théories pragmatiques de Jean Sommer, l’ex-chanteur incroyable devenu coach vocal, hélas) qu’il allait contribuer – contrairement à ce que nous avons peut-être laissé entendre – à la réussite du projet en saisissant l’auditoire par son surjeu grâce à trois atouts flagrants
- (l’intelligence du texte,
- la science de ce-que-c’est-de-parler-en-public,
- la gourmandise des mots),
l’arrangement pour deux pianos – mais si, la phrase va bientôt finir – convainc dès l’introduction et la solennelle « Marche royale du lion ». Les effets
- de confrontation entre les deux mastodontes à cordes et marteaux,
- de caractérisation du personnage et de la situation, et
- de pittoresque animalier réinventé à l’aune de l’humain
effacent presque la virtuosité requise, laissant la jubilation l’emporter sur la technicité – pour les auditeurs, évidemment, mais, semble-t-il quelque peu aussi pour les interprètes. « Poules et coqs » ouvrent aux oreilles le royaume du staccato permettant aux gallinacées de picorer.
- Nuances,
- percussivité et
- musicalité
ne sont certes pas contradictoires avec un morceau à programme ! Les petites saucisses courent à l’unisson après les « Hémiones », offrant de s’ébaubir devant
- le groove (accents),
- la célérité roborative et
- le parallélisme ébouriffant des deux ploum-ploumistes.
Notes répétées et octaves dessinent alors un Offenbach à rythme de « Tortues ». Par-delà le réinvestissement de l’intertexte, savoureux pour les mélomanes, Tristan Pfaff et Gaspard Dehaene parviennent à installer une atmosphère qui désamorce toute réductibilité de l’œuvre à une blagounette pour fins « connoisseurs » (en français dans le texte). De même, « L’Éléphant » échappe à la seule lourdeur signant la conception humaine du pachyderme en caractérisant les différents registres et en équilibrant la récurrence du thème avec ses commentaires. Camille Saint-Saëns et ses porte-voix refusent l’univocité : la stéréotypie iconique (ce qui fait que l’on « reconnaît » un animal à travers les notes) est volontiers subvertie par des propositions annexes – comme dans cette évocation des « Kangourous », où les sautillements plus dansants que bondissants irriguent les deux pianos mais savent aussi s’apaiser sans perdre l’attention de l’auditeur… au contraire. Soudain, après
- la terre de l’éléphant,
- l’air des kangourous sauteurs, voici
- l’eau de l’« Aquarium ».
C’est l’un des deux hits de la suite, que la qualité de la transcription et l’habileté des interprètes honorent. Nous voici nous réjouissant
- de la magie liquide délivrée par des doigts déliés,
- du vertige étonnant provoqué par des synchronisations remarquables, et
- des contrastes lumineux
qui, ensemble, rendent joliment justice à des trouvailles harmoniques pourtant souventes fois entendues. Des « Personnages à longues oreilles », ces ânes qui, pour le carnaval, « ont mis un bonnet d’homme », les deux complices expriment
- les interrogations,
- les dialogues et
- les suspensions.
Nul braiment, vraiment, ici, mais une intériorité qui sonne juste et marque la confiance des pianistes dans la musique, au-delà du côté plaisant de l’imitation conventionnelle. Sur un principe similaire, le « Coucou au fond des bois » et son motif répété, nous signalent les musicologues numérologistes, à vingt et une reprises (heureusement, c’est pas du Bach donc on peut s’épargner la symbolique kabbalistique de la chiffristique appliquée à la musique), joue à la fois sur
- l’imitation loin d’être messiaenique de l’oiseau et du froufroutement sylvestre,
- les échos rebondissant d’une hauteur et d’une nuance l’autre, installant comme une spatialisation stéréoscopique du décor et des personnages, ainsi que sur
- la variété
- de touchers,
- d’accents et
- d’intensités.
On ne quitte point l’ornithologie pas très parkerienne en nous enfonçant dans la « Volière » dont l’atmosphère intense et les parallélismes pianistiques enveloppent l’auditoire avec une efficacité saisissante. Les oiseaux suivants passés sur le grill de CSS sont les « Pianistes », et l’on ne doute pas que les deux énergumènes s’escrimant devant nous ont sans doute beaucoup souffert pour monter ce mouvement, peu habitués à jouer
- mal,
- pas en rythme et
- en léger décalage.
Comme espéré, ça joue affreusement faux : un délice. Les très réussis « Fossiles » évoquent à la fois
- l’animalité des corps sédimentés,
- la proximité avec notre condition de mortels (si, si) et
- la question de la vie après notre mort.
On pense à Barthélémy Saurel, l’un des grands chanteurs avec du texte dans ses musiques, qui affirme aspirer à être « incinéré au bois de hêtre » parce que
J’veux pas qu’que’qu’ chos’ m’arriv’ sans savoir c’qui m’arrive,
et, surtout, je n’veux pas qu’un cadavr’ me survive.
Tristan Pfaff et Gaspard Dehaene déploient avec élégance
- tonicité d’articulation,
- allant rythmique et
- phrasé énergique
qui auréolent cet épisode tragique et drôle d’une musicalité ayant harmonieusement digéré les citations en général et les autocitations en particulier. De quoi ouvrir la cage au « Cygne », second grand hit de la suite. L’œuvre a beau être usée jusqu’à la corde pour nos oreilles contemporaines, elle saisit, poigne et bouleverse dès que les interprètes trouvent la juste mesure entre gestuelle de faquin
- secouant sa crinière de geai,
- yeux fermés,
- corps tordu
pour souligner à quel point l’artiste est ému (alors qu’on s’en fout, de son émotion, on est égoïste, c’est nous qu’on veut être ému) et froideur mécanique tentant de contrebalancer la posture en plastique de certains violoncellistes télévisuels de frère en frère, quel que soit leur incontestable savoir-faire (c’est ça, le pire !). Voici donc venu le temps d’une pièce pas rigolote, au point qu’elle était la seule que CSS autorisât à être jouée après que les glandus, faquins et autres peigne-zizi eussent vilipendé son Carnaval parce qu’il était souvent rien chouette et rigolo. Le projet programmatique demeure, mais le chant du cygne et de la suite résonne différemment.
- Clapotis lacustre d’une grande précision,
- précieuse répartition de la mélodie entre pianistes et registres,
- souplesse de la circulation du lead entre interprètes,
tout cela est exécuté avec justesse et maestria. Reste le finale, sorte de synthèse des treize précédents épisodes tant il concatène l’art triple de la citation musicale :
- citation d’œuvres allogènes d’autres compositeurs,
- citation d’œuvres allogènes de CSS,
- citation du Carnaval des animaux lui-même.
Ouvrant grand le spectre des possibles pianistiques et rendant ainsi hommage aux pianos à queue de Kawai, la puissance invitante (même si l’on n’est pas toujours certain que leur réglage n’aurait pu être optimisé et égalisé – problème de budget, probablement, comme pour les programmes offerts aux spectateurs !), Tristan Pfaff et Gaspard Dehaene profitent d’une séquence riche et d’une transcription à la hauteur pour
- maximiser l’usage des registres de leurs instruments,
- jubiler à travers le jaillissement trépidant des staccati,
- ajuster la pédalisation qui, tout en compensant la sécheresse de l’acoustique, veille toujours à ne pas mordre la netteté
- du discours,
- des échanges et
- de l’harmonie,
- caractériser les changements de couleur, et
- profiter au mieux de l’instrumentarium du jour (on sent que les pianos puissants s’opposent puis se cajolent puis s’excitent puis s’unissent, etc.).
Triomphe
- assuré,
- mérité et
- joyeux
pour les pianistes formidables et pour le récitant parfait. Un air de fête, décidément, que la suite du concert va pourtant nimber d’un crêpe allègrement noir en chantant la mort et l’égalité…
À suivre !
À la nôtre !

Avec Debussy de la Lorette en Cornouailles, partenaire du double album « 44 ou presque ». Photo : Kuhuru.
En ce jour Ferrier, c’est l’occasion de fêter une double bonne nouvelle :
- le cercle des chansons à cinq chiffres sur Spotify s’agrandit avec le franchissement des 10 000 écoutes pour « Au troquet » ;
- et, jusqu’à présent, contrairement à Joaquín Sabina, no « me echaron de los bares que usaba de oficina ».
Je me souviens d’avoir écrit cette fredonnerie au moment où je préparais un tour de chant programmé à Ze Artist, un théâtre spécialisé dans l’humour. La première date était une sorte d’audition. Le patron était dans la salle. Si on faisait rire, on était reprogrammé. Moi, j’aime bien être drôle mais plutôt quand on ne me le demande pas. Alors, j’ai graffité une chanson pas drôle et je l’ai mise en ouverture du récital. Elle a beaucoup Ferrir. J’ai été reprogrammé. J’imagine qu’on a dû fêter ça au troquet.
Pour écouter 44 ou presque sur Spotify, c’est ici.
Pour acheter le double disque, c’est là.
Orlando Bass, “Préludes et fugues”, Indésens – 3/8
Orlando Bass en convient dans le livret de son disque que nous continuons de découvrir : ce « Prélude et fugue » de Karol Szymanowski est un peu une arnaque, dans la mesure où l’aspect construit du binôme est une illusion, les deux parties ayant été écrites indépendamment l’une de l’autre, le lien s’entortillant autour de la tonalité identique d’ut dièse mineur. L’illusion n’en est pas moins parfaite.Et alors ? Des sonates ou des œuvres orchestrales qui
- rassemblent,
- collationnent voire
- concatènent, et hop,
des mouvements composés dans diverses circonstances et non à l’occasion d’un même projet créatif, l’histoire musicale en regorge, tant pis pour les puristes (étonnant que cette race existe encore, bref).
Le prélude, entre 6/8 et 12/8, s’avance
- « Lento ma non troppo »,
- rubato et
- concentré dans des nuances privilégiant le pianissimo, le mezzo piano ou, dans les cas extrêmes, le piano.
Orlando Bass en illustre
- la gravité
- (registre,
- tempo,
- nuances,
- legato des accords,
- pédalisation),
- le swing ternaire et
- l’irrégularité à la fois
- inscrite dans la structure du prélude
- (tenues escamotant les temps forts,
- mesures se dilatant puis se contractant,
- frictions tonales voire modales se gobergeant d’un chromatisme savoureux),
- accentuée par l’agogique à la guise de l’interprète et
- stimulée par les indications incitant çà à jouer « poco avvivando », là « pochettino più.
- inscrite dans la structure du prélude
L’illusion d’un prélude est parfaite, associant
- des lignes brisées récurrentes pour charpenter le texte,
- un allant qui ne fanfaronne pas et pousse donc l’auditeur à se demander où cet introït va le mener, et
- une apparence d’improvisation qu’entretiendraient
- les irrégularités sus évoquées,
- les diastoles et sistoles des registres convoqués (tantôt graves, tantôt aigus, tantôt associés), ainsi que
- les sursauts du flux discursif dont la tranquillité n’est qu’illusoire, la lave grondant dans le volcan, façon mini-Scriabine.
Dès lors, on se laisse absorber avec délectation dans une partition
- d’une grande richesse harmonique,
- d’une belle variété d’intensités et
- d’une admirable construction débouchant sur un fade-out prenant.
La fugue,
- andante,
- binaire et
- « sempre molto legato »,
s’avance sur un sujet zigzagant, pris dans une attraction descendante contre laquelle il tente de lutter. Pour nous laisser jouir de la tentation chromatique, Orlando Bass soigne
- ses articulations,
- ses respirations et
- ses attaques.
La netteté du jeu contraste sciemment avec le déséquilibre profond du texte
- (croches pointées – doubles,
- exposition du sujet à cheval sur deux mesures,
- appogiatures renforçant la claudication)
qui, lui-même, frictionne avec la sévérité contrapuntique de l’écriture. La seconde partie de la fugue s’enrichit
- de trilles,
- de doubles croches,
- de tempi plus souples, ainsi que
- d’une plus grande amplitude
- de registres,
- de nuances et
- de touchers.
Résultat ?
- La lisibilité de la polyphonie pourtant fort riche,
- les délicatesses du toucher,
- l’aisance technique,
- la science de la pédalisation (magique jusque dans la coda) ainsi que
- la capacité à rendre poétiques, captivants et même narratifs
- l’harmonie,
- le chromatisme et
- le savoir-faire du compositeur
font de cette interprétation un moment suspendu confirmant le bien-fondé du projet. En effet, jusqu’à présent, le disque traduit la créativité – multiple, forcément multiple – qui sourd des contraintes quand un maître de l’écriture
- les assume frontalement,
- les peinturlure à sa façon et
- se les approprie.
La prochaine étape promet : nous y aurons rendez-vous avec Alfred Schnittke !
Pour acheter le disque, c’est par ex. ici.
Pour l’écouter intégralement et gratuitement, c’est par ex. là.
Pascal Vigneron – Le grand entretien – 2/7
Moins tête d’affiche que fomenteur d’affiches, Pascal Vigneron dénote, étonne et détonne dans le petit Landerneau de l’orgue. Musicien poly-instrumentiste, homme de réseaux mais pas de coteries, fidèle en amitiés artistiques mais pas monogame, estimé par quelques-uns des grands noms du métier au premier rang desquels Éric Lebrun, l’un des rares interprètes-compositeurs-pédagogues sur qui même les connaisseurs les plus vipérins (les connaisseurs, donc) de l’orgue peinent à postillonner leur venin, l’énergumène rassemble et divise à la fois. Sujets inflammables, convictions intimes, petits secrets, rencontres marquantes et brillantes réussites sont au programme de ce grand entretien où seront évoqués
- le musicien,
- l’organiste,
- l’organologue,
- l’organier numérique,
- l’organisateur et
- le studioman
que sont les mille et un pascalvignerons cachés derrière Pascal Vigneron.
Déjà paru
1. Devenir musicien
Épisode deuxième
Penser l’orgue
Pascal, dans l’épisode liminaire de cet entretien, tu as tenté de dénouer un premier paradoxe : trompettiste par défaut, tu es devenu organiste par choix. Tu en as profité pour nous expliquer pourquoi, selon toi, l’instrument ne fait pas le musicien et réciproquement. Est-ce pas un second paradoxe de la part de quelqu’un qui a travaillé avec Selmer pour peaufiner la fabrication de la trompette, puis qui a conseillé la ville de Toul pour la restauration du grand orgue ? Finalement, l’instrument, ça compte, non ?
Bien sûr qu’il y a un lien entre l’instrument et la musique, mais ce lien existe entre tous les instruments et la musique ! Il est peu ou prou le même entre l’orgue et la musique qu’entre la trompette et la musique. Je te parle d’un état d’esprit, d’une exigence, d’une réflexion qui ne s’arrêtent ni quand on change d’instrument, ni quand on en pratique plusieurs en parallèle comme je l’ai fait.
De là à passer d’expert ès trompette à expert ès facture d’orgue, admets qu’il y a un pas et que vous n’êtes pas nombreux à l’avoir franchi…
Je te l’ai dit, mon but, c’était de faire de l’orgue voire de faire des orgues. Au point que j’ai suivi un CAP de menuiserie, dans ma jeunesse, avec un seul but : faire de la facture d’orgue. Donc j’ai appris à travailler le bois. Pas au niveau d’un facteur d’orgue, peut-être ; mais j’ai les bases. J’ai construit ma maison avec un studio d’enregistrement…
… on en parlera presque bientôt…
… eh bien, dans la maison, dans le studio, j’ai fait à peu près tout moi-même, sauf l’ossature bois. J’ai posé le parquet, j’ai isolé, etc. Pour ça, il faut quand même savoir manier les machines, les onglets, savoir faire une mortaise ou déligner une planche, etc. Les machines aident, c’est sûr, qui plus est en facture d’orgue. Regarde, Jacques Nonnet, un type extraordinaire qui était chez le facteur Giroud, il dispose de machines au millième. Du coup, quand ses collègues et lui posent une mortaise ou un chevron, c’est impeccable. Au dix-huitième siècle, ils devaient faire la même chose à la scie, ça leur prenait infiniment plus de temps et plus de personnel. L’évolution est impressionnante !
« J’aurais bien testé des chamades avec un cône de sax soprano »
Précisons que la menuiserie est souvent la base du parcours des facteurs.
Oui, la menuiserie et un certain esprit, aussi. Comme tu l’as dit, j’ai beaucoup travaillé avec Selmer. Je dois beaucoup à cette boîte. Elle m’a vraiment aidé à développer ma carrière.
J’ai lu que tu ne voulais pas être décrit comme leur essayeur mais comme un « collaborateur privilégié »…
Bon, tout dépend de ce que l’on entend par « essayeur ». J’ai effectivement essayé des innovations avec eux, mais j’étais partie prenante, je réfléchissais, je proposais, je discutais, je ne me contentais pas de venir souffler dans un tube ou une embouchure. La facture instrumentale m’a toujours passionné, peu importe l’instrument, encore une fois ! Avec Selmer, par exemple, on réfléchissait à la taille des ouvertures. C’est tout sauf un détail, si tu y réfléchis, parce qu’un corps sonore, que ce soit une trompette ou, dans un orgue, une flûte harmonique, son principe est le même. Ta pression de base, qu’elle s’exerce par un soufflet ou par le diaphragme, c’est pareil ; qu’elle fasse vibrer une anche ou des lèvres, c’est pareil !
Entre trompette et orgue, à t’en croire, tout ne serait que continuité.
Il y a des spécificités, évidemment. Cependant, il y a beaucoup de points de connexion. Par exemple, j’avais suggéré à Yves Koenig de tester des chamades en partant du cône d’un saxophone soprano. Ne rigole pas, c’est tout sauf bête. Selmer aurait pu s’y coller, mais ça ne s’est pas concrétisé. On aurait pu partir du huit pieds, prendre les cinquante-six ou soixante notes et imaginer un truc intéressant parce que le laiton utilisé chez les sax, surtout avec un vernis mat, brossé, argenté ou aurifié, est beaucoup plus épais. Ça aurait mérité d’être exploré. Dommage !
Sera-ce un signe de ce « manque d’ouverture » que tu dénonces ?
Possible.
« Michel Chapuis guidait les facteurs avec qui il travaillait »
Dans ta démarche, la facture d’orgue te permet d’emboucher, d’une part, ton savoir-faire et de menuisier et d’essayeur au sens que tu as spécifié, avec, d’autre part, l’aboutissement d’une réflexion sur la musique, le souffle et l’ouverture.
Disons que les choses se sont bien boutiquées, d’autant que, là-dessus, est arrivée l’aventure du grand orgue de Toul. J’avais déjà bricolé de belles choses ailleurs. Par exemple, j’avais rapatrié un orgue hollandais à la collégiale de Saint-Gengoult. Je l’avais récupéré en pièces détachées. Je l’ai remonté entièrement de A à Z. Je ne me hausse pas du col mais, pour mener à bien ce genre de mission, faut quand même avoir quelques notions. Cela étant, y a des domaines auxquels je ne touche pas.
Comme ?
L’harmonie.
Pourquoi cette limite ?
Parce que je pourrais essayer de m’y coller, mais je sais que ce ne serait pas bien fait. C’est comme la soudure : sans moi ! Il faut avoir la main. Il y avait un tuyautier chez Mühleisen que Julien Marchal a repris chez Koeing, il est extraordinaire. Il a vraiment une main magique. Il va d’un bout à l’autre, il met son blanc d’Espagne, il assure à chaque fois, c’est formidable. Donc, ça, je ne le ferai pas. Quand tu fais, il faut aussi savoir où t’arrêter. Michel Chapuis, qui était un ami, avait aussi cette lucidité.
Parfois, certains ne l’ont pas.
Non, même de grands bonshommes, même dans de grands endroits. Tiens, par exemple, il y a quarante ans, j’ai vu François Chapelet sortir des trompettes de l’écho pour les mettre en chamade avec des tuyaux. C’était saugrenu, mais ça ne se ferait plus, aujourd’hui !
La page Wikipedia de Michel Chapuis précise qu’il connaissait « la facture d’orgue pour l’avoir pratiquée lui-même, ce qui a simplifié ou compliqué ses rapports avec les facteurs d’orgue »…
Pfff, Wikipedia, qui lit encore ça ? La vérité, c’est que Michel connaissait plein de choses. Ça guidait les facteurs avec qui il travaillait, et ça les guidait en direction du bon sens. Aujourd’hui, les organistes qui mettent les mains dans le cambouis ne sont pas si fréquents. Par exemple, à Toul, à cause des peaux de cuir qui sont usées, on a parfois des pannes sur l’équerre qui remonte vers l’abrégé de pédale : j’y vais, je regarde, je répare, ça évite de faire venir un facteur pour un truc réparable sans lui.
« Je ne veux pas d’une société du clivage donc de la limitation »
Dans le premier épisode, tu évoquais aussi Pierre Cochereau qui, sans offense, avait sa réputation de bricoleur du dimanche…
Pierre bricolait comme un fou. Il bricolait même l’électricité. Quand je suis allé chercher son piano que je vais mettre dans mon studio d’enregistrement, Marie-Pierre m’a montré des fils qui couraient… Oh la la ! Il devait s’offrir de jolis feux d’artifice, avec ça, c’est sûr ! Mais c’était un gamin. Et alors ? C’est pas une performance, quand tu as son talent et son vécu, d’avoir su rester un gamin ?
Soit, mais contestes-tu que, même entre vedettes de l’orgue, les polémiques sur la facture soient légion ?
Bien sûr, s’apprécier, se respecter, ça n’empêche pas les bisbilles. Ainsi, Michel [Chapuis] avait expliqué à Pierre [Cochereau] que le départ de la pédale du Cavaillé de Notre-Dame, pourtant sur moteur pneumatique, était aussi immédiat que l’électricité… sauf que, sans l’électricité, tu n’as pas les combinateurs ou le crescendo pour des orgues de cette dimension. Les deux n’étaient pas d’accord ! De façon plus générale, ce que signifie cette anecdote, à mon sens, c’est que, en facture d’orgue comme dans la vie, les points de vue se discutent. Ils ne s’annihilent pas. Pourquoi opposer ce qui, souvent, peut se concilier et faire avancer ?
Je ne t’apprendrai rien en pointant le fait que la facture d’orgue ne vise pas toujours le progrès.
Mon Dieu, non ! Il y a tant d’orgues que l’on renvoie deux siècles en arrière, ces temps-ci, sous couvert du respect délétère d’une pseudo historicité ! À l’inverse, je pense à Pierre Pincemaille, avec qui j’ai donné beaucoup de concerts. Pierre était pour la synthèse. Il demandait : « Pourquoi, pour écouter du Couperin, il faudrait aller dans telle église, et pour écouter du Vierne dans telle autre ? »
Parce que, sur la plupart des orgues, on ne peut pas tout jouer, peut-être, et que certains font mieux sonner certains répertoires que d’autres ?
Je n’en suis pas toujours sûr. Surtout, je ne suis pas sûr que ce soit l’avenir de la facture. On vit de plus en plus dans une société de la spécialisation, donc du clivage, donc de la limitation. Il faut se méfier de ce réflexe sclérosant. Regarde à la trompette, à la clarinette, on peut tout jouer avec un seul type d’instrument !
Tu sais bien qu’il y a des instruments anciens : il y a des orchestres spécialisés dans le baroque, dans la musique romantique, avec des musiciens munis d’“instruments d’époque »…
Certes, mais on peut aller loin, comme ça, avec l’hyperspécialisation et les scléroses que cela entraîne. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable, donc je lutte en musique et en facture pour proposer d’autres solutions.
Pour découvrir gratuitement l’intégralité du disque célébrant la restauration de l’orgue de la cathédrale de Toul, c’est ici.
À suivre !