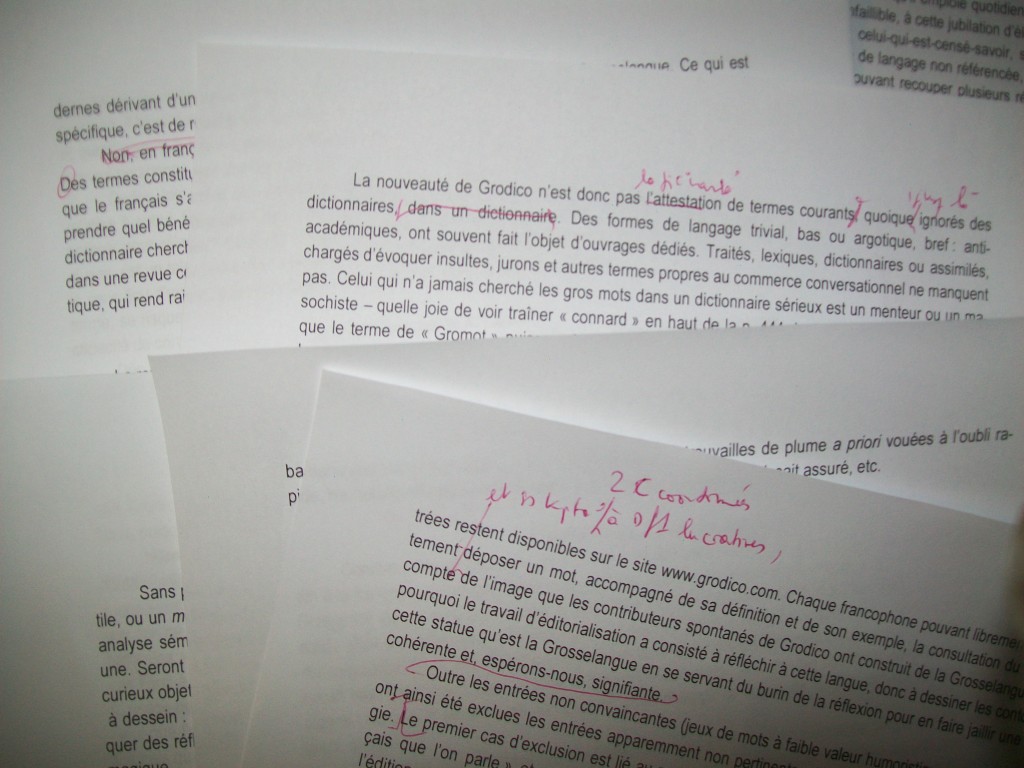Tchicatchicahhhh, la chanson qui s’coule
Le seul bis qui serve aussi de test d’haleine ? Une exclu Bertrand Ferrier. Peut-être ce soir à 20 h lors du concert du Connétable (55, rue des Archives / 75003 / M° Rambuteau). Le chanter avec vous serait un plus positif, limite pomme-pet-deup, ne serait-ce que pour faire chier les connards qui promettent de faire grève pour retarder le moment où je ferai péter la salle pour cause d’excès de spectateurs.
Introduction à la jontologie
Une vieille chanson sur la jontologie, cette médsine pour les psonnes âgées. Premier souvenir du concert propulsé au Magique le 18 octobre…
Mes idées débiles, 05
Si l’on soupçonne un excité d’avoir bu trop de café, est-il arrivé que l’on diagnostique à un mou une ingurgitation excessive de compote ?
Gil Ben Aych fête ses quatorze ans en 2012
 L’Anniversaire du 28 octobre 1962, de Gil Ben Aych (l’école des loisirs, « Médium », 108 p., 7,5 € soit 0,07 € env. la p.) ? Ach, voilà un livre qui laisse perplexe. Ce n’est pas, en soi, un défaut, mais on aurait aimé en être, sur ce cas précis, franchement convaincu. (Voilà, c’est mon accroche pour ce livre. Elle est très perfectible, comme disait cette chère Malina Stachurska du temps qu’elle jaugeait mon travail, mais bon, c’est l’approche qui existe, reconnaissons-lui à tout le moins, j’adore cette expression qui donne envie de cogner quelqu’un, ce défaut ou cette qualité, c’est la moindres des causes.)
L’Anniversaire du 28 octobre 1962, de Gil Ben Aych (l’école des loisirs, « Médium », 108 p., 7,5 € soit 0,07 € env. la p.) ? Ach, voilà un livre qui laisse perplexe. Ce n’est pas, en soi, un défaut, mais on aurait aimé en être, sur ce cas précis, franchement convaincu. (Voilà, c’est mon accroche pour ce livre. Elle est très perfectible, comme disait cette chère Malina Stachurska du temps qu’elle jaugeait mon travail, mais bon, c’est l’approche qui existe, reconnaissons-lui à tout le moins, j’adore cette expression qui donne envie de cogner quelqu’un, ce défaut ou cette qualité, c’est la moindres des causes.)
L’histoire : Gil quitte les Batignolles pour Champigny, où il a de nouveaux profs et de nouveaux kômôrôdes de klass. Il les décrit, mais on s’en fout car le coeur du sujet, c’est le week-end des 27 et 28 octobre 1962, marqué par le référendum gaulliste, la crise des missiles cubains… et le quatorzième anniversaire de l’auteur. Dans une chaude ambiance politique, imprégnée par le communisme virulent des uns et l’indifférence des autres, mais aussi une chaude ambiance religieuse, que nourrissent le judaïsme résolument casher des uns et l’ouverture au halouf des autres, l’auteur esquisse deux jours de tension, où égocentrisme annuel et mondialisme rouge cherchent, bon an mal an, un terrain d’entente.
Le bilan : forcément, chez un fils de pied-noir algérien (si) vivant aux Batignolles et dont une soeur s’est installée à Champigny, il y a un intérêt sinon communautaire du moins familial pour ce genre de témoignage. Pourtant, si ledit fils de pied noir n’oublie pas qu’il a aussi un cerveau et qu’il a passé des années, à tort ou à raison, à construire des critères de jugement argumentés, il doit bien admettre que le troisième livre de Gil Ben Aych publié à l’école des loisirs ne l’a pas entièrement séduit. Voici pourquoi.
En cause, en premier lieu, les artifices dont le maintien en l’état par l’éditeur vise, sans doute, à attester l’authenticité du témoignage, mais nous semble a contrario le desservir méchamment. Les doubles ou triples signes de ponctuation (« ?! », « !!!… », etc.) nous ont toujours paru traduire une faiblesse de l’expression – c’est donc aussi le cas ici. Le langage, le style, les astuces linguistiques de tout poil doivent pouvoir, à notre sens, éviter ces coups de Stabylo entre lourdeur et puérilité. De même, les notes de bas de page, intégrées au texte, qui sous-titrent sporadiquement le récit (« Lenny Escudero, célèbre chanteur d’origine portugaise »), nous désobligent aussi : ou le contexte permet de cerner le sens de cette référence, ou on s’en fout, c’est un petit bonus pour les connaisseurs et les curieux (pas d’ma faute ou presque, j’ai toujours détesté les donneurs de leçon qui exerçaient leur sacerdoce en dehors des cours ou équivalents). Ces astuces peu astucieuses visant à paraphraser et surligner le sens, attestées même dans de très bons livres pour la jeunesse, sont ici si nombreuses qu’elles peuvent paraître saturer le récit et donner une impression d’amateurisme maquillé en signe de véracité, sur le thème : le témoignage n’a pas été écrit par un professionnel de la littérature pour la jeunesse, d’où ces dissonances… D’où, surtout, notre frustration.
Celle-ci est motivée par, en second lieu, une structure bancale, grevée par un long chapitre de quarante pages (les dix autres font donc en moyenne six pages chacun), truffant de commentaires dialogués le récit radiodiffusé de la journée de crise. Cette pénible leçon d’Histoire, même personnalisée de façon assez grossière (itals pour la radio, romain pour les commentaires, tuilage parfait entre les deux), donne l’impression que l’anniversaire du narrateur-autobiographe est un prétexte à un long panoramique didactique sur ce moment, au lieu d’être un réinvestissement personnalisé d’un événement international. Pour les gourmands, disons que c’est l’anti-Quand j’étais soldate de Valérie Zenatti, qui tendait à montrer comment être une jeune femme malgré les tensions israélo-palestiniennes et les joies de la vie militaire – faisant donc le choix du récit construit, nourri et enlevé contre le didactisme ou la plate série de notations d’époque. Cette impression peu favorable est renforcée par des listes descriptives (les profs, les élèves) dont il n’est fait aucun usage narratif. Leur intérêt est sans doute évident pour Gil Ben Aych, mais pour le lecteur, ce sont des pensums inutiles. Bien sûr, on aimerait dire qu’ils permettent de saisir, par petites touches, l’esprit d’une époque, mais on serait carrément des gros menteurs qui puent si on prétendait penser ça.
Le résultat des courses : les faiblesses patentes pointées supra sont d’autant plus agaçantes que le dernier tiers du livre est plutôt prenant. Les personnages de la boulangère et de son mari velu sont bien campés, on s’amuse à la dégustation de conserves interdites, on se réjouit de l’indifférence ironique de la mère, on apprécie l’ambiance assurée par les gens-qui-sont-malgré-tout-venus-à-l’anniversaire. Mais le mal est fait : faute d’un travail éditorial, même sciemment défaillant, qui aurait pu inciter Gil Ben Aych à alléger les répétitions sur l’onomastique, mieux construire son texte pour le gorger d’anecdotes croustillantes et significatives, bref, dépeindre de façon plus personnelle et moins ennuyeuse ce week-end spécial, plus jouer sur les formulations comme il le fait parfois (« merde, pour une fois que j’avais quatorze ans », 45 ; « Où t’y as vu jouer ça, déjà ? », 54 ; « un anniversaire, ça te fait une année de plus à vivre en moins », 104 ; « si je me vois comme une figue, que serai-je dans une troisième vie ? », 107), bref, rédiger un fragment autobiographique plus personnel et plus prenant à la fois, on est déçu et, pensant au livre que l’on n’a pas lu, on peste à coups de « nom d’un petit bonhomme » (oui, comme le village gaulois) et autres saperlipopette.
Mes idées débiles, 04
Projet rétroactif : prendre le Titanic avec la ferme intention de s’y suicider par noyade.
Olivier Balazuc est (mieux que) Laurent Binet
Les apparences sont une arnaque, une fois de plus : sur la photo de Josée Novicz, il y a bien le comédien, romancier, livrettiste, metteur en scène, dramaturge, etc., Olivier Balazuc, un de ces potes qu’on a plutôt envie d’assassiner pour cause d’excès de talents-au-pluriel, mais, avec un p’tit effort, on devine aussi, sous l’oreiller, Leslie Bouchet, dont les tétons ne vont pas tarder à pointer hors du lit. Pour la bonne cause : depuis le 11 octobre et jusqu’au 26, le théâtre de la Commune, à Aubervilliers, accueille l’adaptation théâtrale de HHhH de Laurent Binet, signée Laurent Hatat. J’y suis allé le dimanche 14 en matinée, et voici ce que j’ai vu.
L’histoire : un écrivain compte raconter l’assassinat de Reinhard Heydrich à Prague, en 1942. Sauf que, paralysé par son souci d’exactitude, il n’avance pas, bien que sa marotte détruise son couple (première partie). Jusqu’au jour où il se lance (seconde partie) et accepte les béances de l’Histoire pour narrer, enfin, une grave histoire de parachutistes, jeune fiancée, crypte, Sten merdique, crin de cheval, salopard et trahison, le tout dans un seul souffle – le sien.
L’avis : l’adaptation de Laurent Hatat repose sur l’opposition entre un dialogue soliloqué (l’écrivain parle avec sa compagne, mais tient de moins en moins compte de ses interventions) et un soliloque schizophrène (l’écrivain raconte l’Histoire mais aussi sa difficulté à la raconter, son impossibilité à tout dire, ses silences obligés).
Ainsi donc, dans la première partie, le narrateur évoque son roman, l’Histoire, la réécriture mémorielle. De la sorte, il cherche à discerner ce qui est bien, intéressant, acceptable, etc. Pendant ce temps, sa compagne, après avoir joué le jeu, parfois au sens propre, lui signale qu’elle en a un peu ras la casquette et l’accuse de se laisser fasciner par le nazisme sous prétexte d’intérêt historique. Le couple tourne dans le lit, accompagné d’extraits de films que le narrateur commente, de projections du texte ou de sources qui tantôt défilent, tantôt s’ouvrent à la manière de notes de bas de page – pop-up, etc., jusqu’à ce que l’écrivain soit, à l’évidence, au bord d’une manière de folie, entendue comme emmurement ou déconnexion, ce que manifeste la désertion bien compréhensible de sa compagne. C’est là qu’on croit toucher le coeur d’un projet dramatique palpitant, en tout cas qui nous fait palpiter : il s’agirait de faire sentir la folie de l’art, l’invasion de l’écriture sur la vie, le retournement de la proie – le narrateur songeait-il écrire l’Histoire ? voilà que, en l’obnubilant, c’est elle qui écrit la vie de l’écrivain.
Or, la mise en scène n’est pas à la hauteur de l’enjeu. Demander à un acteur de jouer la folie en l’extériorisant (déstructuration du décor en forme de lit, bonds et jets de manuscrit) peut paraître vain à bon droit, tant l’effet Stabylo (tu as vu, spectateur, ce que je veux te faire comprendre ?) a quelque chose de lourdaud, voire d’insultant pour mes p’tites cellules grises. Olivier Balazuc tente, avec une abnégation stupéfiante, de le compenser. Comme pour signifier que le fou n’est pas que le vociférateur ou le proférateur pusillanime – je suis pas sûr que « pusillanime » s’applique ici, tant pis, je laisse car ça crache – mais est aussi celui qui interroge et s’interroge juste un peu trop, comme pour pointer que l’artiste en danger de démence est parfois celui qui repousse les limites de la norme en croyant qu’il saura s’arrêter à temps, partant maîtriser cette ivresse, Olivier Balazuc, donc, décline une palette impressionnante d’attitudes, de registres vocaux, de rythmes, de jeux avec le silence brefissime, d’expressions faciales, qui captent le spectateur et alimentent son attention. Pas entièrement suffisant, à notre goût, pour compenser les faiblesses de l’adaptation de Laurent Hatat (personnage fantoche interprété par Leslie Bouchet, début de la pièce joué entièrement nu par Olivier Balazuc – on l’a souvent vu postérieur dénudé, mais était-ce vraiment symbolique de lui demander d’exposer ses couilles ? – et presque entièrement nue par sa partenaire, musique clichetonnante…).
D’autant que trop court est le moment où l’on croit voir advenir un enjeu, un projet susceptibles de nous captiver. En effet, la seconde partie, après que l’acteur a tiré le rideau sur ce qu’il reste de son lit, est entièrement constituée d’un monologue de, quoi ? disons d’une vingtaine de minutes ininterrompue, qui réalise le débat entendu précédemment. La promesse de raconter l’assassinat est enfin mise à exécution, ha ha, avec une répartition des rôles plus qu’attendue – héroïques Résistants, connards et cons de nazis. Que cela corresponde à une réalité historique importe peu ; j’étais violemment déçu de me retrouver devant un récit, certes bien mené, mais dont l’absence d’originalité littéraire remet en cause l’intérêt des débats littéraires et historiographiques ! L’adaptateur a-t-il voulu jouer sur la dimension déceptive du résultat (en clair : tout ça pour ça, toutes ces réflexions pour un résultat si convenu) ? Cette hypothèse n’est pas tout à fait convaincante, car la happy end (retour de la compagne en imper) plaide plutôt pour un éloge d’une normalité retrouvée, ce qui est, dans la vie, rassurant, mais, en littérature, moins déceptif que décevant. Et pourtant, en direct, on ne peut que constater la virtuosité de l’acteur. Explosent sur scène le talent, le métier et l’art de conteur d’Olivier Balazuc, sa capacité à rapter la salle d’un regard, d’une intonation, d’un débit affolant (dans sa rapidité ou ses brusques brisures), d’un geste ou d’une immobilité, et d’une diction toujours parfaitement intelligible quoique jamais surfaite (on est aussi loin de la préciosité alla Comédie-Française que du marmonnement pseudo-profond d’une impatientante Jeanne Balibar). Cette prestation, sinon diabolique du moins surhumaine, ne peut que sonner l’esprit critique du spectateur, puis emporter son adhésion momentanément, et son admiration définitivement.
Le résultat des courses : ben oui, avouons-le, pendant le morceau de bravoure final, réellement exceptionnel – pas tant par sa longueur, même si bon, déjà, que par l’intensité du jeu d’Olivier Balazuc -, on est enlevé par l’évidence de cette interprétation, donc presque séduit par ce qui se dit, à la façon régressive de « raconte-moi une histoire, encore, encore, encore ». Mais, à l’arrivée, le soufflé retombe : l’acteur est éblouissant, c’est sûr, gravé, incontestable ; reste qu’il joue une adaptation peu épicée, malgré le sujet touchy, où l’essentiel de ce qui nous paraissait le plus alléchant est occulté. Vu le zozo qui joue ce texte, c’est quand même un chouïa dommage !
Mes idées débiles, 03
Principe du Rubik’s Cube appliqué : si tous les gens garés loin de leur destination changeaient de place avec les gens garés loin de leur-destination-à-eux, mais proches de la destination des gens-du-début-de-la-phrase, ben, ce serait plus logique, non ?
Carrément à l’américaine
Tiens, une nouvelle chanson, extraite du concert du 9 octobre au Connétable ! L’occasion de nous souhaiter une joyeuse vie réelle à nous tous.
Et sinon, n’oubliez pas : concert aujourd’hui au Magique (42, rue de Gergovie / 75014 / Métro : Pernety). Le fan-club permanent étant indisponible ce soir, j’ai absolument besoin que vous veniez et que vous rameutiez du people. Entrée libre, quart de queue, cave insonorisée, la grande classe pour les curieux. D’avance, merci les gens !
Robert Charlebois à l’Européen : le concert extraordinaire d’un chanteur pas ordinaire
 Le contexte : Robert Charlebois a traversé cinquante ans de carrière. C’est le chanteur québécois par excellence, tantôt à texte, tantôt rock, tantôt psychédélique. Il revendique d’avoir usé à peu près de toutes les drogues, même légales, ce qui l’a détruit, construit, instruit. Dix ans après son retour en France (2003), à l’occasion d’un concert bouleversant à l’Européen qui le relançait dans l’Hexagone, il re-revient au même endroit. J’ai acheté ma place début mai – inutile de dire que j’y étais ben à l’avance, avec un peu les choukoutounses : trop vieux ? trop identique ? Le verdict est ci-d’sous, même si le titre de la note, voire la note du titre, donne une idée du résultat.
Le contexte : Robert Charlebois a traversé cinquante ans de carrière. C’est le chanteur québécois par excellence, tantôt à texte, tantôt rock, tantôt psychédélique. Il revendique d’avoir usé à peu près de toutes les drogues, même légales, ce qui l’a détruit, construit, instruit. Dix ans après son retour en France (2003), à l’occasion d’un concert bouleversant à l’Européen qui le relançait dans l’Hexagone, il re-revient au même endroit. J’ai acheté ma place début mai – inutile de dire que j’y étais ben à l’avance, avec un peu les choukoutounses : trop vieux ? trop identique ? Le verdict est ci-d’sous, même si le titre de la note, voire la note du titre, donne une idée du résultat.
Le spectacle : le tour de chant – attention, kind of spoiler – s’ouvre par deux hits au piano, avec une surprise : l’artiste, réputé pour sa nullité pianistique, s’est drôlement amélioré. Son niveau est désormais très bon ! De même, la voix monte toujours sans souci sur Québec Air à la recherche de Sophie. D’ailleurs, le chanteur n’est pas près de revenir définitivement à Montréal, même pour se marier avec l’hiver : après une semaine complète à l’Européen, il reviendra remplir le Trianon le 23 mars.
En ce soir de première, bien que le zozo frisé admette n’avoir pas rechanté depuis un mois et demi, le concert vaut déjà la chandelle. Marqué par une invasion de guitares de toutes sortes, entre ambiances intimistes et folie rockeuse, la set-list pivote raretés, quelques nouveautés (la plus potable, pardon Réjean Ducharme, étant sans doute « Je chante, donc je suis », signée par l’Académicien Jean-Loup Dabadie, présent), et un gros lot, et non un grelot, ça n’aurait pas de sens, de classiques. Surtout, excellente nouvelle, il s’organise autour de pôles classés par genre (les latinos, même si Dolores est, et c’est une bonne idée, séparée de Concepción ; les rocks ; les blues ; les folks, etc.), avec de bons arrangements rythmiques – dommage que le choeur des musiciens ne soit pas plus utilisé, il sonne bien ! Grâce à ce cocktail vitaminé, comme en 2003 mais avec une aisance retrouvée qui enlève en émotion ce qu’elle ajoute en plaisir immédiat, Robert Charlebois mélange avec art ses propres ingrédients, et c’est bon.
Comme en 2003 aussi, les chansons dynamiques envoient du son, avec l’accompagnement de deux guitaristes-bassistes (dont « le plus fringant des Cowboy Fringants ») et un très bon batteur. C’est un peu trop fort pour l’Européen (grosse caisse abusive sur les premières chansons), mais cela respecte le sound code – comme il existe des dress codes – des chansons énergiques et énergisantes. Robert Charle fait bois, oh, ça va, de tous les clichés, ironise sur ses différentes périodes musicales mais joue tout ce qu’il a choisir d’interpréter avec la même conviction, le même premier degré nécessaire, et un dynamisme spectaculaire. Les textes sont sus (quelques erreurs visibles et assumées sont là parce que c’est du live, merde !), le métier est patent, les accompagnateurs n’en font pas trop : l’artiste pousse la liberté jusqu’à faire une fin en decrescendo, avec chansons intimistes – alors qu’il aurait pu clore sur l’hyperpêchu et formidablement con « C’est pas physique, c’est électrique », « hommage à EDF », plaisante-t-il.
Le résultat des courses : c’est vrai, contrairement à la reine Diane Dufresne, le tsar Robaert Charlebohé n’écrit plus de chansons déjantées ou bouleversantes. Mais, partant de cette évidence, le Québécois en insère juste ce qu’il faut pour ne pas être qu’un musée vivant ; pour le reste, il se fonde sur un répertoire richissime qui vivifie un art de la chanson protéiforme et, dans chaque genre convoqué, merveilleusement maîtrisé. Chanteur pas ordinaire qui veut de l’amour au point de montrer le ventre plat qui signe sa sveltesse retrouvée (« J’veux d’l’amour » ouvrait le précédent concert européen, elle conclut le tour de chant 2012), Robert Charlebois n’éblouit pas malgré ses cinquante ans de carrière, il éblouit tout court. Bref, c’était pomme-pet-deup d’assister à la nouvelle prestation de ce talent.
Ah, et sinon, en première partie se produisait une pitoyable jeune femme dont on préfère oublier, car elle a l’air sincère et sympathique, qu’elle s’appelle Ingrid Saint-Pierre. Rien n’est bon : la chanson drôle n’est pas drôle, les chansons chougnantes sont juste chougnantes, pas émouvantes faute de talent musical, poétique ou scénique. La pauvre et chanceuse fille rend donc, malgré elle, furieux quand on pense aux talentueux chanteurs québécois (ou même juste connement français) que l’on aurait eu tant de jubilation à découvrir…