Salle Pleyel, 8 janvier 2013
« C’est très russe, ce soir », juge avec une lucidité impitoyable un spectateur averti. Remarque d’une justesse éprouvante, puisqu’il s’agit du deuxième volet de l’intégrale Chostakovitch donné par les troupes du Mariinsky (non, aucun rapport avec Mariinskyng Clark), sous la direction de Valery Gergiev.
Le programme est, une fois de plus, copieux. La première partie s’ouvre sur la Symphonie n°3, dite du Premier mai. Une demi-heure de musique dense, variée, belle, qui permet d’entendre la richesse d’un orchestre qui semble à l’aise (surtout si l’on n’a pas vu les musiciens tirer violemment sur leurs sèches à l’entrée des artistes, juste avant d’entrer en scène). Une fois de plus, dans cette partition très prenante, on croit percevoir la faiblesse de cet ensemble : les voix aiguës du Chœur, qui semblent souvent fausses et imprécises dans leurs départs. Néanmoins, la beauté des solistes orchestraux, la qualité des attaques, les bonnes synchronisations : tout cela l’emporte sur les réserves, et se révèle d’autant plus appréciable que l’orchestre a, comme la veille, le bon goût de s’effacer dans le Deuxième concerto pour violoncelle, afin de laisser s’exprimer Mario Brunello. La composition alterne morceaux de bravoure et passages posés, étirés ; et il convient de faire mieux que prêter l’oreille pour la savourer. En sus, on ne jurerait pas qu’il s’agit de la plus belle interprétation violoncellistique jamais entendue. So what? Les difficultés techniques sont assez impressionnantes pour qu’on n’ait cure d’éventuelles petites maladresses qu’un ingénieur du son gommerait en studio. En effet, le soliste joue vraiment sa version, intime, en direct. Les rares problèmes de justesse permettent d’entrevoir l’humain derrière le virtuose. Car, tout au long des trente-cinq minutes que durent les trois mouvements, le violoncelliste écoute l’orchestre, s’assure de la bonne circulation de la musique… Les deux bis très expressifs qu’il offre à un public admiratif lui assurent une ovation méritée.
La seconde partie est constituée par l’impressionnante Symphonie n°13, dite Babi Yar, manière de devoir de mémoire anti-antisémite. Gros orchestre, ensemble vocal masculin et soliste basse sont exigés pour l’exécuter. L’œuvre, qui dure un peu plus d’une heure, réussit à capter l’attention de bout en bout, par son aspect massif et sa variété d’atmosphères. Ici, chacun tient sa partie avec brio. Le Chœur mâle envoie, malgré sa piètre position (pour des raisons financières, il est collé pile derrière l’orchestre). L’Orchestre tâche d’être précis, de répondre aux variations d’ambiances par des nuances pertinentes, et d’offrir une base sûre d’où émergent des solistes rarement pris en défaut. Valery Gergiev dirige avec une volonté certaine de précision indispensable. Et la vedette du jour, pourtant, n’est ni la masse, cohérente et de qualité supérieure, ni le chef : c’est Mikhail Petrenko. On avait entendu en ces lieux l’excellent Sergei Leiferkus. Pourtant, on ne se souvient pas d’avoir été aussi impressionné que par la remarquable basse chargée de tenir son rôle ce soir-là. La puissance (et non la criaillerie) est spectaculaire ; mais la douceur de certaines notes (les pianos allant chercher les aigus, par ex.) ne l’est pas moins. La voix n’est jamais forcée ; elle résonne aussi joliment sur l’ensemble des registres traversée ; et elle donne au texte un relief musical saisissant.
Bref, une superbe soirée. Vivement le troisième épisode (l’an prochain, je crois). Qui devrait, rassurons l’expert entendu ce 6 janvier, être, lui aussi, extrêmement russe !
Salle Pleyel, 7 janvier 2013
En première partie, la Symphonie n°1 attaque fort. L’Orchestre du Théâtre Mariinsky est précis, puissant, varié. La netteté des attaques, la capacité de nuancer, la beauté des soli, tout concourt à séduire l’ouïe. D’autant que la partition, en quatre mouvements, permet une écoute sans cesse en éveil. Le compositeur contraste, installe des ambiances, renâcle, repart, développe, ajoute des bribes, fait du bruit, s’emporte… et ses interprètes le servent avec une application qui suscite à juste titre l’enthousiasme d’une salle Pleyel quasi comble. Certes, les spécialistes voient surtout dans la pièce une compo de conservatoire, donc un premier lèche-culisme institutionnel de DSCH ; mais comme je ne suis pas un expert, j’ai p’t-être le droit de dire que c’est fort palpitant, à écouter – et si j’ai pas la légitimité, ben, j’la prends.
La Symphonie n°2 qui suit est d’une espèce différente : c’est un bloc de vingt minutes, dont le début est saisissant – grouillement des graves, agitation des cordes, rythmes qui se délitent (un pupitre énonce une série de notes, un autre la reprend mid-tempo, ainsi de suite). Après dix minutes, cependant, le Chœur du Théâtre Mariinsky intervient pour déclamer un poème débile d’Alexandre Bezymenski, louant « Octobre » et caressant l’anus du Berlusconi de l’époque (« Notre devise : Octobre et Lénine, l’âge nouveau et Lénine, la commune et Lénine »). Les sopranes sonnent faux et les voix aiguës en général pas forcément très précises, mais les interprètes font ce qu’ils peuvent pour rendre l’énergie martiale que la pièce impose ; et l’on ne peut que louer le son compact et percutant obtenu par Valery Gergiev en dépit de conditions limite (les choristes sont placés derrière l’orchestre, et non dans les gradins comme de coutume, afin que puissent être vendues les places où ils eussent dû se tenir d’ordinaire). Reste que cette deuxième symphonie n’est pas la plus palpitante du compositeur.
En seconde partie, le Concerto pour piano n°2 renoue avec la veine quasi pétillante que DSCH savait aussi exploiter. Denis Matsuev joue avec autorité une pièce qu’il connaît sur le bout des doigts – et, comme toujours chez Chosta, des doigts, il en faut. L’orchestre a le bon goût d’engager un dialogue parfaitement maîtrisé avec lui : les duos sont nets (on part ensemble, on arrive ensemble), l’équilibre entre tutti et solistes est sûr, les dynamiques sont tenues (vivacité sans esbroufe, élargissements opportuns sur les mouvements lents) – que demander de plus ? Le parti pris d’une interprétation non-géniale (pas de folie, pas d’excès, mais le texte, l’esprit, la précision) est tenu, et il est plutôt séduisant. Le bis paraît un peu plus approximatif (la pédale ne peut pas effacer tous les canards), mais cela n’a aucune importance : l’essentiel fut joliment joué.
Il est temps de faire disparaître le piano du soliste sous la scène – le public applaudit, c’est curieux, le mécanisme de régie alors sollicité – et d’attaquer un gros morceau : la Symphonie n°15. Soit une cinquantaine de minutes dans cette version (dans l’intégrale de Barshaï, elle dure moins de trente-huit minutes : peut-être cette dilatation explique-t-elle pour partie l’ennui que suscite cette gergievisation…), dont l’audition est réservée à des oreilles averties et en éveil. En effet, après un début grinçant (thème ironique des trompettes), la pièce alterne citations, échos de thèmes plus ou moins connus, et soli cycliques, dans une sorte de plat paysage où les reliefs sont rares et vite arasés. L’intérêt est d’entendre les solistes du Mariinsky, tous admirables, parmi lesquels le trombone, le violoncelle, la clarinette… Admettons néanmoins que ce côté Piccolo et Saxo (je fais entendre les différents pupitres) n’est pas de nature à susciter une audition passionnée en continu, même s’il y a quelque chose de stimulant dans cette longue langueur, et réciproquement, qui marque ainsi la dernière symphonie du zozo.
Le bilan de ce concert est donc contrasté : l’orchestre est excellent, visiblement très bien dirigé (même si un peu de peps supplémentaire ne nuirait pas toujours à VG) ; les musiciens ne sont pas venus faire leur tournée européenne en touristes dilettantes ! Mais l’exigence de l’intégrale n’a pas permis de construire un concert brillant, en crescendo : le charme de l’encyclopédie, à la différence de Grodico, n’est pas toujours dans l’affriolante exhibition de froufrous ! Et pourtant, il faut conclure par l’essentiel : au vu de la valeur de l’ensemble, on ne peut qu’avoir hâte d’assister au deuxième épisode de la saga. Chic, c’est ce 8 janvier. On en reparle donc bientôt ici.
Salle Pleyel, 6 janvier 2013
Bon, correct, extraordinaire : en résumé, le concert donné à Pleyel par le « Philar » (ça fait connaisseur, ou bien ?) de Radio-France, dirigé par Marek Janowski, accompagnant divers solistes.
Pour ce second volet Wagner, la première partie s’ouvre sur l’enchantement du Vendredi Saint, scène vedette de Parsifal. On y retrouve Stephen Gould en Parsifal, et on y découvre Albert Domhen en Gurnemanz. Le premier est à la hauteur de ce que l’on a entendu le 4 janvier : la voix est superlative, sûre, précise, tenue de bout en bout et sous toutes les coutures ; mais, en prime, le chanteur vit son personnage, cette fois, et stupéfie le public par son mélange de puissance, d’aisance et de musicalité. Albert Dohmen, que le programme présente comme le Wotan de référence, ce qui est un peu prétentieux, offre un Gurnemanz sérieux mais manquant assurément de coffre pour résister à un orchestre peu soucieux d’accompagnement : sa voix est souvent couverte par la masse, ce qui n’est pas sa faute mais bien celle de musiciens sans doute mal dirigés par Marek Janowski (ils ne sont pas en fosse, un peu de discrétion ne nuirait pas). D’autant que la suite leur permet de bien s’exprimer tout seuls : Siegfried-Idyll, chant d’amour sans parole de vingt minutes, sonne plutôt bien, même si on aimerait, et c’est bien notre droit prétentieux de spectateur, plus de cohérence, de tension dans les transitions, ces parties qui ne sont ni spectaculaires ni dégoulinantes de joliesse amoureuse.
La seconde partie reste le moment très attendu de l’après-midi. Dans une salle Pleyel pas tout à fait pleine, se donne la fin du Crépuscule des dieux, id est le voyage de Siegfried sur le Rhin, la marche funèbre pour le héros incestueux et l’immolation de Brünnhilde (qui, rappelons-le, récupère l’anneau maudit et se jette dans le brasier cramant son époux afin d’y périr avec son Grane, ce qui est la marque d’une sacrée salope, mais bon). Aux commandes vocales, Violeta Urmana. On l’avait entendue chanter Verdi à Bastille, elle était malade, c’était sublime ; on l’avait entendue mourir en Isolde le 4 janvier, c’était magnifique ; la voici sur le point de se barbecuiser, et c’est d’emblée magique. L’interprète, de la voix à l’esprit, impose d’emblée sa marque : timbre exceptionnel, aisance et présence. Regrettera-t-on, pour ne pas jouer au fana fada, certains aigus propulsés un peu vite ? Ils sont sans aucun doute dans l’esprit du personnage. Pas une note n’est escamotée, pas une tenue n’est truquée, pas un exploit pyrotechnique n’est oublié. Malgré la difficulté du morceau, tout sonne musical, tout est prenant, et l’interprète profite pleinement de ne chanter « que » cet extrait pour affiner une exécution plus divine que crépusculaire. On en oublie même – momentanément – les inégalités de l’orchestre – départs sporadiquement imprécis, accents plus violents que puissants, difficulté à tenir la distance avec la même intensité. Parmi d’autres, plusieurs fois, les cornistes sont en souffrance ; et on ne parierait pas que les cordes aient toujours joué au bon moment leur partition. Néanmoins, sur l’instant, peu importe : l’excellence de la cantatrice emporte toute réserve sur son passage.
Si on survit jusque-là, on la reverra cette année même à l’Opéra de Paris. Avec une nouvelle peur au ventre : sera-t-elle à la hauteur de son excellence wagnérienne ? Inch’Allah, je vous raconte, promis.
Psitt : le concert sera diffusé le 14 janvier à 14 h sur France-Musique…
Salle Pleyel, 4 janvier 2013
Chic, les vacances sont presque finies, ce qui signifie que les propositions de concerts à aller goûter voire écouter se multiplient. Ainsi, les deux cents ans de Wagner (qui ne les pas vraiment atteints, précisons) sont le prétexte de deux concerts donnés par l’Orchestre philharmonique et le Chœur de Radio-France. Le premier s’est tenu vendredi 4 janvier.
La première partie s’ouvre sur la très belle ouverture du Hollandais volant. En théorie du moins, puisque l’impatientant orchestre se permet de répéter pendant les vingt minutes qui précèdent le concert. Disons-le : cette impolitesse est minable.
L’Ouverture du Hollandais puis le Prélude de Lohengrin, eux, paraissent plutôt interminables – on exagère à dessein. La direction de Marek Janowski, qui tient à sévir essentiellement par cœur, alterne de belles tensions – notamment dans les passages virtuoses, où l’orchestre fait preuve d’une brillante maîtrise digitale – et des moments ennuyants – transitions molles, passages lents qui semblent étirés sans fin… De quoi attiser la hâte d’un public venu applaudir la spécialiste du rôle d’Elsa, vue sur Arte pendant les fêtes : Annette Dasch, qui vient chanter, ça doit bien la faire rigoler tant elle est habituée aux intégrales, un bout du troisième acte (son personnage, marié depuis peu à Lohengrin, trahit alors son serment et demande à l’époux de révéler son identité, ce qui entraîne la cygnisation du chevalier mystérieux). Après des premières phrases étonnamment timides, la vedette déploie un timbre très dramatisé : même en version de concert, la quasi-Scarlett Johansonn joue son personnage, le vivifie, veille à en traduire les émotions. Le contraste est donc puissant avec Stephen Gould, qui impressionne par une voix puissante sur toute la tessiture de Lohengrin, mais n’incarne pas son rôle – lire la partition ne l’aide peut-être pas… L’ensemble, vocalement, est de belle facture, peut-être néanmoins en-deçà des attentes, le laps laissé à Annette Dasch pour subjuguer un public acquis étant, semble-t-il, trop court pour que la star mette à profit l’étendue de son talent.
Signalons tout de même l’incorrection du Chœur, à la hauteur de celle de l’orchestre ou du service comm (« bienvenue à ce concert de Noël », « vos réponses nous serons très utiles », palsambleu !) : pendant sa brève apparition en tutti (les femmes chantaient en off deux minutes lors de la seconde partie), on entendait plus les tournes de page que la Marche des fiançailles. C’est franchement lamentable. Au moins. Notons aussi, pour l’anecdote que, pendant la mi-temps, très brève, Annette Dasch a accepté de se prêter au jeu des autographes et des photos avec une bonne grâce étonnante. (On a fait attention à la graphie de grâce, mais, de grâce, la prochaine fois, que l’on attend avec appétit, pourquoi ne pas opter pour une robe moins, comment dire, près du bidon ?)
La seconde partie offre le début de Tannhäuser (Ouverture et Venusberg), dans la version de « Paris » précisent les connaisseurs. Derechef, l’orchestre alterne des passages splendides (incipit joué avec des nuances très délicates) et des moments où, as far as we’re concerned, on s’ennuie. Les attaques ne sont pas souvent précises (il nous semble entendre de nombreux décalages entre les pupitres, et des rattrapages un peu bâtards), et les contrastes de dynamiques ne rendent pas autant qu’ils devraient, tant le chef semble avoir du mal à mener les musiciens dans ce rude morceau de roi. L’apparition de Violeta Urmana est attendue avec d’autant plus de gourmandise.
En effet, la diva chargée de conclure le concert affronte un court classique, la Mort d’Isolde (cette sotte se suicide un chouïa trop tôt, juste avant que son mari officiel vienne la pardonner). Et le résultat est magnifique. Même si l’orchestre semble, là encore, se traîner, la soprano saisit son auditoire dès les premières notes. Ce n’est pas seulement bien chanté, ce qui est déjà cossu vu la partition, c’est surtout beau. La voix est splendide – pas juste spectaculaire : riche, profonde, harmonieuse ; et l’interprète semble s’amuser des difficultés inouïes de la partition (largeur de la tessiture, sauts de registre, pianos dans les suraigus, tenues impossibles…). Même si un iota de vibrato en moins aurait pu emporter les minimes réticences des esprits les plus chagrins, quel dommage de ne pas en entendre davantage ! C’est incontestablement – d’autant que je suis d’accord avec moi, et que c’est moi qui décide – le grand moment de la soirée.
Par chance, ce 6 janvier, Violeta Urmana revient à Pleyel affronter la scène de l’Immolation. Ce sera forcément extraordinaire, mais j’ai hâte d’aller le vérifier.
Paroles, livres et musique
Amis curieux, fans transis, victimes du spam, autres (entourez ce qui vous fait zizir d’entourer),
Puisque vous avez a priori survécu au Réveillon ET à la fin du monde, ce qui n’est pas rien, voici le programme de janvier dans le même mouvement souple et sensuel qui caractérise mon positionnement dans l’espace – sauf quelques cas difficiles, d’accord, mais on n’est pas là pour raconter ma vie non plus.
Voici donc le contenu prévisionnel, c’est classe, du mois des cinq jeudis.
- Jeudi 3 janvier, 20 h : concert au Connétable (55, rue des Archives / 75003 / Métro : Rambuteau). Salle voûtée, proximité, facéties, effets spéciaux, chansons, good vibes francophones et plaisir de quasi inaugurer 2013 ensemble. Durée : 1 h 10 env. Pour les gourmands, sachez que, après une pause pendant laquelle on se pourra humecter la glotte, Claudio Zaretti chante dans la même salle. Si ça vous tente, ce zozo fait de la chanson conviviale, sympathique et drôlement maîtrisée. C’est optionnel, surtout pour les couche-tôt, mais c’est bien.
- Jeudi 10 janvier, 21 h : concert au Magique (42, rue de Gergovie / 75014 / Métro : Pernety). Piano quart de queue, salle parfaitement insonorisée, fredonnages, vocalisations microphonées – carrément – et plaisir de créer de nouveaux inédits en partageant raretés et clasicos, comme on dit en footballistologien. Bien sûr, besoin de votre soutien pour cette troisième date dans le lieu où chantaient, il y a à peine quelques jours, Michel Bühler et Sarcloret. Les kiffeurs kifferont. Les autres peuvent toujours faire « ouais, j’connais… » ! Durée : 1 h 15 env.
- Jeudi 17 janvier, dans toutes les librairies : parution des Mémoires d’une femme de ménage d’Isaure (Le Seuil, « Points »), que j’ai co-écrits. Enfin dispo à prix poche, voici la nouvelle édition du témoignage à succès qui a séduit critiques et lecteurs en 2012. Hope you like this version.
- Jeudi 24 janvier, dans toutes les librairies : parution de Grodico. Le dictionnaire du français tel qu’on le parle (Éditions de l’Œuvre, 530 p., 20 €), dont j’ai dirigé, hop, la publication et signé la grosse préface liminaire. C’est un Groprojet de plusieurs années, qui présente, décrypte et sous-titre le français inconnu du Robert et les mots que Word souligne en rouge, entre linguistologie, enquêtologie, lexicolistique et humourisme.
- Jeudi 31 janvier, entre 19 et 21 h : dédicace-dégustation des Mémoires, de Grodico et de quelques raretés. Thierry Welschinger nous accueille dans sa cave à vins (10, rue Bridaine / 75017 / Métro : Rome ou Place de Clichy) pour une dédicace agrémentée d’une dégustation à l’aveugle de trois vins. L’entrée est libre et gratuite, on peut goûter les vins – toujours savoureux – ou pas, voir les nouveaux livres, acheter des uns et des autres ou pas, discuter raisin avec un oenophile sympa, connaisseur et passionné… Bref, passez quand vous voulez : on devrait pouvoir passer un moment convivial et casual. Ensemble. La preuve : j’apporterai une ou deux chip à suçoter. C’est dire.
En 2013 comme en 2012, je vous rererenouvellerai avec force mes mercis pour votre soutien (diffusion de la bonne parole, présence aux concerts, achat des livres, frappation des amis pour qu’ils vous accompagnent aux spectacles, pouçation des vidéos YouTube – pour lesquelles vous pouvez vous abonner, afin d’être avertis des nouveautés…). De fait : merci. Dans cet esprit, je nous propose de poursuivre la bataille visant à rester acidulés, fresh, plaisants et même, si possible, vivants.
Aux plaisirs de vous rererecroiser en direct lailleve de préférence fort bientôt,
Bertrand.
Dernier article avant le prochain
Prenons une pause plutôt qu’une pose. Et retrouvons-nous. En concert le 3 janvier, 20 h, au Connétable. Sur ce site à tout moment. Sur ce blog très bientôt. Et d’ici là, continuons à faire l’humour.
Dernier concert avant Noël (il était temps)
 Ce 24 décembre, à 15 h pétantes, je vous invite à visiter l’orgue de Saint-André de l’Europe (Paris 8) – je vous suggère de vous hisser à la tribune, j’ouvre la Bête, j’explique ce qui se passe dedans – puis à assister à un concert tutti frutti : orgue, orgue et trompette, chants de Noël, guitare et trompette… Ces 45′ conviviales se terminent par un chocolat chaud. Le tout est gratuit. Vous pouvez ne pas venir, bien sûr, mais c’est dommage. Featuring Rémy Richard à la trompette, et Damien Ferrier himself, le charismatique chanteur de JMAF, rien que ça !
Ce 24 décembre, à 15 h pétantes, je vous invite à visiter l’orgue de Saint-André de l’Europe (Paris 8) – je vous suggère de vous hisser à la tribune, j’ouvre la Bête, j’explique ce qui se passe dedans – puis à assister à un concert tutti frutti : orgue, orgue et trompette, chants de Noël, guitare et trompette… Ces 45′ conviviales se terminent par un chocolat chaud. Le tout est gratuit. Vous pouvez ne pas venir, bien sûr, mais c’est dommage. Featuring Rémy Richard à la trompette, et Damien Ferrier himself, le charismatique chanteur de JMAF, rien que ça !
Le best of est on !
Il est temps de fêter 2012. Merci à ceux qui ont suivi l’aventure chansonnique. Prochain concert le 3 janvier. Keep in touch.
Dans mon grenier, j’ai aussi une trilogie de foufou !
Ding dong ! Encore des idées pour bestofiser votre bibliothèque ? Welcome, on continue avec la trilogie « Ézoah », co-écrite avec ce dingo de Maxime Fontaine.
 Oui, ici, on vous a mis la version russe pour crâner. Mais, en gros, c’est la meilleure trilogie d’imaginaire de tous les temps intemporels (au moins). L’histoire d’une magibricoleuse, petite soeur in a way d’Arthur et les minimoys, qui bascule dans mille deux cents pages de drôlisme, fantaisisme et autres fofollismes scénaristiquement chiadés. Bien sûr, je serais fier que cette histoire vous happe et vous déstructure sur place. En VF, elle est encore dispo ici. Puisse-t-elle séduire les curieux.
Oui, ici, on vous a mis la version russe pour crâner. Mais, en gros, c’est la meilleure trilogie d’imaginaire de tous les temps intemporels (au moins). L’histoire d’une magibricoleuse, petite soeur in a way d’Arthur et les minimoys, qui bascule dans mille deux cents pages de drôlisme, fantaisisme et autres fofollismes scénaristiquement chiadés. Bien sûr, je serais fier que cette histoire vous happe et vous déstructure sur place. En VF, elle est encore dispo ici. Puisse-t-elle séduire les curieux.
Dans mon grenier, pour les vieux
Aujourd’hui, focussss sur les livres pour vieux que je vous propose d’acquisitionner pour des prix très folichons, en remplissant le questionnaire de sondage disponible ici (tarifs aux petits oignons valables pour la France métropolitaine, of course). Voir nos CGV ici.
 Revenez-y est mon premier roman (le deuxième roman pour ancêtres est dispo ici). Deux hommes viennent me voir tous les soirs. Ils entrent, ils boivent un gin, ils repartent. Pas un mot n’est échangé. Au début, ça fait bizarre, bien sûr. Puis on s’y accoutume. Puis ça devient vital. Surtout si le reste se défait. Et pourtant, il y a forcément une raison, un drame, un p’tit quelque chose. Sinon, y aurait pas d’histoire, et on n’y reviendrait pas. Et certains y sont venus…
Revenez-y est mon premier roman (le deuxième roman pour ancêtres est dispo ici). Deux hommes viennent me voir tous les soirs. Ils entrent, ils boivent un gin, ils repartent. Pas un mot n’est échangé. Au début, ça fait bizarre, bien sûr. Puis on s’y accoutume. Puis ça devient vital. Surtout si le reste se défait. Et pourtant, il y a forcément une raison, un drame, un p’tit quelque chose. Sinon, y aurait pas d’histoire, et on n’y reviendrait pas. Et certains y sont venus…
- « Revenez-y est un premier roman qu’on lit d’un trait entre rire et fascination. » (Michèle Gazier, Télérama)
- « Revenez-y fait montre d’un humour contagieux et d’une science des effets qui ne sont pas sans rappeler un Echenoz ou un Chevillard. » (Claude Mourthé, Le Magazine littéraire)
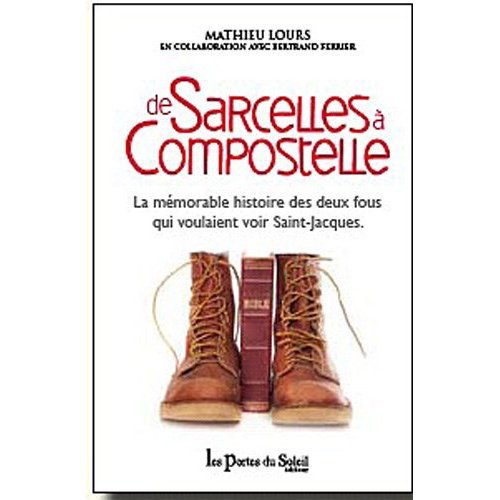 De Sarcelles à Compostelle est le récit du pèlerinage que Mathieu Lours fit avec son pote Hidir de Burgos à Compostelle. Dit comme ça, ça s’annonce chiant. C’est pourtant un récit hilarant et profond, mordant et spirituel, auquel je suis très fier d’avoir prêté mon savoir-faire. L’autre autobiographie partielle à laquelle j’ai vendu main forte est dispo ici.
De Sarcelles à Compostelle est le récit du pèlerinage que Mathieu Lours fit avec son pote Hidir de Burgos à Compostelle. Dit comme ça, ça s’annonce chiant. C’est pourtant un récit hilarant et profond, mordant et spirituel, auquel je suis très fier d’avoir prêté mon savoir-faire. L’autre autobiographie partielle à laquelle j’ai vendu main forte est dispo ici.
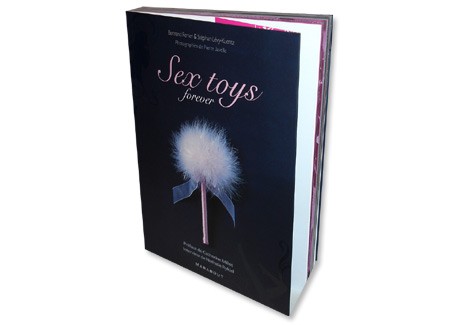 Sex toys forever est un beau livre et un étonnant voyage encyclopédique dans des contrées amusantes, en général méconnues, même aujourd’hui. Appuyés sur une enquête de terrain menée avec Stéphan Lévy-Kuentz, les textes vialattiques proposent des variations humoristiques (si) et précises sur les drôles de bitounious, typologisés et illustrés par d’élégantes photos de Pierre Javelle. Je sais, ça paraît sale et gore. En fait, je crois bien que c’est rigolo et classe. Oui, classe. Mais la maîtresse n’est pas fournie.
Sex toys forever est un beau livre et un étonnant voyage encyclopédique dans des contrées amusantes, en général méconnues, même aujourd’hui. Appuyés sur une enquête de terrain menée avec Stéphan Lévy-Kuentz, les textes vialattiques proposent des variations humoristiques (si) et précises sur les drôles de bitounious, typologisés et illustrés par d’élégantes photos de Pierre Javelle. Je sais, ça paraît sale et gore. En fait, je crois bien que c’est rigolo et classe. Oui, classe. Mais la maîtresse n’est pas fournie.
Pour commander ultravite, rdv ici !







