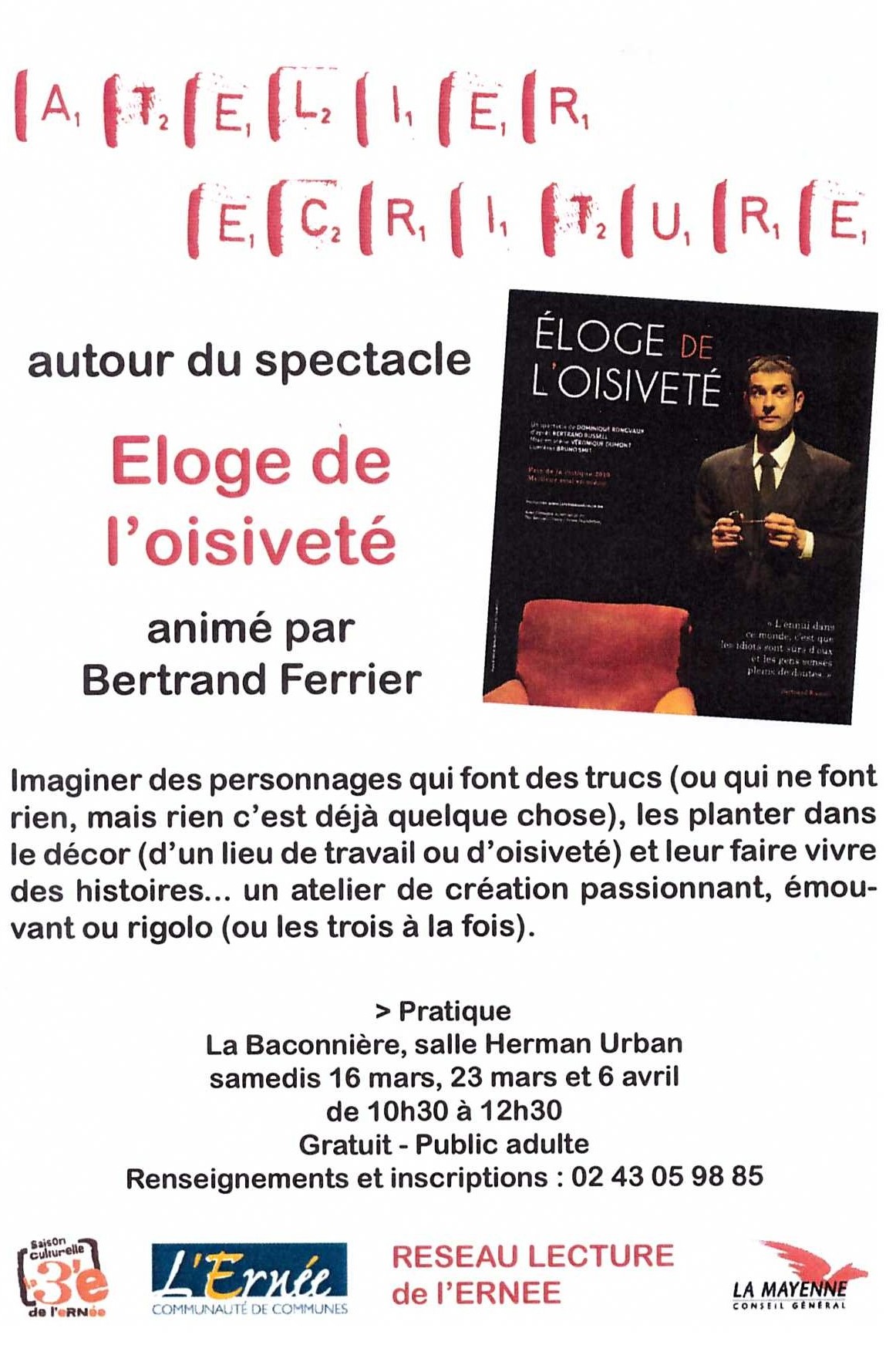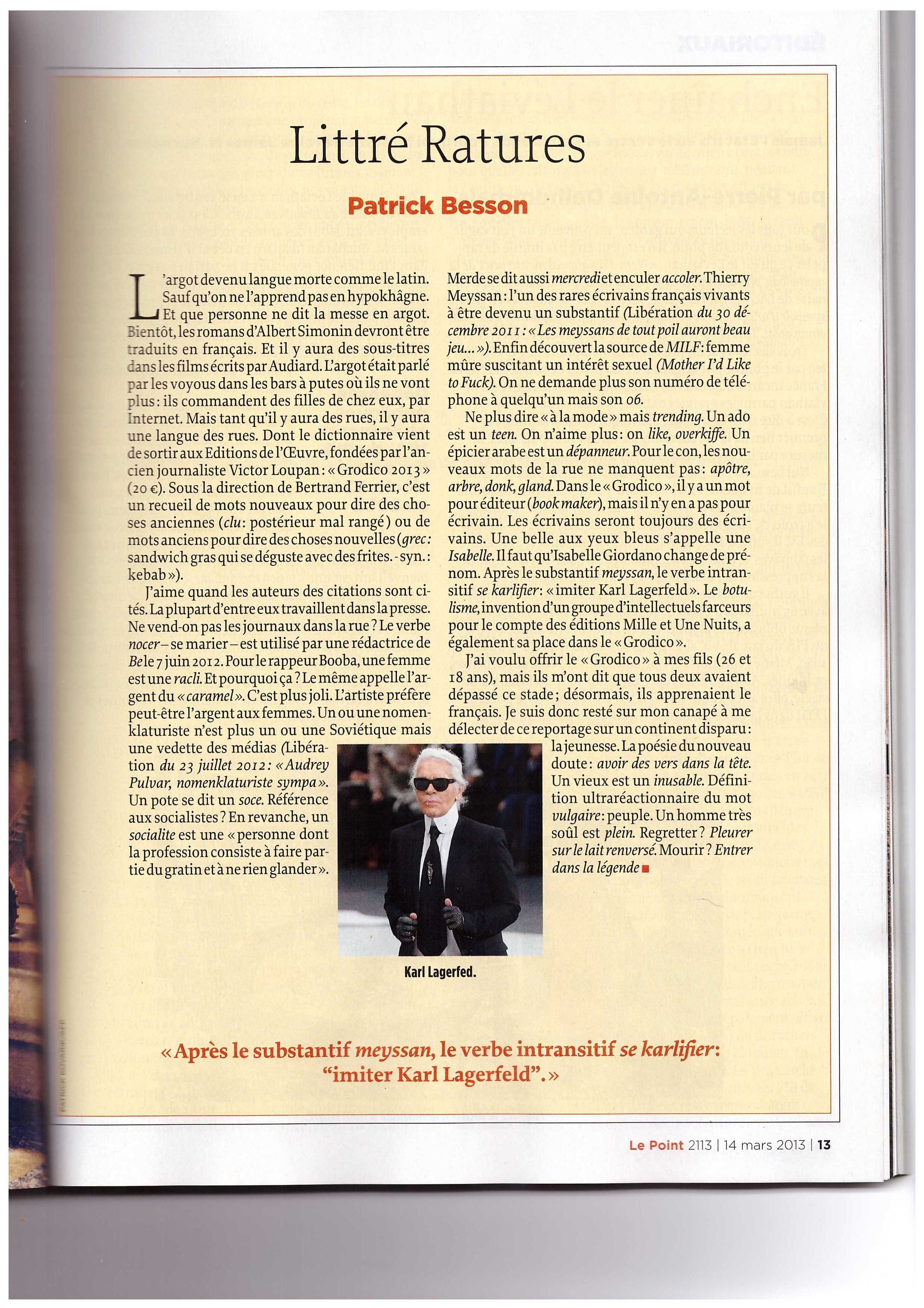Salle Pleyel, 12 avril 2013
Cette saison, on l’a jugé médiocre et excellent, selon les concerts. Quel visage allait présenter, ce vendredi 12 avril, l’Orchestre philharmonique de Radio-France ?
Le programme s’ouvre sur la divertissante Ouverture du Candide de Leonard Bernstein. En cinq minutes, fanfares, contrastes et contretemps mettent en appétit car l’orchestre, dirigé par Diego Matheuz, un gamin de 28 ans issu du Sistema, s’emploie sans retenue à rendre le dynamisme et l’art consommé de la musique plaisante (ritournelles, harmonies plaisantes, modulations joyeuses, grands effets efficaces, exploitation des différents pupitres de l’orchestre) que connaissait si bien Bernstein.
La pièce solistique (classe, non ?) du jour est double : il s’agit du Concerto pour piano, trompette et orchestres à cordes de Dmitri Chostakovitch, une composition pétillante, variée, belle, d’une vingtaine de minutes. Au piano se pose Plamena Mangova. une ancêtre à l’aune du chef : 33 ans. Son corps massif – disons-le : quasi difforme – ne laisse pas présager la subtilité de son jeu. Musicienne très expressive, elle domine son sujet de bout en bout. Tonicité des accords percussifs, vélocité des unissons pyrotechniques, nuances incroyables (les pianissimi perlés dans les aigus) : ceux qui pointeraient ici ou là une minime et rarissime erreur de texte ne seraient même pas dignes d’être écoutés. C’est techniquement très bon et musicalement séduisant – il suffit de voir le défi que lance la pianiste à l’orchestre dans le troisième des quatre mouvements pourtant calme, pour sentir que la notion même de « concerto » est présente dans cette interprétation. David Guerrier, trompettiste et corniste de 28 ans, dialogue à l’avenant, en contrastant son jeu comme l’exige ce concerto. La partition de la trompette, redoutable quoique pas aussi massive que celle du piano, est exécutée avec maestria : c’est beau, tenu dans l’ensemble des registres, phrasé comme à la parade. Derrière ces leaders, l’orchestre fait le travail en soignant notamment les départs. L’aurait-on aimé plus caractérisé, avec un son peut-être plus riche dans les mouvements lents ? Détail. Le résultat donne une belle version du premier Concerto pour piano de Chostakovitch. Sucre glace sur la cerise, Plamena Mangova y ajoute deux bis impressionnants de musicalité : les nuances et le toucher sont fabuleux. Brava !
Après l’entracte, la Symphonie « Petite Russie » de Piotr Ilyitch Tchaïkovski, sa deuxième, propose 35 minutes de musique articulées en quatre mouvements. La composition capte l’intérêt de l’auditeur. Loin de la réputation de siruposité (?) ou de longueurs redondantes que traîne parfois Tchaïkovski, elle fourmille d’idées, de trouvailles harmoniques et de dynamisme (dernier mouvement). On pourrait craindre la sucrerie ou le délayage – erreur. Les tempi sont tenus ; Diego Matheuz caractérise avec goût les différents moments ; l’orchestre suit sa direction, qui oscille entre précision des départs et, sporadiquement, lâcher-prise quand il paraît inutile de guider l’orchestre. Belle façon de conclure un beau concert, donc de réjouir les spectateurs qui avaient eu la bonne idée de venir applaudir un orchestre en forme, des solistes inspirés et un chef à suivre. Pour prolonger, le concert est disponible en réécoute durant un mois ici.
Opéra-Comique, le 25 mars 2013
C’était un tube jadis : Le Roi d’Ys d’Édouard Lalo était donné (enfin, vendu) en version de concert ce 25 mars 2013 au profit de l’association ColineOpéra qui fait des trucs mais, après écoute des discours de circonstance, impossible de dire quoi.
L’histoire : pour sauver son peuple, Margared accepte d’épouser Karnac, le chef des ennemis d’Ys. Rozenn, sa sœur, s’en fout : elle aime la vedette des guerriers autochtones, Mylio, lequel rentre précisément la veille du mariage de Margared. Problème : Margared aussi est in love with Mylio (acte I). Margared, jalouse, rejette Karnac, qui provoque la guerre, mais Mylio défonce Karnac. Pour se venger et venger son ex-futur jules, Margared lui conseille d’ouvrir les écluses (acte II). En plein mariage, la tempête envahit donc la ville d’Ys. Mais Mylio bute Karnac, et saint Corentin accepte d’apaiser la colère des flots en échange de la vie de Margared (fin joyeuse de l’acte III).
Le résultat : rarement proposé en spectacle, cet opéra est présenté pour la première fois avec un prologue parlé : l’Orchestre de Montpellier Languedoc-Roussillon, qui officie ce soir avec le Chœur du même nom, prévient qu’il a accepté de jouer mais qu’il boude, car son patron pue du cul (je simplifie). Il assurera néanmoins sa partie avec vaillance, permettant d’apprécier notamment ses bois (flûtes en tête), d’une belle vigilance dans des duos exigeant une grande précision. Il est dirigé par Patrick Davin, que nous avions vu à l’œuvre an avril 2012 dans La Muette de Portici, et le 20 septembre 2012 à la tête de l’Ensemble Intercontemporain, dans un programme Bach – Kurtág – Nodaïra. De nouveau, le chef fait forte impression : précision des indications, sens des nuances, capacité à dynamiser un ensemble qui tend à s’endormir après un prélude joué tambour battant. Par contraste, le chœur paraît très faible ou mal préparé : puissance limitée, attaques imprécises, justesse discutable (les soprani 1 ne sont clairement pas réglées sur le même diapason que le reste de l’équipe). Quant au plateau vocal, il surprend par son caractère hétéroclite.
Honneur aux hommes, pour ainsi dire : Sébastien Guèze, en Mylio, déçoit. Certes, il a fait préciser qu’il était un peu enrhumé ; mais ce genre de partition ne pardonne pas. Très souvent en souffrance, fréquemment en difficulté, parfois dans l’impossibilité de chanter sa partition, il n’est pas à la hauteur. Les seuls à sortir du lot, c’est-à-dire à se faire entendre des plus hauts balcons, sont à la rigueur, petit à petit, un Franck Ferrari (Karnac) qu’on a cru entendre jadis plus puissant et plus musical, et le costaud Nika Guliashvili, dont le minirôle de saint Corentin sonne précis, français, tonique, et fait regretter la brièveté de l’intervention.
Côté filles, deux rôles solistes seulement. D’un côté, le faire-valoir théorique, Rozenn : le rôle est dévolu à Julianna Di Giacomo. C’est la révélation, à nos ouïes, de la soirée. Certes, on se demande physiquement comment Mylio peut la préférer à sa sœur… mais les aigus ne lui posent aucun problème ; les notes sont tenues avec grâce et sûreté ; les sautes de registres sont pipi de chat pour cette interprète formidable ; le phrasé est globalement très intelligible ; et le rôle – un peu niais, à notre aune – est interprété avec fermeté et dignité. C’est d’autant plus impressionnant que Sophie Koch, la soprano vedette française, l’excellente Fricka du Ring parisien, celle qui monopolisera les scènes notamment parisiennes la saison prochaine, est, en gros, plutôt à la rue. Son français est étonnamment imbittable ; et, même si la voix est globalement sûre, certains aigus manquent, plusieurs notes redoutables sont escamotées, et des tenues sont abandonnées avant l’heure. Pour quelqu’un qui a déjà interprété le rôle en version scénique, cette prestation est franchement décevante.
Étonné, on voulut voir ce qu’en disait l’intéressée après le concert. Pourquoi parlait-elle un français inintelligible ? Malheureusement, les vigiles nous conseillèrent de repasser « dans deux heures au moins, après le banquet ». Il est vrai que, comme pour toute soirée de gala au bénéfice d’une association, les interprètes majeurs étaient invités à festoyer. Y a de la thune, profitons-en, non ?
Le bilan : dans un Opéra-Comique archicomble (il y avait même Roselyne Bachelot, c’est dire), cette représentation imparfaite a malgré tout été l’occasion d’entendre une œuvre rare à Paris, associant l’étonnante déception kochistique au plaisir de découvrir Julianna Di Giacomo. Pour 15 €, on aurait mauvaise grâce de faire la tête.
Droit de réponse offert à Coline Opéra
Les articles de cette page d’accueil n’étant pas toujours amènes – même si je tâche d’expliquer le fondement des critiques -, il arrive que je reçoive des courriels d’insultes. Souvent anonymes, parfois signés de crétines illettrées, ils gagnent une réponse sommaire, un blacklistage et le cyberdoigt d’honneur qu’ils méritent. Au contraire, certaines réponses gagnent à être portées à la connaissance des curieux. C’est le cas de celle-ci.
C’est avec un certain étonnement que je lis votre article ce jour.
Comme vous le constaterez peut être, l’extension de mon adresse mail est « colineopera.org » , je suis la chargée de production et de communication de ce fonds de dotation. Je ne suis pas là pour critiquer votre analyse ou pour émettre un point de vue mais simplement pour vous expliquer qui nous sommes et quels étaient les tenants et aboutissants de cette soirée caritative (car malgré vos doutes c’était bien le cas). ColineOpéra a été conçu dans la continuité de l’association Coline en Ré dont les recettes de plus de 50 concerts de musique classique instrumentale de haut niveau, ajoutée aux dons reçus, ont permis de donner à la Chaîne de l’Espoir (chirurgie cardiaque de l’enfant) l’équivalent de plusieurs centaines d’opérations vitales d’enfants pauvres dans ses hôpitaux.ColineOpéra place l’art lyrique au cœur de son action en mobilisant les plus grands artistes (Sophie Koch est notre marraine, Edita Gruberova, June Anderson, Annick Massis, Michael Spyres, Patrizia Cioffi et tant d’autres), la générosité des Maisons d’Opéra (Montpellier, Nice, Paris, Rouen, Opéra du Rhin…), les donateurs privés et le mécénat d’entreprise. Ainsi, la totalité des recettes de ces concerts et des opéras sont mises à la disposition des organisations efficaces et transparentes dont nous soutenons les actions et dont nous évaluons les résultats.
ColineOpéra, comme Coline en Ré désormais, a choisi de soutenir trois organisations éminentes travaillant au profit de l’enfance en danger, en France et loin de notre pays, dans les domaines essentiels que sont la santé, la protection et l’éducation: la Chaîne de l’Espoir pré-citée, Toutes à l’École pour l’éducation des petites filles au Cambodge et la Fondation française Mouvement Villages d’Enfants, qui s’occupe d’accueillir des frères et sœurs, au sein de villages d’enfants et/ou de foyers, séparés de leurs parents suite à une décision de justice pour cause de maltraitances.
Nous sommes habilités à émettre des reçus fiscaux pour les dons reçus tel que prévu par la loi de finances en vigueur. Ainsi, chacun peut donner en déduisant de ses impôts jusqu’à 75 % de la valeur de son don ce qui explique « le banquet » dont vous parlez. Il s’agit en fait d’un remerciement à nos donateurs: en effet ces personnes à qui nous offrons un cocktail ont payé leur place au prix de 350€ et oui les artistes qui ont pour la plupart fait de gros effort sur leur cachet (voire un abandon total), étaient également conviés.
J’espère que votre regard sur notre association sera un peu adouci et je vous remercie de m’avoir lu.
Bien à vous,
Ludivine Vantourout.
Opéra Bastille, 23 mars 2013
Pour développer ses activités et valoriser son orchestre, partant du principe que des orchestres symphoniques accompagnent l’opéra donc pourquoi pas l’inverse, l’Opéra de Paris multiplie les soirées de concert, avec des programmes souvent stimulants. Pour preuve, ce samedi, la Symphonie n°8 d’Anton Bruckner était sur le grill avec Semyon Bychov.
La composition est un monstre d’1 h 20, articulée en quatre sections contrastées, ce qui permet au public, entre deux mouvements, de proposer un étrange concert de bronches subitement encombrées. Un orchestre massif est indispensable à l’exécution de l’autre musique (pas les toux forcées des spectateurs, donc). Subséquemment, la difficulté est de ne pas se laisser engluer par le potentiel de lourdeur pataude inscrite dans l’effectif requis. Pour capter l’auditoire pendant la durée de l’œuvre, il est malin de rendre les caractères multiples de la partition – tantôt fanfaresque, tantôt délicatement prédebussyste (en clair : y a des harmonies toutes douces un peu bizarroïdes, avec des solistes qui émergent puis disparaissent peu après).
Propriétaire de la baguette ce soir-là, Semyon Bychkov ne se laisse pas aller à la facilité de faire ronfler dès que possible l’orchestre qui lui fait face. Au contraire : il passera presque quatre-vingt minutes à contrôler notamment les cordes en réclamant plus de piano, afin de faire sonner de façon plus éclatante les tutti explosifs ou triomphants. Cette stratégie saine permet de donner de la vitalité à ce gros morceau, malgré des tempi que le chef laisse parfois s’étirer – as far as I am concerned, un p’tit chouïa de pêche en plus, aux moments opportuns, n’aurait pas été pour me déplaire.
En bref, en somme, en résumé et toute cette sorte de choses, malgré quelques petits décalages inévitables et, a-t-il pu sembler, quelques rares fausses notes (dans des unissons de trompettes, spécifiquement), c’est une vision élégante, personnelle, précieuse d’un mastodonte qui fut donnée. On regrette donc que le programme soit plutôt court : une petite pièce en prélude n’aurait pas été abusive. Sans doute est-ce le signe que cette Huitième fut délectable – ou que je suis vraiment proche de mes sous, l’un n’empêchant pas l’autre.
Franco fun
 Tiens, ce samedi, on parle français : à 10 h 30, deuxième atelier d’écriture en Mayenne, sur le thème « Travail et oisiveté » ; à 17 h, dédicace à la Librairie Pages après pages (rue des Dames / 75017) pour l’édition 2013 de Grodico (éditions de l’Œuvre). Vroum !
Tiens, ce samedi, on parle français : à 10 h 30, deuxième atelier d’écriture en Mayenne, sur le thème « Travail et oisiveté » ; à 17 h, dédicace à la Librairie Pages après pages (rue des Dames / 75017) pour l’édition 2013 de Grodico (éditions de l’Œuvre). Vroum !
Opéra Bastille, 21 mars 2013
Après avoir provoqué la mort de ses jumeaux pour complaire sa femme, Wotan, boss des dieux, aidera-t-il son petit-fils à épouser Brünnhilde, sa fille ? L’affaire est chaude, Wagner était sur le coup, et voilà l’travail – ça s’appelle Siegfried, et c’est le troisième épisode de l’Anneau du Nibelung, alias le Ring.
L’histoire : premier acte (1h20), Siegfried, petit-fils de Wotan, en a ras-la-courge d’être élevé par Mime, un nain forgeron qui fait de la soupe. Sous la menace de Siegfried et de l’inquiétant Wotan en personne, la personne à verticalité contrariée finit par admettre qu’il n’est pas son père et qu’il a recueilli le môme quand sa mère est morte en couche. Ce qu’il reste des parents de Siegfried ? Une épée en morceaux. Siegfried la ressoude et la baptise Nothung, avec un objectif, soufflé par Mime : affronter le pire danger du monde, un dragon appelé Fafner.
Deuxième acte (1h20), Siegfried erre dans la forêt, où le triple complot se prépare. Un, Wotan veut superviser « sans intervenir » car il souhaite vérifier si Siegfried est vraiment un héros. Deux, Alberich, qui fut le maître du monde avant de tout perdre, espère récupérer le trésor du Nibelung, gardé par le géant survivant, devenu le dragon Fafner. Trois, Mime escompte empoisonner Siegfried après que le héros sans peur aura défoncé le dragon. Conseillé par un rossignol, Siegfried déjoue les pièges et se trouve un nouveau défi : découvrir l’amour en réveillant une fille posée sur un rocher entourée de flammes – the famous Brünnhilde.
Troisième acte (1 h 20), Siegfried doit affronter Wotan. Le dieu en chef est en plein doute, au point d’interroger puis d’envoyer chier Erda, maîtresse du savoir (et de Wotan, avec qui il a eu Brünnhilde). Conscient que la fin des dieux est proche, il espère trouver un digne successeur en Siegfried. Donc il l’affronte pour le tester avant que le héros n’arrive devant le rocher où dort sa belle. Sans souci, Zizi l’emporte, franchit les flammes, découpe l’armure de sa demi-tante et, vingt minutes plus tard, la convainc de devenir sienne. Et pas chienne, hein, restons dignes.
La représentation : le plus difficile, dans Wagner, c’est de se taper les mises en scène honteuses qui frappent ses opéras. En l’espèce, sous la direction du consternant Günter Krämer, Mime est une folle maniérée aux costumes de Falk Bauer croisant la movida d’Almodóvar avec le design des Bronzés font du ski ; Siegfried, affublé d’encombrantes dread-locks blanches, est à la tête d’une mégaplantation de chichon (à moins que ce soit la folle qui consomme ?) ; et le dragon Fafner est protégé par des hommes des forêts qui brandissent des joujoux plastique forcément bite à l’air ; le rossignol est matérialisé par un gavroche chargé de faire chier le public en l’éblouissant avec un miroir cheap. C’est pitoyable, mais au niveau des décors tocs et pseudo-profonds (l’escalier où sommeille une table renversée symbolise le rocher de Brünnhilde ; un mini-écran de projection diffuse des images de feu ; et quid de la plantation de cannabis ?), de la « chorégraphie » d’Otto Pichler, incluant les pauvres intermittents chargés de rester immobiles pendant plus d’une demi-heure avant d’entourer Wotan en magicien bourré… Enough said : c’est d’la merde.
L’interprétation : cette fois, la crottitude de la mise en scène est d’autant plus regrettable que le reste, c’est-à-dire la musique, l’interprétation, le chant – l’essentiel, donc – est de belle facture. En ce soir de première (première de reprise, mais première quand même !), on apprécie un orchestre à la hauteur des attentes, même si on a parfois l’impression que la direction de Philippe Jordan pourrait être plus dynamique. En l’état, néanmoins, la pâte sonore est belle, et les solistes (notamment cuivres et clarinettes) excellent comme espéré.
Quid du plateau vocal ? Le premier acte surprend : Mime et Siegfried ont du mal à envoyer. On en profite pour apprécier leur sens du cabotinage, jusqu’à ce que la voix puissante d’Egils Silins réveille tout le monde. Voilà la bonne surprise de la soirée. En effet, on avait entendu Wotan en mauvaise posture dans La Walkyrie : ici, même s’il s’éteint un brin au troisième acte, puissance du timbre et justesse laissent clairement supposer qu’il était malade, ce 28 février, car, en dépit de ses accoutrements souvent ridicules, il campe avec force un dieu sûr au bord de la déchéance. Avant de mourir à la fin du second acte (ridicule mise en scène de la mort off et découpage d’une tête en plastique), Wolfgang Ablinger-Sperrhacke a joué avec gourmandise son Mime queer qu’il connaît sur le bout de la glotte. Il multiplie les jeux de scène grotesques, amuse le public par sa perversité assumée et tente même des trucs pas tout à fait aboutis (balancement autour d’un lustre). Les choix de mise en scène peuvent agacer, la mise en voix est peut-être un peu longue (on n’entend pas grand-chose pendant quarante minutes, quand même…) mais l’interprétation se tient et relève du très haut niveau. La grande vedette de la soirée reste pourtant Torsten Kerl, qui campe un Siegfried un peu décevant au début, mais incontestable dès que sa voix se secoue. Dès lors puissant, sûr, surjouant avec pertinence la naïveté sympathique de son personnage, surmontant sans paniquer les petits décalages sporadiques avec l’orchestre, il mérite pleinement l’ovation de la salle : ce rôle écrasant, exigeant jusqu’aux dernières mesures du dernier acte, il le maîtrise et l’interprète avec une évidence énergique qui force le respect.
Dans son sillage, les rôles secondaires sont quasi tous à leur meilleur : Peter Sidhom est l’Alberich chafouin et rageux que l’on aime ; Peter Lobert promène ses graves avec délectation dans le rôle de Fafner ; Qiu Lin Zhang est une Erda à l’irréelle voix grave et torturée ; Elena Tsallagova, après quelques notes hésitantes, envole le Rossignol comme à la parade, bien que le rôle soit sous-dimensionné eu égard à son talent… Reste Alwyn Mellor, la nouvelle Brünnhilde. Dans La Walkyrie, elle était à la fois catastrophique et inquiétante, ce qui n’est pas rien. Autant dire que l’on serre les dents car c’est à elle de terminer le travail dans un grand duo d’une vingtaine de minutes. Le résultat est mitigé : les aigus sont là, la puissance impressionne dans les registres les plus « melloriens » ; mais le souffle semble manquer (projection hachée), et la prononciation allemande, avec notamment un étrange abus de consonnes, paraît exotique. Pas de quoi rassurer pleinement avant Le Crépuscule des dieux, où du très lourd attend l’artiste…
Au bilan, ce fut, dans l’ensemble, une soirée de très belle (et pas seulement très grosse) facture. Les acteurs-chanteurs étaient bons, les musiciens contrastaient bien… Vivement le quatrième épisode de la tétralogie, et les prochaines représentations des opéras qui ont déçu !
Grodico sur RFI : la rediff
Grodico était sur RFI le 18 mars à l’invitation de Jean-François Cadet, pour son émission « Vous m’en direz des nouvelles ». Si vous cliquez sur les flèches ci-d’sous, vous pourrez réentendre ces deux sons (18′ puis 26′). Bonne écoute aux curieux, et bonne commande du livre, par ex. sur Amazon !
VMDN 1/2
[audio:http://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2013/03/vous_m_en_direz_des_nouvelles_1_20130318_0810.mp3]
VMDN 2/2
[audio:http://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2013/03/vous_m_en_direz_des_nouvelles_2_20130318_0833.mp3]
Cité de la musique, 19 mars 2013
Quartett de Luca Francesconi, au programme de la Cité de la musique ce 19 mars, est sans doute l’opéra le plus cul sur le marché, loin devant Anna Nicole (auquel Allison Cook a participé). Inspiré des Liaisons dangereuses, il projette pendant 1 h 20 deux solistes lyriques, un orchestre de petite taille, une bande enregistrée et des logiciels d’informatique musicale dans le monde merveilleux de la souillure, du sexe et du suicide. En voici le compte-rendu.
L’argument : au début, c’est simple. La Marquise (Allison Cook) retrouve Valmont (Robin Adams), un ex, le déteste et le kiffe. Elle lui reproche de vouloir niquer une grenouille de bénitier mariée au Président qu’elle aurait bien épousée, elle ; et elle l’incite donc par opposition à dépuceler sa nièce. Puis l’affaire se complique : Allison Cook prend le rôle de Valmont en séducteur, puis celui de la nièce. Valmont lui donne la réplique, tantôt femme incorruptible, tantôt instructeur sexuel au lexique métaphysique. Dernier élément qui corse l’affaire, par instant, les solistes se félicitent mutuellement du rôle qu’ils jouent. Alors, jouent-ils, incarnent-ils leurs personnages ? L’important est sans doute que cela se finisse entre déshonneur, fellation, sodomie et empoisonnement, avant une belle coda shakespearienne réservée à Valmont sur le thème : « J’espère que mon spectacle ne vous a pas ennuyé, ce serait impardonnable. »
Le résultat : avec ses effets cinématographiques (à-plats orchestraux, crescendos soudains, sons surprenants disséminés dans toute la salle, direct / bande enregistrée, nombreux contrastes vocaux et sonores), son langage musical fort accessible à toutes les esgourdes (avec quelques petites ironies amusantes : trompette bouchée type wawa, cordes façon musique de cour…), ses modestes décors lumineux et sa durée resserrée, Quartett est un opéra auquel il fait plaisir d’assister (diffusion sur France Musique le 8 avril à 20 h). Certes, la dramaturgie inspirée de Heiner Müller est un peu molle : ainsi, d’un point de vue scénaristique, le monologue liminaire d’Allison Cook tire un chouïa sur la corde. Mais c’est sans doute pour mieux faire attendre l’inéluctable. Car l’ensemble de la pièce séduit par sa variété, la beauté de certains effets orchestraux et la précision avec laquelle cela est exécuté. D’autant que, à la mi-parcours, le retournement qui conduit les protagonistes à cour pour mélanger leurs rôles offre un regain d’intérêt à l’histoire proprement dite. Bref, efficacité musicale, harmonies délicates et très belle fin, entre tutti percussif et apaisement inquiétant : c’est très séduisant.
Le bilan : à nos ouïes, ce petit opéra est une grande réussite. Il la doit donc à l’ensemble des intervenants, outre le compositeur (présent ce soir-là). Susanna Mälkki dirige, pour la dernière fois en tant que patronne, l’Ensemble intercontemporain, avec sa rigueur coutumière. Robin Adams utilise sa voix de baryton (voire plus, sa voix de tête étant très souvent sollicitée) avec constance et, quand les graves ou le haut médium arrivent, puissance. Toutefois, il paraît plus limité scéniquement qu’Allison Cook, au visage incroyablement expressif. La voix de la soprano, quoique sûre, n’est pas la plus soyeuse qui nous ait caressé les oreilles ; et pourtant, malgré un rôle très exigeant, elle assure de bout en bout, sans la moindre faiblesse apparente. C’est juste, posé, varié ; les sautes de registre, du parlando à l’aigu puis au médium, sont maîtrisées avec facilité ; et l’ensemble est à la fois joué, incarné, distancié avec une spectaculaire force de conviction. On a hâte de voir cette wagnérienne-mais-pas-du-tout-que dans de nouveaux rôles parisiens. Et en attendant, on a passé une belle soirée de musique. Vivement la suite.
Soyons francophones, n’ayons pas l’air de rien
Rendez-vous sur RFI chez Jean-François Cadet : « Jusqu’au 24 mars, c’est la semaine de la langue française. Alors aujourd’hui, on va s’intéresser au français tel qu’on le parle. Une langue bien plus riche que ce qu’on peut penser, il suffit de se plonger dans le Grodico 2013 de Bertrand Ferrier, aux éditions de l’Œuvre. » Et ça s’passera par ici.