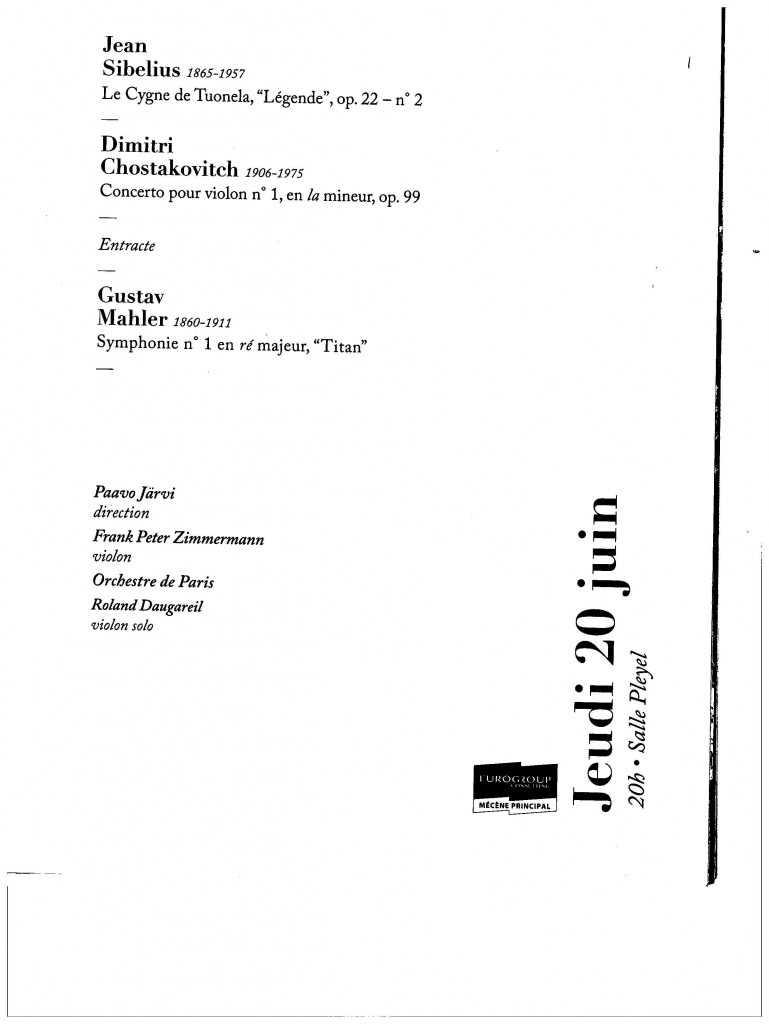Salle Pleyel, 20 juin 2013
Étrange mais enthousiasmant concert que celui donné par l’Orchestre de Paris le 20 juin, dans une salle Pleyel bondée !
La première partie joue la carte de l’austérité. En ouverture, Le Cygne de Tuonela de Jean Sibelius, extrait connu de la Suite de Lemmikaïnen, pose un climat lent et statique. Paavo Järvi dirige l’orchestre sans en rajouter : pas de grands effets, pas d’accents, rien qui surligne et pourrait charmer l’auditoire. Ce choix d’un Sibelius non-spectaculaire est d’autant plus courageux que la pièce s’enchaîne avec le premier Concerto pour violon de Dmitri Chostakovitch. Quatre mouvements d’une durée totale de quarante minutes alternent des moments à la fois calmes et inquiétants (mouvements impairs) et des explosions de virtuosité pour le soliste et l’ensemble (mouvements pairs). Dans l’ensemble, la musique est austère, abrupte, comme contenue, jusqu’au burlesque final, dont l’hagiographie chostakovienne affirme qu’elle illustre « la vanité de la bonne humeur dans l’Union soviétique ». Au violon, Frank Peter Zimmermann, malgré une partition peu évidente (chant tendu pendant l’essentiel du morceau, virtuosité décoiffante pour finir), propose une lecture unie, un son riche et un souci constant de communiquer avec le chef, qu’il connaît bien, afin de se concerter vraiment avec l’orchestre. Même si la partition ne m’a pas enthousiasmé, la qualité du travail est certaine ; et elle n’est pas absente non plus du bis (Bach, bien sûr), vivace jusqu’à l’absurde, que le soliste offre aux spectateurs pour les quitter.
La seconde partie du concert programme la Première symphonie de Gustav Mahler, dite « Titan ». Reconnaissons que, après une première partie de belle facture mais peu affriolante, on ne s’attendait pas à ce qui se préparait. En effet, dans cette page d’une heure (ici réduite à 55′), le chef va pousser l’orchestre à rutiler comme on l’a rarement vu rutiler – ce n’est presque pas une blague. La beauté du lent piano liminaire saisit. La liberté de tempo et le sens de l’ironie (mordante sans être vulgaire : une performance !) séduit dans le second mouvement. Les contrastes du troisième mouvement, entre « Frère Jacques » et musique zim boum boum, emballent. Et la capacité à tenir de bout en bout le dernière mouvement de 20′, pourtant constitué de sections très contrastées, du piano au fortissimo maîtrisé. Le résultat séduit donc, car il donne la sensation d’assister, de la première à la dernière note, à une vision très personnelle de cette œuvre, impulsée par le chef et suivie avec enthousiasme par l’orchestre. La clameur nourrie qui suit l’explosion finale rend hommage avec pertinence au travail effectué.
En conclusion, même si on doit regretter la pingrerie de la Salle (quand on sait que tous les billets sont vendus, pourquoi ne pas prévoir un nombre de programmes suffisant ?), on ne peut qu’être emballé par la complémentarité des deux parties et la qualité de la prestation proposée ce jour-là par l’Orchestre, son chef et le soliste invité. Vivement la saison prochaine !
RDV au festoiement du musicalisme
C’est vendredi 21 juin, pour la fête de la musique. Avec vous, peut-être, dans le rôle de Lazare, Champollion, Funky boum boum et l’incroyable petit Boris.
Salle Pleyel, 14 juin 2013
Le 14 juin, le concert de l’Orchestre philharmonique de Radio-France affichait complet. Au programme : Julia Fischer et la Quatrième symphonie de Chostakovitch.
Le concert, qui aurait pu s’enrichir d’une œuvre d’introduction afin de mettre en appétit les spectateurs, s’ouvre sur le Concerto pour violon et orchestre en ré mineur de Tchaïkovski. Aux manettes de l’orchestre, Vasily Petrenko dirige à sa façon : indications quand nécessaire, bride relâchée quand l’orchestre peut s’autogérer. D’où nous sommes placés (dans les hauteurs, ce qui n’est certes pas un problème à Pleyel), l’équilibre entre la masse et la soliste paraît mettre un mouvement avant d’être optimal. Julia Fischer ne se démonte pas pour autant. Elle joue avec autorité, loin du storytelling et des photos dites « glamour » qui enveloppent son image discographique. La tension que la virtuose impose ainsi est vitale pour ne pas laisser le concerto sombrer dans de la musiquette mignonne mais potentiellement lassante. Le deuxième mouvement, featuring une canzonetta, refuse de se laisser aller au joli. L’émotion naît donc de cet arc entre un jeu nerveux et une composition qui pourrait inciter à plus de sentimentalisme. Le contraste entre un orchestre posé et une soliste jamais relâchée se dissipe avec force dans le troisième mouvement : les doigts tricotent de part et d’autre, les accents sont bien posés, l’ensemble est enlevé, et le résultat séduit. La star de la soirée conclut par ses bis préférés, including le troisième mouvement d’une sonate de Hindemith (auquel France Musiques avait préparé ses auditeurs en la diffusant quelques heures auparavant) et un bout de Bach sémillant. Beau travail.
Après l’entracte, un gros morceau attend l’orchestre : la Quatrième symphonie de Chostakovitch, soitune heure de musique, pour une fois à peu près équilibrée dans sa construction (deux gros mouvements de 25′ encadrent une respiration de 8′). Nous avions été déçus par l’interprétation qu’en avait donnée l’Orchestre de Paris en octobre. Cette fois, le chef propose une copie qui nous convainc. L’équilibre entre les pupitres est intéressant ; les ruptures de rythme ou de caractère sont clairement dessinées ; et si le tutti de l’orchestre n’hésite pas à tonner comme on a rarement entendu ici tonner un orchestre, les parties piano ne sont jamais gnangnan. Cela rend justice à une pièce présentée par Chostakovitch comme un pied-de-nez contre les mauvaises critiques portées à Lady Macbeth : d’une part, en effet, un goût de la dissonance et de la fureur musicale qui venait d’être jugé inconvenant ; d’autre part, un souci de plaire, avec des alternances de style séduisantes, et une ivresse du foisonnement orchestral (le troisième mouvement distribue les soli à la plupart des pupitres de l’orchestre, c’est le côté Piccolo et Saxo du morceau !). Le « Philhar » tient le choc, et les quelques décalages ou rares couacs perceptibles n’ont aucune importance : ce qui compte, c’est l’énergie, la cohérence et la puissance que les musiciens parviennent à rendre avec talent.
En conclusion, une belle soirée, et un beau doigt d’honneur aux sots qui quittèrent la salle à la mi-temps, la vedette ayant fini son travail – et le concert perdant donc tout intérêt à leurs yeux. Tant pis pour (y)eux !
Théâtre du Châtelet, 11 juin 2013
Ce 11 juin, le minimalisto (et non le mini Balisto) – répétitif John Adams était célébré dans le temple du musical parisien, le Théâtre du Châtelet, à l’occasion de la reprise d’I was looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky.
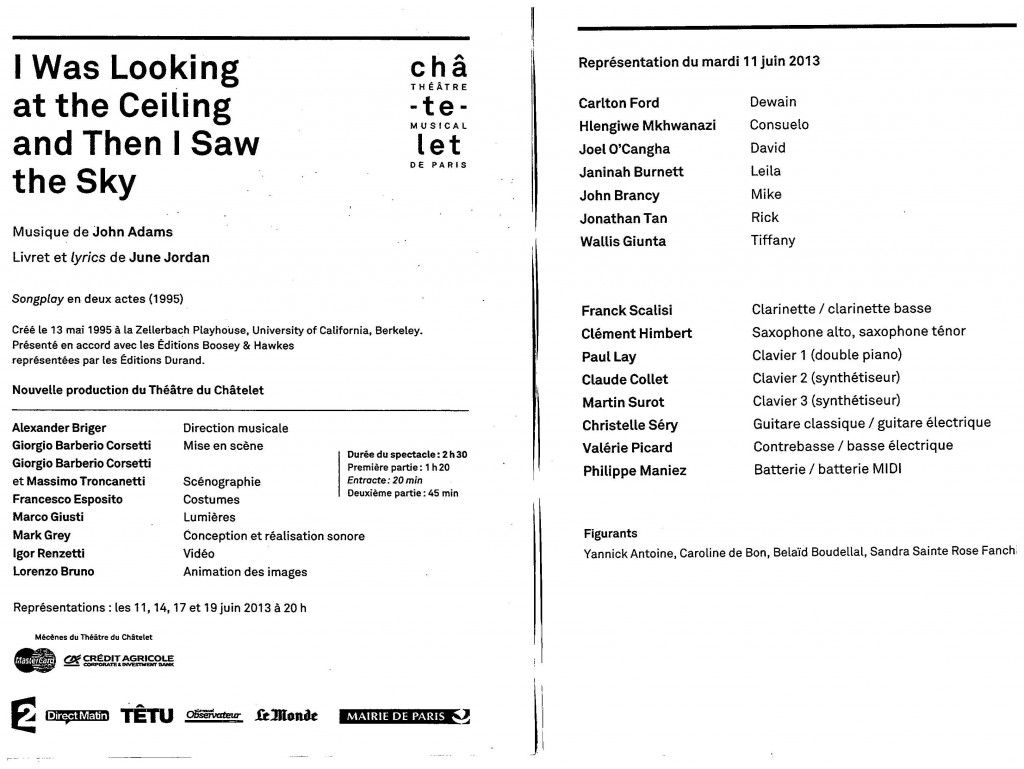
L’histoire : Dewain, récemment libéré de prison, doit retrouver sa p’tite Consuelo, auto-exfiltrée du Salvador. Mais, pour fêter ça, il vole deux bières dans une épicerie et se fait pécho par Mike, un jeune policier Blanc. Ledit Mike patrouille dans Los Angeles avec Tiffany, journaliste prête à le suivre partout pour le scoop et plus si affinités. Dans les parages volette David, un pasteur qui se tape toutes les bonnasses qui passent avant de jeter son dévolu sur Leila, responsable de l’espèce de Planning familial local. Et pas loin se prépare Rick, un avocat d’origine vietnamienne, qui défendra Dewain, draguera avec succès Tiffany, laquelle tentera de convaincre David qu’il est pédé puisqu’il ne la désire pas (le spectacle est sponsorisé par Têtu). Le tremblement de terre qui « fait voir le ciel au lieu du plafond », survient au cours du second acte et accélère le mouvement, séparant les uns (sexualité, mort, choix du terrorisme pour la Salvadorienne en sécurité nulle part), et unissant les autres faute de mieux.
L’œuvre : avec un effectif plus pop que classique (batterie, basse, guitare, clavier, deux souffleurs), ce songplay est essentiellement un musical. Jazz, petite pincée de funk et de variétoche, et chouïa de minimalisme répétitif composent ce programme aguichant de « quinze numéros », qui s’ouvre et se ferme sur le pétillant « I Was Looking at the Ceiling ». Sur un livret de June Jordan, la première partie (1h20) éclate donc l’histoire en autant de vignettes qui se rejoignent petit à petit, entre clichés (l’avocat hâbleur, le Noir victime, le Blanc flic) et petites fêlures dont le tremblement de terre sera une métaphore exacerbée. C’est précisément autour de ce tremblement, dans le second acte (45′), que la musique se ré-adamsise et fouille un peu plus l’accompagnement, rendant le spectacle moins spectaculaire, comme si tout le décorum du musical avait volé en éclat sous le choc tectonique.
La représentation : pour cette nouvelle production, le Châtelet propose un décor basique (des praticables qui bougent) sur lequel se projettent des images (dessins, traits, photos retravaillées). Le résultat, signé Giorgio Barberio Crosetti et Massimo Troncanetti, avec Igor Renzetti et Lorenzo Bruno à la vidéo, est assez séduisant, même si l’inventivité semble décroître à mesure que le spectacle avance. La partition met en valeur les chanteurs sonorisés, qui doivent associer une technique variéto-soul et des notions de chant classique. Janinah Buyrnett, John Brancy, Hlengiwe Mkhwanazi et Wallis Giunta, très expressive, séduisent. Joel O’Cangha en pasteur soul convient au rôle, mais on (téléphone) peut être plus réservé sur le beau gosse Carlton Ford, dont les aigus souffrent dans tout le second acte, et sur Jonathan Tan, dont on regrette le manque de projection, de tenue de la voix et de justesse à l’atterrissage dès que sa ligne saute de plus d’une quarte. L’ensemble est dirigé presque chorégraphiquement par un Alexander Briger qui prend son kif ; les musiciens expriment bien les changements de style (funk, jazz, gospel, classique adamsien) ; et le tout forme un spectacle de fin d’année fort sympathique.
En conclusion, voilà une soirée divertissante, agréable et pas inintéressante (la fusion des genres n’est pas si fréquente) ; le plus gros reproche que l’on puisse faire concerne, on jugera comme cela est fondamental, les surtitres de Sylvie Durastanti. Moins traduction intensive que rerédaction caricaturale (registre systématiquement baissé pour faire style genre, en décalage avec le livret), cette version distordue tranche avec la qualité générale du spectacle. Dommage.
Cité de la musique, 30 mai 2013
Fallait pas se tromper à la sortie du métro : tout droit, c’est Patrick Bruel ; si on bifurque, c’est Heinz Holliger. Je bifurquai. So long, Patou.
Ce jeudi où il drachait plus qu’abondamment, était donnée à la Cité de la musique l’intégrale de Scardanelli-Zyklus, un ensemble de pièces inspirées par les poèmes que Hölderlin signa Scardanelli. Le tout est annoncé pour durer 2h30 sans entracte ce qui, après une journée de labeur peut effrayer. Pourtant, disons-le d’emblée et sans snobisme, la durée ne sera jamais pesante, même pour un non-spécialiste. On peut en proposer trois explications.
Premièrement, l’événement : entendre l’ensemble de ces pièces dirigées par le compositeur, considéré comme une vedette dans son domaine, est une rareté qui aiguise la curiosité. Deuxièmement, la diversité : le cycle rassemble des pièces pour ensemble, solistes (gros solo de la flûtiste Sophie Cherrier), chœur a capella ou accompagné, musiciens acoustiques ou sonorisés, de sorte que l’alternance stimule l’audition et l’intérêt. Troisièmement, la musique, interprétée par des spécialistes de haute volée : malgré des notes de programme imbittables de Kristina Ericson (« les processus ne se développent pas sur la base de rapports de cause à effet, mais ils sont menés presque systématiquement jusqu’à leurs propres limites, jusqu’à une sorte d’effondrement », gâ ?), la variété des climats, la beauté des harmonies obtenues par moments, l’exploration continue des possibilités musicales et vocales (souffles, aspirations, notes filées ou perdues, claquements, déchirures…), l’alternance de tensions brutales ou de contrastes moins rapprochés donc attendus, l’interrogation perceptible de l’écriture (au centre de la composition, un choral harmonisé par Bach est accompagné par un orchestre qui rature toute cette écriture traditionnelle et juxtapose aux harmonies traditionnelles une autre forme d’accompagnement : choc 100% garanti !), bref, tout cela, qui est audible par tout être de bonne volonté, capte l’oreille, en dépit de quelques répétitions d’effets rappelant que le « cycle » est en réalité appelé à être joué par petits fragments plus souvent que d’un seul bloc.
Le résultat, porté par l’Ensemble intercontemporain et le Chœur de la Radio lettonne, invité pour la Biennale d’art vocal, est palpitant et souvent beau. On regrette d’autant plus que la Cité ait cru bon de ne fournir qu’une liste de titres à une partie des spectateurs, au lieu d’un programme (sans couverture, ben voyons) que seuls quelques privilégiés ont pu obtenir. En sus de l’aspect désagréable de la chose, c’est esthétiquement dommage, car Scardanelli-Zyklus propose une évolution dramatique, un agencement spécifique, que l’on peut certes écouter sans guide mais qui gagne à être entendue avec trois pages d’indications. Cette piètre raspinguerie est stupide (combien coûte un programme dans le budget d’un tel événement ?), mais elle ne remet pas en cause l’intérêt que j’ai eu à profiter, cette année, de l’abonnement à l’Ensemble intercontemporain (cinq concerts originaux et stimulants à 10,8€ la place, c’est bon d’habiter Paris, parfois). Mais bon, ça énerve quand même.
QCM
Un libraire vous contacte pour signaler qu’il a vendu un exemplaire d’un de vos livres. C’est plutôt :
a) une bonne nouvelle (il a vendu) ;
b) une moyenne nouvelle (il en a vendu un) ;
c) une nouvelle un peu vexante (c’est si exceptionnel qu’il vous le signale) ; ou
d) la réponse d ?
Existentielle question…