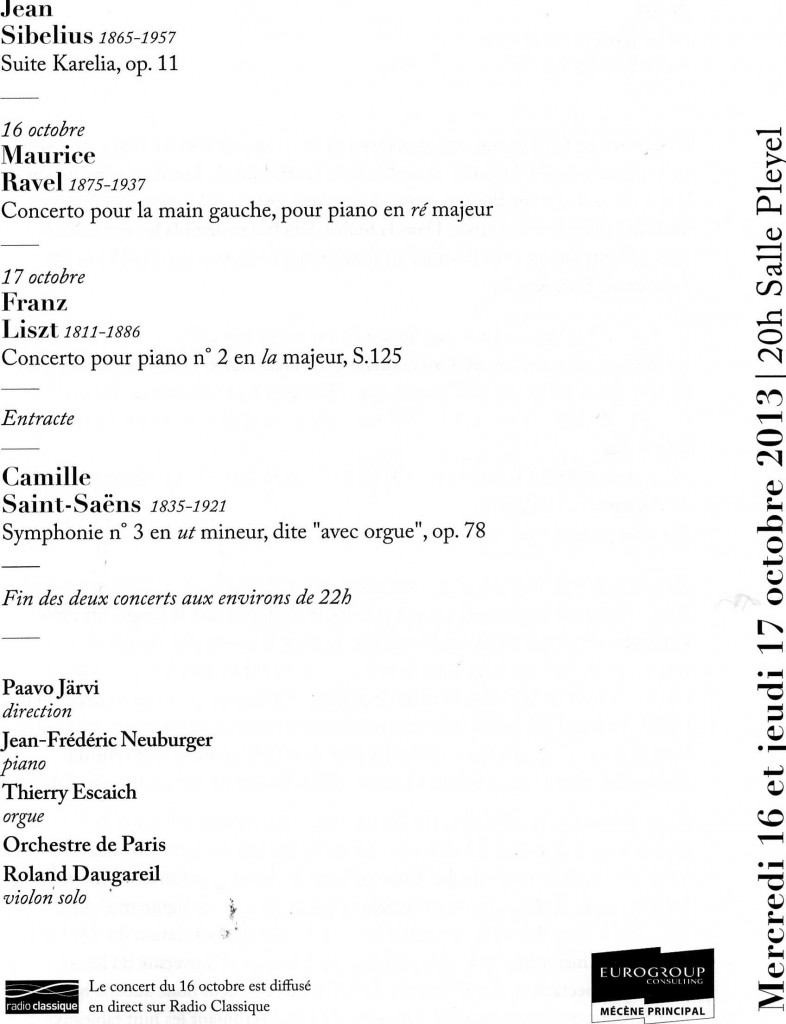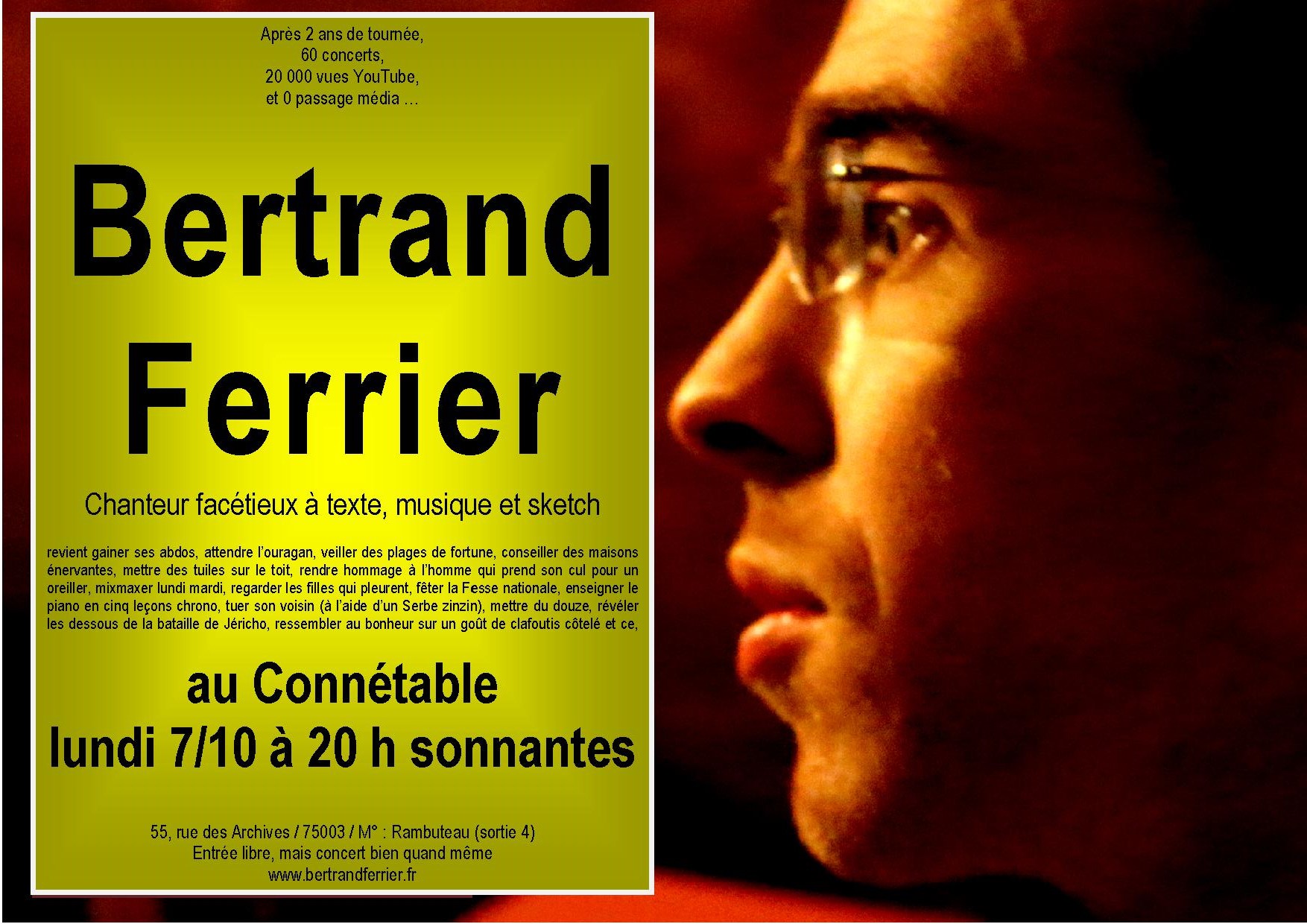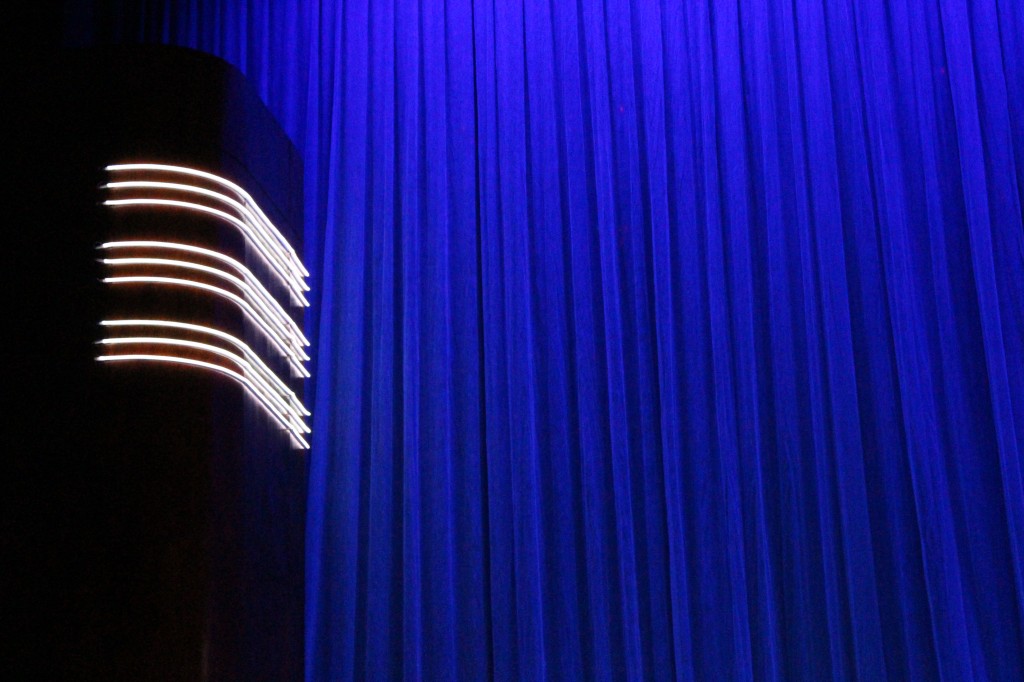Salle Pleyel, 16 octobre 2013
Devant une Salle Pleyel complète, l’Orchestre de Paris s’attaque à un joli programme, ce 16 octobre : Sibelius, Ravel et Saint-Saëns.
En ouverture, la Suite Karelia de Jean Sibelius,composée en 1893. Cuivres, percussions, cordes en réponse, mélodies entêtantes, hymnes solennels : tout pour faire de la musique pompier. Pourtant, sous la houlette d’un Paavo Järvi souriant, la phalange parisienne s’obstine à faire de la musique. Du piano très beau au forte martial, avec des effets de crescendo/decrescendo réussis, l’orchestre parvient à donner du corps à cette musique d’accompagnement (à la base, elle servait pour illustrer un spectacle historique), au point d’accrocher l’auditeur au-delà du poum poum qui saisit d’emblée. Beau travail qui valorise cette musique plaisante.
Pour le morceau avec soliste, ce soir-là, la programmation dégaine le Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel (le lendemain, la pièce était remplacée par le Concerto pour piano n°2 de Franz Liszt). Au clavier, Jean-Frédéric Neuburger. D’apparence à l’aise, à l’évidence à l’écoute de ses accompagnateurs, le soliste attaque cette partition redoutable avec férocité – vu ce qu’il y a à taper, vaut mieux. Quel dommage, donc, qu’il noie une grande partie du mouvement liminaire dans une pédale omniprésente ! D’où nous sommes, l’effet est désastreux. Toute l’énergie, toute la puissance, toutes les nuances d’attaques différentes, tout est englouti dans un halo incompréhensible. C’est d’autant plus regrettable que les notes sont là ! La main dévore le clavier, cherche visiblement des contrastes, se démène et rebondit avec la verve nécessaire pour rendre justice aux défis (hystérie des notes, illusion de deux mains, multiplicité des styles – du jazz à la marche en passant par les grands sentiments à la sauce romantique). La pédale s’allège à mesure que ces vingt minutes de virtuosité s’écoulent, ce qui permet de mieux goûter et les efforts du soliste et les effets de dialogue avec la masse orchestrale. Mais la déception est d’autant plus grande que le soliste conclut par un redoutable Debussy qui montre que Jean-Frédéric Neuburger sait user plus subtilement de la pédale qu’il ne nous semble l’avoir fait dans son morceau imposé.
Après la pause rillettes-cornichons-bière (ou « juste une coupe de champ' », selon les religions), c’est l’heure – enfin, les quarante minutes – de la curiosité de l’année : la Symphonie n°3 « avec orgue » de Camille Saint-Saëns, plusieurs fois programmée à Pleyel cette saison. Gros machin que cette symphonie, avec gros orchestre, piano à quatre mains et orgue décoratif pour faire encore gonfler la sauce. L’introduction en douceur est plutôt bien négociée par l’Orchestre de Paris, même si certains départs ne semblent pas parfaitement nets, et même si (c’est dire) on eût aimé, peut-être à tort, des tempi un chouïa plus soutenus pour éviter la dilution de l’émotion. L’arrivée du leitmotiv qui imite le Dies irae pousse l’orchestre à sonner. L’orgue est tenu – c’est pas tout à fait rien – par un Thierry Escaich qui ne feint pas de se passionner pour une partition il est vrai peu exigeante à son aune, peu susceptible de le mettre en valeur, et qu’il a trop jouée, si l’on en juge par son air blasé. Précisons que l’orgue électronique retenu pour la soirée remplit correctement son rôle d’accompagnateur. Paavo Järvi se soucie de donner du souffle à la partition en ouvrant et fermant avec précision la boîte expressive de l’orchestre. Comme il convient, l’ensemble est impressionnant, malgré quelques départs qui donnent la sensation de se faire un peu à l’arrache, mais l’interprétation manque peut-être d’une pointe de tension musicale, d’inquiétude quasi métaphysique (on parle quand même d’un Dies irae) pour nous combler.
En cadeau, et on se réjouit de ce bis, un bout du Samson et Dalila conclut festivement cette belle soirée où l’Orchestre de Paris se montre à son avantage, notamment en rappelant que Jean Sibelius comme Camille Saint-Saëns ont écrit de la belle musique… surtout quand l’interprète la joue sans vouloir « faire joli ».
Salle Pleyel, 2 octobre 2013
Apéro, solo, plat de résistance et dessert : tel est le programme qu’affronte l’Orchestre de Paris ce 2 octobre à la salle Pleyel.
En apéritif, le Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy semble surprendre les musiciens. Certes, jolie introduction en nuances douces, mais peu de froufroutements ensuite, peu d’émotions et de contrastes perceptibles. Les couleurs de l’orchestre tiennent plus de l’aquarelle que de la peinture – en clair : c’est un peu plus mignon que beau, ce qui ennuie chez Achille de France… Et cela inquiète d’autant plus que s’annonce le solo : le Troisième Concerto pour piano et orchestre de Béla Bartók. C’est le moins explosif des trois, celui où la puissance percussive du piano s’efface devant la recherche moins d’une mélodie que d’une communion (insertion du piano dans l’orchestre, questions-réponses, commentaires sur un thème de l’orchestre…) entre le soliste et l’ensemble. Pour cette soirée sponsorisée par l’Institut polonais de Paris, Piotr Anderszewski fait montre à la fois d’une assurance technique quasi fanfaronne, voire fanfaronne et demie, et d’un souci de dialogue avec l’orchestre et le chef – il est sans cesse tourné vers eux à les écouter et à les chercher du regard. Le résultat est heureux, avec de beaux passages d’ensemble, mais aussi – comme quoi, on doit être chagrin ce soir-là – une impression sporadique de laisser-filer, comme si la tension musicale cédait parfois sous la « jolitude » des harmonies – encore une fois, brillant mais plus joli que prenant. A contrario, le bis permet à Piotr Anderszewski de jouer un Bach très personnel, avec des wagonnets de rubato, pour une pièce certes antimusicologique au possible, mais résolument intériorisée et subjective. Que demander de plus à un bis ?
Après l’entracte, le plat de résistance s’appelle Symphonie en trois mouvements et est signée du chef cuistot Igor Stravinski. Et là, la magie orchestrale opère. Rigueur des départs, énergie des cordes même dans les pianissimi, brillant réglage des échos entre pupitres, efficacité de la direction de Paavo Järvi apparemment plus impliquée, interventions percutantes de la pianiste d’orchestre : et c’est ainsi qu’une partition de fond de tiroir (Stravinski l’avait ressortie et promptement réhabilitée pour répondre à une commande) se révèle enthousiasmante, mêlant beauté des timbres, rage des cuivres mais pas que, construction dramatique et fourmillement d’idées… Cela vaut bien des bravos ! Reste alors le dessert, qui explique sans doute que la salle Pleyel soit quasi pleine, même à la fin du concert : l’indécrottable Boléro de Maurice Ravel. C’est donc parti pour un petit quart d’heure permettant de découvrir l’orchestre, d’apprécier l’implication des musiciens (et pas que du caisse-clairiste !), et de profiter d’un tube qui enthousiasme toujours le public. Le chef est à l’ouvrage : il retient ses ouailles, les fait gronder comme il faut, et la soirée s’achève, tranquille, par un triomphe un brin exagéré au regard du Stravinski qui précédait.
En résumé, une soirée diverse donc stimulante, articulée autour d’interprétations entre bon et très haut niveau, et éclairée par une Symphonie en trois mouvements au contenu aussi passionnant que son titre manque d’entrain !
L’orgue mémoire
En souvenir de Yannick Daguerre, concert collectif fut donné le 15 septembre en l’église de L’Isle Adam. J’y proposai cinq improvisations « à thème ». En voici la retranscription intégrale, enregistrée par l’organisateur.
1. Introït et broderies furieuses sur la Pastorius toccata pour sonder si l’accord est bon partout (4’40)
[audio:http://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2013/10/Impro-1.mp3]
2. Variations sur un choral inventé (4’30)
[audio:http://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2013/10/Impro-2.mp3]
3. Valse infinie sur un cantique chiant [« Viens avec nous, Marie »] (4’20)
[audio:http://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2013/10/Impro-3.mp3]
4. Lamento technodance (3’40)
[audio:http://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2013/10/Impro-4.mp3]
5. Requiem révolté (4’20)
[audio:http://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2013/10/Impro-5.mp3]
Opéra de Paris, 27 septembre 2013
Moins sexy que Le Barbier de Séville, L’Affaire Makropoulos ? C’est ce que laisse supputer un Opéra de Paris inhabituellement peu rempli. Tant pis pour les absents.
L’histoire : au premier acte, Emilia Marty, cantatrice admirée, débarque dans un cabinet d’avocats sur le point de conclure une affaire de testament. Elle révèle, Dieu sait comment, l’existence d’un testament contradictoire susceptible de leur assurer la victoire. Au deuxième acte, Emilia Marty séduit à tour de bras : un ex d’il y a cinquante ans (si), l’homme qui pourrait lui récupérer le document qu’elle convoite, le fils de celui-ci, avant de se donner à l’homme au doc, par intérêt. Au troisième acte, Emilia Marty récupère son document, alias le « Vec [secret] Makropoulos », titre en tchèque : la formule paternelle d’un élixir susceptible de lui permettre de vivre trois cents ans de plus (elle en a déjà 337), et sans lequel sa vie va s’arrêter incessamment. Finalement, convaincue de la vanité des choses, elle préfère se laisser mourir et faire disparaître la formule tant convoitée.
La représentation : cette reprise d’une production de 2007 est portée par la direction très « musique contemporaine » de Susanna Mälkki. Précision, clarté, exigence guident la gestuelle de l’ex-patronne de l’Ensemble InterContemporain. Le résultat est donc très convaincant, même si l’orchestre paraît, aux moments vitaux, un brin sur la réserve – on l’imaginait pouvant tonner plus, mais l’option de privilégier la musique en toute circonstance se révèle, à la longue, très défendable.
Côté chanteurs, il n’y a qu’une vedette : Ricarda Merbeth. Le chœur d’hommes a droit à un service minimal, et les autres solistes ne peuvent briller face à l’ouragan Emilia Marty. Pourtant, tous tiennent leur rôle – difficile – sans encombre. On apprécie ainsi l’incarnation de Jochen Schmeckenbecher en Kolenaty, l’interprétation du dadais niais Janek par Ladislav Elgr, ou le rôle de bouffon triste assumé par le vieux Ryland Davies, honteusement affublé de boucles d’oreilles (il affirme avoir dérobé les bijoux de sa femme, pas les avoir mis, bordel !). Reste que le compositeur écrit essentiellement pour Emilia Marty – un rôle de cantatrice pour une grande voix. Ricarda Merbeth l’assure avec aplomb, malgré les palanquées d’aigus puissants au programme. Vigueur du timbre, maîtrise du souffle et endurance jusqu’à la dernière intervention, redoutable : que demande le peuple ?
Peut-être le spectacle total que demande l’opéra. Donc que l’on place au centre d’un grand bûcher joliment crépitant, après les avoir longuement fouettés et insultés, Krzysztof Warlikowski, le metteur en scène (dont on serait curieux de savoir combien de demi-minutes il a passé pour régler les déplacements de ses personnages – voir par ex. la scène de police du III), et Malgorzata Szczesniak, la décoratrice-costumière (à qui il faudra sans doute apprendre à lire, afin qu’elle ait une chance de comprendre un livret, la prochaine fois qu’elle sévira, de préférence loin, en Mandchourie du Sud peut-être – ou alors, qu’elle m’explique où elle a vu au I le compositeur réclamer des « micros sur pied »). Par leur toute-puissance, ces crétins ont déplacé l’histoire à Hollywood, Emilia Marty devenant Marilyn Monroe, avec perruque, robe qui volette et pénibles vidéos type INA. L’idée est stupide (L’Affaire Makropoulos est un opéra sur l’opéra, pas une composition sur la célébrité), lourde, vulgaire (surtitres en fond jardin se déformant comme des fonds d’écran de secrétaires d’état-civil à la fin des années 1980), et constamment hors-sujet. Ainsi de la transformation de Krista (jouée par Andrea Hill) en Marilyn bis, alors que Krista ne cesse de dire qu’elle va arrêter le chant, et qu’Emilia Marty ne lui transmet finalement pas le secret des Makropoulos. Ainsi de l’insertion passante de décors de toilettes (avec écrans de télé intégrés), d’une salle de bains, d’une piscine. Ainsi de la quasi-nudité récurrente d’Emilia Marty, qui se change sur scène et enlève tout caractère de fable ou de récit philosophique à cette histoire extraordinaire. Ainsi de la grande scène finale, avec mort anticipée, superbe dialogue avec le chœur sur la vanité des choses, destruction par les flammes du secret de vie éternelle : ici, rien – coma banal, hommes en T-shirt à la gloire de Marilyn-Ricarda-Emilia, fondu au noir dans une piscine en coupe…
En conclusion : dans ces conditions, alors que Ricarda Merbeth, souvent, était nue (ou presque), l’émotion, elle, est ténue – bof, d’accord ; mais la morale de cette histoire, c’est surtout qu’il est scandaleux que des incompétents de la trempe d’un Warlikowski ou d’une Szczesniak, prétentieux et si peu musiciens de cœur, aient le loisir de monter un opéra qui, partant des conventions les plus archétypales confrontées à une musique détonante, finit sur un questionnement poignant tout en interrogeant le sens même de l’opéra – et non celui de la culotte de Marilyn. Dramatiquement, donc, une soirée détestable ; musicalement, un moment bien stimulant.
Cité de la musique, 20 septembre 2013
Après une tournée triomphale commencée non moins triomphalement à Paris, et après la sortie du DVD du spectacle, Alexandre Astier est revenu à Paris pour quatre dates, afin d’y donner Que ma joie demeure !, son one-man-show où il est Bach.
L’histoire : Johann Sebastian Bach est vénère. Il est obligé de donner une journée de formation musicale aux bouseux de Leipzig. Armé d’un tableau et d’un clavecin, il va donc leur enseigner l’harmonie, le rythme, la musique internationale et l’art de faire entrer une tranche de jambon ronde entre deux tranches de pain carré. En chemin, il apprendra à une stérilisatrice de génisses qu’elle n’a pas l’oreille absolue, il écrira son nouveau morceau grâce aux miettes de pain disposées dans le fond d’un moule par le Saint Esprit, il entendra crier son petit dernier alors qu’il est chez une cousine, et il règlera l’expertise de l’orgue transformé en ruche au su du clergé (qui vend le miel fabriqué dans les tuyaux dits « manquants »). En contrepoint, on voit Bach bourré commenter le massacre de son dernier choral, chercher la rédemption en se confessant – étrangeté que l’auteur a fini par contourner en ajoutant un métatexte, jouer un bout de suite à la viole et confirmer que, pour s’endormir, rien ne vaut le clavecin (à condition de finir par une cadence parfaite).
Le spectacle : muni de deux béquilles à l’ancienne – il s’est blessé à la toute fin de son spectacle bordelais, troquant désormais ses « putain de mocassins » pour des Nike customisées par Jean-Christophe Hembert, Alexandre Astier intègre tant bien que mal cette nouvelle contrainte à un spectacle de très haute volée. Le créateur de la série Kaamelott, musicien classique frotté au jazz, peut ainsi, malgré tout, s’amuser dans son registre coutumier : l’anachronisme subtil, la trivialité du génie, le misérable comme refuge de la transcendance. Si. Cela donne une pièce de très haute volée, jouée avec conviction par son auteur, qui casse avec habileté les codes des genres utilisés – la conférence parodique, le one-man-show, le théâtre musical.
Certes, on doit pointer les défauts évidents de cette forme couturée, dont le contenu semble avoir beaucoup évolué (moins de place pour les drames familiaux, tant mieux ; l’interprétation musicale s’est réduite, pourquoi pas, mais dommage que Que ma joie demeure soit désormais limitée à tenir lieu d’interlude ; adieu au gag du portable de 1730 et à ses élèves de musique tous appelés Wilhelm, rencontrés dans le sketch de Montreux en 2010, snif) à mesure que les représentations avançaient. Par exemple, l’unité de temps (une journée de conférence + le retour à la maison) est ratée, puisque Bach semble chez lui à l’université (il entend Johann Christoph crier) mais reste coincé dehors en rentrant. C’est la patte Astier : dans Kaamelott, les incohérences spatio-temporelles sont légion, sinon romaines – oh, ça va, hein, humour.
Reste l’essentiel : l’évidence du talent. C’est très drôle, et, de surcroît, la performance est que l’auteur évite tant le démago que, pire, le pédago. La transformation du premier prélude dit « de l’Ave maria de Gounod » en valse à dix-neuf temps (même si on saute un épisode dans cette version, dommage), est remarquable ; les emprunts-hommages à Dieudonné sont, sinon courageux – Alexandre Astier a toujours soutenu l’humoriste – du moins efficaces ; le surgissement de l’absurde (questions du public fictif, usage de la ruche) n’éloigne jamais du propos, au contraire, qui semble être profondément autobiographique chez le créateur, et qui l’est sans doute chez chacun de ses fans : quelle est, en moi, la part du médiocre et la part du génie ? suis-je le bouseux venu assister à la vie avec un seau de graisse de mouton en cas de fringale, ou le mec capable de lire une note en une dizaine de clefs différentes ? le quotidien m’a-t-il assez abruti ou suis-je encore en train de lutter pour ne pas être réduit à ce que la société me demande d’être ?
Cette inquiétude sourde – que Dieu finit par nommer à Bach sous son vrai nom : la tristesse – vibre tout au long de Que ma joie demeure !. C’est aussi ce qui fait le charme de ce divertissement haut de gamme, et sans rival d’aucune sorte en France : mettre en scène avec force un oxymoron permanent, une boule de contradictions, associant un pédagogue qui ne veut pas enseigner, un parent qui voit mourir ses enfants, un génie qui a les deux pieds et jusqu’aux cuisses même dans la crotte du quotidien, un homme rationnel qui se demande si la raison ne serait pas de devenir fou. En conclusion, ce n’est donc pas seulement un très bon spectacle comique : c’est un très beau spectacle. Partant, il est juste que les villageois vous acclament comme… comme des villageois, Sire !
Théâtre des Champs-Élysées, 18 septembre 2013
Théâtre archi-comble, ce mercredi de septembre, pour Le Vaisseau fantôme de Richard Wagner en version scénique. En scène, l’orchestre de Rotterdam dirigé par le lutin Yannick Nézet-Séguin. Le chœur de l’Opéra de Hollande (pas lui, l’autre) est placé derrière pour soutenir cette histoire de flotte.
L’histoire : Daland (Franz-Josef Selig), capitaine, est presque chez lui quand une tempête l’oblige à s’ancrer dans une crique. Patatras, alors que le timonier (Torsen Hoffman) s’est endormi, débaroule un autre étrange bateau, mené par le Hollandais (Evgeny Nikitin). Celui-ci fait étalage de ses richesses, seule passion de Daland, qui lui promet sa fille en échange. Fin de l’acte I (1 h), et repos pour les spectateurs – la dernière production à l’Opéra de Paris renonçait, elle, aux délicieux profits du bar. L’acte II (50′ env.) voit les filles filer, sauf Dame Mary (Agnes Zwierko), qui coache, coordonne et manage, et sauf surtout Senta (Emma Vetter), qui rêve au mystérieux marin maudit, ne revenant sur Terre que tous les sept ans afin d’espérer trouver enfin une femme fidèle qui le sortirait de sa curieuse malédiction. Erik (Frank van Aken), p’tit chasseur de peu, enrage, car il la considère comme sienne, et les présages lui laissent peu d’espoir. L’acte III (30′ env.) voit enfin débarquer les marins de Daland qui festoient avec les filles locales, vu que les marins fantômes de l’autre bateau ne semblent pas intéressés. Le Hollandais est ravi d’avoir trouvé une femme qui lui jure fidélité par compassion pour la terrible épreuve qu’il a subie. Las, Erik affirme que Senta lui avait déjà promis fidélité. Grâce à une astuce de casuiste, le Hollandais, dégoûté mais grand seigneur, sauve Senta de la malédiction à laquelle elle aurait pu être vouée, et quitte le rivage en promettant de ne plus jamais remettre pied à terre. Senta, qui voit son rêve s’enfuir et ne voulait sans doute pas finir avec un modeste tueur de galinettes cendrées, se suicide. Bing, c’est la fin.
Le concert : commençons par le général (et non le capitaine, ha, ha). Très haut niveau d’ensemble. Orchestre motivé, le plus souvent précis, dirigé avec fougue mais sens du détail par Yannick Nézet-Séguin, jeune bondissant et souriant, qui souffle même à certains chanteurs le début de leurs phrases.
Deux chanteurs dominent la distribution. Côté hommes, c’est une surprise, l’homme qui ressemble presque au capitaine Haddock, Franz-Josef Selig, séduit par la palette des émotions qu’il joue. Le capitaine qu’il est doit être roublard, mais aussi maître et père. En jouant sur les nuances, il offre une palette impressionnante de couleurs musicales. La richesse de sa voix puissante, qui n’a pas honte d’en garder sous la glotte, éblouit malgré la bassesse de son personnage dont il rend bien le côté antipathique – une performance. Côté femmes, la vraie révélation de cette soirée pour nos oreilles est Emma Vetter. Certes, elle n’a qu’une heure vingt à tenir (elle ne chante pas au premier acte), mais son rôle est très exigeant. Cela ne l’handicape pas : de la première à la dernière note, malgré une étonnante nervosité (mains tordues, à l’instar de Evgeny Nikitin lors de son entrée au deuxième acte), elle tient son personnage de cruche rêvasseuse. Mieux, elle tire cette greluche vers la figure de la passionnée, grâce à l’intensité de son interprétation et à la plénitude de sa voix, à l’image de sa robe crémeuse et superbe. C’est intense, et ça plus-que-mérite d’être suivi.
Avant de parler des seconds rôles, parlons du rôle-titre, interprété par Evgeny Nikitin, l’artiste lyrique le plus controversé. En effet, on sait qu’il fut bouté fors de Festival des faux-culs de Bayreuth car il garde de sa jeunesse des tatouages nazis sur le dos – cet ostracisme rappelle au besoin que les cons ne sont pas tous nazis, loin s’en faut. Loin de ces polémiques de pauvres débiles ayant besoin de lécher l’anus du consensus mou (c’est un euphémisme), l’interprétation d’Evgeny Nikitin déroute : il choisit la posture de l’homme en colère. Non, soyons clairs, il joue le mec vénère de chez vénère. L’option ne colle pas parfaitement avec le texte, mais pourquoi pas ? La voix est puissante, le bonhomme est cohérent (pas de veste ou queue-de-pie, contrairement à ses confrères, genre : je suis poli mais je nique le système, d’ailleurs t’as vu mes tatouages sur les mains, nanani nanana ?), la version vaut d’être ouïe. Hélas, le charme se dissout dans la seconde partie : la voix a des ratés. De méchants ratés. Dans l’ensemble, cela reste impressionnant et extrêmement valable. Néanmoins, sans la voix d’airain, le personnage remotivé par l’artiste perd sa cohérence intrigante, et notre avis est donc plus mitigé que lorsque nous avions entendu ce même artiste la saison dernière.
Les seconds rôles méritent un petit mot, ne serait-ce que parce que c’est mon site et donc j’y fais c’que j’veux avec mes ch’veux, non mais. Torsen Hoffman en timonier-pilote est un curieux Schtroumpf rebondi qui vire au rouge quand il chante. Il semble à chaque fois au bord de la rupture, mais la voix tient avec constance, et le résultat mérite des bravos nourris. Bien qu’il n’eût pas demandé par avance l’indulgence de l’assistance, comme cela arrive souvent, Frank van Aken était de toute évidence souffrant – méchante grippe, au moins. Sa voix puissante et facile dans les aigus était donc au supplice, ce mercredi : graillons, ratés, vibrato relâché. Sortant d’une nuit à 40°, on a soudain terriblement mal pour lui. Et pourtant, le zozo impressionne, se met en scène pour les besoins de la cause et non pour chercher à cacher ses ratés (superbe fausse-vraie sortie finale). Là encore, on a envie de le réentendre quand il aura guéri, car ça doit dépoter ! Enfin, le croisement de Maurane et de Natacha Derevitzky, alias Agnes Zwierko semble se demander ce qu’elle fait là. Seule de la distribution à utiliser la partition (bien sûr autorisée pour les opéras en concert), elle campe correctement son personnage : belle voix, belles moues, belle présence scénique malgré l’absence de mise en scène et les longues minutes sans intervention. Ce nonobstant, quand il faut prononcer un texte très vite, ce n’est plus le moment de chercher ses mots dans la partition… sous peine de mâchmouchmichouillonner un peu n’importe quoi, ce qu’elle finit par faire, le « un peu » en moins.
En conclusion, et bien que l’on puisse critiquer certains aspects quasi négligeables (méforme de tel artiste, justesse sporadiquement perfectible des bois…), l’engagement de l’orchestre (premier violoncelliste passionné en tête), la rigueur souriante du chef et la qualité d’ensemble du plateau ont donné une très belle et très stimulante interprétation de ce grand opéra des débuts wagnériens.
Salle Pleyel, 17 septembre 2013
Le 17 septembre, c’était la reprise de ma saison de spectateur – ô impatience ! L’orchestre symphonique de Cologne ouvrait le bal dans un programme Beethoven + Strauss.
En première partie, classique mise en bouche, l’ouverture d’Egmont de LVB rugit avec l’énergie requise puis laissait entendre un plaisant souci de contrastes. Entre alors en scène Karita Mattila pour le tube des sopranes et mezzos, les Quatre derniers lieder de Richard Strauss. D’emblée, l’attention se déplace. L’orchestre paraît avoir peu répété avec la vedette (les solistes en réponse font le boulot, mais les parties en duo avec certains pupitres ne coïncident pas parfaitement), mais son chef réussit à le mettre en arrière-plan pour laisser la soprano s’exprimer. Or, Karita Mattila profite de tempi contrastés mais sans excès (début allant mais pas excessivement pour « Frühling », bonne pulsation dans le parfois traînant « Im Abendrot ») pour faire ce qu’elle aime faire désormais : valoriser l’expressivité. La micro-chorégaphie accessoirisée avec son étole, dont elle se drape, qu’elle prend en mains puis qu’elle pose, illustre ce que porte sa voix – une volonté de donner à sentir plutôt que d’impressionner. Capable de fortissimi, la soprano ne craint pas d’aller chercher ponctuellement des pianissimi quasi inaudibles, au risque de perdre en portée vocale ce qu’elle gagne en émotion. En définitive, la star, forte de son bagage technique et de sa carrière, semble privilégier la musique sur la perfection. À l’arrivée, cette option est très convaincante : la voix est belle sur l’ensemble de l’ambitus, et c’est une poignante interprétation personnelle, que Karita Mattila donne, ce soir-là, de quatre lieder qu’elle a pourtant dû interpréter des palanquées de fois.
En seconde partie, l’orchestre attaque la Cinquième Symphonie de LVB, feat. le célébrissime « Pom pom pom pom » liminaire, aussi appelé « Hymne de la pince à linge » depuis Pierre Dac et Francis Blanche. L’orchestre prend ses aises car, pour lui, c’est le moment de briller : Beethoven fait abondamment circuler la parole entre les pupitres, plaçant çà et là des ponctuations puissantes du tutti. Le résultat est plaisant, et même stimulant. Jamais tonitruant, l’orchestre, autant appliqué qu’impliqué, choie les différentes ambiances, écoute rebondir la balle mélodique d’un bout à l’autre du court de musique, puis se jette à corps perdu dans le final brisé et pyrotechnique. Malgré une direction qui paraît gestuellement peu précise, Jukka-Pekka Saraste tient son orchestre et le conduit avec sûreté sur les eaux tumultueuses de cette Cinquième. Le bis, tradition des orchestres étrangers en visite, est un vrai bis, pas juste une p’tite danse hongroise exécutée les doigts dans l’zen, par obligation. Aussi ce cadeau, quoique convenu, est-il à l’image d’une soirée de très haute tenue, où la musique l’a emporté sur la virtuosité et le tumulte.
As far as we’re concerned, c’est tout smooth.