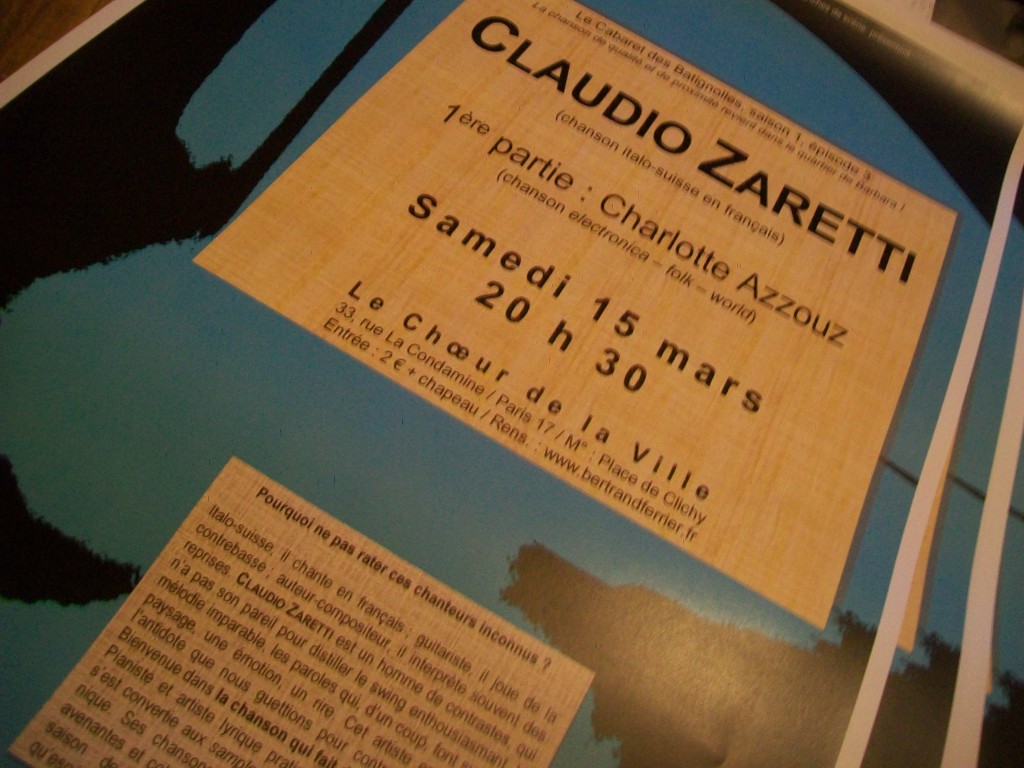In the mood for a peplum (kind of)
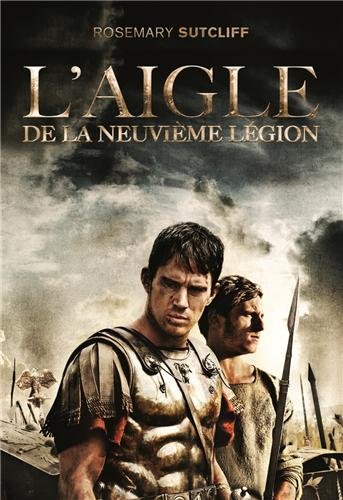 Ce lundi soir, sur D8, est diffusé L’Aigle de la neuvième légion, film tiré d’un excellent roman de Rosemary Sutcliff, traduit en son temps par… moi-même je. Un roman à retrouver en grand format et en poche chez Gallimard Jeunesse.
Ce lundi soir, sur D8, est diffusé L’Aigle de la neuvième légion, film tiré d’un excellent roman de Rosemary Sutcliff, traduit en son temps par… moi-même je. Un roman à retrouver en grand format et en poche chez Gallimard Jeunesse.
Théâtre des Champs-Élysées, 18 mars 2014 : « Der Rosenkavalier » de Richard Strauss
Souvent joué sur les scènes mondiales, Le Chevalier à la rose de Richard Strauss débarquait au TCE avec, pour seule tête d’affiche presque française, Sophie Koch. Nous y étions.
L’histoire : la maréchale (Soile Isokoski), notable local, est une cougar : elle couche avec le tout jeune Octavian (Sophie Koch), qui lui jure amour éternel. Surgit le baron Ochs von Lechernau (Peter Rose), venu demander un messager pour porter une rose à Sophie (Christiane Karg) sa fiancée : une gamine bourgeoise qu’il ennoblira en l’épousant, tout en empochant la fortune de son beau-père, Monsieur de Faninal (Martin Gantner). Octavian apporte la rose, séduit Sophie et monte donc un scénario vaudevillesque pour montrer l’inadéquation du futur mari – celui-ci veut s’envoyer Octavian alors déguisé en femme (bien qu’il soit un homme joué par une femme, faut suivre). La maréchale et Faninal débarquent, l’affaire est révélée, l’histoire s’arrange, et tout se finit par un tour en calèche offert au bourgeois épaté par la maréchale herself.
La représentation : il s’agit officiellement d’une « version de concert » tirée d’une production de la Bayerische Staatsoper. En réalité, même si, bizarrement, Sophie Koch tient à s’appuyer sur son pupitre sporadiquement, on est à la frontière de la version « mise en espace » tant les chanteurs intègrent de mini-jeux de scène dans leur interprétation. L’orchestre, placé sous la direction de Kirill Petrenko, joue lui aussi ce vaudeville avec une conviction dramatique : énergie, tensions, nuances expressives et suivi convaincant des artistes font partie des qualités évidentes de sa prestation. Le chœur, peu sollicité et placé en fond de scène, caractérise avec talent chacune de ses interventions, et l’on apprécie la justesse des voix féminines.
Le casting de la vingtaine de solistes sollicités par la partition est à l’avenant. Certes, on regrette de nouveau qu’une scène française omette de laisser leur chance à des autochtones ; toutefois, aucun des chanteurs présents ne démérite, y compris parmi les petits rôles – Wookyung Kim, dans le rôle du ténor caricatural, exécute avec panache son air italien. De plus, brillant, le quatuor de vedettes mérite assurément tous les bravo et deux précisions : non Sophie Koch ne chante pas Sophie, et Peter Rose n’est pas le chevalier à la rose – voilà, c’est fait, on n’y revient plus.
Soile Isokoski n’a, physiquement, rien de la séduisante cougar attendue, et il est corsé de ne pas sourire quand on entend son toyboy l’appeler « Bichette » à tour de répliques. Une fois cette convention assimilée, reste une voix sûre, jamais prise en défaut, qui recherche autant la précision des notes que l’expressivité, jusque dans sa minuscule dernière réplique (« ja, ja »). Face à elle, Sophie Koch dégaine un Octavian évolutif : son personnage, qui répond au petit nom de « Quinquin », bref, prend de l’assurance à mesure que l’opéra avance ; et l’artiste, familière du rôle, semble le suivre. Pour la Fricka de Bastille, la puissance de la projection n’est jamais un problème ; et cette facilité – qui n’en est pas une – lui donne tout loisir de rendre admirablement expressif une partie à la fois redoutable techniquement et un peu concon dramatiquement. Christiane Karg, sa fiancée du soir, campe une Sophie d’emblée décidée, bien qu’elle soit d’abord censée être soumise à son futur mari afin de quitter le giron paternel. Cette option s’appuie sur une voix joliment paradoxale – très belle et cependant assez expressive pour sonner la révolte mesurée d’une gamine prête à refuser un mari… pour se jeter dans les bras d’un autre petit con qui lui plaît davantage, même si elle comprend qu’il ne fut pas un moine. Le résultat est tout à fait séduisant, comme l’est l’abattage de Peter Rose, basse bouffe associant le grotesque du benêt pataud et la force tranquille de celui qui se croit tout permis. Porté par un rôle très théâtral et malgré un déficit de mouchoir qu’il passe un acte à chercher en vain dans sa poche de costume, le zozo se balade : présence physique, charisme patent, aisance ludique, tessiture parfaite (les graves attendus sont là, et malicieusement appuyés), l’homme associe une excellente interprétation musicale à un savoir-faire sidérant mêlant l’art d’acteur et de chanteur. J’ai envie de dire : bob, casquette – chapeau, en somme.
En conclusion, une superbe soirée, feat. : une partition assez captivante pour faire presque oublier un livret faible ; un orchestre et un chœur dirigés avec sûreté par un chef attentif aux chanteurs et soucieux de dynamique ; des solistes de haute volée exécutant leur rôle comme à la parade… et même un public étonnamment silencieux pendant la représentation. De quoi lever son pouce et plus car affinités. (Oui-da, c’est nul, mais j’ai pas de meilleure chute en stock, alors bon, on n’a qu’à dire que ça passe pour cette fois.)
On approche de la happy end
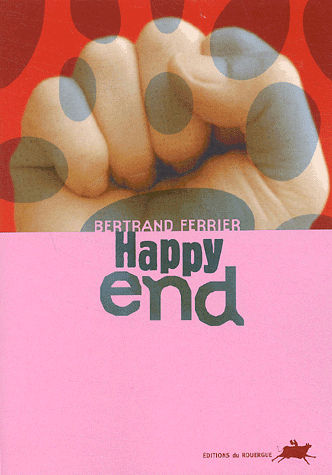 Pour la quasi dernière de Happy End dans l’excellente version théâtrale inventée par Thierry Moral, je suis invité par la Comédie de Béthune pour une rencontre avec le public, après la représentation de ce vendredi 21 mars à 20 h au théâtre de Lillers. Rens. ici. J’aime bien les fins tristes aussi sympathiques, et j’espère la partager avec quelques grosses tonnes de foufous (au moins).
Pour la quasi dernière de Happy End dans l’excellente version théâtrale inventée par Thierry Moral, je suis invité par la Comédie de Béthune pour une rencontre avec le public, après la représentation de ce vendredi 21 mars à 20 h au théâtre de Lillers. Rens. ici. J’aime bien les fins tristes aussi sympathiques, et j’espère la partager avec quelques grosses tonnes de foufous (au moins).
Salle Pleyel, 14 mars 2014 : les « Gurrelieder » d’Arnold Schoenberg

Salle Pleyel, 14 mars 2014. L’effectif de fou exigé par les « Gurrelieder » est ici photographié par Josée Novicz.
Extraordinaires : avec six solistes de classe internationale, un double chœur mixte, un orchestre massif incluant une soixantaine de supplémentaires, et une scène agrandie pour l’occasion, les Gurrelieder d’Arnold Schoenberg programmés à Pleyel ce 14 mars sont un événement hors du commun, dignes de la mission de service public qu’est, pour partie, celle de l’Orchestre philharmonique de Radio France (le concert est disponible en replay ici). Nous y étions.
L’œuvre : les deux heures de musique annoncées s’ouvrent par une première partie où le roi Waldemar (Robert Dean Smith) se réjouit de rentrer à Gurre. C’est là que vit la belle Tove (Katarina Dalayman). Après soixante-dix minutes, celle-ci meurt, assassinée par la reine jalouse, comme le rapporte l’oiseau interprété par Michelle De Young. La deuxième partie est un bref interlude où Waldemar maudit Dieu, lui expliquant que, au lieu des anges qui passent leur temps à lui passer de la pommade, « quelqu’un sachant blâmer » serait plus utile au big boss. La troisième partie fait voler en morceaux la clarté du récit. Un paysan (Gábor Bretz) et un bouffon (Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, à la diction ironique si caractéristique) encadrent les dernières interventions du roi, avant qu’un récitant (ici la grotesque Barbara Sukowa) et que le chœur mixte ne concluent en chassant la mort et ses spectres, devenus omniprésents, par l’invocation du soleil qui « monte des flots de la nuit ».

Devant l’orchestre, on aperçoit Gábor Bretz, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Robert Dean Smith, Barbara Sukowa, Michelle De Young et Katarina Dalayman. Photo : Josée Novicz.
Le concert : alors qu’un Mikko Franck fondu est repéré dans le public, c’est à Esa-Pekka Salonen qu’il revient de diriger cette pièce monumentale. Et le chef est à la hauteur de sa tâche : tensions, brèves dilatations opportunes de la battue, contrastes, maîtrise de la puissance des cuivres et percussions, souci des départs, volonté énergique de dépasser le mélodrame en valorisant tous les aspects dramatiques et esthétiques de cette incroyable partition (jusqu’à cinquante portées environ !), qu’il s’agisse des tutti sidérants, du vibrato poignant des cordes, des envolées des bois (récurrent cor anglais), du contrechant des timbales, de la stridence des piccolos ou de la détresse furieuse des contrebasses… Nuances, différences et dynamiques sont soignées, rendant justice à une composition passionnante de bout en bout, jusque dans le dernier quart d’heure où surgit la séduisante surprise de la voix parlée, accompagnée par une partition orchestrale somptueuse.
Cette énorme machine instrumentale ferraille en premier lieu avec deux wagnériens patentés : Robert Dean Smith manque comme d’habitude d’un brin de puissance pour passer au-dessus de l’orchestre fortissimo, mais il ne fait qu’une bouchée des exigences de la partition, poussant ses aigus comme à la parade, interprétant son personnage de telle sorte qu’on y entend davantage le tragique que la niaiserie stéréotypée. Brünnhilde réputée, Katarina Dalayman se promène elle aussi dans les difficultés qui hérissent sa partition d’une heure dix, campant une Tove sûre et volontaire, et jouant sur les différents registres de la partition pour rendre magnifiques les billevesées sirupeuses jalonnant son texte. Michelle De Young, au rôle très ténu, intervient pourtant avec force et intelligence quand vient son tour, après une heure de poireautage sur scène, séduisant le public par une voix précise et sans afféterie (aime bien ce mot, moi, même s’il m’énerve – peut-être parce qu’il ressemble à « friterie », ce qui n’est pas très élégant dans le contexte).
Des seconds rôles masculins, surnage Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, dont la diction inimitable renvoie à son Mime de l’Opéra de Paris. La voix du chanteur est belle, la présence du comédien est séduisante, même dans cette forme « concert » ; surtout, comme on est débarrassé des tics qui transformaient Mime en folle de son cul, c’est une joie d’applaudir cet interprète sans être partagé entre l’admiration et l’agacement suscité par son rôle de mentor tafiolique, le néologisme est faible, de Siegfried. Quant aux chœurs, au rôle quantitativement faible mais musicalement essentiel, ils montrent leur capacité à tonner juste. En fait, le seul regret est lié à la présence de Barbara Sukowa, récitant ridicule aux accents de Chantal Goya germanophone : elle fait passer l’invocation de la nature pour un remake du sketch des Inconnus rendant hommage aux insectes nos amis. Pour ce crime, nous proposons sa mise en congé sabbatique définitive des scènes musicales.
En conclusion, une soirée passionnante, une musique hors du commun, une œuvre captivante, une interprétation ambitieuse et pleine d’allant. Le peuple pourrait réclamer plus, mais, en fait, non. Comme quoi, il n’est pas toujours aussi con que supputent les élites.
Cabaret des Batignolles, épisode 3

Samedi 15 mars, 20 h 30. 33, rue La Condamine / 75017 / M° : Place de Clichy. Entrée : 2 € + chapeau si vous avez aimé.
Ce samedi 15 mars, à 20 h 30 pétaradantes, j’organise une soirée « concert chansons ». Pour le plaisir. Le programme : dans une cave idéale (spacieuse, lumineuse, insonorisée et conviviale, qui dit mieux ?), on suçote un coup en sirotant une chip, on écoute une chanteuse prometteuse et en développement comme un pays, on regrignotte un coup en sirotant quelque victuaille, on applaudit un chanteur roué qui propulse avec métier des chansons qui font du bien par où elles restent, et on reboit un coup si ça se présente. Bref, on passe une soirée cabaret tout simplement, simplement, un samedi soir, sur la terre des Batignolles. La vivre avec vous serait, bien sûr, plus fresh.
Entrée : 2 € (une conso incluse) + chapeau pour les artistes si vous avez aimé. Réservations par courriel à lecabaretdesbatignolles@gmail.com.
Salle Pleyel, 12 mars 2014 : Strauss et Schubert

Orchestre de Paris, salle Pleyel, 12 mars 2013. Avec notamment Roland Daugareil (2ème à gauche) et Marek Janowski, qui a un coup (d’archet) dans le nez.
Après la démission de Anja Harteros, l’Orchestre de Paris a monté in extremis un programme exclusivement instrumental dans une salle forcément très clairsemée.
La première partie s’ouvre par Mort et transfiguration de Richard Strauss (25′), un poème symphonique en quatre mouvements enchaînés. L’orchestre est massif, avec cuivres et percussions de rigueur. D’emblée, Marek Janowski semble affirmer ses directives : pas de spectaculaire, peu de pathos, mais des nuances volontiers fondues-enchaînées. Les premières mesures présentent des piano maîtrisés, qui donnent à entendre l’orchestre sous son meilleur aspect. Par la suite, on regrette que la phalange capitale (je sais, mais, dans l’immédiat, j’ai pas d’autre synonyme en tête pour « orchestre parisien ») ne laisse pas éclater la puissance de la composition : peu de fortissimo réellement éclatants, comme s’il s’agissait de privilégier la musicalité sur la puissance de l’écriture orchestrale. Cette option se révèle très précieuse dans une grande partie de ce « poème symphonique », qui s’ouvre et se ferme sur un murmure magnifique ; mais elle eût sans doute été plus gouleyante à nos ouïes si elle avait plus nettement contrastée avec de toniques scènes de batailles en milieu de bal.
C’est d’ailleurs cette même impression de manque de tonicité qui catalyserait nos menues critiques pendant l’audition de la Huitième symphonie de Franz Schubert (25′). La pièce, il est vrai, est curieuse : dans le premier mouvement archicélèbre, la force des thèmes s’associe avec la science des marches harmoniques, le tout subtilement distillé entre les pupitres ; dans le second, le compositeur joue davantage sur le développement d’un matériau récurrent qu’il prend plaisir à exploser puis à réexposer entre deux variations ou digressions. Manque au moins un dernier mouvement – d’où l’appellation fantasmatique de « symphonie inachevée ». L’Orchestre de Paris, qui a glissé cette pièce dans le concert pour pallier la défection de la soprano, rend bien, malgré quelques apparences de décalages sporadiques, l’élégance et la subtilité d’une œuvre réellement séduisante. Les vents (clarinettes, flûtes, hautbois en premier chef) jubilent, et l’on apprécie les sonorités très caractérisées des solistes, Pascal Moraguès en tête. Et cependant, en dépit de la beauté de la composition et de la qualité d’ensemble des musiciens, peut-être parce que nous sommes grognon de nature, il nous manque une petite pincée d’énergie, de dynamisme, d’allant qui pourrait complètement nous emballer.
Après la pause douiche-champagne, la brève seconde partie poursuit l’assèchement de l’orchestre : après que celui-ci s’est allégé en passant de Strauss à Schubert, le voici réduit à un ensemble de vingt-trois cordes solistes pour les Métamorphoses de Richard Strauss (25′). Magnifique est cette pièce, qui sonne comme un quatuor à cordes amplifié, avec des thèmes qui montent des contrebasses aux violons, puis s’égaillent parmi les musiciens, gonflent, s’essoufflent et grondent de nouveau. Les bien-cultivés y lisent des allusions à la destruction de l’Opéra de Munich (l’œuvre est achevée en 1945) et à tel thème beethovénien : franchement, on s’en tampiponne le bibobéchon, tant chaque audition de la pièce saisit. Les musiciens de l’Orchestre de Paris, presque sans un regard pour leur chef, réussissent une belle version, très cohérente, d’où émergent cependant quelques sons singuliers qui ajoutent du piquant. Là encore, un soupçon d’énergie supplémentaire, ou à tout le moins un zeste de tension retenue par moments, aurait achevé de nous convaincre.
Restent un programme tronqué mais bien construit, des interprétations parfois prudentes mais de bonne facture, et cette impression de sérieux et de qualité qui, associée aux précédentes qualités, font, en dépit du faux bond d’Anja Harteros, les bons concerts de Pleyel ; d’ailleurs, pour une fois, les applaudissements nourris du maigre public traduisent avec pertinence cette joyeuse impression. Alléluia (même si, bon, en Carême, c’est de mauvais goût, point n’en disconviens-je) !
Best of colloque international « Cinéma et littérature »
Qu’est-ce qu’un colloque ? Un endroit où des gens prononcent des phrases qui ont parfois du sens in situ mais qui surprennent hors contexte, au-delà même des astuces visant à parler le plus longtemps possible (au bout de 5’/20 autorisées, on déclare : « Je voudrais commencer ma communication » ; au bout de 20’/20, on annonce : « Je vais terminer par trois exemples » ; au bout d’une demi-heure, on lâche : « Enfin, je voulais ajouter, avant de conclure », etc.). Surgissent de la bouche des communicants et des spectateurs, pendant les exposés comme pendant les « débats », des emballements liés à la fougue de l’oralité, des expressions incontrôlées, des trouvailles étonnantes, des professions de foi peu étayées par le raisonnement, des formulations témoignant de la joie universelle de jargonner un brin, des étrangetés amusantes… Par réflexe, je note ces miscellanées, quelquefois épicées par les embardées des interprètes. Et, cette fois-ci, lors du colloque « Fiction littéraire et cinéma » organisé à Carthage par l’Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, j’ai notamment graffité ceci.
- « Comme disait le poète, le roman est un miroir avec lequel on se déplace le long d’une route. »
- « Le cinéma et la littérature sont les moyens par excellence d’expression de la souffrance et de la détresse humaine. »
- « L’iconologie essaye d’étudier les différentes interférences entre les différents genres d’expressions. »
- « Ici, je pense surtout au grand roman de García Marquez, Un siècle d’isolement. »
- « Le cinématisme est un langage offrant une modalité d’expression très précieuse. »
- « Le cinéaste doit-il résister à des pressions extérieures qui ne peuvent être combattues ? »
- « Quand on lit un livre, on voit beaucoup mieux ce qu’on lit qu’au cinéma. »
- « Comme dit Blanchot, le roman va toujours vers un focus, et c’est au lecteur de chercher ce focus pluriel. »
- « La littérature est née parce que l’œil qui voyait a commencé à écrire. »
- « Les romans, depuis Nathalie Sarraute, vont dans le sens du cinéma. »
- « Le romantisme veut préserver l’amour jusqu’à la mort, comme on le voit dans Tristan et Iseut. »
- « Quand je parle de généalogie, c’est un peu fanfaron de ma part. »
- « Jean-Paul Sartre, dans L’Imaginaire, étudie l’imaginaire. »
- « On sait tous que Proust a produit beaucoup d’images littéraires. »
- « Chez Proust, l’image mentale fonctionne comme un hypotexte mémoratif. »
- « La métaphore de la spatialisation temporelle est dénotée par l’emploi du mot jour. »
- « Cette utilisation du couloir révèle une géographie spatiale à vocation dédalique. »
- « Le travelling est une métaphorisation spatiale de l’image en mouvement. »
- « Ce qui frappe, incontestablement, c’est qu’il y a une heuristique de la coprésence absolument monumentale. »
- « Ce qu’il faut, c’est prendre en compte la situation socio-civilisationnelle – je ne dis pas socio-historique, attention ! »
- « On ne fait pas un film tout seul. On travaille avec des gens. »
- « La littérature, il lui faut au moins deux molécules pour se former. »
- « Bref, pour le dire plus sobrement, la figure du kaléidoscope conjugue les aspects incoatifs et terminatifs. »
Délices de la sémioticité bruélienne
Oui, sur cette photo volée à ma grande surprise, diffusée par des médias internationaux et longuement commentée dans les foyers, l’on constate que, entre deux séances du colloque international sur « Fiction littéraire et cinéma : constantes et mutations dans le monde contemporain », organisé par l’Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts (Beït al-Hikma), j’ai pu, brièvement, me faufiler jusqu’à Sidi Bou Said et son Café des délices afin d’envisager la suite des débats intellectuels, féconds et ô combien enrichissants (gling), avec une manière de recul sociocritique culturellement mieux informé. Devrais-je me justifier de ce souci de contact, de proximité avec la réalité locale ? On croit rêver !