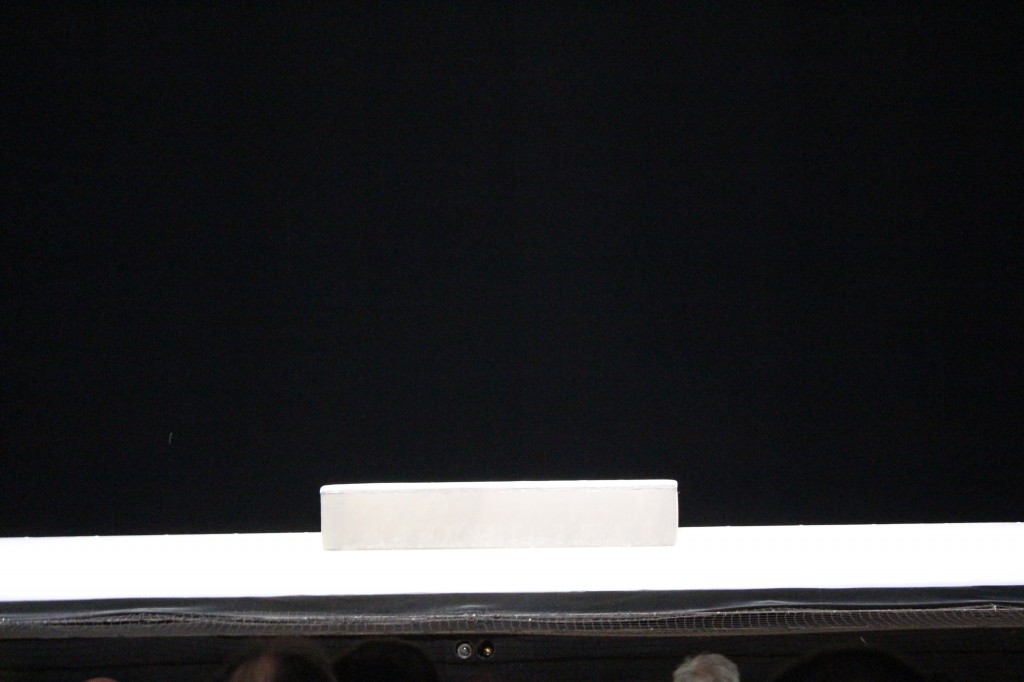Saint-André de Lille, 26 avril 2014
- En bas, un Merklin de choeur. Appelons-le Junior.
- En haut, un Merklin de tribune. Ze boss.
- L’entrée du GO. Pratique même pour Michel Petrucciani. Sinon, baisser plus que la tête. Aïe.
- Pour monter, escalier de bois puis faufilade dans le roc(k). (Ah, précision : aucune métaphore graveleuse n’est autorisée, désolé.)
- … Et de là-haut, on voit ça. En mieux, si on a une bonne vue. En moins bien, si on est à l’orgue. Faut choize.
- La console du grand Merklin. Avec des couleurs très schtroumpf, dans l’esprit, non ?
- Les pédales d’appel à la pelle. Pas facile de ne pas les mélanger. (Non, pas les pelles).
- Franchement, ça crache ou ça crache ? Bon. Quand même.
Mariage joué sur les Merklin de Saint-André de Lille. C’était bien, c’était chouette. Au programme, curieusement : Super Mario Bros 2, Zelda, Atlantys, « Famille » de JJG et « Onde sensuelle » de -M- en écho spatialisé à un duo guitare électrique-flûte. Une expérience digne du marié, Maxime Fontaine, le mec bien secoué qui a écrit la « trilogie d’Ézoah » (Intervista et PKJ) avec moi.
Opéra de Paris, 12 avril 2014 : Tristan und Isolde

Tristan (Robert Dean Smith) et Isolde (Violeta Urmana) dans l’immensité de Bastille. Photo : Josée Novicz.
Qu’est-ce qu’un opéra ? Une pièce musicale chantée ou une œuvre dramatique qui mérite mise en scène, décors et costumes ? La scandaleuse version de Tristan und Isolde, proposée à l’Opéra de Paris pour la vingt-cinquième fois ce samedi, permet de se re-poser la question.
L’histoire : soyons sincères, elle a peu évolué depuis la dernière fois que nous avons applaudi l’opéra. On en trouvera un résumé ici.
La représentation : structurée en trois actes d’environ 1h20′, l’œuvre de Wagner suit une logique claire en trois moments (la traversée pendant laquelle Tristan ramène Isolde et boit la potion d’amour ; la nuit où il se fait gauler pendant qu’il lutine Isolde ; et le jour où il retrouve Isolde qui meurt peu après lui). Cette lisibilité, il est vrai peu dramatique en soi (le second acte est tout intériorité), est anéantie par une absence de mise en scène signée Peter Sellars, qui rend pesant ce qui devrait être claire. C’est d’autant plus cruel pour des acteurs sans présence scénique immédiate, comme Robert Dean Smith, qui a vraiment besoin d’un technicien pour lui donner une épaisseur psychologique qui passe la rampe. Heureusement, pour les amis du n’importe quoi, l’absence de mise en scène – qui n’empêche pas Alejandro Stadler d’être rémunéré, on croit rêver, comme assistant à la mise en scène, le bâtard de sa race – se double d’une absence de décors (hormis un canapé-lit), à peine ornée de dégueulasses vidéos de Bill Viola (la mer pixélisée, un bois, le temps qui passe à la campagne, un barbu et une femme aux seins divergents qui se mettent à poil). Dans la même veine talentueuse, l’absence de costumes est signée Martin Pakledinaz (I et II avec tout le monde en noir, sauf le roi Marke en uniforme militaire ; III avec un peu plus de kaki dans des coupes sans intérêt), et les éclairages de James F. Ingalls, s’ils intéressent le néophyte (wouah ! des éclairages carrés !), sont, comme il se doit, insuffisants pour permettre de bien distinguer les héros – ce qui permet au contraire de bien valoriser les vidéos qui ne peuvent qu’inciter au meurtre de Bill Viola, le « vidéaste » fût-il simultanément l’invité du Grand Palais.
Cette colère, que l’on avait anticipée pour avoir été suffoqué d’indignation après la représentation du 3 décembre 2008, est d’autant plus justifiée qu’elle s’appuie sur une interprétation extraordinaire. L’orchestre, dirigé par Philippe Jordan, commence certes le premier prologue sans entrain ; il va cependant se révéler dynamique, puissant et assez souple pour accompagner pleinement les chanteurs. La spatialisation de la musique (solistes lyriques et Christophe Grindel au cor anglais sévissant parfois du balcon) est plutôt une bonne idée pour investir le gros opéra Bastille, mais l’essentiel de la soirée repose sur les chanteurs. Certes, ce n’est pas la première fois que l’on est subjugué par ceux qui « peuvent » chanter cette pièce : ainsi, en 2012, Lioba Braun campait une Isolde bouleversante au Théâtre des Champs-Élysées. Cette fois, le duo du titre est formé par Violeta Urmana et Robert Dean Smith, et il est vocalement extraordinaire.
La Urmana, très attendue dans un lieu qu’elle connaît bien, sidère par une maîtrise technique doublée d’un art peu commun de faire passer les sentiments. Être conscient des difficultés dont la partition est hérissée ne prémunit pas contre l’admiration pour les prouesses esthétiques plus que physiques dont cette petite bonne femme est capable. C’est fait, c’est bien fait et c’est joliment fait. Malgré les conditions scéniques déplorables, la chanteuse saisit son public, le secoue dans les longs tunnels du II (duos vivants avec Janina Baechle en Brangäne austère) et l’emporte par un dernier air aussi macabre qu’impeccable. Mêmes bravos pour Robert Dean Smith. Son rôle est écrasant, et sa voix n’est pas ménagée, mais l’homme n’en a cure. Il se balade techniquement, et opte pour une double bonne idée : un, assumer le fait que, sans mise en scène, rien ne sert d’en faire trop en tant qu’acteur (de toute façon, c’est mort) ; deux, mieux vaut faire passer l’émotion par la musique, comme s’il s’agissait d’un opéra de concert, que de courir après une expressivité ici bannie. En décidant de ne pas lutter contre sa prestance de, curieusement, gentleman anglais, l’artiste concentre toute l’attention sur sa ligne vocale : souffle, aigus de parade, tessiture de rêve, constance et musicalité sont remarquables de bout en bout. Autour de ces phénomènes, que du bon et même parfois de l’excellent : on salue le Kurwenal très expressif de Jochen Schmeckenbecher – même si, scéniquement, il en fait un peu beaucoup ; et on applaudit Franz-Josef Selig avec un König Marke superlatif dans la mesure où il permet d’apprécier, malgré la brièveté du rôle, l’exceptionnelle résonance de ses basses et la puissante évidence de sa tristesse intériorisée.
En conclusion, on ne peut que trouver lamentable le fait de confier un tel opéra à des personnages aussi peu artistes et respectueux du public que Peter Sellars, à vomir avant de lui défoncer la face à coup de roche rouillée, si c’est possible, et Bill Viola, à trucider aussi lentement que sûrement. Ce nonobstant, on se réjouit d’avoir vaincu l’horreur inspirée par de tels arnaqueurs, afin d’applaudir la virtuosité et le talent de chanteurs à la hauteur, eux, d’une partition efficace et puissante.
Chanson indus’
 Samedi, en bon invité industriel, je chanterai une petite heure « dans un décor à l’esprit loft », ni moins ni encore moins, avant François Marzynski et son incrédébile guitariste Jean-Marc Boël. Compter sur votre soutien pétaradant serait limite foisonnant. RDV à L’Industrie. Inscriptions possibles sur Facebook pour le plaisir d’encourager le monde.
Samedi, en bon invité industriel, je chanterai une petite heure « dans un décor à l’esprit loft », ni moins ni encore moins, avant François Marzynski et son incrédébile guitariste Jean-Marc Boël. Compter sur votre soutien pétaradant serait limite foisonnant. RDV à L’Industrie. Inscriptions possibles sur Facebook pour le plaisir d’encourager le monde.
Cité de la musique, 25 mars 2014 : « Momente » de Karlheinz Stockhausen
Et si musique quasi contemporaine et moment de jubilation sonore n’étaient pas contradictoires ? Pour les sceptiques, la Cité de la musique programmait les Momente de Karlheinz Stockhausen ce 25 mars. Nous y étions.
Originellement composé en 1962, révisé en 1972 pour la version donnée ce soir-là, Momente se présente comme une manière de cantate profane ou presque. L’instrumentarium articule des cuivres (quatre trompettes, quatre trombones graves), trois percussions, deux claviers électroniques type Hammond, un chœur mixte organisé en quatre groupes, une soprane soliste et une régie sonore plutôt discrète. Le texte ondule autour du « Cantique des cantiques », tantôt cité textuellement, tantôt sectionné, tantôt repris ironiquement, tantôt mêlé à d’autres bribes de texte. D’emblée, la question est posée par la soliste, seule en scène avec les claviéristes et les percussionnistes : de quoi c’est-il qu’il s’agit de ? Cette interrogation va irriguer l’ensemble de la pièce, construite en deux mouvements d’environ une heure.
Stupéfiantes, les quarante premières minutes clouent le spectateur non averti à son fauteuil : mise en scène et en lumière du son qui envahit l’espace, travail sur les dialogues entre soliste et tutti, découverte des possibles orchestraux et choraux (note, durée, déformation, son brut, voix parlée dérapant dans le chant, ensemble superbe subverti par une voix amplifiée, percussions manuelles ou frappées par des non-spécialistes…). Puis le compositeur se concentre sur son matériau et semble rejeter ses effets liminaires pour triturer l’aspect percussif du chœur (claquements, frappements, modifications des voix, souffles…). Des effets de nuances saisissants paraissent accélérer le temps jusqu’au vertige précédant la mise en abyme qui annonce l’entracte : le chef dirige les applaudissements et les pouët-pouët des cuivres pendant que les artistes s’applaudissent eux-mêmes pendant trois bonnes minutes. Ce pourrait être risible ou pseudo-conceptuel : c’est à la fois drôle et puissant, car, par-delà les enjeux formels insaisissables par le profane, l’ironie prolonge l’interrogation liminaire : de quoi s’agit-il ? qu’est-ce que la musique ? qu’est-ce que la représentation du son ? pourquoi sommes-nous ici ce soir ?
En miroir, après un entracte revigorant, la seconde partie s’ouvre sur une scène similaire à celle qui clôturait la première. Et la petite heure qui suit est l’occasion pour le compositeur d’explorer, à travers des textes qui s’entrecoupent et des techniques musicales qui se superposent, différentes façons de susciter le son et l’émotion de l’auditeur. Jouant parfois de l’harmonie chorale, parfois de la fureur cuivrée, parfois de l’art des percussions (le gros gong est travaillé, les claviéristes se mettent à leur tour à sévir sur les instruments supplémentaires qu’ils doivent manipuler), alternant effets de synchronisation et dissociations spatialisant le son de façon acoustique (chaque groupe de musiciens intervenant en décalé, avec à l’occasion des parties dissociées à l’intérieur même des blocs choraux), la composition de Stockhausen, portée par la direction intense du compositeur Peter Eötvös, palpite et frémit, emportant l’adhésion d’une Cité de la musique très remplie pour l’occasion.
En conclusion, un WDR Rundfunkchor de Cologne attentif et talentueux (chaleureuses basses, beaux ensembles des voix de femmes), une soliste précieuse et multifacette (Julia Bauer) sachant parler et chanter jusque dans de redoutables pianissimi suraigus, des cuivres précis, un chef aux petits soins et un claviériste boudeur (apparemment déçu de sa prestation, Dimitri Vassilakis a refusé de se lever pour saluer), ont joliment mis en valeur une œuvre ambitieuse et stimulante. En un mot comme en moult davantage : youpi.