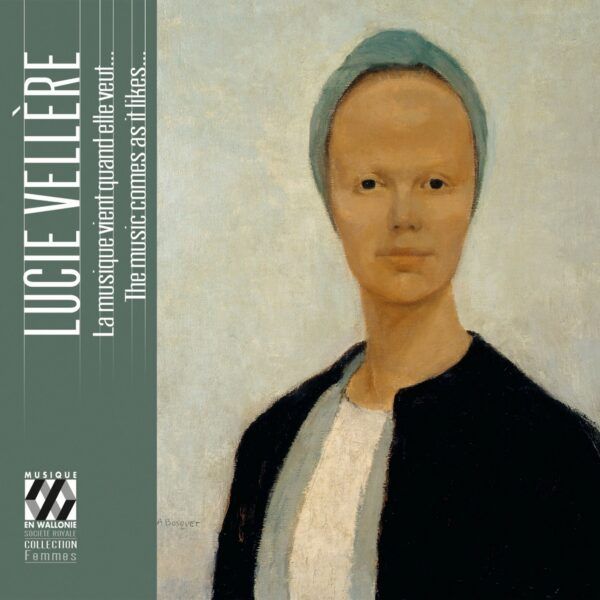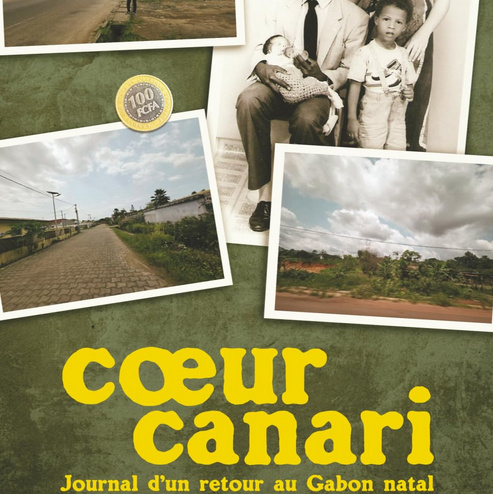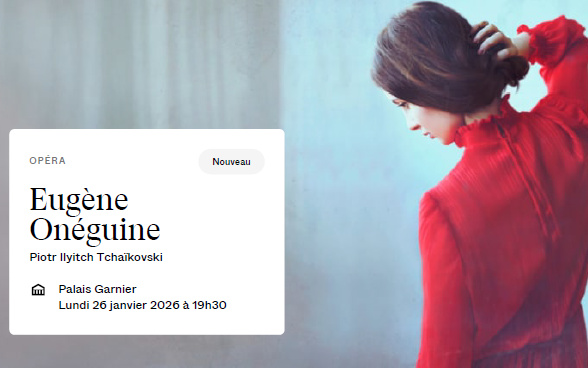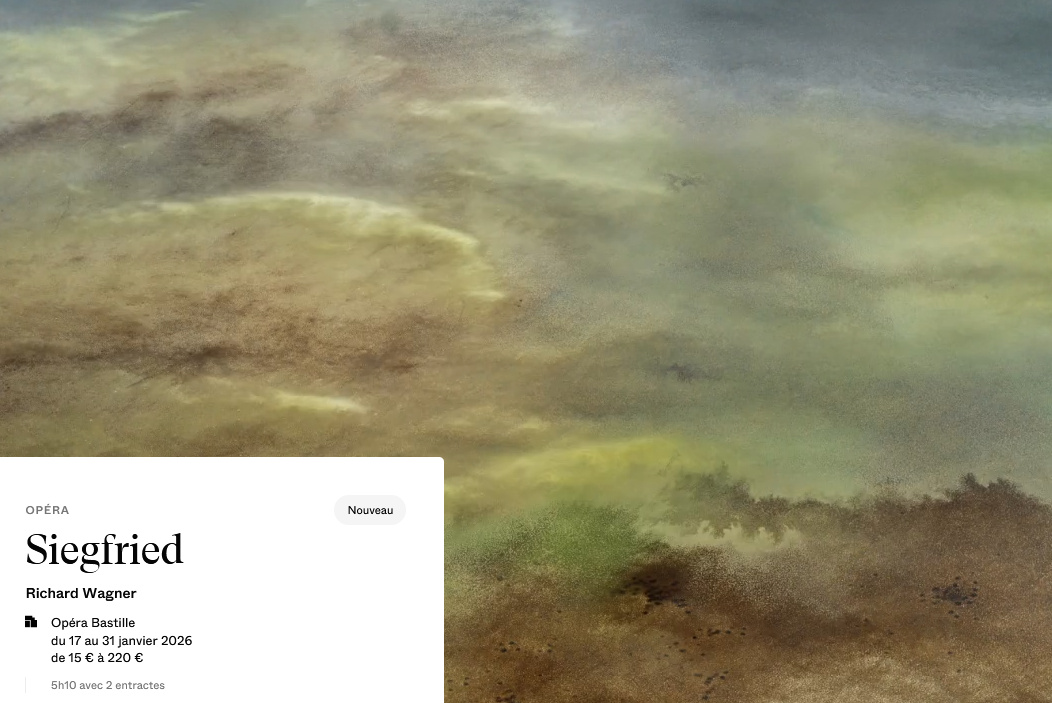Avant de suspendre ce blog le temps de finaliser la préparation d’un double récital de chansons, bouclons l’épopée avalinienne, commencée ici et continuée là. Nous nous sommes quittés en pleine série de nocturnes. Le troisième sur la liste (nous croyons reconnaître l’opus 27 n°2 en Ré bémol), évoque une nuit
- paisible, comme libérée du joug du jour,
- silencieuse, comme si la musique prolongeait le silence et non l’inverse, et
- frémissante, comme si, derrière l’immobilité apparente, d’imperceptibles mouvements continuaient d’agiter les vivants endormis et leurs frères défunts.
Quatrième sur la set-list, l’opus 37 n°1 en sol mineur n’est pas moins évocateur. Interprété avec la profondeur caractéristique d’Irakly Avaliani, il inspire un sentiment moins de fatalité que
- d’abandon presque léger,
- de pragmatisme assumé et
- de sourire triste.
Pour posé qu’il soit, le jeu demeure prompt à
- assumer sa versatilité (traits éphémères),
- s’envoler (euphorie des trilles hésitantes), et
- s’incarner (science du ritendi qui ne défluidifie – et hop – pas le rythme).
Le dernier nocturne au programme exprime à son tour
- une langueur hypnotisante,
- un engourdissement de la psyché qui semble çà et là lutter contre lui-même, et
- un effacement qui paraît, in fine, s’accepter.
La confrontation de multiples manières de traiter le clair-obscur, y compris avec des résonances étonnantes (par exemple entre le deuxième et le cinquième nocturnes) renforce l’intérêt de cette suite de nocturnes concoctée par le concertiste. Il montre avec habileté comment, derrière le titre générique de « nocturnes », se cachent différentes formes de ballades qui sont autant de balades intérieures où se fondent, dans un même creuset labyrinthique,
- les états d’âme du compositeur,
- l’art de l’interprète et
- les pensées batifolantes de l’auditeur-spectateur.
Le récital s’achève officiellement sur la polonaise opus 53, comme si Irakly Avaliani avait décidé de secouer son auditoire en s’offrant enfin une excursion dans le registre héroïque jusqu’ici gardé en réserve. Voici venu un nouveau moment « vous êtes bien sur Radio Classique » avec ce golden hit des pianistes qui savent envoyer
- le pâté,
- les cornichons et
- la quille de rouge.
Toutefois, le colosse géorgien évite la démonstration rutilante de virtuosité donc le gigotage intempestif de saucisses réservé aux clients d’une croisière premium « Sur les pas de George Sand », émoustillés de reconnaître un truc qui leur dit quelque chose. Il nous est rappelé par le son que, si cette musique est connue, ça reste de la musique. Aussi Irakly Avaliani distille-t-il
- de la rigueur dans l’échauffement,
- de la netteté dans l’embrasement, et
- de la maîtrise dans l’éclatement.
Les amateurs de kitsch coupable en seront pour leurs frais. Point
- de crescendi vulgaires,
- de sentimentalisme envahissant ou
- de digitalité tapageuse.
La maison ne mange pas de ce pain-là. Au contraire, le geste musical
- construit une marche solide,
- pose des octaves fermes et
- assume l’efficience motorique des accords répétés.
Cette poétique décidée ne rend que plus savoureux le contraste avec
- les arabesques,
- les trilles et
- les atermoiements
- mélodiques,
- rythmiques et
- thymiques
qui animent la section suivante. Démonstration que, pour évoquer
- les tourments d’une sensibilité,
- la grandeur d’un peuple (à ses yeux, forcément) et
- les ondulations de l’humeur,
le cinéma est souvent superfétatoire : souvent, la musique suffit… mais à condition d’être en quantité suffisante. Or, la tradition exige qu’un concert n’est jamais fini quand il est fini. Irakly Avaliani accède à la demande des fans et claque l’indispensable bis.
En guise de péroraison, il a choisi le tubesque impromptu de Franz Schubert opus 142 n°2 en La bémol qui, par-delà le plaisir que suscite la réécoute de cette œuvre saisissante, est ici mis en scintillements – je tente l’expression – par l’équilibre que trouve l’interprète
- entre retenue captivante,
- indispensable potentiel martial et
- calme habité que les passages plus agités ne désamorcent jamais longtemps.
Le triomphe qui salue la performance et traduit l’émotion conclut le récital avec la ferveur qui s’imposait.
Pour retrouver nos 58 chroniques précédentes sur Irakly Avaliani, c’est ici.