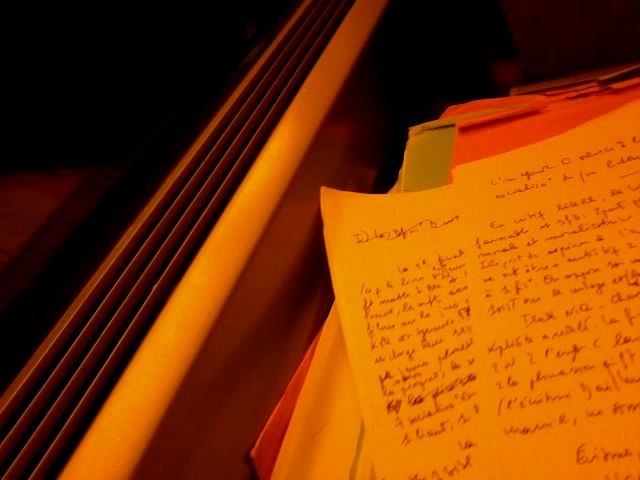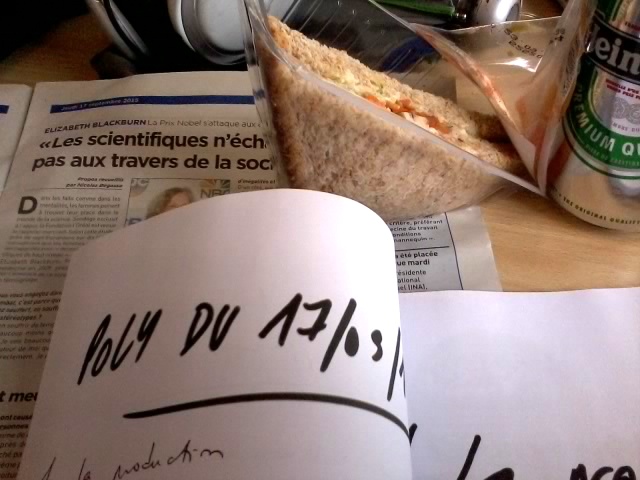Je reprends les Rennes
Sept ans que Catherine Daniel, Solenn Dupas et Jean-Paul Thomas m’invitent à faire souffrir les étudiants de l’UFR ALC de Rennes-2 en leur dévoilant les bûûûleverserants secrets de l’édition pour la jeunesse. Quitte à me lever à 04:30, je dis oui, merci.
L’important, c’est l’or-ga-ni-sa-tion (surtout pour le repas de midi).
Les étudiants sont sympa, parfois même mignons, quasi toujours tranquilles. Mais frémissant est aussi le TGV du retour, quand t’es seul ou quasi seul dans le demi-wagon de tête, et que tu kiffes la vaillebe en sirotant une banane dans l’édition de la Pléïade. Genre : YOLO, et Vian (comme l’eau, quasi).
Si ça s’trouve, quand le train s’arrête, tu pourrais même faire des photos stupéfiantes sans savoir comment.
D’où la question finale : est-ce que tu ne te la pètes pas un p’tit peu trop, you Bewtwand Fewwier ?

Le Freischütz, Théâtre des Champs-Élysées, 14 septembre 2015

De gauche à droite : Yorck Felix Speer (Kouno), Christina Landshamer (Annette), Nikolai Schukoff (Max), Véronique Gens (Agathe), Dimitry Ivashchenko (Gaspard), Miljenko Turk (Ottokar), le consternant Graham F. Valentine (récitant) et Franz-Josef Selig (l’Ermite). Photo : Bertrand Ferrier.
Aller voir un opéra en « version de concert » a, a priori, un côté rassurant : au moins, suppute-t-on après quelques expériences attristantes, la mise en scène ne parasitera pas l’œuvre. Erreur ! Il existe des astuces pour gâcher une représentation musicalement de bon aloi. Illustration, ce 14 septembre, avec la production du Freischütz donnée au « TCE », annoncée en rediff sur France Musique le 10 octobre à 19 h.
L’histoire : un concours de tir met la pression sur Max. S’il ne vise pas bien demain, il n’épousera pas Agathe, sa promise. Pour mettre toute chance de son côté, il accepte de vendre son âme au diable grâce à l’intercession de Kouno, jaloux du futur mari et pressé de négocier un sursis avec Samiel-le-diable moyennant une âme (acte I). Pendant qu’Agathe s’impatiente et déprime tour à tour, près de sa proche parente Annette, Max rejoint le lieu terrifiant où seront forgées ses munitions miraculeuses (acte II). Le lendemain, Max tire sur commande… mais, alors qu’Agathe s’effondre, trop stressée, la balle touche et tue Kouno. Un bannissement est prononcé, mais l’Ermite lui substitue une mise à l’épreuve d’un an, et tout finit donc presque bien (acte III). Le tout est distribué en deux parties d’une heure séparées, youpi, par un entracte, ça compte aussi.
La particularité : celui qui n’aurait pas un p’tit peu bossé son synopsis voire son livret avant la représentation n’a aucune chance de comprendre l’histoire, déjà passablement tortueuse. Pas parce qu’il est imprévoyant donc sot : juste parce que, pour cette série de représentations (deux exécutions viennent de résonner à Hambourg), « les dialogues parlés sont remplacés par un texte de Steffen Kopetzky dit par Samiel ». Ce texte, en français s’il vous plaît, intercalé entre les airs voire au milieu des chansons (à part pour prouver sa bêtise, pourquoi gâcher le Volkslied des demoiselles d’honneur, au troisième acte ?), est d’abord une paraphrase verbeuse, aux tendances pseudo-poético-philosophiques, autour du Mal et des tentations de l’homme, puis, le temps passant, une manière de résumé libre. Il est interprété par Graham F. Valentine, coiffure de clown entre Gauthier Fourcade et David Sire sans le talent des zozos cités, prononciation grandiloquente, parfois hésitante, associant sporadiquement les « r » roulés et les « r » pas roulés. En attendant, c’est le spectateur qui se sent roulé car, sans les dialogues parlés et avec cette verrue logorrhéique moderne, l’opéra ressemble à une succession d’airs de concert dont on ne perçoit ni la cohérence, ni les enjeux dramatiques – pour un opéra, c’est quand même un chouïa gênant.

De gauche à droite : Christina Landshamer, Dimitry Ivashchenko, Nikolai Schukoff et Miljenko Turk. Photo : Bertrand Ferrier.
L’interprétation musicale : la partition, variée, luxuriante, oscille entre l’art mozartien, le plaisir du folklore, la puissance émotionnelle de l’orchestre romantique et même des promesses presque wagnériennes. En prime, elle met en valeur nombre de pupitres de l’orchestre (notamment cors, bien sûr, clarinette, violoncelle, alto mis en scène pour la romance d’Annette au III…), et chaque musicien y tient vaillamment sa partie, ce soir-là. Ainsi, après un premier départ peut-être légèrement asynchrone, les cors font montre d’une justesse et d’une constance irréprochables. Thomas Hengelbrock, même s’il commence un peu mollement à notre goût, assure par la suite une direction qui rend raison des diverses humeurs parcourant la partition. Le talent des solistes finit d’emporter l’adhésion ; et cette remarque vaut aussi pour le chœur, dont on apprécie les nuances, la force lorsque nécessaire, la justesse y compris dans les passages tendus, et la variété des voix qui chantent en solo.
Le plateau vocal : aucun chanteur n’est hors de propos ou hors de forme ce 14 septembre, même s’il nous a semblé entendre parfois un allemand exotique (comme nous ne sommes pas germanophone, c’est sans doute une illusion de snob). Franz-Josef Selig, spécialiste des rôles brévissimes, vient jouer les utilités de luxe à la toute fin de la pièce, impressionnant par ses graves parfaits et son médium rond, en dépit d’un vibrato que nous-petit-spectateur aimerions un poil moins relâché et envahissant. Cependant, les vedettes annoncées sont à chercher du côté de Max et Agathe, les futurs époux. Nikolai Schukoff, quoique un peu stressé sur la fin (il revient à la partition dont il n’avait pas fait usage avant la seconde partie), manque peut-être en concert du charisme qui incarnerait son personnage et séduirait pleinement ; cependant, il propulse avec savoir-faire un timbre clair, une voix sans fatigue et une unité de sonorité sur toute sa tessiture. Véronique Gens propose une Agathe très intérieure. Aucun reproche vocal ne paraît pertinent, mais l’on aurait aimé l’entendre parfois libérée, afin de mieux rendre raison, à notre point de vue, de l’étendue et de l’intensité des émotions qui habitent son personnage, tout nunuche soit-il. Yorck Felix Speer coule son Kouno dans un monolithe grave, où la précision de la voix étouffe parfois la force dramatique qu’on attendrait du personnage. Miljenko Turk, le beau gosse du lot, impressionne quand il saisit en volant le sceptre d’Ottokar : du souffle, de la constance sur ce bref rôle, mais une agaçante maladresse scénique à sembler attendre des bravos dès qu’il ferme la bouche – alors qu’il joue le prince régnant, personnage ferme qui n’a pas besoin de l’approbation de ses sujets. Restent les deux chanteurs qui nous semblent les plus impressionnants ce soir-là : Dimitry Ivashchenko campe un Gaspard à la fois humain et trrrès maléfique, profond à souhait, comme il sait si bien faire ; et Christina Landshamer rayonne en Annette déchaînée – belle voix et jolie présence scénique donnent envie de la revoir tantôt pétiller sur scène car, devant son interprétation d’Annette, on se lève tous pour elle (pas pu m’en empêcher, même pas désolé).
En bref, beau concert, superbe musique, mais haro sur la pseudo-créativité stupide du « texte nouveau » dans lequel on ne saurait trop blâmer les producteurs d’avoir investi.
J’étais à (Radio) Notre-Dame
Et pour les gourmands férus de mp3, voici le podcast de l’entretien mené par Juliette Loiseau sur Radio Notre Dame, à propos de L’Homme qui jouait de l’orgue…
Comme un insecte fou
Entrer dans la lumière d’une répétition technique pour le concert du 18 septembre au Magique : check. Quelques places encore disponibles ici !
Christian Camerlynck, Théâtre de l’île Saint-Louis, 5 septembre 2015
Christian Camerlynck, interprète de chanson « à texte », est en concert jusqu’au 20 septembre au Théâtre de l’Île-saint-Louis (Paris 4). Nous allâmes l’applaudir à sa première. So what?
En présence d’Anne Sylvestre, ce n’est pas rien, et même d’Éric Nadot, côté « personnalités du monde de la chanson », Christian Camerlynck attaque son tour de chant au côté de Nathalie Fortin, sa pianiste, en feuilletant silencieusement un album (photo mais pas que). Sur scène, un piano recouvert de tissus et d’un bocal feat. Sushi le poisson orange. Deux sièges, une table et trois sculptures, dont une amovible, scandant le visage de l’interprète, complètent le décor.
Le récital, d’une durée totale d’une heure trente, s’articule autour de longues séquences (entre 20’ et 30’) tuilant chansons et textes dits, dont auteurs et compositeurs éventuels seront dévoilés a posteriori aux spectateurs. Au programme, notamment : moult Jacques Debronckart, quelques pincées de Ferré voire de Caussimon (« Le temps du tango », « Le funambule »), la dose convenable de Québécois (« En attendant l’enfant » et « La vie » de Leclerc, ainsi que « C’est le temps », si typique de Vigneault), trois cuillerées d’Anne Sylvestre, du Romain Didier – pas le plus connu – et une goutte d’espagnol, façon Juliette. L’assemblage, sur une même set-list, de ces chansons dessine un paysage intérieur propre à Christian Camerlynck. Ceux qui espèrent du facétieux et du brillant en seront pour leurs frais : sans que l’on s’ennuie une seule seconde, grâce à la personnalité de l’interprète, ici il s’agit plutôt de poésie et de portraits saisissants (« Je suis comédien », si joliment proche et différente du « Mort de théâtre » de Jehan Jonas) que de chansons-à-chutes. Grâce au chanteur, on redécouvre le plaisir de la description et de l’évocation, sans que cela exclue ni un p’tit focus sur la cause homosexuelle (adaptation à la première personne de « À quoi ça tient » de Romain Didier) ni un accent mis sur le féminisme mondialiste d’Anne Sylvestre, la chanteuse pas si dégagée que ça (« Une sorcière », « Les dames de mon quartier »).
La représentation est digne d’une première : elle est brute, avec ses immédiatetés, ses fulgurances, ses inquiétudes suscitant bégaiements et « trous » inhabituels (celui qui n’a jamais chanté n’a jamais eu de « blancs », c’est certain !), ainsi que ses transitions pas encore fluides. Rien de rédhibitoire, puisque c’est du spectacle vivant et que l’ensemble se tient avec dignité. Pour tout dire, on apprécie l’authenticité de l’interprétation, la maîtrise de la voix – serrée au début, s’élargissant petit à petit, s’épanouissant sur la fin –, la sûreté du piano – hélas terriblement faux et malsonnant. Regrette-t-on la surcharge d’une mise en scène inégale, parfois too much (début « dramatisé » pendouillant un brin car non exploité par la suite), peu claire (sortie du chanteur par la salle à 1 h 25’) et guère utile dans un petit théâtre ? Se dit-on que les chansons encore en chantier, qui nécessitent un prompteur acoustique dans le ventre voire le bidon mou du milieu, n’étaient peut-être pas utiles ? Pense-t-on que, même si c’est sans doute un problème de temps et de budget, de vrais arrangements auraient mieux servi les plus belles chansons, au lieu d’un accompagnement valeureux mais parfois sans grande imagination et peu contrasté (l’usage sporadique de percussions, mignon, ne suffit pas à illuminer le projet musicalement) ? On mentirait en disant le contraire.
Reste que, en l’état, Christian Camerlynck propulse 90’ de chansons intelligentes, choisies selon ses goûts, évidemment vécues, qui valent que l’on fasse abstraction de l’excès d’apparat qui les entourait à la première. La fragilité, liée probablement à l’ambition du projet, qui transparaît à certains moments (le squizz sur « La religion », chanson guère difficile et si souvent chantée par l’artiste, en est un exemple) souligne la solidité du reste : le répertoire, l’audace de mettre en scène de la chanson ambitieuse dans un théâtre parisien, et l’envie de partager des émotions de musique populaire mais pas conne. En d’autres termes, si le critique autoproclamé ne peut pas ne pas pointer ce qui, bientôt, sera amélioré ; si le chanteur pas professionnel compatit aux petites échardes du soir (étrange comme on se souvient toujours mieux de la p’tite couille que du potage…), incitant l’artiste à présenter in fine, avec humour, cette représentation comme un « premier filage » ; le spectateur, lui, se réjouit avec force d’une soirée singulière, en rien compassée ou surannée, donnée dans une étonnante petite salle du bord de Seine par un artiste septuagénaire qui adresse ainsi joli doigt d’honneur à la raréfaction, euphémisme, des interprètes. Dans la catégorie des gens qui sont soi avec les mots de tant d’autres, aux côtés du virtuose VF Trio – passé, comme la star du jour, par les fourches caudines de KissKissBankBank, Christian Camerlynck perpétue une convaincante tradition d’intelligence poétique et musicale, plus qu’éloignée : à l’opposé du business de la reprise opportuniste. Si, vous savez, cette astuce pratiquée par les charognards qui se jettent sur le répertoire des morts célèbres (pour une Marie-Paule Belle réinvestissant Barbara, combien d’arrivistes alignant les tubes de la dame en noir, poses en sus ? et combien de hyènes, parfois très talentueuses, ont-ils pas improvisé des spectacles estampillés « Allain Leprest » pour transformer sa mort en filon ?) ou des pas-encore-morts-mais-bon-on-sait-jamais (Anne Sylvestre en fait l’expérience, et ça va pas s’arranger).
Voilà, c’est dit.
En résumé, une soirée originale avec de belles chansons dedans, ça fait une belle sortie. Avis aux amateurs !
Du 5 au 20 septembre. Christian Camerlynck, accompagné par Nathalie Fortin. Théâtre de l’île Saint-Louis / Paris 4 / Rés. : 01 46 33 48 65 / Prix : 15 €.