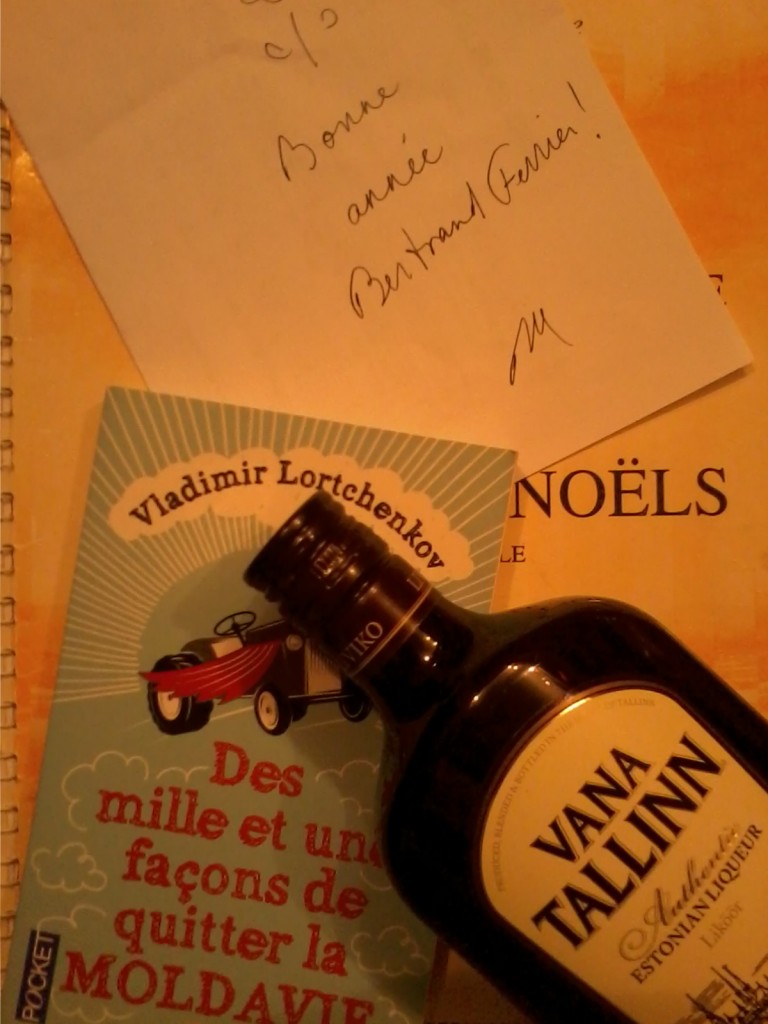Lard content pour un
 Signez Kristian Goltanski, qui est à Christian Boltanski ce que le Butella est au Nutella. Appelez ça « Promenade expérimentale dans la nuit des hommes ». Faites payer huit euros l’entrée. Éteignez les lumières et conduisez les visiteurs par la main, après leur avoir expliqué qu’ils allaient voyager dans les heures les plus sombres de notre sinistre mémoire. Bingo.
Signez Kristian Goltanski, qui est à Christian Boltanski ce que le Butella est au Nutella. Appelez ça « Promenade expérimentale dans la nuit des hommes ». Faites payer huit euros l’entrée. Éteignez les lumières et conduisez les visiteurs par la main, après leur avoir expliqué qu’ils allaient voyager dans les heures les plus sombres de notre sinistre mémoire. Bingo.
Théâtre de l’Odéon, « Richard III », 14 janvier 2016
 Étrange est Richard III version Odéon 2016. Emporté par la Piccola Familia de Thomas Jolly, la pièce de William Shakespeare frappe par son alternance entre moments de grâce, de virtuosité et de lourdeurs.
Étrange est Richard III version Odéon 2016. Emporté par la Piccola Familia de Thomas Jolly, la pièce de William Shakespeare frappe par son alternance entre moments de grâce, de virtuosité et de lourdeurs.
L’histoire : après que les contrées de York et de Lancastre se sont fracassées, Édouard IV, apparemment tuberculeux, a accédé au pouvoir. Las, l’ambition qui taraude Richard, noble estropié, pousse ce triste pas-encore-sire à assassiner et à faire assassiner à tour de bras. Avec succès : il obtient (presque) toutes les femmes qu’il veut, et il finit par être propulsé roi à la demande tout à fait spontanée du peuple et des autorités (2h15’). Deux ans plus tard, c’est chaud. Les trahisons se multiplient, la révolte grogne, et Richard doit affronter la bande emmenée par son ennemi Bosworth, qui a fédéré les coléreux. De cette ultime grande battle, le King ne sortira pas vainqueur (1h35’).
Le spectacle : plateau vide, teintes noires, praticables escamotables, paravents amovibles portraits royaux montant jusqu’aux cintres quand le rideau le veut bien… Thomas Jolly, acteur vedette, metteur en scène, scénographe et co-adaptateur de la pièce, ne s’embarrasse pas de falbalas historisants. Dans une ambiance sombre, son personnage se démène énergiquement avec sa patte folle, son manteau de plumes et son bras desséché, entouré d’intrigants plus ou moins ambitieux, dont certains semblent soucieux de prononcer comme des Grands Acteurs Français, avec par exemple cet insupportable sossottement pédant qui fait sooo, voire sot, théâtre français – la mère du monstre sosotte, elle, pour de vrai semble-t-il. Comme dans les mauvais films, une musique simpliste, une sono (réverb’, écho, hachures…) et un éclairage jouant un rôle de personnage surlignent les moments dramatiques, à croire que Thomas Jolly n’avait pas confiance dans son propre choix, cliché tant il est répandu mais choix tout de même, visant au dépouillement. Cette automéfiance est regrettable car, sans les ajouts, on pourrait applaudir, entre autres : 1) l’adaptation du texte, assez convaincante pour laisser un p’tit passage freestyle point trop envahissant à la fin de la première partie, avec faux Michel Fau inclus ; 2) l’envie de traduire scéniquement, en dépit de la stéréotypie de cette économie, la vacuité de ces pantins nobles se déchirant façon Dallas sur une scène remplie uniquement de vide, de rideaux masquant et, sporadiquement, d’écrans de vidéosurveillance ; 3) le néant des jeux de pouvoir, que la pièce s’amuse à démystifier à force d’en détailler les sordides ressorts. En optant pour des coups de Stabylo-Boss fréquents, le metteur en scène semble porter sur le théâtre ses propres doutes – compréhensibles, vue l’ambition vertigineuse de la pièce, mais peu touchants sous cette forme.
 Cette hésitation contraste avec le personnage de Richard III, pour lequel Thomas Jolly pousse le « lorenzaccisme » jusqu’au bout, pulsions homos incluses (il aime embrasser les hommes sur la bouche), et paraît inciter ses nombreux comparses à quasi surjouer leurs états d’âme. Hélas, si l’on apprécie le duc de Richmond (Mohand Azzoug) pour sa relative sobriété, rares sont les comédiens qui évitent d’en faire trop, trop, trop. Ainsi, parmi les sosotteurs fanatiques, on remarque un des principaux fidèles, un hyperexpressionniste de type asiatique, ce qui surprend les moins benettons d’entre les spectateurs – c’est raciste ? montrez-moi un yakuza « de type caucasien » dans un film japonais, sans que cela surprenne, et on en reparle.
Cette hésitation contraste avec le personnage de Richard III, pour lequel Thomas Jolly pousse le « lorenzaccisme » jusqu’au bout, pulsions homos incluses (il aime embrasser les hommes sur la bouche), et paraît inciter ses nombreux comparses à quasi surjouer leurs états d’âme. Hélas, si l’on apprécie le duc de Richmond (Mohand Azzoug) pour sa relative sobriété, rares sont les comédiens qui évitent d’en faire trop, trop, trop. Ainsi, parmi les sosotteurs fanatiques, on remarque un des principaux fidèles, un hyperexpressionniste de type asiatique, ce qui surprend les moins benettons d’entre les spectateurs – c’est raciste ? montrez-moi un yakuza « de type caucasien » dans un film japonais, sans que cela surprenne, et on en reparle.
Regrettons surtout la direction des actrices, contraintes de s’adonner à des pantomimes et des lamentations que l’on aurait pu rendre plus émouvantes en glissant çà et là un peu de sobriété dans cet étalage d’excès. En jouant toutes larmes dehors, ces dames annihilent toute possibilité d’expression et lassent fortement, surtout en seconde partie. On veut presque bien admettre que l’hyperémotivité ainsi étalée évoque ou des personnages proprement hystériques à force de vivre près d’un psychopathe, ou la facticité d’un système politique quand il est fondé sur la veulerie, la lâcheté et l’envie ; on craint toutefois que ce soit trop d’honneur pour un choix d’interprétation qui ne nous a guère séduit. Peut-être notre scepticisme est-il aussi motivé par le fait que les monologues qui pullulent vers la fin de la pièce nous ont semblé sonner faux, non par la facticité de la situation, mais par le manque de conviction des acteurs quand cessent les artifices lumino-musicaux et qu’ils se retrouvent empêtrés dans un silence dont ils ne savent que faire. Par pitié, enfin, nous ne signalerons presque pas les insupportables enfants à GameBoy, têtes à claque criant un texte qu’ils ne comprennent visiblement pas, sans que l’on soit convaincu, euphémisme, que cette récitation stupide vise à mimer la fabrication des jeunes élites manipulées par les adultes et incapables de comprendre ce qui se trame autour d’eux.
Disons-le avec clarté : l’ensemble de la pièce est enlevé, mené avec une efficacité certaine, et les quatre heures vingt (avec entracte de demi-heure) passent comme un choral de Brahms sous les doigts de François Ménissier. Et cependant, d’autres aspects encore déçoivent franchement. La fin de la première partie, par exemple, est pitoyable, avec une effarante chanson technoïde propulsée façon rockstar par un Richard III, entre Mercury et Bowie, entouré de Clodettes (« I’m a dog, I’m a toad, I’m a hedgehog, I’m a monster »). On veut bien, parce que l’on essaye de comprendre malgré tout, que cela tende à montrer la dimension entertainment et manipulatrice du pouvoir ; mais, d’une part, ça ne marche pas tant que ça (une large partie du public est, avec lucidité, consternée par cette nullité) ; d’autre part, on ne sent pas les acteurs totalement à l’aise ni avec cette excroissance, ni avec la tentative de semi-interactivité qui a précédé, même si se faufile, dans le principe de la fin chantée, un hommage à Olivier Py-miss Knife (et, par exemple, ses interludes type Cantique de Jean Racine aux entractes du Soulier de satin). Ce passage semble surtout l’opportunité, pour le metteur en scène, de jouer les chanteurs et, bonheur suprême, de faire entrer en scène un homme, déguisé en sanglier, qui montre son cul juste avant l’entracte, histoire de montrer que, quand il veut se la ouèj, il prend plutôt les spectateurs pour des anus que pour des cons.
Ajoutons à ces regrets d’étranges perruques façon Crazy Horse qui affublent personnages secondaires et jeunes princes, des pancartes qui surtitrent les moments-clés aussi inutilement qu’un pétomane nauséabond signalant qu’il a dégazé, un attristant final additionnel avec poudre rouge et aimants pour dessiner le mot fin, et un cheval en plastique censé, suppose-t-on, symboliser la facticité de la scène de guerre, bâclée, afin de rappeler que la politique n’est que théâtre de piètre qualité. De la sorte, notre lecteur aura une idée de quelques-unes de nos perplexités, nourries par l’ambition qualitative qui irrigue pourtant l’ample représentation.
 En conclusion, hormis quand la mise en scène défaille (voir les trois monologues de femmes, où il ne se passe scéniquement rien – peut-être pour traduire la détresse des trahies, etc., mais tout de même), le spectacle n’est ni ennuyeux, ni réductible à un projet grotesque. On croit deviner à la fois une influence py-ologique (imagerie homosexuelle sporadique avec servantes jouées exclusivement par des hommes, si si ; travestissement du texte ; recours à la chanson ; utilisation d’un théâtre à quatre dimensions – hauteur, profondeur et largeur de la scène + salle et même parvis avec exposition permanente, etc.) et la volonté d’y échapper en n’y cédant point tout à fait. Cette tension, associée à la qualité de l’adaptation de la pièce de Shakespeare, fagote un spectacle un peu bizarre, oui, mais presque jamais inintéressant.
En conclusion, hormis quand la mise en scène défaille (voir les trois monologues de femmes, où il ne se passe scéniquement rien – peut-être pour traduire la détresse des trahies, etc., mais tout de même), le spectacle n’est ni ennuyeux, ni réductible à un projet grotesque. On croit deviner à la fois une influence py-ologique (imagerie homosexuelle sporadique avec servantes jouées exclusivement par des hommes, si si ; travestissement du texte ; recours à la chanson ; utilisation d’un théâtre à quatre dimensions – hauteur, profondeur et largeur de la scène + salle et même parvis avec exposition permanente, etc.) et la volonté d’y échapper en n’y cédant point tout à fait. Cette tension, associée à la qualité de l’adaptation de la pièce de Shakespeare, fagote un spectacle un peu bizarre, oui, mais presque jamais inintéressant.
Le début et la fin
 Dernier « dimanche de Noël ». Baptême. En bas, crèche d’Isabeau. En haut, l’orgue en cours de restauration chez Yves Fossaert. C’est plutôt joyeux, par ma foi.
Dernier « dimanche de Noël ». Baptême. En bas, crèche d’Isabeau. En haut, l’orgue en cours de restauration chez Yves Fossaert. C’est plutôt joyeux, par ma foi.
SPA Grammont, 8 janvier 2016
 Que ce soit pour l’amour ou pour la vie, comme chantait cette grande princesse, Flash est un chien qui pom-pom-pomme, joue, câline et ne pose nulle difficulté. La preuve : pour commencer, pas deux photos sans Flash.
Que ce soit pour l’amour ou pour la vie, comme chantait cette grande princesse, Flash est un chien qui pom-pom-pomme, joue, câline et ne pose nulle difficulté. La preuve : pour commencer, pas deux photos sans Flash.
 Après, j’ai repéré une petite chienne de trois mois voire de moins neuf mois (« née en 09/2016 » stipule la SPA sur Internet) qui jouait avec ses nounours.
Après, j’ai repéré une petite chienne de trois mois voire de moins neuf mois (« née en 09/2016 » stipule la SPA sur Internet) qui jouait avec ses nounours.
 Sa proprio rentrant à l’hôpital, elle l’a abandonnée avec tout le matos. Comme la gamine avait l’air triste dans son box, j’ai une fois de plus décidé de dire merde au règlement en sortant Zitta, même si « NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES CHIENS DOIVENT ÊTRE SORTIS DANS L’ORDRE INDIQUÉ SUR LA LISTE », pouët-pouët.
Sa proprio rentrant à l’hôpital, elle l’a abandonnée avec tout le matos. Comme la gamine avait l’air triste dans son box, j’ai une fois de plus décidé de dire merde au règlement en sortant Zitta, même si « NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES CHIENS DOIVENT ÊTRE SORTIS DANS L’ORDRE INDIQUÉ SUR LA LISTE », pouët-pouët.
 Après, j’avais envie d’un peu de chic, alors j’ai promené M. Dior, qui préférait être discret sur la photo. Pourtant, ce sympathique zigouigoui est extrêmement efficace dans les disciplines olympiques suivantes : sprint, grattouille, déconnade collective et vagabondage dégingandé. Bon pour Rio, à tout le moinsssse.
Après, j’avais envie d’un peu de chic, alors j’ai promené M. Dior, qui préférait être discret sur la photo. Pourtant, ce sympathique zigouigoui est extrêmement efficace dans les disciplines olympiques suivantes : sprint, grattouille, déconnade collective et vagabondage dégingandé. Bon pour Rio, à tout le moinsssse.
 Et puis j’ai fini par Dazz, de retour à la SPA après avoir été essayé par des maitres pas à la hauteur, faut-il croire. Parce que, pour le reste, c’est un bonhomme qui sait courir, s’adonner à la lutte gréco-romaine en laissant gagner son master, jouer au rrru(g)by sans ballon, s’arrêter quand on lui en donne l’ordre et imiter un chiot pour se faire grattouiller la partie dite « du bidou au cou, avec un ‘o’, merci ».
Et puis j’ai fini par Dazz, de retour à la SPA après avoir été essayé par des maitres pas à la hauteur, faut-il croire. Parce que, pour le reste, c’est un bonhomme qui sait courir, s’adonner à la lutte gréco-romaine en laissant gagner son master, jouer au rrru(g)by sans ballon, s’arrêter quand on lui en donne l’ordre et imiter un chiot pour se faire grattouiller la partie dite « du bidou au cou, avec un ‘o’, merci ».
 Sinon, c’est un vrai chien, et on peut l’adopter, lui aussi, soit dit sans rien dire, gnagnagna.
Sinon, c’est un vrai chien, et on peut l’adopter, lui aussi, soit dit sans rien dire, gnagnagna.

Théâtre de Chaillot, 6 janvier 2016, Ballet de Lorraine
Pendant trois jours, le Ballet de Lorraine donne au Théâtre de Chaillot (Paris 16) un spectacle composé de trois chorégraphies réunies sous un titre pas très justifié, Paris – New York – Paris.
En première partie, toujours scandaleux, Relâche est une reconstitution d’un « ballet instantanéiste en deux actes, un entracte cinématographique et la queue du chien ». Chapeauté par Francis Picabia en 1924, ce tunnel de 41’ encadre un film de René Clair par deux saynètes de théâtre plus ou moins dansé. Eros et Thanatos dominent la situation. En effet, autant la partie live tourne autour du désir d’une femme incarnée par Élisa Ribes, autant le long film tourne autour de la mort (canon, corbillard poursuivi, disparition magique du cortège, symbolisation – grand huit de la vie, secousses et disruptions, etc.). La danse elle-même ne s’embarrasse pas de grands effets, l’objectif étant de dénoncer les conventions et de les subvertir par une feinte décontraction de type cabaret. Quelques ensembles, un rôle joué (le soldat qui verse len-te-ment de l’eau d’un seau dans l’autre, et réciproquement), des mouvements stéréotypés et presque aussi répétitifs que la musique : le propos n’est pas de faire joli, spectaculaire, mais de se moquer, d’ironiser et de nouer complicité, ha ha, avec le spectateur en le provoquant. Sur ce plan, l’efficacité du dispositif est remarquable. En effet, une partie de la vaste salle archicomble siffle, rigole gras, applaudit pour protester, pousse des « ha » de soulagement quand le tableau évolue, un peu comme si un spectateur venant voir le Soulier de satin se réjouissait que l’on ne donne pas la paire car « une seule chaussure, c’est déjà long » (ben t’étais au courant, non ?). Le projet « historique » animant cette pique contre les spectacles tout smooth et destinés à plaire platement mérite pourtant que l’on s’y attarde ; et il est joyeux de constater que la capacité d’irritation, 91 ans plus tard, de ce pseudo-ballet ne s’est pas dissipée.
Toutefois, il faut attendre la seconde partie pour trouver un projet artistique moins réservé aux archéologues. Elle s’ouvre avec Corps de ballet, un projet de 26’ créé en 2014 par Noé Soulier – tiens, on en parlait. Hélas, il débute par une longue séquence sans doute autant symbolique que ridicule, et très symbolique. Un danseur éclaire un à un des éléments de décor, devant puis derrière. Après que l’on a apprécié un vitrail, une statue, un banc, etc., tout est retiré et la scène redevient nue, suscitant des rigolades et des huées parmi certains spectateurs, certes lucides mais, déduira-t-on, plutôt partants pour un concert de Patrick Bruel que pour un spectacle de danse contemporaine. Néanmoins, cet inicipit plus cliché que cliché donne le ton du spectacle de façon moins sotte que l’on pourrait craindre, quoique plus déjà-vu que provocatrice. En effet, à la mise en scène du dépouillement répondent les remix musicaux qui vont accompagner, sur bande son, les ébats chorégraphiés. Après le silence liminaire, retentiront des bouts du dernier mouvement de la Quatrième symphonie de Schubert ainsi que du Finale de Rigoletto, débarrassés des parties mélodiques pour l’un et chantées pour l’autre, comme s’il s’agissait de dépouiller la notion même de spectacle et, pour cela, d’en garder l’architecture (l’accompagnement) sans les ornements (la mélodie ou les aria).
 De fait, Corps de ballet propose une mise à nu du spectacle, explicitée par des sorties d’artistes marchées, comme si le chorégraphe voulait donner à voir, concrètement, le temps du spectacle et sa limite, en laissant sur scène ce qui est souvent mis off. Dans un premier temps, il décline les pas de danse classique « par ordre alphabétique », apprend-on, en exigeant des interprètes des décalages dans le semblable (par groupe, les danseurs exécutent presque la même figure, mais pas tout à fait), comme si le chorégraphe souhaitait décliner l’éventail des possibles d’ordinaire corsetés par un choix unifié. Dans un deuxième temps, où s’invite derechef le silence, le ballet décline les « pas de préparation », montrant des danseurs qui s’apprêtent à exécuter un mouvement… et les détournant in extremis de cette figure, comme si le chorégraphe, toujours dans sa perspective de désossage des conventions spectaculaires, voulait suspendre la logique stéréotypée guidant d’ordinaire la danse. Dans un troisième temps, une danseuse, seule en scène, enchaîne des « gestes de pantomime ». Cette fluidité continue casse la narrativité de ces figures centrées sur les bras et les mains. Les gestes ne signifient plus rien, comme si le chorégraphe tâchait d’interroger le mouvement par-delà le sens qu’il est censé porter. Modérons notre transport en signalant que, d’après la note de programme, cette sobriété antinarrative permet de se concentrer notamment sur « les expressions de visage ». C’est sans doute plus une provocation qu’une ânerie : dans une salle de 1250 places, à moins d’être sis dans les premiers rangs ou d’avoir emporté ton télescope, l’expression du visage, c’est comment dire ? un pizzicato d’alto dans un forte chez Wagner – précieux, sans doute, mais, dans les faits, guère plus que conceptuel donc, si l’on en abuse et s’y intéresse en exclusivité, un brin ennuyant. En définitive, Corps de ballet n’est certes pas inintéressant ; mais l’on soupçonne que seule une connaissance poussée de la danse permet d’en apprécier tant la substantifique moelle que l’ironie.
De fait, Corps de ballet propose une mise à nu du spectacle, explicitée par des sorties d’artistes marchées, comme si le chorégraphe voulait donner à voir, concrètement, le temps du spectacle et sa limite, en laissant sur scène ce qui est souvent mis off. Dans un premier temps, il décline les pas de danse classique « par ordre alphabétique », apprend-on, en exigeant des interprètes des décalages dans le semblable (par groupe, les danseurs exécutent presque la même figure, mais pas tout à fait), comme si le chorégraphe souhaitait décliner l’éventail des possibles d’ordinaire corsetés par un choix unifié. Dans un deuxième temps, où s’invite derechef le silence, le ballet décline les « pas de préparation », montrant des danseurs qui s’apprêtent à exécuter un mouvement… et les détournant in extremis de cette figure, comme si le chorégraphe, toujours dans sa perspective de désossage des conventions spectaculaires, voulait suspendre la logique stéréotypée guidant d’ordinaire la danse. Dans un troisième temps, une danseuse, seule en scène, enchaîne des « gestes de pantomime ». Cette fluidité continue casse la narrativité de ces figures centrées sur les bras et les mains. Les gestes ne signifient plus rien, comme si le chorégraphe tâchait d’interroger le mouvement par-delà le sens qu’il est censé porter. Modérons notre transport en signalant que, d’après la note de programme, cette sobriété antinarrative permet de se concentrer notamment sur « les expressions de visage ». C’est sans doute plus une provocation qu’une ânerie : dans une salle de 1250 places, à moins d’être sis dans les premiers rangs ou d’avoir emporté ton télescope, l’expression du visage, c’est comment dire ? un pizzicato d’alto dans un forte chez Wagner – précieux, sans doute, mais, dans les faits, guère plus que conceptuel donc, si l’on en abuse et s’y intéresse en exclusivité, un brin ennuyant. En définitive, Corps de ballet n’est certes pas inintéressant ; mais l’on soupçonne que seule une connaissance poussée de la danse permet d’en apprécier tant la substantifique moelle que l’ironie.
La seconde partie se conclut par Sounddance, une pièce de 17’ créée en 1975 par Merce Cunningham sur une musique (un piètre bruitage linéaire, type Livre de la jungle) de David Tudor, et c’est même pas un jeu de maux. Cette fois, ô surprise, il y a un décor – un grand rideau doré à franges positionné en fond de scène, d’où surgissent des danseurs tout bouillonnants. Le ballet s’organise autour de deux lignes de force : une série de figures iconiques qui secouent les danseurs à tour de rôle (tête rentrée, mouvements saccadés, immobilisations soudaines), formant une manière de fil rouge ; et un chaos multi-narratif, constitué par des groupes de danseurs qui se font, se défont, s’agitent en parallèle, interagissent, s’échangent les danseuses, démantèlent les corps, les portent en triomphe, les propulsent dans des figures fulgurantes ou en suspension, saturant la capacité de concentration du spectateur qui devient incapable de tout suivre. Le foisonnement d’événements chorégraphiques, l’énergie communicative et perpétuelle, la gestion quasi graphique de l’espace (investissement de l’ensemble de la scène puis rapprochement au fond du jardin, éclatement des groupes puis brisures millimétrées, profusion des événements chorégraphiques puis solo final, etc.) font de cette pièce la plus accessible de toutes celles au programme ce soir, en dépit d’une bande-son pénible.
En clôturant la trilogie sur un hit roboratif et qui, cette fois, exige plus des danseurs que de l’assistance, Petter Jacobsson et Thomas Caley offrent un triomphe mérité à leurs marionnettes, laissant aux spectateurs, même incultes tant que curieux, le plaisir d’avoir passé un moment à la fois agréable et stimulant.