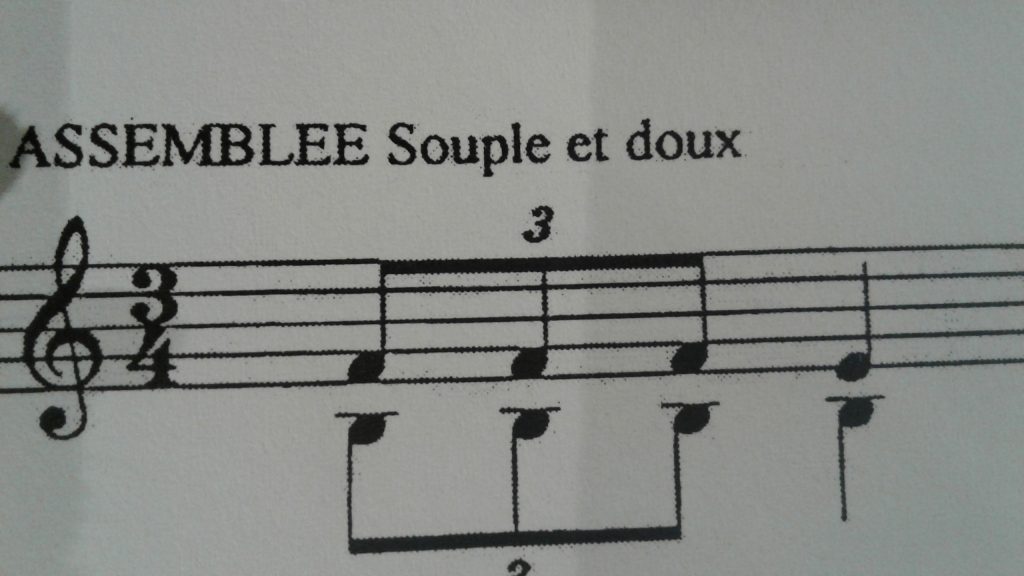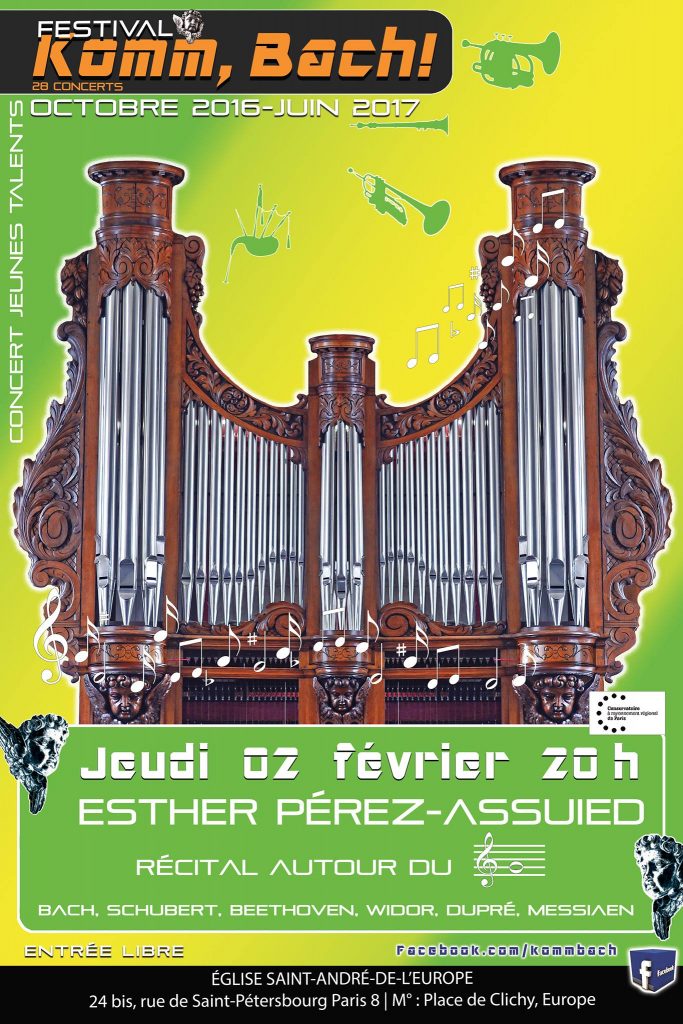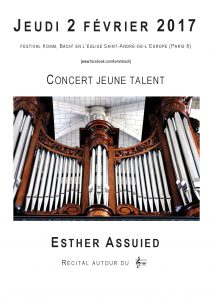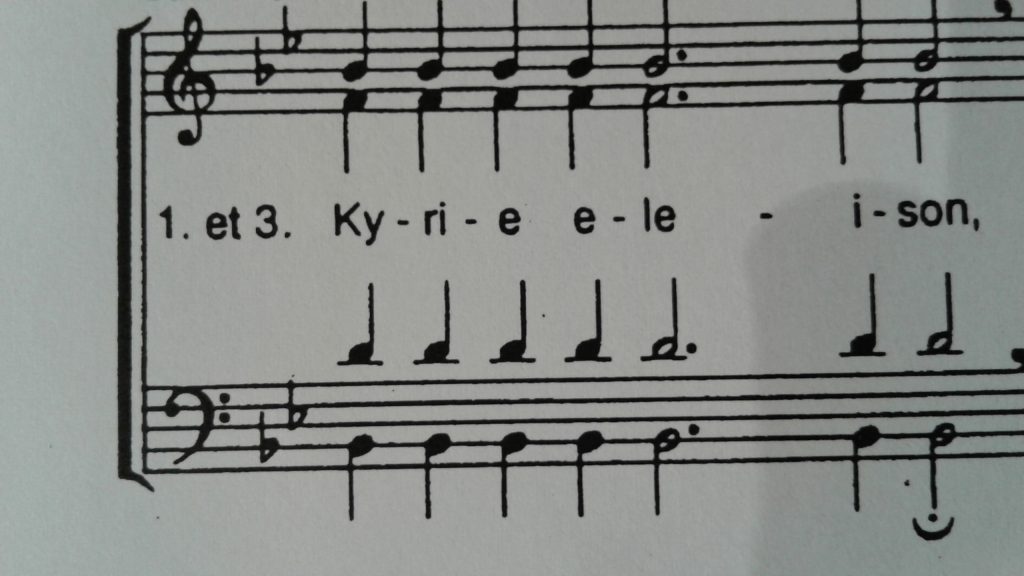Hardy Rittner, Institut Goethe, 7 février 2017
C’est certain, le fat pointerait une cyberpromesse de concert qui aurait mérité une relecture francophone (« C’est aussi en 2010 que Hardy Rittner complète ses études un programme dans un autre discipline majeur »). Même si, grammaticalement, c’est pertinent, artistiquement, un tel reproche est idiot car, fidèles à leur tradition portée par un sens de l’accueil tout sauf français et bousté par l’énergie de François Segré pour Socadisc, les concerts de l’Institut Goethe, à la portée de tous (1 h + pot après), sont un joyeux moment pour découvrir des artissses brillants, méconnus, entiers et offerts à l’oreille du curieux pour un tarif oscillant entre 5 et 10 €, dans une salle confortable… mais, désormais, pleine à chaque fois.
Le pianiste du mois est Hardy Rittner, un revenant qui a sévi en ces lieux six ans plus tôt. Son projet : propulser sans afféterie une musique brillante. Pourtant, tout commence par la sonate KV 279, soit la première sonate pour piano de Mr Mozart. Un quart d’heure de musique plutôt attendue, distribuée en trois mouvements, qui met donc en scène la patte Rittner : le musicien n’est pas celui qui joue des tubes, il est celui qui fait sonner des œuvres dont il croit qu’elles valent d’être entendues. Pour cela, Hardy Rittner remplit les conditions – doigts assurés, sens du tempo, foi dans Amadeus.
On attend avec d’autant plus de curiosité ses Chopin, qui encadrent une grosse pièce de Brahms. Or, dans la quasi miniature, même si elle est moins applaudie par un public trop respectueux (à l’exception de la pétasse qui agite ses bracelets pour se faire remarquer), le virtuose dégaine un sens de la caractérisation qui focalise l’attention. On a rarement entendu des plans aussi clairement distincts dans un prélude, un impromptu ou une étude. L’exécution est quasi pédagogique, tant l’homme est capable de jouer en trois dimensions afin de donner chair auditive aux différentes strates de l’accompagnement et de la mélodie.
Les Variations sur un thème original op. 20 de Brahms confirment la conviction de l’auditeur. Nous avons bien affaire à une personnalité singulière, qui associe le côté analytique (même si toi, tu aurais besoin d’une quinzaine de doigts par main et de quelques cerveaux supplémentaires pour jouer ce que je propose avec un index ou deux, je peux à tout moment t’essspliquer comment la pièce est construite) au sens de la dramaturgie (le public est porté par la gourmandise pianistique du héros et sa capacité à faire sentir la progression des œuvres). Peut-être regrette-t-on çà et là le revers de la médaille (pour rendre évidents les contrastes, le musicien utilise souvent une nuance mezzo forte qui met bien en valeur les parties solistes, forte ou piano, mais lisse parfois tensions et intentions), et l’utilisation généreuse d’une pédale qui, dans l’acoustique assez sèche de l’Institut, noie sporadiquement le propos dans un flou chaleureux mais un brin excessif à notre goût.
Pour autant, ce flou n’a rien d’une facilité. En témoigne la dernière pièce, la célèbre Toccata de Ferruccio Busoni, une de ces pièces injouables qu’adorent les purs virtuoses. Hardy Rittner ayant déjà prouvé qu’il était inutile d’aller vérifier s’il sait jouer, il en profite pour diffuser de la musique avec ce qui pourrait n’être chez d’autres qu’un brillant tombereau de notes à peu près domestiquées. Le choix de tempi différenciés, la volonté d’affirmer la clarté du discours sous de nombreuses formes (rythme récurrent accentué, dissociation des plans sonores, legato spectaculaire sur les octaves en cascade), et l’investissement du pianiste dans son interprétation achèvent de sidérer un public justement en transe.
Le concert se conclut par trois Chopin en bis, dont un nocturne délicat à souhait et une séduisante mazurka que Hardy Rittner tire, par sa rythmicité, du côté de Grieg. Ne reste plus qu’à déguster le pot d’après-concert, facilité par des serveurs dignes et cordiaux. Le fat, persistant, regrettera des vins de qualité discutable ; le spectateur intelligent se réjouira de cette façon de prolonger un concert impressionnant par une sorte de sas de décompression conviviale entre le brio de Hardy Rittner, le sens de l’accueil des organisateurs et la médiocrité de nos vies quotidiennes. Même si je suis pénélopé puisque j’étais derechef invité, faut bien le dire avant que le Canard ne le stipule, je conseille aux lecteurs friands de grande culture cordiale et pas chère de se préparer à réserver pour un « concert lecture » d’Yves Henry qui parcourra le piano de Chopin, Schumann et Liszt le mardi 14 mars à 20 h.
Boulot, boulot
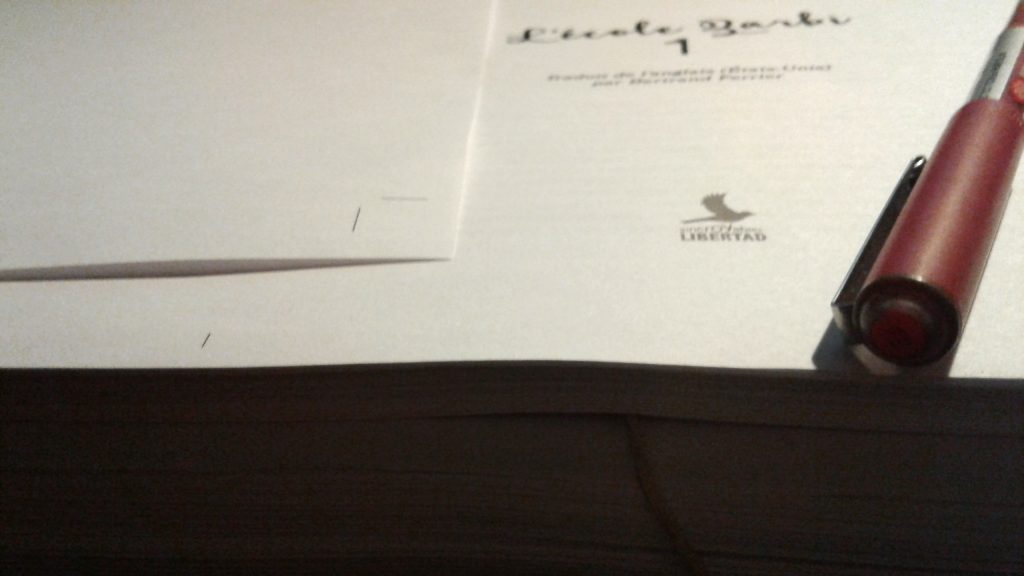 « Bon, Bertrand, vous avez corrigé les huit cents pages que l’on vient de vous remettre alors qu’on les avait depuis plusieurs jours mais on a oublié de vous le signaler ? Vous avez traduit les trois cents pages pour lesquelles nous vous accordons mille euros (sélection du texte, négociations de droits, traduction pas terrible d’ailleurs, relecture, discussions avec l’auteur, correction orthotypo, vérification d’intégration comprises malgré une compositrice incapable qui part en vacances pile au moment crucial avant l’impression) ? Vous avez obtenu l’accord de l’attachée de presse free-lance pour les conditions que nous avons décidées sans vous contacter ? Vous avez optimisé les couvertures avec la directrice artistique ? Vous avez préparé le lancement de la nouvelle série de livres de… Bertrand, vous m’écoutez ou vous êtes, juste, en train de péter très fort ? »
« Bon, Bertrand, vous avez corrigé les huit cents pages que l’on vient de vous remettre alors qu’on les avait depuis plusieurs jours mais on a oublié de vous le signaler ? Vous avez traduit les trois cents pages pour lesquelles nous vous accordons mille euros (sélection du texte, négociations de droits, traduction pas terrible d’ailleurs, relecture, discussions avec l’auteur, correction orthotypo, vérification d’intégration comprises malgré une compositrice incapable qui part en vacances pile au moment crucial avant l’impression) ? Vous avez obtenu l’accord de l’attachée de presse free-lance pour les conditions que nous avons décidées sans vous contacter ? Vous avez optimisé les couvertures avec la directrice artistique ? Vous avez préparé le lancement de la nouvelle série de livres de… Bertrand, vous m’écoutez ou vous êtes, juste, en train de péter très fort ? »
Le Soum-Soum 9, 3 février 2017
Avec de plus en plus de chanteurs invités par Barthélémy Saurel, dont le formidable Claudio Zaretti, la mouette Terrebrune et l’étonnant patriarche dit « l’Ermite », le Soum-Soum organise une scène de plus en plus ouverte et diverse où, à nouveau, j’ai glissé quelques chansons dont une chanson sportive La ballade du ballon…
… une nouvelle, quoique ancienne, chanson vaudoise de Michel Bühler – une de mes préférées parmi les pas-drôles du maître suisso-parisien, Monsieur Saint-Pierre…
… et une dernière, avec un dérapage presque contrôlé, avouant que Je suis venu tout seul.
Et qui sait ce que l’on fredonnera vendredi prochain, inch’chalalala ?
Adam Bernadac, église Saint-Augustin, 29 janvier 2017
 On m’avait prévenu : l’orgue de Saint-Augustin, c’est difficile à maîtriser, t’es sûr que tu veux aller écouter Adam Bernadac le toucher alors que la France joue la finale du championnat de handball ? Je déclarai que oui, je voulais. Une fois de sus, sans m’vanter ou presque, j’eus raison, euphémisme.
On m’avait prévenu : l’orgue de Saint-Augustin, c’est difficile à maîtriser, t’es sûr que tu veux aller écouter Adam Bernadac le toucher alors que la France joue la finale du championnat de handball ? Je déclarai que oui, je voulais. Une fois de sus, sans m’vanter ou presque, j’eus raison, euphémisme.
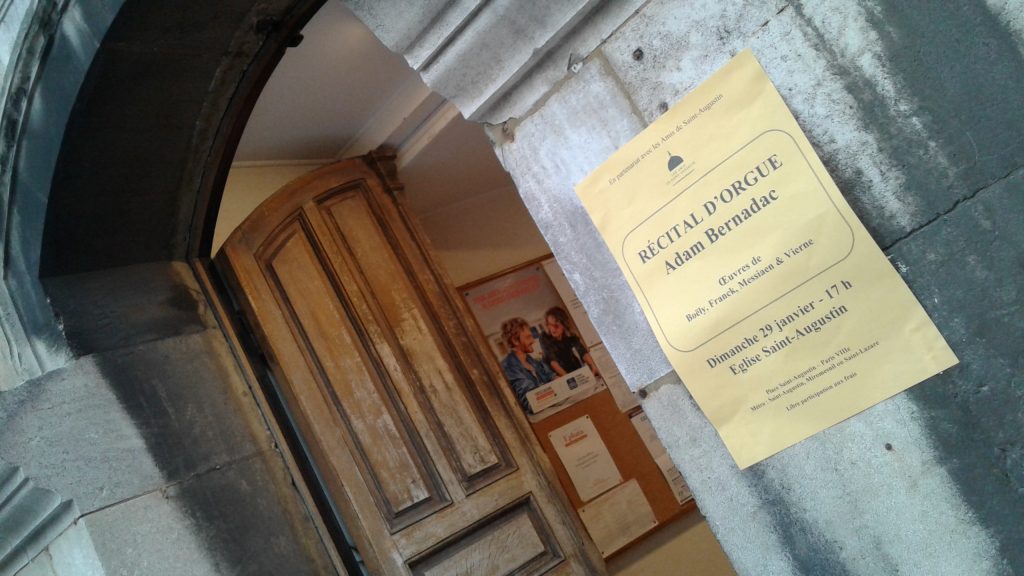 Après une altercation cordiale (« c’est pas vous qui programmez les concerts de Saint-André ? vous voyez, ici, il fait chaud ! / – Certes, c’est agréable, mais Saint-Augustin, c’est pas les mêmes moyens, et je vois pas le grand écran, bon, laisse, Christian »), je dois avouer que, Adam, je venais le ouïr pour une raison très précise. Si. Après l’avoir entendu en tant qu’étudiant du CRR, j’avions été si impressionné que je l’avions invité à revenir donner un récital rien que tout seul, sous le titre « Adam Bernadac l’exceptionnel », le 11 juin, pour le Festival Komm, Bach!. C’était donc une manière de tester si je n’en avions pas trop fait au niveau du titre. Ben ouais, on pouvait toujours concocter des affiches ajustées, genre « Adam Bernadac le moyen ». Même que, si ça se trouve, les médiocres auraient préféré.
Après une altercation cordiale (« c’est pas vous qui programmez les concerts de Saint-André ? vous voyez, ici, il fait chaud ! / – Certes, c’est agréable, mais Saint-Augustin, c’est pas les mêmes moyens, et je vois pas le grand écran, bon, laisse, Christian »), je dois avouer que, Adam, je venais le ouïr pour une raison très précise. Si. Après l’avoir entendu en tant qu’étudiant du CRR, j’avions été si impressionné que je l’avions invité à revenir donner un récital rien que tout seul, sous le titre « Adam Bernadac l’exceptionnel », le 11 juin, pour le Festival Komm, Bach!. C’était donc une manière de tester si je n’en avions pas trop fait au niveau du titre. Ben ouais, on pouvait toujours concocter des affiches ajustées, genre « Adam Bernadac le moyen ». Même que, si ça se trouve, les médiocres auraient préféré.
 Le p’tit djeunse ouvre son programme sur les Fantaisie et fugue en Bb d’Alexandre-Pierre-François Boëly. La mise en bouche annonce la signature du zozo : pas d’effet grandiloquent ou de bruitage facile, pourtant pas très compliqué à concocter sur cet orgue. Le mec valorise les notes, la précision et la musique avec une cohérence de briscard roué. Pas d’applaudissements après cette première pièce, mais stupéfaction admirative, à tout le moinsss.
Le p’tit djeunse ouvre son programme sur les Fantaisie et fugue en Bb d’Alexandre-Pierre-François Boëly. La mise en bouche annonce la signature du zozo : pas d’effet grandiloquent ou de bruitage facile, pourtant pas très compliqué à concocter sur cet orgue. Le mec valorise les notes, la précision et la musique avec une cohérence de briscard roué. Pas d’applaudissements après cette première pièce, mais stupéfaction admirative, à tout le moinsss.
Suit La Prière de César Franck, qui permet de vérifier cette option du non-show-off. En dépit du lourdaud introït de présentation au micro, qui tentera de plomber chaque morceau, la pièce du soi-disant pater seraphicus offre à l’interprète, aspirant compositeur, l’occasion de rendre hommage au Belge le plus Cavaillé-compatible en superlativant sa musique par une dextérité irréprochable et non mise en scène, ce que l’on apprécie, ainsi qu’une science des couleurs organistiques très émouvante.
(Si, « superlativant », je trouve que ça sonne bien, on dirait une chanson des années 1980-1990 que l’on écoutait sur les gradins, en bord de mer, en disant que c’était fécal.)
Deux pièces de Louis Vierne concluent la première partie. La Toccata démontre une nouvelle fois la capacité étonnante qu’a le zozolibrius à faire de la musique avec des notes, même quand elles sont beaucoup et visent à fournir un « grand effet », comme on disait jadis. Le Carillon de Westminster est une joyeuse gourmandise qui exige de l’organiste une concentration sans faille, des doigts et des pieds sûrs, et un subtil sens des nuances pour soutenir l’attention de l’auditoire. C’est certain, le musicien du jour a tout ça. L’enthousiasme du public, même juste avant que l’on réclame « des sous pour l’artiste, des sous », en est, pour une fois, une heureuse preuve.
 Impressionner, même avec l’aide d’un registrateur en feu, virevoltant entre le musicien et les preneurs d’image, ne suffit pourtant pas. On attend l’hurluberlu dans des musiques sérieuses, voire sacrées. Deux pièces d’Olivier Messiaen visent à finir d’époustoufler l’auditoire. Et pourtant, cela se joue sans esbroufe.
Impressionner, même avec l’aide d’un registrateur en feu, virevoltant entre le musicien et les preneurs d’image, ne suffit pourtant pas. On attend l’hurluberlu dans des musiques sérieuses, voire sacrées. Deux pièces d’Olivier Messiaen visent à finir d’époustoufler l’auditoire. Et pourtant, cela se joue sans esbroufe.
« Joie et clarté des corps glorieux » se glisse dans l’harmonie du lieu en associant précision rythmique, science de la registration et maîtrise de l’instrument. Adam Bernadac ne laisse pas seulement l’impression que jouer de l’orgue est facile : à chaque œuvre qu’il joue, il donne une dimension à la fois nécessaire (comme s’il n’avait pu en jouer une autre) et évidente – comme si toute musique était déjà prête à se lover en ronronnant dans l’oreille de chaque auditeur, mélomane ou non. En sus, et c’est sans doute sa qualité que je préfère, il fait fuir, par le seul nom de Messiaen, la dame aux deux gamins mal élevés qui gonflaient tous les zozoditeurs depuis le début du récital. Que demander d’autre (la traduction de Nespresso est un peu lourdaude, mais bon) ?
 Avec « Dieu parmi nous », du mec de la Trinité, l’organiste achève de séduire l’assistance en imposant sa marque : il ne se contente pas de jouer, il laisse respirer l’acoustique pour donner profondeur et chair au mysticisme messiaenique. Quand on connaît la partoche, on suppute ce que cette précision et cette aération exigent de maîtrise pour sonner avec l’impression de liberté et de finesse que donne Adam Bernadac.
Avec « Dieu parmi nous », du mec de la Trinité, l’organiste achève de séduire l’assistance en imposant sa marque : il ne se contente pas de jouer, il laisse respirer l’acoustique pour donner profondeur et chair au mysticisme messiaenique. Quand on connaît la partoche, on suppute ce que cette précision et cette aération exigent de maîtrise pour sonner avec l’impression de liberté et de finesse que donne Adam Bernadac.
Le bis est mérité, et donne l’occasion au gamin de claquer une Toccata de Widor que l’on a rarement entendue (accord du subjonctif médian avec le prédicat placé en tête de structure, donc « entendue », bien sûr) avec autant de clarté et de souci de nuances. En bref, un récital impressionnant d’intelligence, de maîtrise et de musicalité. Et, en plus, le mec « poursuit un master d’écriture au CNSMDP ». Comme si ça ne lui suffisait pas de relativiser la science de nombre de très bons interprètes…
Rendez-vous est donné le 11 juin aux gourmands et aux sceptiques soupçonnant un exercice de lèche-culisme (bien l’genre de la maison, il est vrai), pour un lailleve retransmis sur big screen à Saint-André de l’Europe !