Vincent Crosnier est en approche !
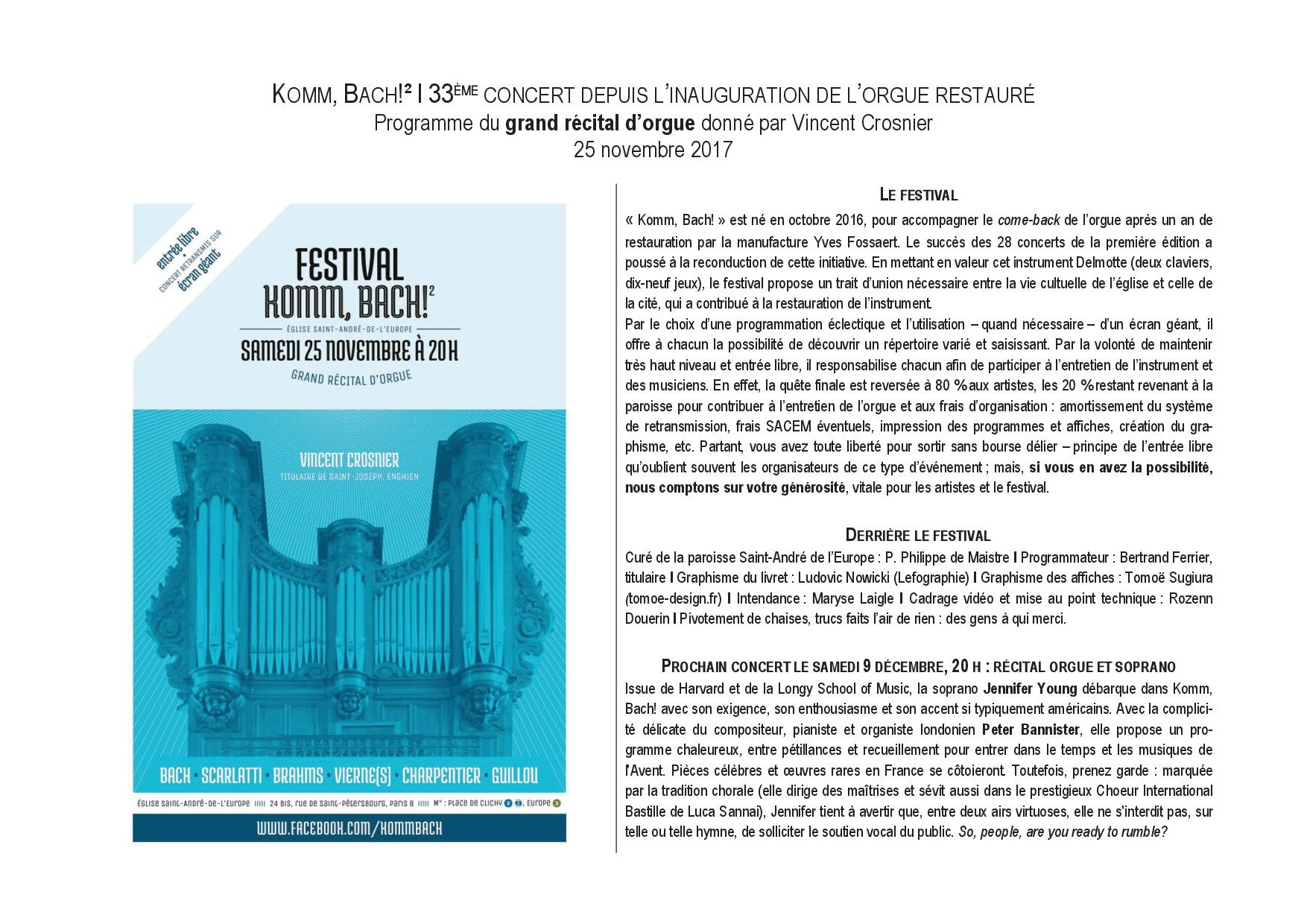 Match revanche en vue. Après avoir martyrisé l’orgue de Saint-André lors d’un récital où la Bête n’avait pas résisté à six pièces de Jean Guillou, Vincent Crosnier, l’élève préféré du maître, même s’il ronchonchonne quand on le présente de la sorte, revient avec un programme tout aussi explosif. Au programme ? Du gros Bach, du Brahms qui fait zizir, du Schumann réservé à l’élite des virtuoses, des Viernes (René et Louis), du Jacques Charpentier et… du Jean Guillou. L’orgue est prévenu.
Match revanche en vue. Après avoir martyrisé l’orgue de Saint-André lors d’un récital où la Bête n’avait pas résisté à six pièces de Jean Guillou, Vincent Crosnier, l’élève préféré du maître, même s’il ronchonchonne quand on le présente de la sorte, revient avec un programme tout aussi explosif. Au programme ? Du gros Bach, du Brahms qui fait zizir, du Schumann réservé à l’élite des virtuoses, des Viernes (René et Louis), du Jacques Charpentier et… du Jean Guillou. L’orgue est prévenu.
Rozenn Douerin, la cadreuse officielle du festival, assurera la sécurité de l’orgue et de l’organiste en retransmettant le concert en lailleve sur grantécran. Le tout en entrélibr, à deux pas de la place des Clichés. Comme d’hab’, malgré un musicien formidable, un programme ksépssionnel, le programme papier offert aux cinquante premiers arrivants, l’écranjian et la gratuité, on voulait faire mieux mais, mârde, on n’a pas réussi. C’est pas une raison pour pas venir nous encourager en vous faufilant dans la foule, samedi, hein !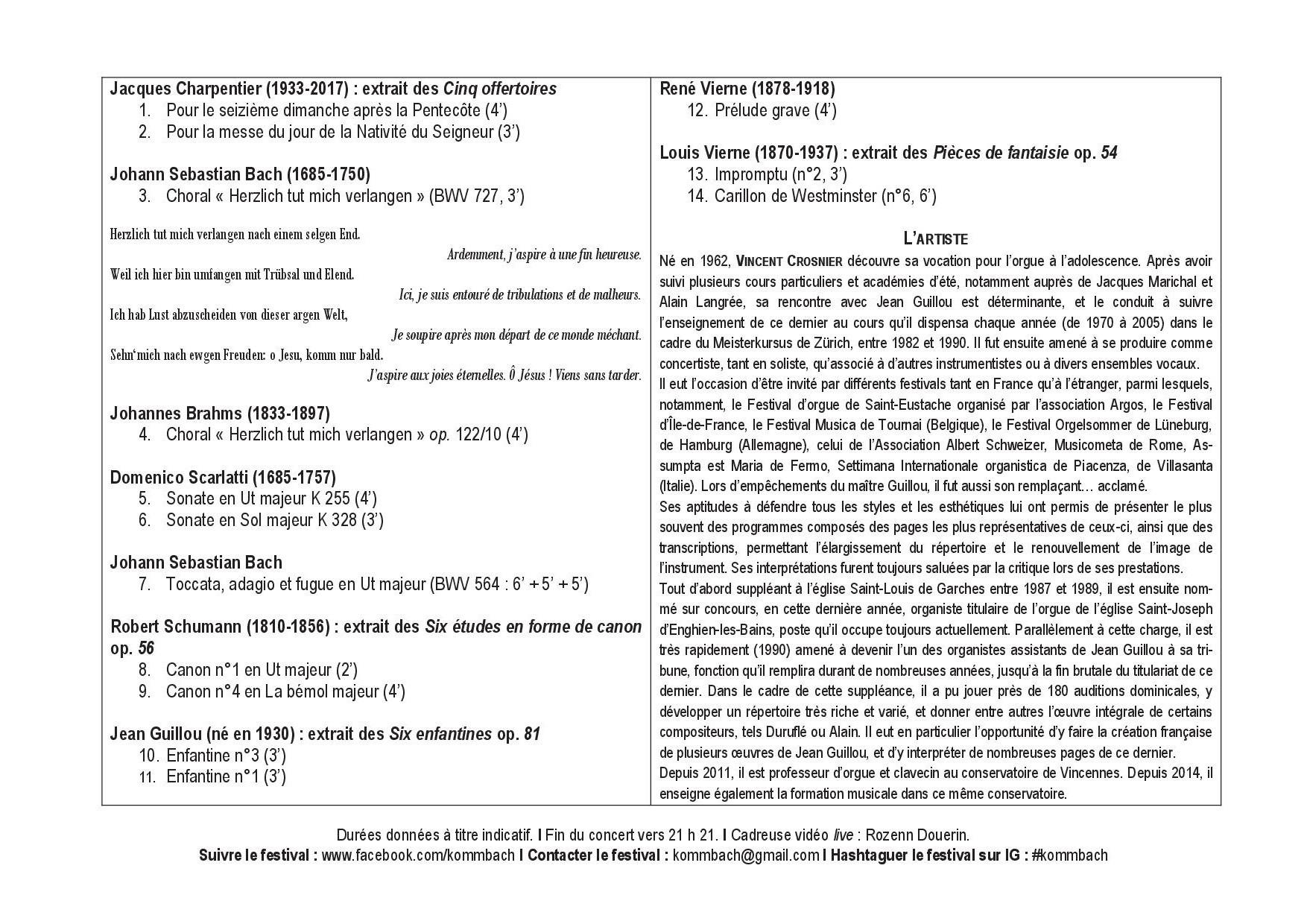
The Square, Ruben Östlund, Pathé Wepler, 22 novembre 2017
L’histoire
Christian (Claes Bang) est à la fois papa divorcé de deux p’tites blondes dodues, et conservateur d’un grand musée d’art contemporain, un endroit que si tu mets du gravier ou un sac à main par terre, c’est une œuvre d’art. D’un côté, il prépare le lancement d’une exposition déclinant un « carré de la bienveillance », le « square », où chaque personne qui entre est censée bénéficier de l’attention de l’autre, ce qui laisse supposer comment ça se passe à l’extérieur. De l’autre côté, il se fait voler son portable et son portefeuille. Pour le récupérer, il menace avec succès tout un immeuble… mais, trop préoccupé, il ne contrôle pas le lancement de l’expo du carré. Résultat, l’agence de comm’ lance un clip choc où une p’tite blonde avec un chaton explose. Scandale. Alors qu’il ne s’est pas dépêtré de son histoire de cul avec une journaliste américaine (Elisabeth Moss), il doit démissionner.
La critique
Ouvrir des portes, les laisser battantes, profiter du courant d’air et changer de pièce, telle semble être l’option esthétique ici envisagée, tant dans le scénario que dans les prises de vue. Concrètement, le film de Ruben Östlund part sur un air de comédie à trois sujets :
- faire rire de l’art conceptuel et de ses mécènes,
- dénoncer la vacuité éhontée de la comm’, et
- souligner notre dépendance aux réseaux sociaux, à titre personnel (importance de notre smartphone) et collectif (rôle du buzz dans notre valorisation), triple dépendance qui fait écho à l’échec de nos vies non-sociales (déréliction de la famille, éclatement d’amours avortées où l’homme baise car il est connu mais a peur de se faire voler son sperme, indécidabilité de notre personnalité).
À vrai dire, même si l’on rit sporadiquement, aucun des éléments de critique (critique de l’art conceptuel, et critique de la critique de l’art conceptuel) n’innove ou ne creuse ce thème, façon Jean-Michel Ribes. Sans doute s’agit-il d’un choix du cinéaste, qui, plus que la linéarité démonstrative, privilégie les contrastes :
- contraste entre ellipses, saynètes et séquences étirées (le repas de gala) ;
- contraste dans les focalisations diégétiques (presque tout le film est vu par le conservateur, donc c’est ce « presque » qui est intéressant) ;
- contraste entre les rythmes, oscillant entre le bref, le répétitif (enfant appelant à l’aide), le pointillé (préparation de la publicité vidéo), le lent transformant l’espace en temporalité (plan fixe sur les filles du conservateur pendant le trajet vers la zone), etc. ;
- contraste entre les centres d’intérêt tournoyants du film (la scène où l’amante américaine vient demander des comptes au conservateur est typique de cela, où les personnages, dans le musée, sont nets, tandis que la montagne de chaises en arrière-plan reste floue au contraire du vacarme que l’on imagine dû à une autre installation en cours, ce qui mime la vie d’un conservateur, à la fois humain et homme d’art) ;
- contraste entre la majesté des décors dorés et la platitude, physique, des œuvres proposées, à ras du sol quand elles ne sont pas floues (même le gorille se déplace volontiers à quatre pattes avant de tenter de violer une participante sur le sol)…
Ces contrastes, le réalisateur les traduit par une alternance faussement dégingandée, ça veut rien dire mais j’aime bien, entre scènes narratives de type téléfilm (champ-contrechamp : entretien avec la journaliste-amante) et autres stratégies plus esthétisées (caméra mouvante ; longs plans fixes ; effets de plongée pour accompagner la circulation dans un escalier ; travail sur les couleurs oscillant entre le vif, le fané, le presque noir et blanc, etc.). Un tel impressionnisme visuel, fonctionnant par taches successives, parfois conjointes, parfois nettement séparées, souvent imprévisibles, exige la participation du spectateur pour combler les blancs, accepter les à-coups, encaisser la faiblesse de certains passages (la scène des pom-pom-girls dans le gymnase), modifier sa perception du récit, et comprendre que la fluidité cinématographique et narrative est consubstantielle du propos : The Square n’est pas un film sur l’art contemporain mais une œuvre d’art sur un homme qui se trouve être conservateur de musée.
Que certaines séquences se tournent sciemment vers une comédie plus facile (scène de l’oignon dans le sandwich offert à la mendiante) ou banale (projet de remettre du gravier sur l’œuvre à moitié aspirée, puisque l’art n’est qu’une illusion à la portée de tous ceux qui peuvent exposer dans un musée), que certaines scènes paraissent paresser (retour de l’enfant protestataire, certes dans l’espace intime d’un conservateur habitué aux espaces publics, mais lourdaud) ou esthétiser un brin banalement le répugnant (scène de la poubelle en plongée s’élargissant peu à peu, comme si, en recherchant un numéro inutile, l’homme redevenait conservateur et transformait le sale en art), cela n’a rien d’étonnant, puisque le réalisateur tâche de balayer le spectre d’une vie, entre grandeurs arty, avec nœud papillon, et classique agacement de papa devant ses fistonnes qui se disputent. Il n’est pas jusqu’au placement de produit (Tesla, Jackie, San Pellegrino, Justice pour complaire à la coproduction française…) qui n’ait un lien avec les nécessités comptables de l’art, essentielles en cinéma comme en muséologie, ce qu’évoque le film et que symbolise un couple de mécènes recevant un ridicule bouquet pour cinquante millions de couronnes.

Un peu d’humiliation avec Terry Notary dans le rôle du gorille. Photo de presse fournie par Bac Films.
Partant, patent est le choix du réalisateur valorisant le divers, le diffus, le touffu ou le tout fou parfois. Ainsi, l’éclatement du propos autour d’un personnage, les tensions entre lumières blanches du musée et pénombre caractérisant souvent le monde extérieur, la volonté de rendre, dans la construction du film comme dans les choix de cadrage, le multiple et l’inachevé communs à l’art et à la vie pourront légitimement décevoir les spectateurs que la revendication d’inachèvement et d’œuvre ouverte désarçonnera sans retour. En effet, le scénario, signé par le réalisateur, veille à tout laisser en suspens : l’exposition aura-t-elle lieu ? que va devenir le conservateur après sa démission ? reverra-t-il Anne ? qu’est devenu le garçon censé avoir été puni par ses parents à cause de Christian (et pourtant inexplicablement toujours dehors, alors qu’il se plaint d’être « coincé chez lui ») ? On ne le saura pas… et c’est presque un détail. De fait, pour apprécier le film, il faut accepter cette insaisissabilité du « fin mot de l’histoire », et prendre conscience de la porosité entre les forces en présence : les critiques bateau sur l’art interrogent l’humanité de Christian (au fond, si chics que nous soyons, nous ne sommes que des topoi qui aimons picoler et niquer sans avoir une idée précise de ce que serait le bonheur) ; et, réciproquement, l’humanité du conservateur investit l’art conceptuel, capable, par-delà son ridicule apparent, de poser des questions fondées et, ce, par le truchement d’installations artisanalement ridicules mais philosophiquement signifiantes.
La conclusion
Il n’est pas certain que ce film conduise à partager le fond de bonne conscience sociale revendiqué par le réalisateur, soucieux de réhabiliter les mendiants et « ces gens-là », id sunt les pauvres qui vivent dans des immeubles presque moches et sont donc craints quoique aussi dignes que les gens autoproclamés « bien » qui vont aux musées pour se goberger ; mais il est évident qu’il y a, dans ces cent quarante-cinq minutes, de quoi réfléchir, moins grâce à la substantifique moelle du propos que grâce à la concaténation subtile et bancale d’éléments aussi disparates qui restent dans l’air sans être solubles.
Dès lors, le résultat est un beau pied-de-nez à la spécularité vertigineuse du propos (The Square est une œuvre d’art mise en scène dans un film portant son nom ; ce film met en scène un musée visant à abriter The Square, donc le film ; le musée est lui-même mis en scène alors qu’il met en scène lui aussi des œuvres d’art dont le nom est celui du film qui le met en scène, etc.). L’infinitude frustrante du film fracture utilement cette circularité, invitant le spectateur à se questionner sur le processus de création et de réception, donc sur la notion d’art.
Bref, à notre sens, un film à la fois pensé et jamais tout à fait convaincant ; autant dire : un film intéressant.
Ensemble Quentin le Jeune, Institut Goethe, 21 novembre 2017
 Derrière son petit air de monsieur sage à lunettes, il y a de l’audace chez François Segré, le grand manitou des concerts mensuels intitulés « Classique en suites » et fomentés à l’Institut Goethe, soit qu’il programme un excellent pianiste que les gens raides jugeront controversé, ce qui est toujours bon signe, soit qu’il propose à ses spectateurs fidèles un concert de musique du dix-huitième siècle. Lui-même a conscience du défi que représente ce pourtant appétissant ensemble de quatre sonates en trio : ne pointe-t-il pas la présence de spectateurs somnolents dès son prologue parlé ? Il faut incontestablement prendre cette fatigue comme un compliment, signalant l’envie d’assister à cet événement en dépit de la lassitude du quotidien, ou du sommeil en retard !
Derrière son petit air de monsieur sage à lunettes, il y a de l’audace chez François Segré, le grand manitou des concerts mensuels intitulés « Classique en suites » et fomentés à l’Institut Goethe, soit qu’il programme un excellent pianiste que les gens raides jugeront controversé, ce qui est toujours bon signe, soit qu’il propose à ses spectateurs fidèles un concert de musique du dix-huitième siècle. Lui-même a conscience du défi que représente ce pourtant appétissant ensemble de quatre sonates en trio : ne pointe-t-il pas la présence de spectateurs somnolents dès son prologue parlé ? Il faut incontestablement prendre cette fatigue comme un compliment, signalant l’envie d’assister à cet événement en dépit de la lassitude du quotidien, ou du sommeil en retard !
Pour soutenir l’intérêt, les musiciens de l’Ensemble Quentin le Jeune (deux violonistes et une violoncelliste baroque, plus un clavecin, formés notamment par Patrick Cohën-Akénine, Patrick Bismuth, Thérèse Bollet, Sylvia Abramowicz, Nina Ben David, Michèle Dévérité…) problématisent leur concert, donc le disque qu’ils publient ce jour même avec une set-list quasi identique, et explicitent leur fil rouge – en l’espèce suivre les goûts d’Adélaïde et de Victoire, filles de Louis XV, musiciennes et sponsors. Le quatuor s’attaque à quatre trios au format presque identique (quatre mouvements en général, du type vite – lent – dansant – vite). L’intérêt sourd donc de la répétition, en ce sens que la norme et le formatage incitent l’auditeur à une écoute paradoxale. Dans cette musique qui flatte l’oreille mais paraît lisse voire anti-événementielle, qu’est-ce qui distingue l’automatique du talentueux, le codifié du p’tit supplément d’âme, le conventionnel du joyeux bizarre ?
Pour ouvrir le bal, voici Giovanni Pietro Ghignone, compositeur francisé en Jean-Pierre Guignon à une époque où la francisation patronymique n’était pas encore considérée comme une preuve de nazisme aggravée mais comme un gage d’intégration. En non-spécialiste, on peine à entendre cette patte italienne qu’annonce Jean-Christophe Lamacque, mais on est d’emblée saisi par le travail sur la synchronisation du quatuor, qui permet de faire chanter le lead. La chaleur, suppute-t-on, dérègle certes la belle mécanique sur les deux derniers mouvements, mais, après un nouvel accord, le combo se jette dans la première sonate en trio n°6 d’Antoine Dauvergne, surtout compositeur d’opéra, nous apprend-on. Le souci de concision, donc de concentration du matériau mélodique, bénéficie d’un violoncelle et d’un clavecin attentifs tant à la pulsation qu’aux inflexions des violonistes. À la fioriture, l’Ensemble Quentin le Jeune préfère la lettre et l’épure. C’est d’une exigence rare.
Hélas, les pistes d’écoute déroutent parfois : nos limites auditives nous empêchent de saisir le caractère « symphonique » de la Cinquième sonate à trois parties de Johann Stamitz, vendu par le premier violoniss. Au-delà de la piste qui nous est barrée, cette pièce est néanmoins l’occasion de vérifier la qualité du travail en commun : le souci de précision sur les sforzandi ou les (légères) ruptures de caractère, par exemple, permettent à l’auditeur d’apprécier la volonté de valoriser les micro-événements brisant la linéarité du discours musical. Ce nonobstant, on finira de décevoir les lecteurs en reconnaissant que nous échappe la dimension « géniale » de Julien-Amable Mathieu, dont le Deuxième trio n°3 est censé entremêler le chant des deux violons de façon fort originale – notre sens de la contradiction et notre méconnaissance de ce répertoire, probablement, nous empêchent, à la première écoute, d’abonder dans ce sens. Pour notre part, assumant la part d’inculte qui n’a pas su faire taire notre pulsion de curiosité musicale, nous goûtons plus modestement une belle musique jouée avec un enthousiasme qui passe par le ciselage plus que par l’extraversion.
Un double bis (un « Tambourin » et un « Andante » tiré de la suite symphonique qui a le plus passionné mes voisins grâce au storytelling du « compositeur suicidé car trop génial ») permet aux artistes de recevoir leur flot d’applaudissements mérités, avant de filer signer leur tout nouveau disque. C’est alors que survient le miracle : même les mamies permanentées que la perspective d’un concert baroque épuisait retrouvent leur énergie et leur grossièreté pour trottiner jusqu’au buffet afin de se jeter sur le vin, les chips et les p’tits saucissons offert aux survivants.
À tous, donc. Après le concert solide, le beau geste.
Prochain concert de la série, très prometteur : le 19 décembre, à 20 h, Irène Duval (violon) et Aurélien Pascal (violoncelle) jouent Bach, Kodály, Halvorsen et Milstein. Se rapprocher de l’institut pour réserver est une idée prudente – la plupart des concerts sont complets très vite. Prix : 5 ou 10 €. Placement libre.
Dégoût

Quand tu te bats gracieusement, grâce aux artistes, pour valoriser l’orgue dont que t’es titulaire, et que les musiciens invités jouent avec un art quasi superfétatoire. Quand, avec l’aide de spectateurs, tu ranges en fin de soirée l’écran du concert brillant auquel tu viens d’assister, le tout dans un endroit discret convenu avec l’intendante. Quand tu découvres ce que le curé en a fait, sans doute grâce aux enfants de chœur vues les empreintes sur l’écran (en sus de jeter à la poubelle une demi-centaine de tracts qui ne leur avaient rien fait et que la paroisse avait financés), sans même t’en parler alors que tu l’as croisé moult fois depuis sa mésaction.
Alors, tu comprends que, en concertation avec l’intendante, il va falloir parler sérieusement avec ce malveillant. Parce qu’il abîme la paroisse, ses investissements matériels et immatériels, avec manière de lâcheté peu recommandable, et que c’est pour le moins benêt.
Enrique Seknadje, « Laisse-toi aller » (ne pas jeter sur la voie publique)

D’Enrique Seknadje, patron de la section « Cinéma » et maître de conférences à Paris-8 – sa mère ça rigole pas du tout car, dans cette université, la section « Cinéma » a du sens –, nous ne savions rien il y a quelque temps. Puis il nous sollicita pour participer à une journée d’étude universitaire très sérieuse sur la novélisation. (Lui l’écrit « novellisation », à la belge, façon Jan Baetens, mais nous luttons car pourquoi ?) Puis nous apprîmes sur les réseaux sociaux qu’il était aussi zicoss, auteur-compositeur-interprète à tendance rock. Joie, donc, de fricoter avec un zozo dissonant, à l’ère des piètres merdasses, maîtredeconférencisées parce qu’elles ont été les sages assistantes de la patronne en poste avant elles, soumises devant les exigences débiles de la hiérarchie et humbles devant les potentats locaux abusant de leur stupide pouvoir (chiasme, one point). Quand, enfin, nous découvrîmes que ledit Enrique Seknadje publiait une sorte de maxi (7 titres, 25 minutes), nous nous roulâmes-boulâmes, du verbe « je me roule-boule, nous nous roulons-boulons, que je me roulasse-boulasse » au prétérit, afin de voir ce qu’est-ce que le zozo avait dans le ventre. Et, in fine, quelle joie de jubiler en ayant démonstration de son talent !
[Et oui, je sommes programmé à ladite prochaine journée d’études ; et non, je n’en attends aucun autre avantage que débattre avec des collègues compétents, issus d’horizons variés, et le plaisir, non négligeable, de causer de ce de quoi c’est que j’ai étudié et pratiqué pendant un p’tit moment. Bref, stipulons-le, oui, je me laisse aller mais je ne lèche pas d’entre-fesses. Si que tu penses le contraire, je comprends ton doute mais passe ton chemin, j’peux rien pour toué, étant entendu que j’assume le « toué », vu que j’aurais aimé aller folâtrer en chantant au Québec, en Gaspésie, en Acadie, mais faut croire que j’ai pas le mojo. Bref.]
Le nouveau disque de l’Enrique est auto-annoncé depuis deux ans. Son actualisation toute fresh met en avant une veine mélodique transcendant maintes questions de style. Bien sûr, on peut chercher à situer l’olibrius. Pour ceux qui nous suivent, ce serait un croisement entre François Marzynski pour le rock en français sans complexe, lyrics compris (« Ça sent le cul » se transforme ici en « C’est juste une folle petite envie de foutre »), et Jean-Jacques Nyssen pour la voix nasale maîtrisée et l’univers singulier (première intro de « Avec excès » !), le tout shooté aux Forbans pour le single voire le plaisir sporadique du « r » roulé. Pour les autres, je sais pas. Ce qui compte, me semble-t-il, c’est trois choses :
- un, le rendu est soigné (son équilibré, multiple, énergique, précis, on n’est pas dans your average EP autoproduit, merci Léonard Mule pour la réalisation et Hubert Marniau pour le mastering) ;
- deux, le travail est multiple (aux singles boostés répondent les mid-tempi assis sur une mélodie et une ligne de basse qui en font des chansons au moins aussi gouleyantes que les titres plus « speedés ») ;
- trois, l’œuvre est certaine (unité dans la diversité ; personnalité ; souci de rappeler que le rock, c’est aussi de la musique, avec l’aide des batteurs Elvis Chedal-Anglay et Jessy Rakotomanga).
Des regrets ? Bien sûr. Au moins deux : la brièveté du disque, dont on imagine la raison (sans doute concentrer les moyens sur un rendu qualitatif) ; et le manque de lâcher-prise sur les soli de fin de chanson, promesses laissées en suspens (« C’est une prière », « Le contrat »), les fade out étant la rançon de notre admiration pour la propreté du rendu. En débarquant dans l’univers de l’artiste, on ne saisit sans doute pas tous les filaments qui donnent chair et sens à son monde. Pourtant, on apprécie à peu près tout, jusqu’à ce que l’on ne comprend pas logiquement, voire jusqu’aux fausses fautes d’orthographe (« Je t’ai pardonnée », avec cette ambiguïté de la fonction du « t' », entre, comme on disait jadis, COD et COI), prolongeant le questionnement de la chanson lors de la lecture du livret.
En résumé, une énergie formidable irrigue le disque, l’ensemble des titres est brillant, le son est excellent, les paroles captent l’auditeur ou dans leur hermétisme ou dans leurs références littéraires (fort « Sans être aimé »), le sens mélodique et le souffle des arrangements avec les moyens du bord emportent une adhésion que la modestie assumée des enchaînements entérine (titres 5/6). C’est vivant, vivifiant, efficace, pro et maîtrisé : on aimerait voir ça en live – et c’est le plus beau compliment que l’on puisse faire à un disque de rock français, as far as we are concerned. Quitte à susciter une inquiétude, forcément fondée : que des gens produisant à leurs frais une musique qualitative, personnelle et néanmoins partageable, s’égosillent dans le désert parce que des saloperies de grosses productions, fussent-elles labellisées indépendantes, saturent le marché et les médias. Pour lutter contre cette hypothèse, soutenons Enrique Seknadje et achetons son disque.
Pour acheter le disque, contacter Enrique Seknadje via Facebook. ou m’envoyer un message via ce site. Le prix est au choix de l’acheteur, entre 7 et 10 €, port compris.
En attendant Vincent Crosnier…
… on a profité du talent technique, musical et très personnel de miss Esther Assuied, à travers Bach, Wagner, Vierne, Debussy, Pärt, Zimmer et Boédec. Oune pétit bijou. Et cette joie de penser que l’aventure Komm, Bach! se prolonge dès samedi prochain avec Vincent Crosnier en personne pour un programme Bach, Scarlatti, Schumann, Vierne, Vierne encore, Guillou et Charpentier. Ouf et chic !
La chouchoute de Komm, Bach! est en voie

Esther Assuied est l’une des jeunes musiciennes les plus talentueuses que l’on connaisse. Complètement disjonctée et cependant élève des plus grands conservatoires en piano, pianoforte, orgue et trompette, elle est donc virtuose, professionnelle, personnelle et passionnelle. Si vous pensez encore qu’un récital d’orgue, c’est un truc chiant, restez chez vous.
Vraiment.
Vous seriez obligés de changer d’avis, et on sait combien ça peut être pénible. Et après, vous reviendriez à tous les concerts du festival Komm, Bach!. Non, on ne veut pas vous infliger ça.
André Derain, « La décennie radicale », Centre Pompidou, 16 novembre 2017
Après que l’on a apprécié l’exposition en trio associant André Derain, Balthus et Alberto Giacometti, l’heure était venue de profiter du complément offert par l’exposition Derain only proposée par Pompompompidou (c’est le nom qui est marrant), en dépit de l’entrée squattée par un groupe de plus ou moins free jazz, pour le grand plaisir de nombreux curieux.
L’unité de temps proposée, 1904-1914, est, certes factice puisque, d’une part, les premières pièces proposées, datées d’avant 1904, sont hors sujet ; d’autre part, la rupture de 1914 paraît, à l’échelle de l’artiste, artificielle. Reste que, en onze salles, inégalement garnies mais, dans l’ensemble, riches de nombreuses propositions, la commissaire Cécile Debray, assistée de Valérie Loth, de Claire Blanchon et de Corinne Marchand (horrible inégalité sexiste, s’offusqueront à bon droit les plus conscious de nos lecteurs), rassemble une production protéiforme qui capte l’intérêt, surprend souvent et ne déçoit jamais, quitte à désarçonner.
Partant sur un exemple monumental de copie d’une toile italienne, retranscrit avec un sens de la géométrie qui prendra sens en fin de parcours, la visite permet d’embrasser une production éclectique tant picturalement (les peintures ressortissent de différents styles) qu’esthétiquement (les peintures côtoient notamment des photographies, des gravures, des dessins aux allures de gribouillis, des sculptures, quelques céramiques et une épistole). Par-delà les différences de style, de support et de format, frappe l’unité. Ou plutôt les trois grandes unités : une appétence pour la chair, une gourmandise pour les couleurs, un désir d’exploration – exploration de paysages, de corps, de techniques, de limites, de propos, de rapports au réel…
En dépit d’un éclairage imparfait car, comme souvent, inadapté puisque trop sujet à susciter des reflets évitables – pourquoi plus de soin dans une peinture que dans un travail lumineux ? –, l’exposition laisse le visiteur se plonger dans l’étrange rapport à la réalité qu’entretenait le peintre. Celui-ci pouvait à la fois mettre au carré le « Bal à Suresnes », évoquer un tronc marron avec quatre ou cinq teintes différentes (orange, rose, bleu, vert, noir…), trouer la couleur unie de la mer par de grands blancs, capter la fragilité d’une jeune fille, symboliser « Mme Derain » avec un visage ovalisé, abandonner les pieds de ses modèles à une simplification carréifiante, leur offrir des mains à six doigts (voir la « Jeune fille en noir », dont l’autre représentation proposée efface ce détail de la main gauche), leur décaler les tétons, épurer à grandes lignes des paysages qui sentent autant le Sud que la banlieue parisienne, s’engoncer dans les champs des villes d’antan en se roulant dans une imprécision choisie, mimer le lointain des cabs londoniens par une forme vague tranchant avec le premier plan, etc.
Saisi, le visiteur benêt que nous sommes s’impressionne volontiers de la variété des manières de représenter. D’autant que l’illusion n’est pas le maître-mot, comme en témoignent ces toiles d’apparence simplistes tranchant avec les efforts fauvisto-impressionnistes fascinants du Londres de 1910. Pour André Derain, il ne s’agit pas d’imiter le réel, mais de l’inviter dans la danse que la peinture permet au trait, à la couleur et à notre imaginaire, d’entretenir incestueusement.
Traversé de pulsions contradictoires donc complémentaires, André Derain laboure tant l’héritage de la Renaissance que le frustre de l’art brut, la symbolisation de l’environnement, le retravail des mythes antiques et le rôle central de la corporéité : le fripon ne se fixe pas sur les baigneuses et les danseuses que pour faire écho à ses prédécesseurs et contemporains, ou que pour faire honneur à la beauté de l’art ; pourtant il leur donne un écho artistique, éventuellement détonnant, qui inspire celui qui regarde le fantasme fixé sur pigments. La variété des formats, de la taille d’une diapo à la toile monumentale qui clôt l’exposition, achève de vertiger le spectateur comme un boxeur ayant du mal à établir sa distance avec un adversaire-partenaire roué.
- « Mme Derain » d’André Derain vue par Josée Novicz.
- Le bal à Suresnes (détail). Photo : Josée Novicz.
- Big Ben (détail). Photo : Josée Novicz.
- Vue de Cagnes (détail). Photo : Josée Novicz.
En conclusion, même si l’exposition a d’évidentes faiblesses (l’avant-dernière salle semble rassembler des objets de bric et de broc, la présence de statues collectionnées par l’artiste s’inscrit difficilement dans le parcours, on n’est pas sûr que la décoration de céramique ait une valeur plus que décorative au regard du reste…), la richesse de l’ensemble est incontestable ; l’intérêt de l’artiste est habilement mis en évidence ; la proposition de visite est à taille humaine et permet de prendre à la fois le temps de vaguer et celui de s’attarder sur des pièces freshy ; la problématisation autour d’une décennie ultracréative est bien conçue par le dialogue des deux grandes toiles ouvrant et concluant l’exposition, l’une sur le réinvestissement d’une tradition, l’autre sur le syncrétisme artistique exp(l)osé par cette visite. En cinq mots, une belle poursuite de découverte – oui, vous pouvez recompter, ça fait bien cinq.
Oisiveté professionnelle
- faire imprimer les affiches du concert du 25 septembre puis les massicoter,
- suivre le règlement de la graphiste,
- contrôler l’affiche pour le concert du 9 décembre,
- remplir + faire tamponner + scanner + envoyer la demande d’autorisation SACEM et la set-list du concert de Vincent Crosnier,
- reclipser l’écran géant et crapahuter sur le hall de l’accueil, dans l’église, pour évaluer la faisabilité d’une dissimulation ultérieure,
- remettre des leaflets à disposition d’un public qu’une main sale et une âme noire ont brimé en jetant les précédents programmes de la saison 2017-2018 ;
- prendre rendez-vous pour hisser l’écran vers les voûtes sans que ça dérange trop le patron,
- se préparer à vidanger la mémoire de la caméra sur le disque dur donc constater la disparition de la connectique adaptée,
- faire imprimer puis plier les programmes du concert d’Esther Assuied,
- boire un café.
Ainsi, l’un dans l’autre, la matinée se passe à rien foutre. C’est l’un des avantages d’organiser un festival, faut bien avouer.
Bisou, Freud
 Cette nuit, fus réveillé par ma propre rigolade : mon inconscient, devant bien s’emmerder pendant mes cauchemars (il est vrai que je me retrouvais à Albi, en escale autobussée, après que mon car est reparti avec toutes mes affaires, le pitch de mârde, quoi), me remémorait cet épisode des aventures d’Eusèbe dans le premier tome de « De cape et de crocs » (Ayroles/Masbou, éditions Delcourt). Pensai donc à le partager ce matin, pour tous les inconscients en veille.
Cette nuit, fus réveillé par ma propre rigolade : mon inconscient, devant bien s’emmerder pendant mes cauchemars (il est vrai que je me retrouvais à Albi, en escale autobussée, après que mon car est reparti avec toutes mes affaires, le pitch de mârde, quoi), me remémorait cet épisode des aventures d’Eusèbe dans le premier tome de « De cape et de crocs » (Ayroles/Masbou, éditions Delcourt). Pensai donc à le partager ce matin, pour tous les inconscients en veille.


















