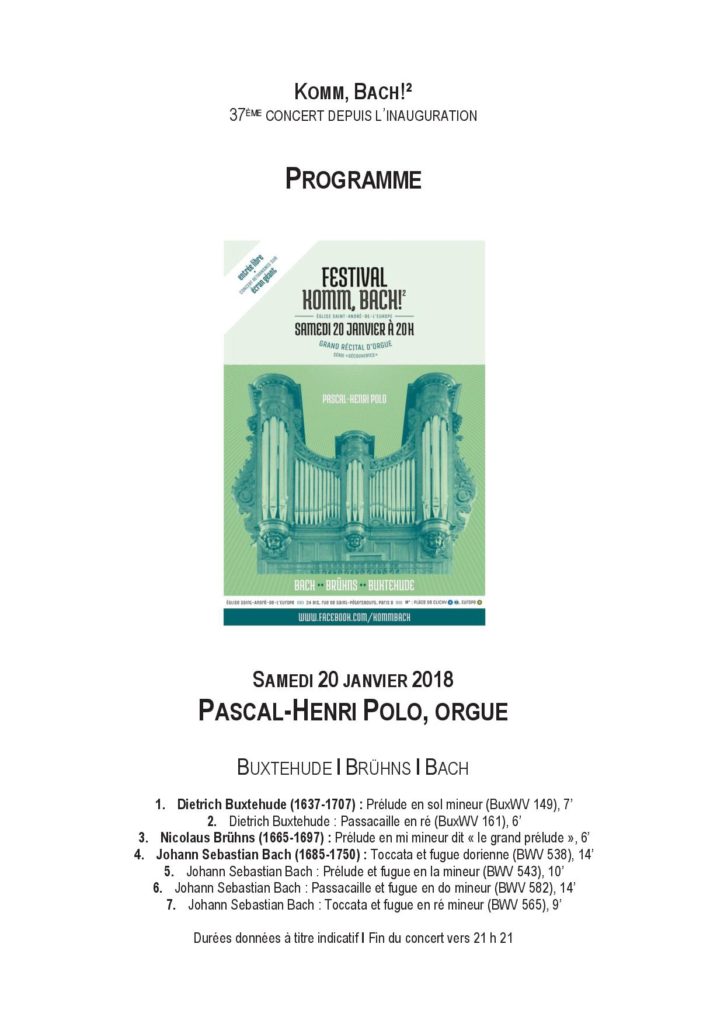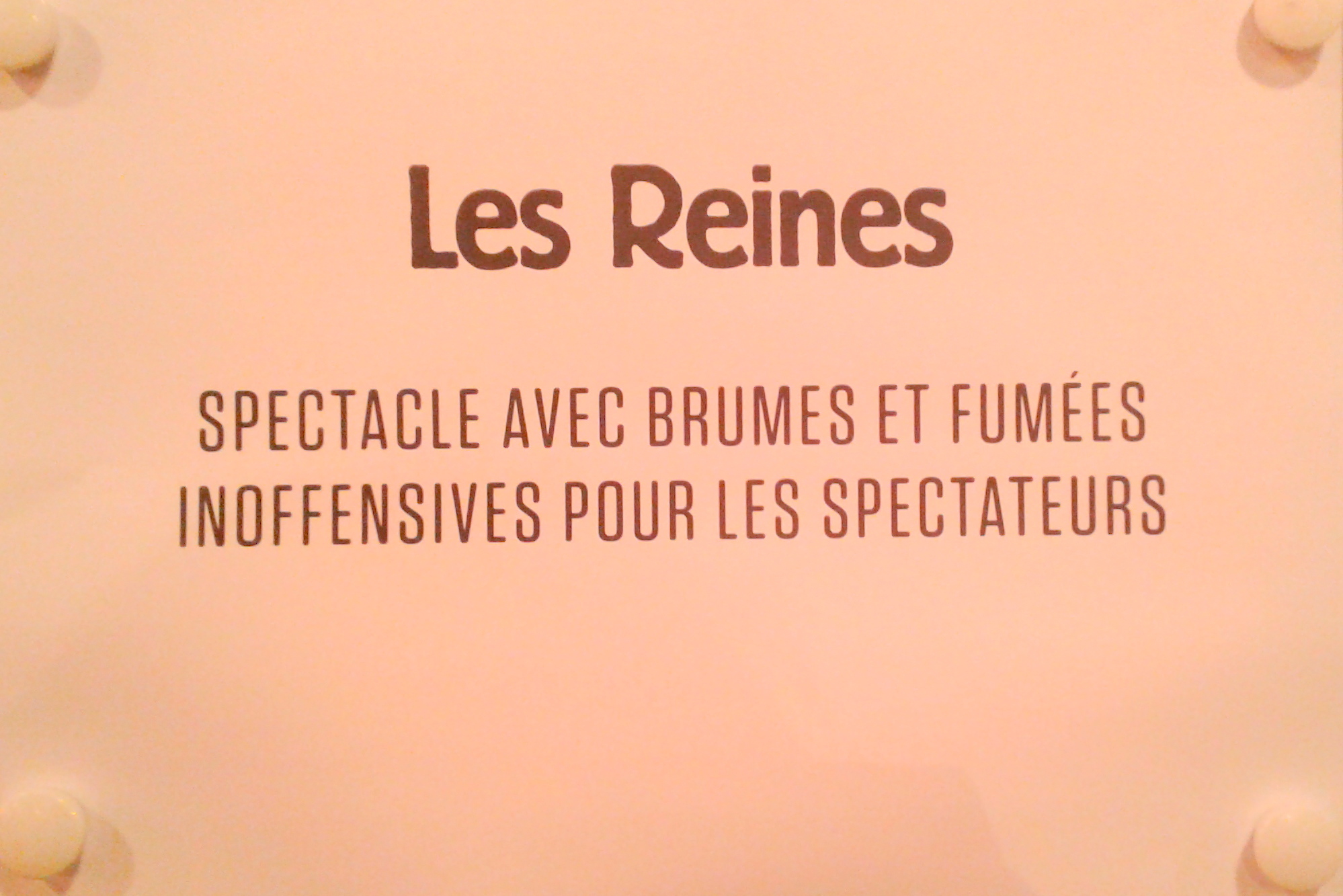Un bal masqué, Opéra Bastille, 22 janvier 2018

Nina Minasyan (Oscar), Piero Pretti (Riccardo), Sondra Radvanovsky (Amelia) et Simone Piazzola (Renato). Photo : BF.
L’histoire
Le comte Riccardo (Piero Pretti), après avoir fait des misères à de nombreux sujets, est menacé par un complot. Cependant, sa vraie préoccupation est de conclure avec Amelia (Sondra Radvanovsky), hélas femme de Renato (Simone Piazzola), son meilleur allié [acte I, 1 h]. Sur les conseils d’Ulrica (Varduhi Abrahamyan), une sorcière entourée de négresses – si, dans le contexte, le terme est pertinent pour évoquer des figurantes à peau sombre traitées comme des esclaves et parfois pas très vêtues du haut –, la nénette part chercher une plante pour ne plus penser au comte qu’elle aimerait s’envoyer en dépit du contrat conjugal. Le comte la rejoint. Renato débaroule pour lui signaler que des méchants arrivent. Il découvre le pot-aux-roses et tout le monde se gausse du cocu putatif [acte II, 30′ puis entracte]. Renato fulmine, tu m’étonnes. Pour se venger, il pense buter sa femme puis décide de rejoindre les méchants pour éliminer le comte – en l’espèce Tom (Thomas Dear) et Samuel (Marko Mimica). Lors du bal masqué organisé le soir même, le mari jaloux repère le comte sous son déguisement grâce à Oscar (Nina Minasyan, ancienne Lucia) et le poignarde. Avant de périr longuement, Monsieur le comte lui pardonne, ouf [acte III, 1 h].
Le constat
Une fois de plus, deux artistes français seulement se glissent dans la distribution – le chef Bertrand de Billy et Vincent Morell dans le minirôle de Giudice. Le reste est non pas arménien (signora Martina Biagini nous stipule qu’Ulrica a fait ses études à Erevan mais est Française, dont acte), canadien, russe, anglais et coréen, voire d’origine monégasque (Thomas Dear revendique sa nationalité française). En soi, ça n’aurait rien de scandaleux si l’État français ne subventionnait pas autant cette institution. Après tout, depuis le film de Jean-Stéphane Bron, la structure utilise sans cesse Mikhail Timoshenko : pourquoi ne pas faire profiter un Français de cet art de la formation ? Ne pas se servir de Bastille ou de Garnier, qui coûte si cher aux contribuables, afin de permettre aux nationaux de s’aguerrir ou de briller est une gabegie culturelle que nous tenons à dénoncer, na.
Le spectacle
Loin des mises en scène extravagantes avec soldats nazis s’enculant pendant Aida, garçons en tutus ou cosmonautes souillant Puccini dans une mégaboîte en carton (on synthétise à peine), la régie de Gilbert Deflo reprise cette saison fait le minimum. Les décors de William Orlandi sont réduits à un élément symbolique (quatre, pour les quatre lieux différents) : un amphithéâtre pour le palais, un hémicycle pour la maison de Renato, un portique pour « le lieu de mort » où se trouve la plante magique, etc. Rien de répulsif, mais ce niveau d’épure sent d’autant plus le travail bâclé que, de mise en scène, point. Les personnages s’ennuient, ne savent que faire de leur corps et de leurs déplacements. Pour mimer l’émotion, ils s’appuient contre un élément scénique et le caressent. Quand ils ne savent plus comment s’occuper parce que c’est pas eux qui chantent, ils s’endorment – ainsi de Renato pendant l’air déchirant où la mère réclame de voir son fils avant d’être trucidée par son époux. C’est affligeant, d’autant que cette absence de densité dramatique impacte, inévitablement, la portée de l’œuvre.
La musique
Trois choses.
D’abord, Un ballo in maschera est l’un des opéras de Giuseppe Verdi les plus plaisants à écouter. Si la finesse d’accompagnement ne rend pas toujours raison du talent du compositeur, la multiplicité des scènes, la foule d’airs pyrotechniques, l’utilisation d’ensembles efficaces et variés, la structuration nette en cinq tableaux réguliers et lisibles, le sens du gimmick et de la mélodie gourmands, tout concourt au plaisir sans fard du spectateur.
Ensuite, entendre ce classique en direct, dans un opéra doté d’un orchestre et d’un chœur du niveau de Bastille, voilà qui renforce le pétillement, même si, parfois, on aimerait, dans notre toute-puissance de spectateur fantasmant, que les contrastes et l’énergie fussent rendus avec plus de vivacité par la bande à de Billy. La tonicité des hommes, la justesse de la phalange et la précision des instrumentistes solistes (clarinette) ou seuls à accompagner (harpe) séduisent.
Enfin, devant la difficulté et la répétition des airs proposés aux premiers rôles, notamment aux II et III, Un bal masqué exige une distribution sans faille. Piero Pretti, qui sait brillamment gérer une voix un peu fatiguée – on la comprend – sur la fin grâce à la volonté et au métier, et Sondra Radvanovsky, qui sera remplacée par Anja Harteros en février (avec augmentation des prix), démontrent sans ambages qu’ils ont l’étoffe, la voix, le souffle et la technique superlatifs indispensables. Dès lors, comment expliquer que ces chanteurs impressionnent, à défaut d’éblouir par la beauté de leur voix, mais émeuvent si peu ? Assurément, la démission de la mise en scène (pas longue à apprendre donc pratique, c’est sûr) et l’absence de travail d’acteur sont fautifs. Face au livret fonctionnel, ridiculement donc plaisamment transposé à Boston pour faire zizir à la censure d’époque, jamais Gilbert Deflo ne commet l’effort de donner du sens à ce mélodrame, par exemple en confrontant l’enthousiasme officiel du peuple et la rage des courtisans qui ont pris cher, sans faute d’orthographe, avec ce tyran vicieux que la pièce présente comme un brave type. Ou en interrogeant cette notion de « pureté » et du récurrent « ciel », ou en besognant la notion d’Amérique (où, aujourd’hui encore, on déplace les critiques que l’on n’oserait point porter sur la France, par exemple pour dénoncer Trump car l’on ne saurait égratigner notre Saint Cochon de Pharaon Ier de la Pensée Complexe Contre les Fékniouz), ou… Ici, rien. Donc grande performance vocale, et béante déficience d’émotion : sans drame, reste le mélo. Dommage.
La conclusion
Un grand opéra suscitant du plaisir, une interprétation digne inspirant des brava, des chanteurs à la hauteur justifiant les applauses de rigueur, mais pas de frissons. Disons que l’essentiel y était, mais ce qui manquait n’était pas superflu.
En attendant Laura Sarubbi et Salvatore Pronesti…

Oui, c’est vrai. Organisateur désorganisé, j’avais oublié mon vrai appareil photo avant le concert de Pascal-Henri Polo. Alors, pour garder trace de ce concert spectaculaire, incluant les deux grandes toccata-et-fugue (la dorienne et le tube), le prélude 543 et la passacaille-et-fugue, rien xô, on a pris des photos pourries mais hypertypées avec des smartphones qui firent ce qu’ils purent, avec un « r ». En commençant par la photo chronologique du concert-d’après-Noël, en continuant par l’image très symbolique sur l’artisss et sa p’tite chérie assignée au redoutable poste de tourneuse de page…

… et en terminant par la classique photo technique. Ça ne dit rien de la performance et du brio de ce néo-Caennais, mais ça signifie que, quand son crowdfunding Ulule sera lancé, on en rereparlera. Na. D’ici là, rendez-vous samedi pour la fin de la trilogie de janvier avec un couple d’Italiens virtuoses prêts pour jouer Alain, Widor, Bach et Mendelssohn. Entrée libre, grand géant (pardon, cran géant), musiciens zzzzinternationaux aux commandes, voulûmes faire sus mais ne pûmes. Le lot commun, en somme.
« Genesis », Classe de composition, CNSMDP, 19 janvier 2018

Laurent Petitgirard et l’orchestre du CNSMDP, avec Manon Galy en violon solo. Photo : Bertrand Ferrier.
On connaissait Genesis revisited, superbe album de Steve Hackett covérisant ses années de groupe. Cette fois, rien à voir avec le combo de rock progressif : Bruno Coulais, compositeur original, demande à ses élèves de la classe de « composition à l’image » du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, ouf, d’écrire, à six, une partition sur Genesis, film de Claude Nuridsany et Marie Pérennou.
Le projet : sur un film célébrant la nature (la naissance fantasmée ou scientifique de la vie, mais aussi les origines mythiques du récit via le griot Sotigui Kouyate), six étudiants du CNSMDP proposent chacun leur musique pour un bout de 1 h 15’, dans une interprétation remarquable – après un début compliqué – de leurs condisciples dirigés par Laurent Petitgirard.
Le résultat : bien qu’un peu souillé par la marque du vidéoprojecteur, suppute-t-on, gravé sur l’image de bout en bout, le métier des compositeurs paraît déjà évident et remarquable. Certains ont bien pointé la difficulté d’écrire dans la presque-urgence (une enseignante du Conservatoire nous rapportait le cas d’une des six personnes à qui elle demandait de raconter ses vacances de Noël et qui lui a rétorqué : « Pas de vacances, je composais »), mais tous ont rendu un travail de grande qualité, alors que chacun n’était pas traité à la même enseigne – c’est plus facile d’ouvrir ou de clore un film, faut reconnaître. Au-delà des spécificités, on remarque un goût général pour le célesta et ses effets aussi faciles qu’efficaces, le piano en monodie et, misère, l’accordéon. Les cordes sont plus souvent valorisées que les vents (un seul compositeur met en avant la clarinette basse) : la composition à l’image doit supposer, conclut-on, une efficience, donc une consensualité assez cadrée.

Laurent Petitgirard, Julien Mazet, Nathan Rollez, Minwhee Lee, David Jorda-Manaut, Stanislav Makovskiy, Pierre David et Bruno Coulais sur la scène de la salle Rémy-Pflimlin du CNSMDP. Photo : BF.
Pour admettre nos préférences, nous proposerons deux catégories. Hasard ou réalité scientifique, la première, qui concerne le métier, reconnaît la clairvoyance du prof qui a attribué l’ouverture et la fermeture à ses deux élèves les plus convenables, ce qui n’enlève rien à leur savoir-faire mais le fait passer devant leur personnalité – peut-être une qualité dans ce genre pour partie fonctionnel. Julien Mazet propose une ouverture assez sûre d’elle pour associer des ensembles orchestraux de géométrie différente, alors que la plupart de ses pairs se servent souvent de l’entièreté de l’extraordinaire outil qu’est ce grand orchestre. Pierre David signe une clôture remarquable dans la variation d’atmosphères. Dans la seconde catégorie, celle des personnalités singulières, on accordera une médaille d’argent à David Jorda-Manaut qui, sans renoncer à quelques effets superfétatoires, parvient à évoquer des contrastes dépassant la stricte description iconique (les excellents bruitages intégrés au film suffisent à cela). Dans notre toute naïveté, nous remettons néanmoins la médaille d’or à Nathan Rollez, pour son sens des harmonies inattendues, qui remotive sans fard la musique de film en y apposant une patte personnelle laquelle, en stimulant l’écoute, stimule aussi le regard – loin des procédés systématiques permettant aux vedettes du genre d’apposer leur griffe sur un film.
En conclusion, une classe visiblement bien coachée, quelques personnalités de compositeur évidentes, un grand outil orchestral et un beau projet à entrée libre applaudi par une salle comble : bref, belle soirée.
Vous repass’rez bien un p’tit Bach ce samedi ?
- KB2 – Programme 09 – 1
- KB2 – Programme 09 – 2
Un florilège Bach assorti à deux grandes pièces de Brühns et Buxtehude, le tout sous les doigts et pieds d’un jeune organiste à découvrir, avec entrée libre, sortie aussi, écran géant pour suivre le concert comme si vous jouxtiez le musicien, et programme papier offert aux quarante premiers visiteurs : peut-être une idée de sortie digne de votre samedi soir ?
Three Billboards outside Ebbing, Pathé Wepler, 17 janvier 2018

Grand film sur la disparition d’un enfant, façon Faute d’amour, ou mélodrame sirupeux sur un deuil impossible – l’héroïne ne travaille pas pour rien dans une boutique de souvenirs ? Les avis tranchés s’opposent pour évaluer ce film que les producteurs présentent comme l’un des favoris des Golden Globes – argument marketing fragile si l’on n’est pas de ceux pour qui un prix, virtuel ou non, donne du prix. Voici donc ce que nous inspira Three Billboards outside Ebbing, Missouri réalisé par Martin McDonagh.
L’histoire
Mildred Hayes (Frances McDormand) enrage car le viol et l’assassinat de sa fille restent impunis. Elle décide de profiter de trois panneaux publicitaires, à l’entrée de la ville, pour interpeler le chef des flics, Bill Willoughby (Woody Harrelson). Les pressions s’accumulent contre cette initiative, d’autant que le policier numéro un se meurt d’un cancer. Inflexible mais blessée par les brimades de l’adjoint au chef, Jason Dixon, joué par Sam Rockwell, et par son ex-mari interprété par John Hawkes, Mildred file un mauvais coton, jusqu’à mettre le feu au poste de police… et partir se venger d’un innocent avec Jason, qui a lui-même mal agi avant de se repentir. Iront-ils jusqu’au bout de leur projet, et sinon quoi ?
Le film
Le projet joue sur les contrastes. Entre de grands paysages et la petitesse d’une ville étouffante. Entre une affaire sordide et des velléités de pastilles drôlichonnes, qu’incarne le personnage pathétique de la mère du flic violent. Entre la volonté d’une héroïne et la vanité de son espérance. Entre la simplicité du déroulement et les dissonances entraînées par des ellipses temporelles (prolepse et analepse). Entre les personnages stéréotypés (la bonne mère têtue, le méchant ex, le good cop vs le bad cop, la nouvelle nana écervelée, etc.) et… et rien, tant Martin McDonagh tient à ce que les acteurs jouent des monolithes, non des êtres de chair évolutifs ou fluents. La caméra oscille donc entre champ-contrechamp banal, plans larges rendant hommage au décor naturel et plans serrés pour mimer la pression qui se resserre sur le personnage et le fait, parfois, exploser.
Le scénario, sérieux et sans fantaisie, exploite posément les ingrédients liminaires (le scandale dans une petite ville), montrant comment nous nous construisons autour d’éléments qui nous cristallisent, nous sédimentent et nous contraignent à jouer le personnage que nous nous sommes inventés. L’exception constituée par le flic violent transformé par la lettre posthume de son ancien patron et par sa semi-crémation, est plus liée à l’envie d’ouvrir une fin ouverte et positive qu’à une originalité dans un océan de platitudes plus souvent sucrées que corrosives – ah ! le pauvre Red Welby (Caleb Landry Jones) se retrouvant par hasard dans la même chambre d’hôpital que son bourreau et lui servant un verre de jus d’orange, comme c’est émouvant !
Les amateurs de radicalité passeront donc leur chemin, tant le portrait de la topique Mère courage, capable de presque tout pour sa famille, s’échoue en chemin (l’engrenage dans lequel elle semble engagée se dissout sur le happy end final, dissipant ainsi le fumet prometteur de tragédie). Ce choix de désamorcer systématiquement, après quelques soubresauts, les minuteurs pourtant fixés sur les bombes humaines – ha, ha, je parle en parabole, moi aussi – serait, n’en doutons pas, moins escagassant si une horripilante musique doucereuse (Carter Burwell) ne souillait pas l’image par sa mollesse digne d’un sycophante mollichon. Annoncé par un tube fredonné par la Fleming, le style contemplatif de la partition additionnelle la fige dans un fond de sauce hérissant et jamais capable de nous emporter comme pouvait le faire, dans une veine pas si éloignée, Pat Metheny décorant A map of the World en 2000. Ajoutons que le sous-titrage est honteux, à la hauteur de la traduction du titre, pourtant joli en anglais et tellement réducteur en VF. Mais voilà, dans l’Hexagone, on ne casse plus les couilles, on enquiquine ; et, de raccourcis approximatifs en euphémismes inappropriés, ces petites lignes blanches frisottant le faux sens à plusieurs reprises ne cessent de rajouter du sucré écœurant dans un film qui n’en demandait pas tant.
La conclusion
Three Billboards semble soucieux de ménager la chèvre (rage devant une police inefficace, même si c’est pas sa faute) et le chou (surtout pas d’éloge de la vengeance perso). Les meilleurs moments rejoignent l’animal et le légume, par exemple quand le réalisateur tente de mettre en scène les conflits de petit lieu clos sur lui-même ; mais les personnages clichés, tel Abercrombie (Clarke Peters en vieux flic sage, ersatz de Morgan Freeman) et l’excessif souci de lisibilité du propos font plutôt pencher la balance annoncée au début du côté du mélodrame sirupeux, où le suicide par balle se métaphorise par la noyade d’un nounours. L’image léchée ou habilement salie déploie ainsi un film digne, pas inintéressant, pas vraiment ennuyeux malgré des cucuteries évitables (le revival platissime de la dernière scène avec la fistonne vivante), mais pas non plus, à notre goût, assez créatif ou vigoureux pour rendre justice d’un pitch prometteur (une femme, seule et décidée, contre un village et un crime parfait).
JSB approche !
Vous ne le connaissez sans doute pas. Pourtant, Pascal-Henri Polo est un de ces jeunes virtuoses résolument originaux qui, tout en n’ayant pas la carrière toute tracée des futurs gendres parfaits et mignons tout pleins, secouent les orgues avec un talent et un art résolument personnels. Au programme spectaculaire de ce « concert des 3B », Bach, Brühns et Buxtehude, un florilège Bach dont la toccata la plus célèbre du monde et le plus beau quart d’heure jamais écrit pour le roi des instruments : la passacaille et plus BWV582.
Oubliez le froid et la pluie de janvier. Profitez de la beauté. Entrée libre et, inch’Allalalalah, écran géant avec vidéaste dédiée. Pour rejoindre l’événement FB, c’est ici.
Flore Vesco a beaucoup de goût
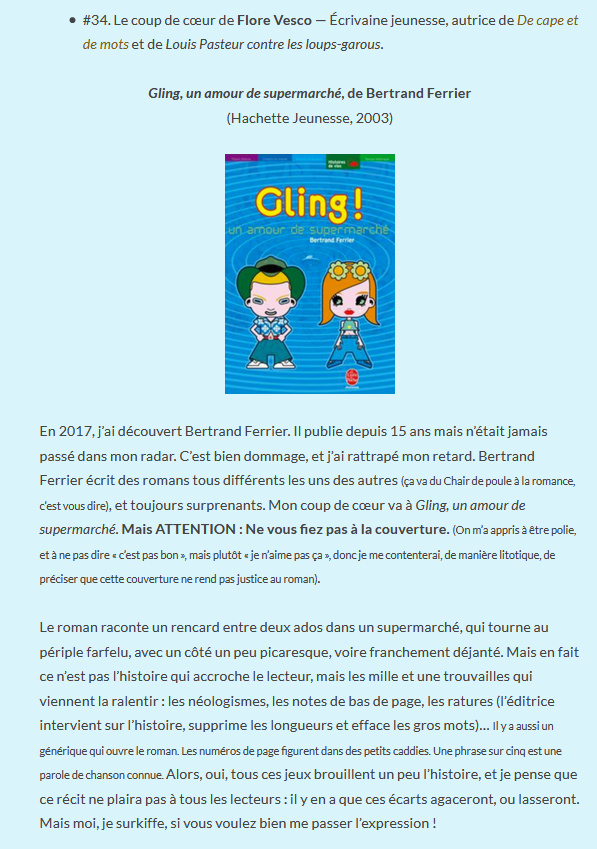 Hâte de lire ce que griffonne cette petite Flore : son goût semble sûr et certain, et j’aime déjà beaucoup son œuvre. Au moins cet article.
Hâte de lire ce que griffonne cette petite Flore : son goût semble sûr et certain, et j’aime déjà beaucoup son œuvre. Au moins cet article.
« Les Reines », Manufacture des Œillets, 12 janvier 2018
À quoi pensent les femmes ? Normand Chaurette pose la réponse en donnant la parole aux reines qui hantent Richard III de Shakespeare. Celles-ci quittent le rôle d’êtres sans défense, celui que Bill leur aurait attribué (#balancetonporc), pour prendre tout l’espace dans cette sorte d’alternative version narrant la lutte entre Édouard mourant et Richard III, côté cénacle des femmes.

De quoi s’agit-il ? Y a Élisabeth (Anne Le Guernec), la reine, la vraie, qui n’est plus reine que pour quelques heures : son époux le roi agonise. Y a Isabelle et Anne Warwick (jolie Pauline Huruguen et omniprésente Marion Malenfant), clairement là pour prendre le pouvoir en s’appuyant sur leurs mecs, leurs mensonges (« j’ai douze ans ») et leur sens du sacrifice des autres, type bébés ou concurrents – spoilons, avec deux « s », ça réussira à Anne. Y a la duchesse d’York (Sophie Daull), réputée pétée du casque – elle a un bandage sur la tête, c’est dire –, qui impose mutisme à qui elle veut. Y a Marguerite d’Anjou (formidable Laurence Roy), running gag triste, toujours sur le départ et toujours là, qu’elle parte pour la Russie ou la Chine. Et y a Anne Dexter (Bénédicte Choisnet), la sœur, dont on a coupé les mains et qui est réputée muette – si on l’entend, c’est le fruit un peu pourri de notre imagination.
Comment ça se passe ? Dans le nouveau Centre Dramatique National d’Ivry, rénové par l’architecte Paul Ravaux, la grande salle se présente dans une configuration « bifrontale ». En clair, imaginez un catwalk qui tient lieu de scène. De part et d’autre, des rangées de spectateurs. Derrière chaque rangée de spectateurs, une tribune où les acteurs peuvent se mouvoir. Théâtre contemporain oblige, pas de décor hormis un indétrônable siège, des personnages qui circulent parfois en patins à roulettes en dépit de costumes qui n’hésitent pas à « faire d’époque », avec robes souvent décolletées, collerettes réalisées par les lycéennes stagiaires et couronne de Barbie marquant le pouvoir. Quelques accessoires meublent l’espace : ainsi, un globe-coffre encombrant symbolise l’impossibilité du voyage, et deux poupons dans des vases clos représentent les enfants d’Elisabeth.

Marion Malenfant (Anne Warwick), un extrait, avec les patins et les deux bébés en bocal. Photo : Bertrand Ferrier.
Et c’est bien ? Admettons-le, pour encaisser ces cent cinq minutes de spectacle, il faut passer outre les stéréotypes censés faire moderne. Par exemple ? Mix’n’match d’époque, surjeu de certaines actrices, bande-son plus souvent consternante que banale (oh, la chanson liminaire ! oh !), tunnels de référenciation (par ex. on attend la mort du roi comme la venue de Godot ou le décès du Roi qui se meurt), association entre des passages plutôt obscurs et des redondances vaines (trois coups de cloche, et une actrice de dire « tiens, il est trois heures » ; ou « le brouillard a envahi Londres », et pschitt, un coup de machine à fumée). Passer outre est néanmoins une bonne idée car la pièce de Normand Chaurette joue sur l’indécision, ce qui stimule. Cet affrontement navrant de femmes passionnées par le pouvoir, « même pour dix secondes », rappelle-t-il que les femmes sont des hommes comme les hommes, les pauvres créatures, ou que l’égalité des sexes n’est pas un antidote à notre désir, aussi ontologique que sexuel, de pouvoir ? Ces scènes d’émotion (la passation de couronne, les départs impossibles) pointent-elles que l’humain batifole même dans le plus sombre d’entre nous, ou que la mécanique égotiste plaquée sur du vivant l’emporte à tous les coups sur ceux qui montrent de touchantes faiblesses ? Ces lumières au cordeau d’Yves Collet et de Léo Garnier, qui créent l’espace scénique (Dominique Lerminier, le directeur technique, était ému en pensant que toutes les ressources de la régie étaient sollicitées pour cette représentation – « ça fait un très joli schéma sur l’écran », confiait-il, touché comme seul un technicien artiste peut l’être, à l’issue de la première), éclairent-elles la noirceur des âmes ou sont-elles permises par ces desseins obscurs qui nous animent (il faut la nuit pour voir la lumière) ?
En conclusion : oui, il est bon de se laisser bousculer par les clichés qui maculent le spectacle, et de presque-oublier les billevesées aussi creuses que pseudo-poétiques déversées par une actrice dans le dossier de présentation – la langue du dramaturge y est décrite comme « une sorte de venin toxique (sic) qui attaque les chairs, pétrifie le souffle, fermente le vivant dans un jus de lune noire », bon sang, mais ferme-la physiquement et à tout jamais. Si on parvient à ne retenir ces excroissances potentiellement disqualifiantes que comme des défauts bénins car consubstantiels d’un certain théâtre contemporain, on sort des Reines, si l’on peut dire, avec le plaisir d’avoir, précisément, été « sorti de sa zone de confort » pour voir surgir, çà et là, de beaux moments de théâtre et des interrogations qui résonnent longtemps après l’extinction des derniers feux. Non, l’effort à fournir n’est pas mince, car, à notre sens, en dépit de la performance technique des actrices et de la performance artistique de Laurence Roy, certaines caractéristiques de la représentation peuvent, à bon droit, hérisser ; mais tenir (les Reines, ô facétie quand tu nous tiens ! – si, tenir les r… bref,) est, in fine, un exercice bien récompensé.
Rens. : ici.
En attendant Pascal-Henri Polo…

La photo n’est pas bonne, mais on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d’un soir : la reine Isenmann chante non pas Goldmann mais Purcell. Photo moche : Bertrand Ferrier.
Même quand tu organises les concerts et que tu es censé connaître au moins une partie des artistes, c’est toujours un plaisir d’être impressionné par ces humains qui font, malgré que l’on en ait, des trucs improbables et beaux. Devant un public important (on n’avait pas prévu assez de programmes papier, c’est dire), la soprano-chef Emmanuelle Isenmann et l’organiste-improvisateur-compositeur Olivier Willemin ont dévalé la route qui conduit des mélodies séfarades et d’Hildegarde von Bingen jusqu’à Olivier Messiaen.

Olivier Willemin. Photo faite vite fait pour pas trop ennuyer l’artiss en plein concert : Bertrand Ferrier.
La pertinence des improvisations, de l’ABA liminaire au brillant exercice de style final, la finesse des interprétations d’Emmanuelle Isenmann, soucieuse de trouver de la musique là où d’autres se contentent de faire entendre des cadences consonantes, la qualité d’un programme de quinze titres variés et brefs ont stupéfié un public où curieux, aficionados et vedettes de la musique d’église se mélangeaient avec cette simplicité des gens apparemment heureux. Malgré le talent des musiciens, tout cela aurait été moins bien valorisé sans l’aide de la cadreuse, assistante au montage donc au démontage technique, qui a aidé à prendre les bonnes décisions et a fait vivre de près le concert aux spectateurs, attisant leur enthousiasme par ses options pertinentes.

La caméra basique mais fonctionnelle du festival, manipulée avec subtilité, autant que faire se peut, par Rozenn Douerin.
Bref, quel concert émouvant, tenu avec passion par Emmanuelle et offert en hommage posthume à Pierre Pincemaille, d’autant que ce gig fut donné malgré les tensions qui secouent autant Saint-André de l’Europe que le festival. L’espoir, c’est que moult vous soyez à venir applaudir un jeune talent non-conformiste qui vous propose, ce samedi 20 janvier, d’entendre les plus grandes pièces de Johann Sebastian Bach. Pascal-Henri Polo jouera notamment les plus belles Toccata et la grande Passacaille. OK, c’est pas une superstar, mais, comme nous non plus, on a pensé que c’était une raison de plus de l’inviter à prouver son talent. On a tellement hâte d’y être que l’on voulait quand même écrire ce petit post pour ne pas garder trace du grand concert Isenmann – Willemin QUE dans nos cœurs.

Emmanuelle Isenmann et son double. Vidéo live : Rozenn Douerin. Horloge locale mais heure indéfendable. Photo : Bertrand Ferrier.
« Degas danse dessin », Musée d’Orsay, 11 janvier 2018
Quel est le projet de l’exposition Degas danse dessin, visible au musée d’Orsay jusqu’au 25 février grâce au sponsoring d’une marque de lingerie ? A priori de mettre en espace et en images un texte éponyme de Paul Valéry. C’est peu dire que la problématique paraît un peu trop fine pour le visiteur. Falote, même, voire tirebouchonnée. Concrètement, il s’agit d’une réunion d’œuvres issues en grande partie du fonds local, qui exploitent un peu la danse et/ou le dessin et/ou Degas et/ou son entourage ; mais cela n’exclut pas des thématiques annexes, des œuvres signées par des artistes dont le lien avec Degas n’est pas explicité, et des modes d’expression fort divers, pas tous en lien avec le dessin (photographie, peinture, pastel, sculpture…).
Par conséquent, pour apprécier la proposition du musée, il faut admettre que la problématisation choisie est un prétexte quelque peu flasque et pendouillant. Alors, et alors seulement, on peut se laisser enivrer par les atouts de ce rassemblement aux contours floutés mais judicieusement contenu (il est riche sans chercher à épuiser la concentration du visiteur). Les pièces ultracélèbres esquissent la fascination de Degas pour les p’tites danseuses ; les tableaux plus rares ou annexes, y compris les nombreux préparatifs du portrait de la famille Bellelli, donnent profondeur et résonance au travail sur l’art de rendre le mouvement et d’interroger le corps comme illusion et manifestation charnelle des justes proportions ou de la grâce – même si les mensurations des danseuses photographiées à l’époque évoquent des critères assez différents des codes actuels ; la multiplicité des techniques utilisées, en deux ou trois dimensions, soutient l’intérêt et permet au candide de garder son attention en éveil dans sa découverte d’un peintre soucieux de se confronter aux limites, donc aux grandeurs, souvent, de son art.
Même si l’éclairage basique gâche le plaisir quand il bute bêtement contre les vitres de protection, la visite réjouit par les découvertes et redécouvertes qu’elle permet. Faute de perspective convaincante, l’exposition travaille par à-plats variés et kaléidoscopiques dont l’effet séduisant est incontestable. On est aisément happé par les représentations de la chair, les torsions du corps, la mise en abyme du beau geste artistique, la fixation du fluide éphémère, l’exaltation d’un érotisme comme désérotisé, le questionnement du réel entre technique et failles ou floutages, l’éventail des possibles offert par la répétition d’un même motif et son éclatement en esquisses préparatoires parfois aussi fouillées que le tableau final, etc. De sorte que, ce qui est le point faible de l’exposition, id sunt son manque de narration et la friabilité de son prétexte, est aussi son premier point fort puisqu’il oblige le visiteur à construire sa propre narration.
- Étude pour un autoportrait. Photo : Josée Novicz.
- Autoportrait au porte-fusain. Photo : Josée Novicz.
Le deuxième point fort de Degas danse dessin, ce sont les œuvres rassemblées, entre à-côtés souvent stimulants et grands jalons dans l’Histoire des beaux-arts. Le troisième point fort, c’est la concentration de l’exposition. Elle offre la possibilité au visiteur de poursuivre son errance dans les collections permanentes du musée, dont les plus proches toiles sont rien moins que des chefs-d’œuvre de l’impressionnisme au sens large – un conseil : privilégier la visite en nocturne, car l’affluence devant les collections permanentes peut être délicieusement nulle (vous excepté, bien entendu), alors que ces salles sont fréquemment bondées en journée !
Rens. : ici.