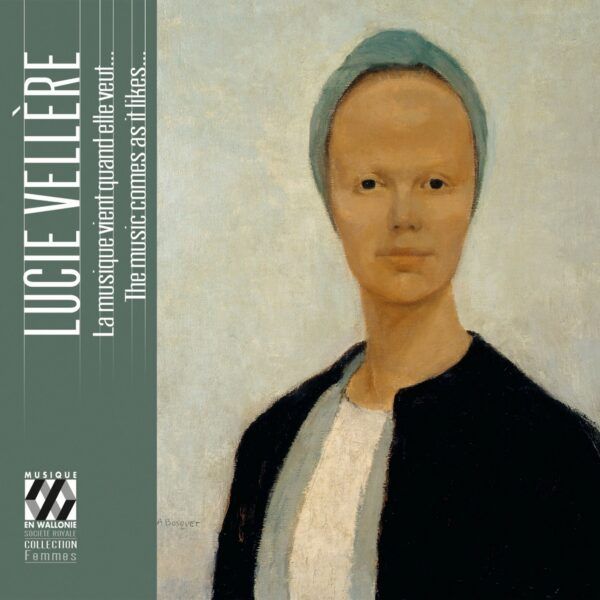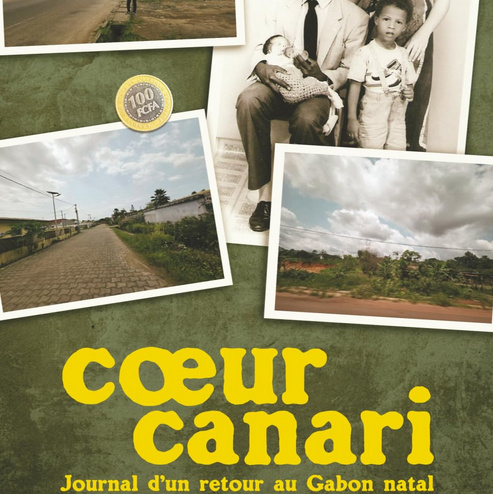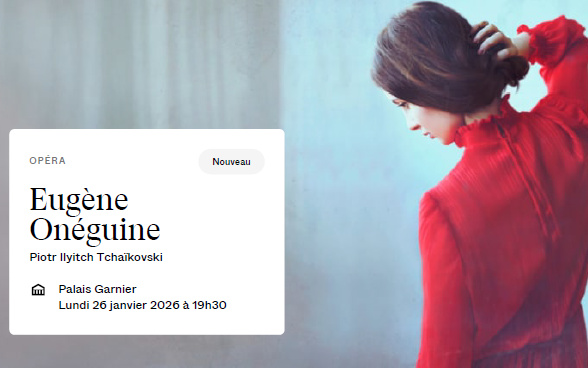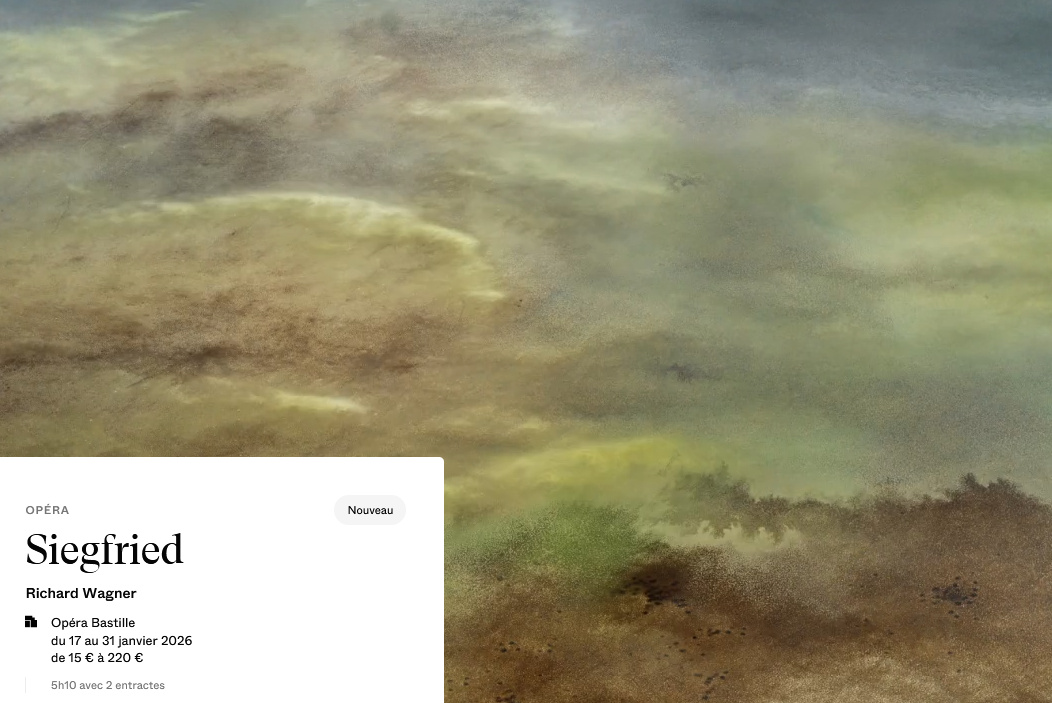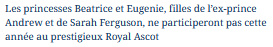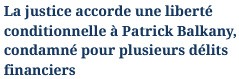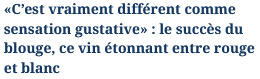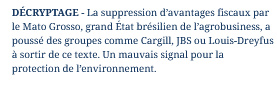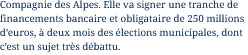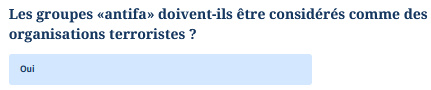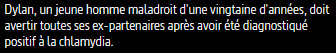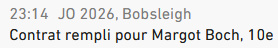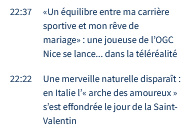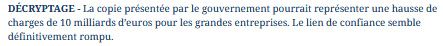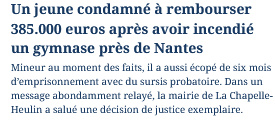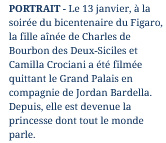Pour son récital annuel à la salle Cortot, Irakly Avaliani a choisi de programmer un florilège chopinien en forme d’arche :
- polonaise en entrée,
- cinq nocturnes en plat, et
- polonaise en guise de dessert.
Première sur la table, la polonaise-fantaisie opus 61 en La bémol composée en 1846 est auréolée du storytelling people qu’affectionnent les musicologues. On y entendrait la déflagration de la séparation d’avec George. Le pianiste n’a visiblement cure de cette historiette sentimentaliste. Il s’intéresse à la musique, pas aux fantasmes biographiques censés expliquer une œuvre, donc la contraindre à une voie programmatique souvent encore plus aplatissante que plate. Le voici tout concentré sur un instrument et un prélude dont il semble mitonner la magie sous nos yeux, grâce à son art
- de la suspension,
- du fondu-enchaîné entre les séquences, et
- du son très avalianien, qui révèle l’immensité des nuances disponibles entre piano et mezzo forte.
Dans ce petit quart d’heure de musique, tout semble couler de source :
- l’agitation des dix petites saucisses,
- les tuilages entre les nombreux segments,
- les effets d’écho entre
- thèmes,
- phrases et
- voix, ainsi que
- l’agogique, d’une impressionnante et enthousiasmante élégance.
C’est
- feutré mais brûlant,
- intense mais ordonné,
- précis mais libre.
Ce qui semble être un grand trou est assumé avec franchise, comme pour certifier que l’on est en direct. Il ne démobilise pas l’interprète. Le chichiteux qui ne veut ni accrochage ni décrochage peut toujours aller ouïr un musicien lisse ou un disque patché cent fois ! Ce qui captive bien davantage que la possibilité d’une faille ponctuelle permettant de prendre conscience de toutes les non-failles, est la capacité d’Irakly Avaliani à transformer l’œuvre en une ample méditation,
- tantôt légère,
- tantôt fuligineuse,
- tantôt éclatante.
Car, sous ces doigts-là, méditation n’est ni ensommeillement ni détrempe. C’est au contraire une hymne à l’art du toucher, si cher au pianiste, qui se plaît donc
- ici à suggérer,
- çà à claquer,
- là à gronder dans un finale passionnant :
- d’abord menaçant,
- ensuite triomphal « à la polonaise »,
- enfin s’effaçant en decrescendo dans les graves.
On a d’autant plus hâte d’ouïr les cinq nocturnes annoncés que, chafouin sans être morfondu, l’interprète promet : « Je vais jouer mieux. » Difficile d’imaginer comment, mais prenons-le au mot. Le premier numéro de l’opus 9, en si bémol mineur, ouvre le bal. Tube Radio Classique s’il en est, ce qui suscite un frémissement dans l’auditoire, ce cheval de bataille de tout chopinologue pratiquant est joué avec une intensité habile. On goûte
- la fluidité de la main gauche,
- les lumières de la main droite, tour à tour
- scintillantes,
- voilées et
- diffuses, ainsi que
- l’équilibre des plans sonores parfaitement étagés.
Emporté par une émotion inattendue tant la crainte de la scie planait, on en viendrait à oublier les couples de contraires que l’artiste parvient à faire si bien matcher :
- pédalisation mais clarté,
- nuances mais continuité,
- unité mais caractérisation des registres, notamment aigus.
Tant pis pour les conventions, l’assistance brave le courroux du pianiste en battant des mimines. « Il en reste quatre », avertit néanmoins l’homme sur la scène. Au si bémol mineur du premier épisode répond le Si de l’opus 32 n°1. C’est l’occasion d’apprécier d’autres atouts chopiniens dont Irakly Avaliani rend la fructueuse tension :
- l’évidence mélodique s’accompagne du charme de la fragmentation,
- le dispositif attendu (accompagnement versus lead) s’enrichit de contrechants à l’alto, et
- l’allant assuré par le motorisme de la senestre se dope à la souplesse de l’agogique qui, grâces lui soient rendues, libère la musique du carcan limitant de la rigueur mesurée.
Le pianiste ne masque rien des étrangetés de l’œuvre, tels le surgissement inattendu du deuxième motif et la fin décontenançante. Remarquable et excitant… d’autant qu’il reste
- trois nocturnes,
- une grande polonaise et
- un bis
à découvrir dans une prochaine notule. Bref, à suivre !
Pour retrouver nos 57 chroniques précédentes sur Irakly Avaliani, c’est ici.