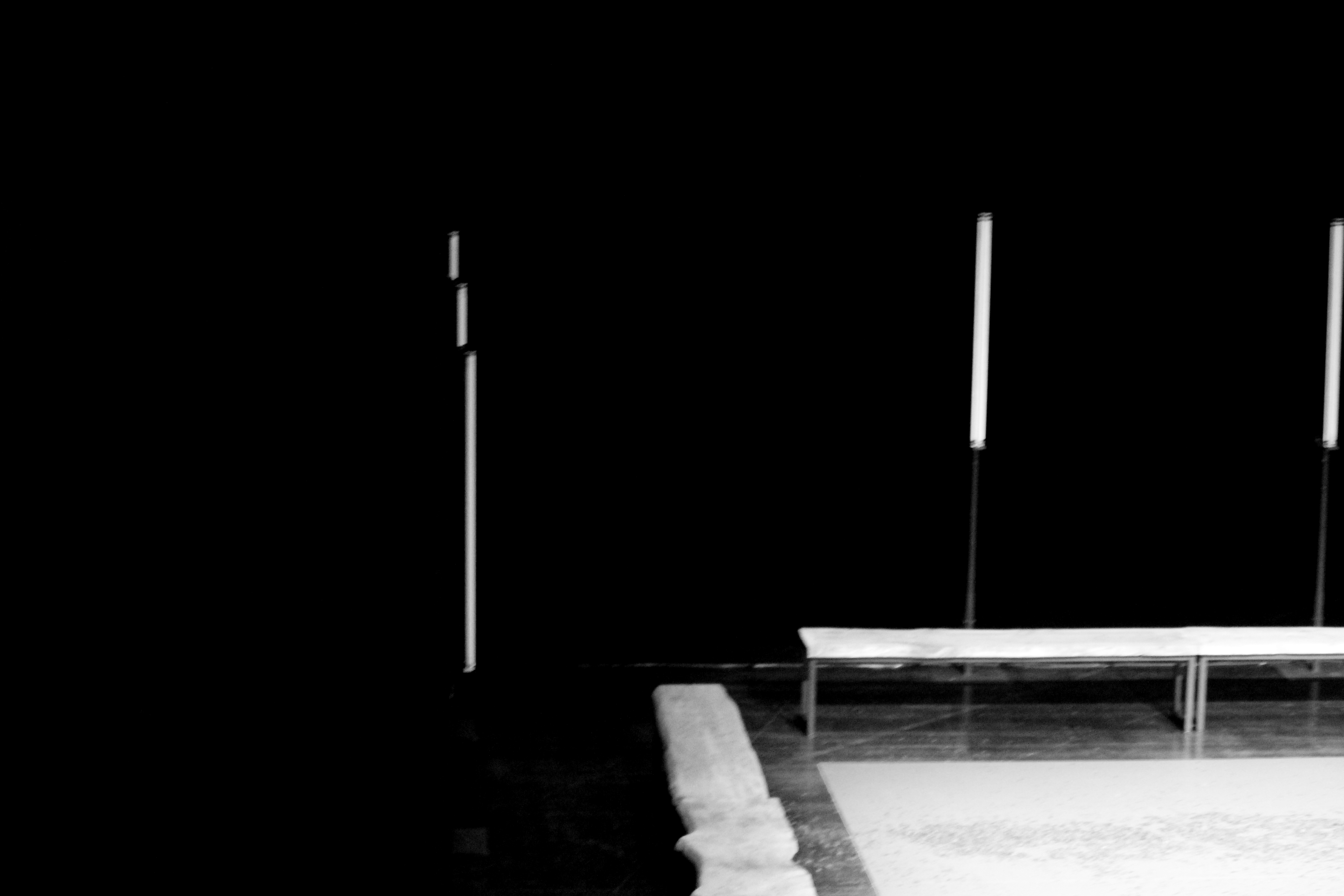Bérénice, Théâtre des Quartiers d’Ivry, 20 mars 2019
Soyons sincère, pour une fois : pas envie de rédiger cette chronique. Parce que la Manufacture des Œillets est certes un endroit lointain à l’aune d’un Parisien du Nord, certes hypermal indiqué dans la ville d’Ivry, certes affublé d’un pompier de sécurité qui s’adonne à une singerie de « fouille de sac » (ce n’est pas une contrepèterie) entre risible et rigolote, mais c’est surtout un endroit chaleureux, agréable, doté d’une salle où toutes les places offrent une bonne visibilité… et d’un bar ouvert avant et après les représentations, ce qui contribue à la convivialité et aux échanges. Oui, pour cette soirée alexandrine, j’étais, mon cher ami, très heureux de te voir. Cependant, il serait malhonnête de ne pas témoigner de mon incompréhension devant ce qui m’attendait en ton sein, ce mercredi soir.
Ce qui nous attendait, c’était des consternations en série autour de cette nouvelle production proposée par le Théâtre des Quartiers d’Ivry, essentiellement en direction des scolaires. Pourtant, Bérénice est loin d’être la pièce la plus empoudrée – ben voyons – de Jean Racine. Le texte résonne de punchlines bien senties ; c’est tragique au sens où l’on sait d’emblée que ça ne va pas bien finir, mais ça esquive la facilité de la mort ; c’est au moins aussi érotique que politique ; et le cadre spatio-temporel restreint paraît donner plus d’écho à l’intrigue qu’il ne l’étrique. Or, la représentation à laquelle nous avons assisté est, autant que nous osions juger à notre aune de spectateur lambda (c’est mieux que lamabada, in a way), trrrès loin d’être à la hauteur de ce monument du théâtre national. Avant d’expliquer pourquoi, pitchons l’histoire.
L’histoire
Antiochus aime Bérénice. Or, depuis cinq ans, Bérénice aime l’empereur Titus avec qui elle a hâte de, enfin, se marier, huit jours après son triomphe. Mais Titus ne veut pas épouser Bérénice car la malheureuse est reine et, à Rome, un empereur n’épouse pas une reine. En gros, Titus préfère les flonflons de la gloire et l’universalité de la pensée du destin à une histoire de cul. Alors qu’Antiochus veut se suicider car il croit que Bérénice lui échappe, Titus lui révèle que Bérénice est libre. Antiochus re-veut se suicider car son pote empereur lui ordonne d’annoncer la nouvelle à la reine. Celle-ci, ayant confirmation de la nouvelle, veut se suicider car elle adooore Titus. Titus veut se suicider car il aime Rome mais il kiffe bien Bérénice aussi. Finalement, Bérénice calme tout le monde : elle se casse, Antiochus se casse aussi, personne ne se suicidera, c’est la vie qui demande ça – tu peux la comprendre, jamais tu ne pourras la décevoir.
Les six déceptions
Déception 1 : le décor est un non-décor. Un tapis rouge couvre la scène. Autour, des bancs en bois bornent l’espace scénique. Des néons façon Olivier Py indiquent la proximité des coulisses. Les personnages sont la plupart du temps sur scène. L’objectif : donner plus de place à la parole. Le résultat : l’impression d’avoir affaire à une représentation de MJC, où l’absence de budget justifie l’absence de décor. Ici, rien ne sourd, rien ne sort, rien n’essore, yo rpz les parophonies, gros. Les costumes – habits de ville contemporains, sauf que les personnages sont pieds nus, ben parce que – sont signés Camille Aït Allouache ; c’est audacieux, de prétendre avoir créé des costumes quand, à l’instar du décor, ce qui est montré se révèle plat et paresseux ! Certainement pas « neutre », car la neutralité sur un plateau n’existe pas ; certainement pas « en retrait pour valoriser le texte », puisque, précisément, l’intérêt du théâtre vivant est de faire incarner, par les acteurs et leur enveloppe scénique, un texte ainsi valorisé ; juste plat et paresseux.
Déception 2 : au-dessus de la scène, au fond, il y a un écran où des vidéos – accessoire obligatoire du théââââtre subventionné – de Grégoire de Calignon montrent, avant la pièce et entre les actes, les personnages ou un visage fixe. À part l’utilisation d’un tic qui fait « mise en scène chic » ou l’occasion de craquer un peu de sous, moi y en a pas compris l’apport dramatique ou le sens de ce gadget superfétatoire.
Déception 3 : sera-ce pour placer une copine qu’Arsace, viril confident d’Antiochus, est confié à Sabrina Kouroughli, assistante à la mise en scène ? Ou l’objectif est-il de proposer un théâtre non-genré ou, mieux, souplement genré – mais pourquoi, alors, conserver un Titus ou un Paulin (le metteur en scène) mâle ? Ce tout tantôt, nous lisions les chougneries de la bibliothèque Louise-Michel après qu’elle a défendu une lecture de contes « queer » qui constitue « une approche safe et tendre des questions autour des genres, des corps et de l’altérité » avant que des livres autour de l’homosexualité soient lus à des ados « par des drag-queens » (20 minutes, 21 mars 2019). Disons que, du moins, ce prosélytisme assumé s’adresse à qui n’en veut. Ici, nul prosélytisme, juste une question, vaine et ennuyeuse : pourquoi cette trahison sexuée ? Que signifient ces caresses appuyées d’Arsace à son patron, au III ? Homoérotisme décalé ou occupation des mains pour actrice désemparée par la direction de jeu ? Avouons que l’on n’a pas même envie de réfléchir davantage à cette option que l’on soupçonne, comme d’autres, d’être in-signifiante.
Déception 4 : notre abandon de l’effort de pensée est motivé par la mise en scène consternante qui accompagne cette récitation. Que signifient ces personnages souvent sur scène, mais pas toujours ? cette absence de dynamisme dans les mouvements ? cette démission devant le texte au point de rendre la logique de jeu inintelligible (la symbolique des bancs, à la fois limes et frontière inclue dans l’espace de jeu puisque Bérénice peut intervenir assise) ? Jamais la moindre énergie ne se dégage de cette option qui paraît moins épurée que feignante, et déplacée devant un tel texte. D’ailleurs, pour ne pas faire déborder ce réquisitoire, nous n’insisterons pas sur les gags consternants visant, sans doute, à réveiller l’attention du public tant la production ne croit pas au théâtre qu’elle est censée défendre : une chorégraphie grotesque assumée par Caroline Marcadé et une pluie de neige noire pour ouvrir le cinquième acte, boursouflures superflues ou verrues à azoter enfonçant une lecture affligeante.
Déception 5 : la direction d’acteurs est à la bassesse plus qu’à la hauteur de la réalisation. Les personnages sont livrés à leur incapacité à se mouvoir, à exprimer leurs émotions autrement que par une diction hésitant entre le plat et le surjeu, à habiter leur corps scénique dans une logique spécifique et maîtrisée – ainsi des mouvements perpétuels du bras droit pour les droitiers, du bras gauche pour celui que l’on soupçonne d’être gaucher. Le texte est débité platement, avec de nombreuses erreurs de diérèses (type « Je veux que vous partiez. / Dieu, quelle violence ! », m’enfin, la diérèse d’insistance sur Di/eu est indispensable, Antiochus !), des respirations inopportunes (« Arsace, je me vois chargé de sa conduite » la pause excessive à la virgule conduit à avaler le pied du « e » muet alors qu’une insistance sur le deuxième « a » eût permis de traduire la virgule sans trahir l’alexandrin), des coupures malvenues (« Ce port / majestueux » segmente Bérénice dès le I), des intentions qui tombent à plat par une mélodramatisation des passages chagrineux, et hop. Même les moments attendus (« je fuis des yeux distraits qui, me voyant toujours, ne me voyaient jamais », « Hé, quoi ? Vous me jurez une éternelle ardeur / Et vous me la jurez avec cette froideur ! », « Et, puisqu’il faut céder, cédons à notre gloire », etc.) sont souvent savonnés, abandonnés à une lecture qui nous laisse à la fois froid – plus facile à écrire qu’à dire – et bouillant d’indignation.
Déception 6 : les acteurs principaux sont tout sauf convaincants. Stéphane Brel, en Titus, nous stupéfie : par quelle erreur de casting lui a-t-on offert et a-t-il accepté ce rôle ? Pendant deux-trois actes, on ne le taxe que de froideur et l’on soupçonne une décision de mise en scène ; mais, dès le quatrième acte, il semble craquer. Techniquement, il paraît désemparé sur scène. Dramatiquement, il est si démuni qu’il est, par exemple, obligé de s’ébouriffer le brushing pour mimer l’émotion (« Mais il ne s’agit plus de vivre, il faut régner »). La voix débite, morne ou vaguement plaintive, un texte pourtant noble et porté par la déchirure entre deux tentations : l’amour et la gloire ; et ce que l’on pouvait redouter arriva. Après avoir longtemps résisté, le public, globalement sage et discipliné, finit par rire de cette pantalonnade qui ridiculise la pièce, y compris sur le « Pourquoi suis-je empereur ? Pourquoi suis-je amoureux ? », qui est quand même le cœur battant de la pièce. Pour une fois, on ne peut donner tort à la manifestation collégiale de scepticisme désappointé. Même le grand monologue du IV est joué comme si le personnage lisait Le Figaro sur un fond bruitiste – précaution anticipant sur l’ennui du spectateur ? Moins de bruit, plus de théâtre, pas de menton qui bouge, accompagné du bras droit, pour signifier « un trouble qui m’agite », et le tour était en partie joué ! Le pire, dans cette déréliction du verbe que l’on soupçonne être au moins pour partie motivée par la direction d’acteurs, c’est que Jean Racine n’est pas mieux servi par Bérénice. Valérie Dréville, qui semble un peu brigitte pour son vert empereur aux airs de Jean-Luc Lemoine ou Benjamin Griveaux, impatiente en surjouant ses deux registres : sa voix de contre-alto façon sorcière ou Cruella, et sa voix fluette pour faire l’amoureuse qui, dès lors, sonne faux. Son jeu de scène fait écho à celui de ses complices : le secouage de crinière pour jouer « Il verra son ouvrage » suscite aussi sa dose de rigolade consternée qui s’impose. Nous devons admettre que, nous aussi, nous finîmes par glousser, malgré la colère de voir Racine si mal servi.
La conclusion
Acceptons l’hypothèse que les excès et maladresses, objectifs et patents, recensés dans la sixième déception, sont moins l’illustration de récitants au niveau d’amateurs médiocres, ce qu’ils ne sont pas, que le fruit d’options esthétiques qui nous hérissent. Contrairement aux apparences, la notule sur le point de s’achever veut porter témoignage d’une consternation globale, et non juger des performances individuelles d’artistes sans doute égarés dans un projet inepte. On n’en regrette pas moins l’échec flagrant de ce non-théâtre que l’on regarde sombrer avec manière d’admiration antithétique. Car, oui, il y a là quelque chose d’aussi triste que quasi fascinant : comment faire aussi faible avec une pièce aussi forte ?