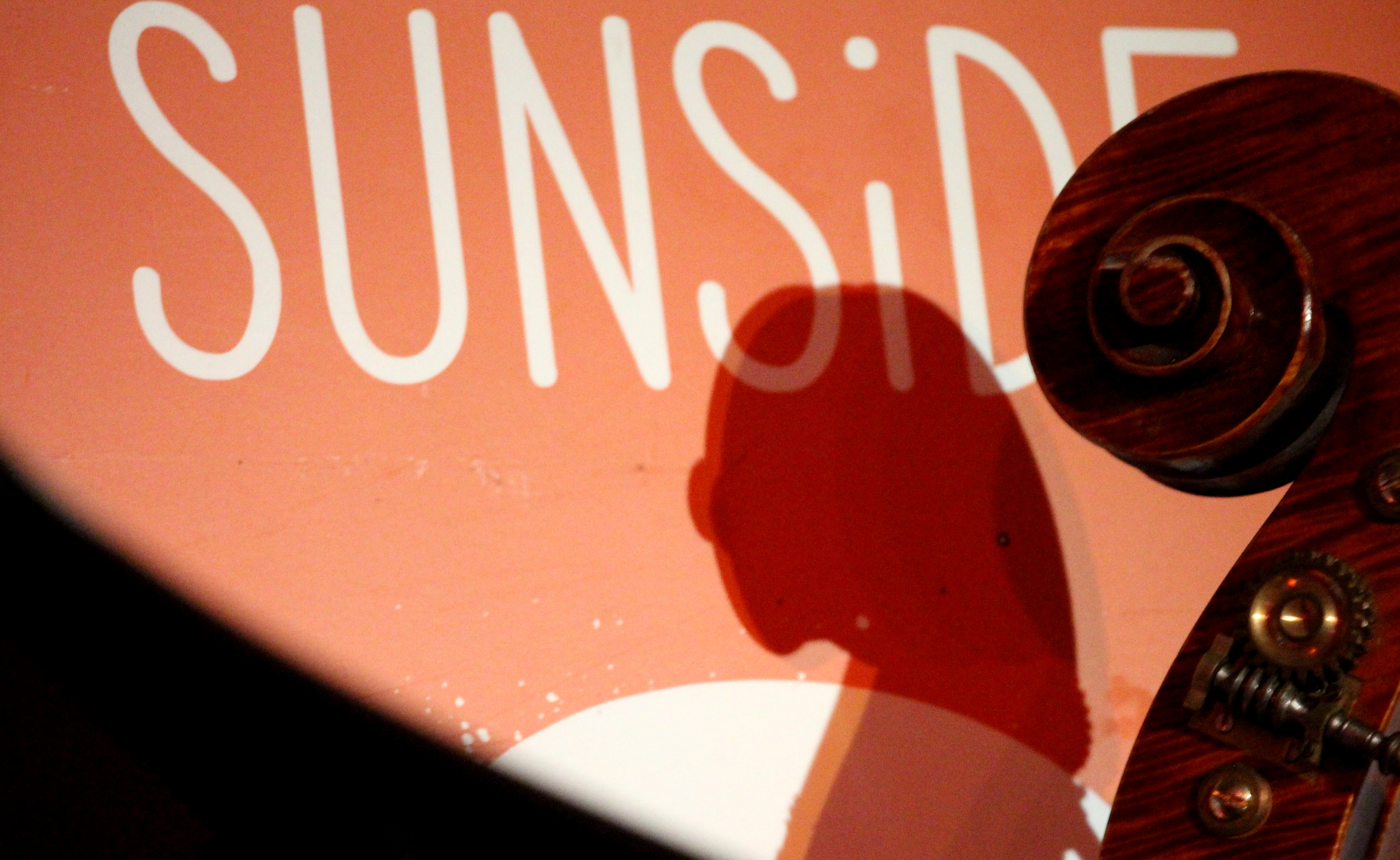Ben Sidran, Sunside, 9 novembre 2018
Souvent programmé dans le club, parfois au Sunset, où nous l’avions entendu jadis, Ben Sidran s’offrait jusqu’à ce samedi trois soirs dans la grande salle de la rue des Lombards, évidemment archicomble. Très bon pianiste de jase, auteur-compositeur revendiquant l’union de la chanson et du jase, l’homme est un OVNI qui associe une image populaire (les puristes snobent ses fredonneries sur l’air de : « C’est pas ça, le jase ») à une veine intello (connaissance fine de l’histoire du jazz ; projets musicaux autour d’auteurs comme García Llorca et, plus récemment, Albert Camus ; écriture d’ouvrages dont le dernier interroge le lien entre jase et judéité aux États-Unis autour d’une question simple qu’il mit dix ans à appréhender : pourquoi 2% de la population est impliquée dans, a minima, 80 % des chansons-phares ?). Cette fois, l’olibrius, à peine diminué par ses soixante-quinze ans, nous embarque dans deux heures trente de musique, feat. deux entractes d’un quart d’heure, avec Rick Margitza le moustachu au sax, l’exceptionnel Billy Peterson à la contrebasse et le fiston Leo Sidran à la batterie, un peu aux discrets background vocals et un tout p’tit peu à la gratte électrique – on goûte cette modeste presque-discrétion.
« Solar », le titre bop qui ouvrait l’album Bop City (1982), lance le premier set de la soirée avec un swing d’emblée (é)patent, même si la sonorisation de la voix n’est pas parfaitement réglée. Dès ce premier titre, le chanteur prévient : « Nothing is forever, nothing lasts », ce qui n’empêche pas le thème de se déployer au sax, au piano, à la contrebasse et aux fûts où sévit avec pertinence le fiston. Pour la suite, rien n’est fixé. Ben Sidran piochera dans ses cahiers au gré de ses inspirations. Cependant, il décide d’axer son premier set sur de « nouvelles musiques ». Donc, le single de son dernier disque studio (2016), interrogeant le mythe de Sisyphe, le tubesque « Picture him happy » enquille avant que « Thank God for the F train » soit l’occasion d’une première pique contre les hipsters, joliment amenée par un duo parlé entre père et fils.
Cette façon de donner vie à une grille convenue est remarquable – et ceux qui trouvent l’épithète ringarde ou dévalorisante peuvent s’aller faire lanlère, avec ou sans vaseline for what I care. Tuilé, « I might be wrong », déclinant toujours la dernière rondelle produite par Leo Sidran pour Unlimited Media et Nardis, joue le midtempo que conteste un groove animé par le solo de piano volontiers rumba avec ses unissons récurrents. On retrouve ici le plaisir de la chanson crépitant de punchlines réellement punchy (« If silence is the answer / What could the question be? »), et le charme de la pêche presque libre, symbolisée par le solo de Billy Peterson, croisement physique entre Chris Squire et Fabrice Dupray, avec la même énergie, la même virtuosité, la même inventivité que ses sosies : y a pas, ce contrebassiste, contrairement à ses semblables, sourit peu, mais il irradie la soirée, l’époustoufle, la wowe (du verbe : je wowe, il ou elle wowe, qu’ils ou elles wowassent, etc.), et je crois que le message est passé.
Ce nonobstant, Ben Sidran ne peut s’empêcher de plonger dans les racines du jase. Il parole donc « Drop me off in Harlem » de Duke Ellington, élargissant encore la palette de son(g)s et de genres proposés ce soir. Le thème géographique lui suggère d’enchaîner avec « King of Harlem », non sans gratifier le public d’une de ces excellentes intro parlées dont tout le monde se réjouit. En l’espèce, il avoue qu’il adooore Llorca et, pourtant, en le lisant décrire New York, il y découvre que, selon l’halluciné, un fantastique homard gorgé d’arsenic (a « great arsenic lobster », j’traduis approximatif) menaçait de choir sur la ville. Comme il comprend pas, tu m’étonnes, il demande à la famille qui gère le musée officiel du poète ; et la nièce lui répond : « Tu sais, Ben, quand il écrit qu’un fantastique homard gorgé d’arsenic menace de choir sur la ville, je pense qu’il veut dire qu’un fantastique homard gorgé d’arsenic menace de choir sur la ville », réponse géniale s’il en est, et il en est, la preuve. Donc, autour de ce mystère qui sent le crustacé, la chanson qui poursuit cette fausse digression, issue de Blue Camus (2014) est une paraphrase formidable d’inventivité parolière, de rythme vocal et de pulsation collective du quatuor. Elle conclut en beauté un premier set euphorisant.
La mi-temps est l’occasion de discuter avec notre voisine, pas celle que nous décrivions dans notre fantasme précédent : celle-ci est pasteur dans une « huge » église presbytérienne de Chicago (« nous sommes huit ») et passionnée, en termes de musique d’orgue, par une « Marche héroïque » dont elle ne retrouvera pas trace dans sa mégabibliothèque virtuelle – sera-ce celle de Camille Saint-Saëns ou de Herbert Brewer ? Dieu seul le saura, peut-être. Nous, on saura que c’est chouette de faire semblant de parler américain pendant quinze minutes avec cordialité et une interlocutrice improbable s’adressant à un interlocuteur tout aussi improbable, subodore-t-on pour se hausser du cool.
Le paisible « Free in America », titre-phare de l’album éponyme (1976) ouvre la deuxième session sur une profession de foi : « The nicest thing about the United States / Everybody’s free to make their own mistakes », soulignant l’engagement politique de cet anti-Trump qui a l’élégance de ne jamais balancer ses opinions comme un connard de consensuel cherchant des applauses en France – cette retenue qui n’en pense pas moins est tellement appréciable. La présence de nombreux Américains dans la salle peut, bien sûr, jouer, mais même eux savent que Ben Sidran n’est pas résolument Républicain (à force de girouetter, l’ordure à la coiffe jaune qui dirige l’Amérique et l’a protégée de l’accession au pouvoir de la femme-de restée épouse du sucé pour accéder au pouvoir, ne sait peut-être plus de quel côté il est)…
Cet éloge de la liberté prélude le passage de relais à Leo Sidran qui, malgré la crêpe jambon-fromage (en français dans le texte) qu’il vient d’engloutir, de son propre aveu, prend la guitare sans lâcher la charleston pour « Speak to me in Spanish » (2014), permettant à Ben d’interagir avec les cris de joie d’une ménagère de plus de cinquante ans : « This woman’s response is the correct answer. » C’est joliment joué, mais ni les paroles ni la musique, très « bonsoir, vous buvez un verre ? », ne nous euphorise en dépit de la sympathie qu’inspire le fils-de, et le retour de la batterie pour accompagner le solo de Rick Margitza.
« Minority », issu de The Cat and the Hat (1979) stipule que, dans les moments de « hard times », il est temps de « looking at the good side of cheap wine » tout en houspillant les « rich folks » qui « treat us like we’re blind ». Ravit une excellente coda funky rappelant que nous essayons tous de « get off » car « we got nothing to miss » (et pas que parce que l’essence est chère). La veine historique de Ben Sidran ressort alors avec « Piano Players », titre parfois passé sous le boisseau de « Turn to the Music » dans le disque Old Songs for the New Depression (1981). C’est bien sûr l’occasion de soli pianistiques à intertexte, tandis que la section rythmique fait le travail avec motivation. Autre « genre » sidranien respecté avec le titre enchaîné, introduit par un long moment parlé sur une séquence parfaite : « Groove is gonna get you through times of no money (better than money ain’t gonna get you through times of no groove) » redynamise le set sur une grille volontiers statique et un feeling qui va bien. C’est pêchu, c’est bien fait, et c’est aussi l’un des highlights de son dernier triple disque live, Ben There, Done That: Livre Around the World, 1975-2015 (2018). Comme s’autofélicitent les artistes a posteriori, « that was a quality rendition of this tune ». Seconde pique aux hipsters, in a way, « Don’t cry for no Hipster », de l’album éponyme (2012), conclut le set en douceur, rappelant que nous aurions plaisir (improbable mais bon) à ouïr Ben Sidran en solo.
- Billy Peterson. Photo : Bertrand Ferrier.
- Photo : Bertrand Ferrier
- Feat. Billy Peterson. Photo : Bertrand Ferrier.
- Leo Sidran. Photo moche : Bertrand Ferrier.
- Rick Margitza. Photo : Bertrand Ferrier.
- Photo : Bertrand Ferrier
- Rick Margitza (détail). Photo : Bertrand Ferrier.
- Rick Margitza. Photo : Bertrand Ferrier.
Le demi-troisième set s’ouvre, devant un public soudain plus clairsemé alors qu’il n’est que minuit un quart, sur l’énergisant « Mitsubishi Boy », extrait de Get to the Point (1982), hommage à tous ces pékins que nous sommes qui, souvent (mais pas sur les réseaux sociaux, tu penses), « burn their desires / and say anything / not to be a failure ». Le titre suivant rappelle que, même quand on a fait de la monnaie, on passe sa vie à dépenser « the stuff ». Au solo de piano répond l’impro du sax qui n’hésite pas à taquiner le suraigu et la note répétée pour créer du swing dans ce blouze (« même chez vous, dans les grottes de Lascaux, ils ont trouvé des flûtes conçues pour le mode pentatonique, donc pour le blouze », pointe la vedette du soir). Un titre bien groovy permet aux artistes de capter le kif des spectateurs via le dylanien « Tangled up in Blue », repris dans Dylan different (2009). On revient au calme avec la dernière chanson, « Was », de Mose Allison, qui conclut aussi le dernier disque studio de 2016, creusant la veine nostalgique du pianiste sur l’air du « What was it like to be then? », signe que, même improvisé, le set est méchamment pensé et construit.
- Le rangement 1. Photo : Bertrand Ferrier.
- Le rangement 2. Photo : Bertrand Ferrier.
- Le rangement 3. Photo : Bertrand Ferrier.
- Le rangement 1. Photo : Bertrand Ferrier.
En conclusion, une prestation solide, un répertoire multiple et palpitant, un contrebassiste irradiant de charisme, un quatuor qui joue ensemble en gardant sa spontanéité, une ambiance chaleureuse, un public multiple : comme qu’on dit en termes critiques poussés, super soirée en compagnie de Mr Ben Sidran.