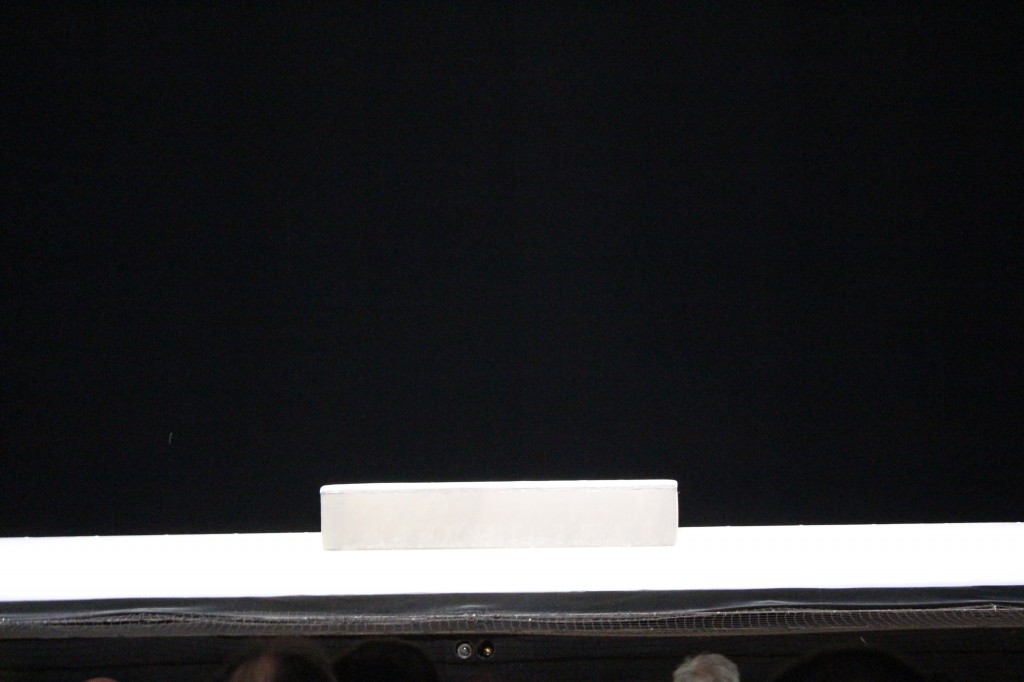Opéra de Paris, 12 avril 2014 : Tristan und Isolde

Tristan (Robert Dean Smith) et Isolde (Violeta Urmana) dans l’immensité de Bastille. Photo : Josée Novicz.
Qu’est-ce qu’un opéra ? Une pièce musicale chantée ou une œuvre dramatique qui mérite mise en scène, décors et costumes ? La scandaleuse version de Tristan und Isolde, proposée à l’Opéra de Paris pour la vingt-cinquième fois ce samedi, permet de se re-poser la question.
L’histoire : soyons sincères, elle a peu évolué depuis la dernière fois que nous avons applaudi l’opéra. On en trouvera un résumé ici.
La représentation : structurée en trois actes d’environ 1h20′, l’œuvre de Wagner suit une logique claire en trois moments (la traversée pendant laquelle Tristan ramène Isolde et boit la potion d’amour ; la nuit où il se fait gauler pendant qu’il lutine Isolde ; et le jour où il retrouve Isolde qui meurt peu après lui). Cette lisibilité, il est vrai peu dramatique en soi (le second acte est tout intériorité), est anéantie par une absence de mise en scène signée Peter Sellars, qui rend pesant ce qui devrait être claire. C’est d’autant plus cruel pour des acteurs sans présence scénique immédiate, comme Robert Dean Smith, qui a vraiment besoin d’un technicien pour lui donner une épaisseur psychologique qui passe la rampe. Heureusement, pour les amis du n’importe quoi, l’absence de mise en scène – qui n’empêche pas Alejandro Stadler d’être rémunéré, on croit rêver, comme assistant à la mise en scène, le bâtard de sa race – se double d’une absence de décors (hormis un canapé-lit), à peine ornée de dégueulasses vidéos de Bill Viola (la mer pixélisée, un bois, le temps qui passe à la campagne, un barbu et une femme aux seins divergents qui se mettent à poil). Dans la même veine talentueuse, l’absence de costumes est signée Martin Pakledinaz (I et II avec tout le monde en noir, sauf le roi Marke en uniforme militaire ; III avec un peu plus de kaki dans des coupes sans intérêt), et les éclairages de James F. Ingalls, s’ils intéressent le néophyte (wouah ! des éclairages carrés !), sont, comme il se doit, insuffisants pour permettre de bien distinguer les héros – ce qui permet au contraire de bien valoriser les vidéos qui ne peuvent qu’inciter au meurtre de Bill Viola, le « vidéaste » fût-il simultanément l’invité du Grand Palais.
Cette colère, que l’on avait anticipée pour avoir été suffoqué d’indignation après la représentation du 3 décembre 2008, est d’autant plus justifiée qu’elle s’appuie sur une interprétation extraordinaire. L’orchestre, dirigé par Philippe Jordan, commence certes le premier prologue sans entrain ; il va cependant se révéler dynamique, puissant et assez souple pour accompagner pleinement les chanteurs. La spatialisation de la musique (solistes lyriques et Christophe Grindel au cor anglais sévissant parfois du balcon) est plutôt une bonne idée pour investir le gros opéra Bastille, mais l’essentiel de la soirée repose sur les chanteurs. Certes, ce n’est pas la première fois que l’on est subjugué par ceux qui « peuvent » chanter cette pièce : ainsi, en 2012, Lioba Braun campait une Isolde bouleversante au Théâtre des Champs-Élysées. Cette fois, le duo du titre est formé par Violeta Urmana et Robert Dean Smith, et il est vocalement extraordinaire.
La Urmana, très attendue dans un lieu qu’elle connaît bien, sidère par une maîtrise technique doublée d’un art peu commun de faire passer les sentiments. Être conscient des difficultés dont la partition est hérissée ne prémunit pas contre l’admiration pour les prouesses esthétiques plus que physiques dont cette petite bonne femme est capable. C’est fait, c’est bien fait et c’est joliment fait. Malgré les conditions scéniques déplorables, la chanteuse saisit son public, le secoue dans les longs tunnels du II (duos vivants avec Janina Baechle en Brangäne austère) et l’emporte par un dernier air aussi macabre qu’impeccable. Mêmes bravos pour Robert Dean Smith. Son rôle est écrasant, et sa voix n’est pas ménagée, mais l’homme n’en a cure. Il se balade techniquement, et opte pour une double bonne idée : un, assumer le fait que, sans mise en scène, rien ne sert d’en faire trop en tant qu’acteur (de toute façon, c’est mort) ; deux, mieux vaut faire passer l’émotion par la musique, comme s’il s’agissait d’un opéra de concert, que de courir après une expressivité ici bannie. En décidant de ne pas lutter contre sa prestance de, curieusement, gentleman anglais, l’artiste concentre toute l’attention sur sa ligne vocale : souffle, aigus de parade, tessiture de rêve, constance et musicalité sont remarquables de bout en bout. Autour de ces phénomènes, que du bon et même parfois de l’excellent : on salue le Kurwenal très expressif de Jochen Schmeckenbecher – même si, scéniquement, il en fait un peu beaucoup ; et on applaudit Franz-Josef Selig avec un König Marke superlatif dans la mesure où il permet d’apprécier, malgré la brièveté du rôle, l’exceptionnelle résonance de ses basses et la puissante évidence de sa tristesse intériorisée.
En conclusion, on ne peut que trouver lamentable le fait de confier un tel opéra à des personnages aussi peu artistes et respectueux du public que Peter Sellars, à vomir avant de lui défoncer la face à coup de roche rouillée, si c’est possible, et Bill Viola, à trucider aussi lentement que sûrement. Ce nonobstant, on se réjouit d’avoir vaincu l’horreur inspirée par de tels arnaqueurs, afin d’applaudir la virtuosité et le talent de chanteurs à la hauteur, eux, d’une partition efficace et puissante.