Augustin Dumay et Louis Lortie, Johannes Brahms, Onyx
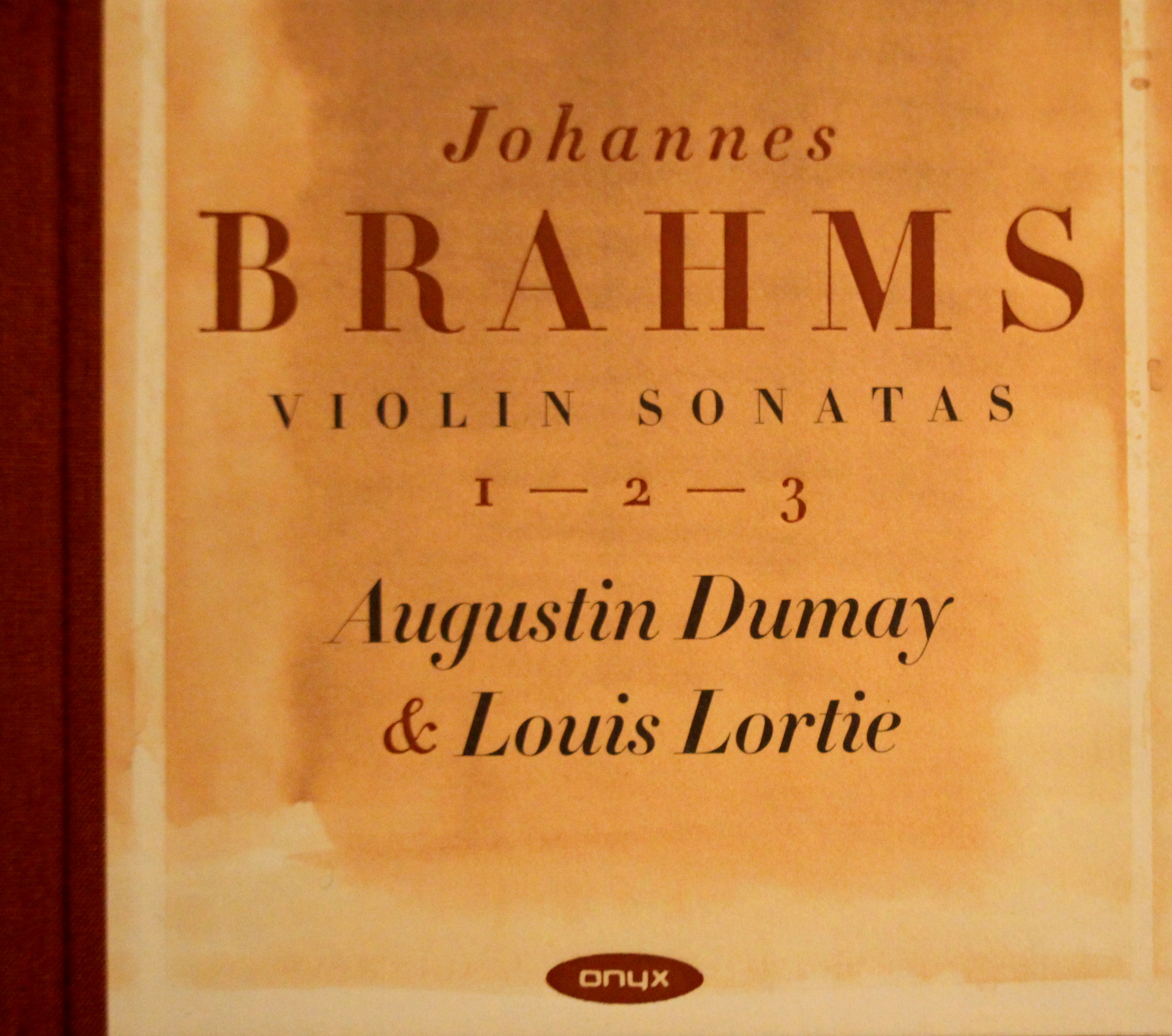
Alors que, à la fin du mois de mars, la Philharmonie de Paris ouvrira son « salon Brahms » pendant trois soirs à Louis Lortie et Augustin Dumay, en compagnie de Migel da Silva et Jian Wang – événement déjà quasiment plein –, Laurent Worms nous suggère de faufiler quelque oreille vers ce disque publié en 2014. Toujours avide de nouveautés reçues en avant-première, nous avons cédé à cette musicale pression en esgourdant les trois sonates pour violon et piano (entre autres) de Johannes Brahms dans la version Onyx. Et voici le résultat de notre petite audition sans aveugle.
Certes, la danse du même nom est plus connue ; mais la Première sonate pour violon et piano de Johannes Brahms (29’) est présentée comme la Regensonate, donc la Sonate de la pluie, notamment parce qu’elle évoque le lied du même nom grâce à son récurrent swing pointé. Qu’importent ces débats musicologiques, quand la musique commence, plus posée et carrée que ce que l’indication de « Vivace ma non troppo » eût pu laisser craindre. En effet, d’emblée, un double mouvement nous saisit.
- D’une part, on peinera à masquer quelque irritation devant la prise de son – cosignée par Chris Alder et Tom Ruβbüldt – au plus près du violon. Ce choix ajoute en authenticité (on ne loupe rien des respirations du musicien – c’est éventuellement informatif pour les apprentis violonistes, soit, mais est-ce vraiment l’objet d’une captation ?) ce dont il nous prive en termes de pureté musicale et d’équilibre entre les instruments.
- D’autre part, on ne niera pas plus une inclination spontanée pour les options qui semblent présider à cette interprétation, à la fois sereine et libre jusque dans les rubato sobres, osés et réussis lors des unissons violon-piano.
Nulle esbroufe, point de vertige ou de folie, mais quelle assurance, quelle manière de faire vivre la musique y compris lors de la reprise inversée où le violon accompagne le piano ! Car la carrure de l’exécution n’est pas lancinance (je tente) : en témoigne ce forte qui remplace le crescendo habituel (mes. 105, 4’49). Le confort apporté par la virtuosité discrète du soliste – les notes, oui, mais la sonorité, les attaques, les tenues, les vibratos et les fins de phrases cerisées sur le gâteau, pfff –, l’écoute mutuelle des artistes et une certaine liberté dans la définition des tempi captent l’oreille en habitant les itérations du thème liminaire, parfois lassantes quand tels ou tels interprètes jouent plus la partition qu’ils ne la donnent à vivre. Ici, les acolytes rendent avec variété les atmosphères diverses qui éclairent ces 11’30 – pour l’auditeur, c’est grande joie.
Or, voici que l’Adagio surprend. Après une belle promenade en Sol, le Mi bémol secoue l’auditeur, quoi qu’il reprenne le sol final pour, semble-t-il, tuiler les deux propos. Les caractéristiques générales sont identiques : captation très authentique (le si bémol frôlé par l’archet est audible bien avant la première note – pourquoi ce choix d’un rendu aussi brut de cidre, que l’on retrouve à l’ouverture de la piste 7 ?), le tempo est lent et l’investissement des musiciens puissant. Cependant, cette fois, au piano sérieux s’oppose son partenaire très vibrant, et ce dialogue sans concession rend justice de la spécificité du mouvement, moins lisse que le premier, avec une partie de piano plus présente et des breaks renouvelant le langage formel employé jusqu’ici. L’on passe d’un développement riche et harmonieux à un propos plus riche sans, pour autant, être heurté. En témoigne, à la vingt-cinquième mesure, le changement d’esprit (« più andante »), énoncé avec tonicité par Louis Lortie avant la prompte modulation en si mineur. Entre vigueur et douceur, retenue et vitesse, identité rythmique et modulations, paix et tension des doubles cordes, thème au piano puis au violon, le compositeur tâche, stipule la notice, d’exprimer ses tendres sentiments à Clara Schumann, mal en point en sus d’avoir perdu son p’tit Felix dont le père est interné – bonjour galères. Au-delà de l’anecdote, on apprécie la façon dont les artistes laissent sourdre l’émotion sous l’apparente quiétude du tempo lent et du mode majeur : la dernière tenue, presque raclée, du violon serait partout ailleurs maladroite – ici, elle est une saisissante synthèse du mouvement qui s’achève, d’une part, et, d’autre part, de l’art que les interprètes ont d’incarner, par le son, l’émotion suggérée par la partition.
L’Allegro molto moderato final fricote, lui, avec une sorte de sol mineur. Le système de réponses entre les deux musiciens est parfaitement exécuté, sans exclure les secousses (levée de la mes. 45, 2’16) tant écoute et délicatesse ne sont pas, ici, synonymes de tiédeur ennuyeuse. La légèreté du toucher pianistique permet aussi de contraster l’élégance de ces sautillements avec la plate modulation en Mi bémol soulignée par le violon, comme si le compositeur convoquait deux arts complémentaires d’exprimer une même préoccupation – la finesse et la force de décision. Elles ne tardent pas à se concilier comme l’illustrent, par exemple, les réponses à la tierce ou en écho que se donnent les interlocuteurs. Nul show-off, ici, mais de la vie, qu’anime ici ce mi bémol in extremis à 5’28, paraissant refuser la paresse, que c’est drôle, du mouvement répétitif afin de privilégier la vitalité de l’échange entre piano et violon – écoutez ce dernier quart de soupir gommé, contrairement aux deux précédents. Là encore, le violon semble soucieux de reprendre la main sur son collègue à marteaux et de bousculer son ronronnement tripartite, histoire de mieux exprimer la vigueur de ses sentiments. À l’instar du précédent phénomène, l’interprète prépare ainsi l’auditeur à la nouvelle explosion lyrique à laquelle il va s’abandonner. Le retour à la tonalité du début, annonce la péroraison du troisième mouvement, qui ne peut s’effectuer qu’en Sol, tonalité emblématique quoique partielle de la sonate.
En bref, un travail d’interprétation techniquement admirable et musicalement très fouillé.
Sept ans après ce brillant essai, Johannes Brahms a composé simultanément ses deux successeurs. La Deuxième sonate pour violon et piano (21’) doit chanter. Elle aussi est partiellement inspirée d’un lied du quinqua amoureux d’une même-pas-trentenaire, ainsi que du chant de concours des Maîtres chanteurs, nous apprend, inculte assumé que nous sommes, le texte de Jeremy Nicholas. Notons au passage que cette partie de la notice tranche avec le bavardage pontifiant et mielleux du suintant Olivier Bellamy dont le laïus ouvre le bal textuel – faute de goût si regrettable que, tout en imaginant sans difficulté les objectifs médiatiques d’une telle bévue, l’on ne saurait excuser l’éditeur.
L’Allegro amabile en trois temps et en La positionne d’emblée la polymorphie des interprètes, si si, ça veut presque dire quelque chose. Ainsi du violon qui n’hésite pas à jouer les fragiles (mi de la mes. 10, 0’16) sans pour autant renoncer ni à sa prestance quand le thème lui échoit (0’36), ni à son autorité quand ses doubles cordes marquent le temps face aux accords du piano (0’53) ; or, ce mouvement va se jouer sur la kaléïdoscopie, ben voyons, des échanges entre l’accompagnateur, au premier plan, et le soliste sporadique. L’art des musiciens de passer d’un état ou d’une hiérarchie à une autre fait pour partie le prix de cette version. Peut-être la prise de son, associée à un usage généreux de la pédale de sustain (3’40) privilégie-t-elle le climat au détail, ce qui gagne en halo ce que la partition perd en intensité ; cependant, l’on peut aussi estimer que ce choix permet de renforcer les distinctions d’émotions. Dans cette perspective, l’entrée du dialogue avec le thème à la main droite et le violon en accompagnateur (mes. 137, 4’06) inaugure un moment magnifique, qui tire presque Brahms vers Schubert. La douceur du piano, dans sa réponse, est un délice à la hauteur de ce que l’on vient d’entendre, et une belle introduction à la réexposition des thèmes liminaires. On goûte alors la tonicité et la pointe de nostalgie parfaitement adéquates que les musiciens esquissent avec sapidité, on va s’gêner.
Comme le Mi bémol suivait le Sol dans la Première sonate, le Fa succède au La pour l’Andante tranquillo de la Deuxième. Avec ses à-coups systématiques, le mouvement est plus rapiécé que rhapsodique, et plus dual qu’ambigu. Après l’Andante majeur à deux temps, un Vivace à trois temps tenté par le ré mineur se faufile. Quasi danse hongroise, cette partie frétille grâce à la précision de l’archet et à la légèreté du pianiste… et du piano que l’on pressent fort bien réglé par un accordeur non nommé. Au Vivace répond la réexposition de l’Andante customisé ; puis le Vivace en partie en pizzicati pulse à souhait ; un bref Andante et un Vivace concis synthétisent l’affaire avec maestria, toujours portés par cette capacité des interprètes à passer d’une dynamique à l’autre en un tournemain.
L’Allegretto grazioso (quasi Andante), qui revient en La, est pris sans traîner mais non sans esprit, ainsi que le soulignent les respirations prises autour des arpèges du piano. Le mouvement est fort intéressant, semblant mettre en sons la lutte entre, d’une part, son envie de développer le thème initial et, d’autre part, son souhait d’aller butiner d’autres formes d’inspiration fors cette contrainte. L’écoute mutuelle des musiciens fait cette fois l’intérêt : on devine un compagnonnage fécond, mais aussi une confiance dans la musicalité de chacun, qui pousse l’un et l’autre à faire écho à l’énergie apportée en direct au cours de la session. Ainsi cette sonate joyeuse associe-t-elle la maîtrise de deux interprètes très sûrs et la vitalité de deux complices prompts à s’écouter et à interagir.
Bref, c’est, là encore, un fort bel ouvrage.
La Troisième Sonate en ré mineur (22’) apporte un peu d’originalité dans ce carcan sonatologistique carrément. En effet, elle s’articule en quatre mouvements, révolution ! L’Allegro s’ouvre sur manière de trio : la main gauche du piano donne la pulsation ; la main droite offre le contre-temps (par demi-soupir ou grâce à des triolets) ; et le violon expose sa mélancolie. La sonorité si riche d’Augustin Demay fait merveille dans ce registre, d’autant que le charme de la pièce apparaît d’emblée – en l’espèce, il s’agit d’une sorte d’oxymoron entre la mélancolie du soliste et l’idée d’un « allegro », que rend le violoniste en refusant le détaché souvent sollicité pour les dernières croches de la mesure 23, 0’43. L’interprétation est précise et précieuse. Par exemple, les déferlements de vigueur est aussi bienvenu que leur résorption est habilement menée. De fait, en doublant le mi bémol (mes. 67, 1’59), par choix ou par hasard de montage, le violoniste privilégie la force-qui-va à quelque ennuyeuse perfection plastique. La sorte de toccata qui ouvre la deuxième partie du mouvement (2’30) n’en est pas moins jouée avec la douceur et le legato qui s’imposent, afin de contraster avec la brève partie en fa# mineur et ses modulations. La fougue judicieusement contenue remue la sonate et prélude au rappel, pour les besoins de la coda, des structures et thèmes précédents… avec une tierce picarde utile pour préparer le mouvement suivant – même si l’on se demande s’il était vraiment utile de laisser lors des finitions, à 8’34, le p’tit pouët qui accompagne, suppute-t-on, la levée de la pédale.
L’Adagio, pris posément autour d’un thème qui will ring a bell aux amateurs de chanson surannée, fracasse sa tranquillité ternaire et majeure sur la tension précédente, les interprètes y exprimassent-ils des interrogations inquiètes que subsument, je sais mais bon, des unissons à l’octave parfaitement réalisés. Le détaché de Louis Lortie souligne cette capacité des artistes ici réunis de tenir le cap sans se laisser déborder par la subjectivité de l’émotion, même quand elle s’exprime par des crescendi soudains ou des accélérations de tempi, comme un cœur qui boum-boume plus promptement sous le coup du popopopo (pardon pour ces termes de musicologie, ils m’ont paru s’imposer).
Après l’apaisement, il est joyeux qu’un mouvement plus bref et plus preste, « con sentimento » et en mineur, vienne re-booster notre gourmandise. Cela frétille avec une aisance non dénuée de prudence – non pas technique mais intérieure : il s’agit d’une stratégie narrative préparant l’explosion de tension puis le reflux conduisant aux modulations et à la signature majeure qui arrive sur le dernier accord. Le mouvement suivant est plus franc. C’est un Presto agitato, et les interprètes s’en emparent sans jouer les mijaurées, les midinettes ou les ministresses de la Gentillesse en marche. Forte ou piano, un flux puissant lance ce finale où la vigueur, le swing (1’34), les unissons impardonnablement parfaits vont tester, en vain, les musiciens à l’ouvrage. Dans ces pages dynamiques quoique non univoques, les artistes brillent de mille feux, au moins, tant ils savent que vite n’est pas forte et piano n’est pas mou. Les à-coups sont intelligents et rythment avec intelligence le propos. Au toucher superbe de Louis Lortie répondent les sonorités magnifiques d’Augustin Dumay, armes idéales pour gagner la bataille de cette partition bien connue et pourtant toujours étonnante… quand elle est aussi bien enlevée. Cela vaut bien quelques grognements (par ex. à partir de 4’27) pour attaquer une coda qui hésite entre brio et tendresse – la vie rêvée des hommes, en somme.

En guise de bis, les interprètes proposent l’Allegro (dit « Scherzo ») d’une sonate collaborative, écrite avec Robert Schumann et Albert Dietrich pour Joseph Joachim. Johannes Brahms ne souhaitait pas la voir publiée, elle le fut donc. Sa structure A (Allegro, 6/8 en do mineur) B (deux temps Moderato en Sol, moderato) A + coda en Do, avec une étonnante modulation, ne brille pas par son originalité, mais l’originalité est-elle toujours scintillement ? Du moins, en 333 secondes, cette pièce propose-t-elle une alternance vif-lent-vif rendue avec esprit et envie par des interprètes qui prennent l’œuvre au sérieux et lui offrent le meilleur d’eux-mêmes. C’est une fin joyeuse pour un superbe objet et enregistrement dont on peut, certes, discuter les choix de prise de son mais dont on ne saura mettre en cause, autant que concerné nous sommes, ni la science des interprètes ni le résultat puissant, généreux (77’), joliment présenté et plein de vitalité.
Bref, bonne écoute aux curieux !

