Samson et Dalila, Opéra Bastille, 24 octobre 2016
 Trois défis pour cette nouvelle production à Bastille donnée dans un espace comble : faire chanter un opéra français par des non-francophones ; rendre justice à cette superbe musique à la fois wagnérienne (usages orchestraux, rôles des leitmotivs, réinvestissement amoureux des mythes…), française (rôle des airs et de la mélodie) et accessible (trois parties entre 35 et 50 minutes) ; relever le niveau médiocre de la mise en scène constatée ces derniers semestres à l’opéra Bastille. Nous étions donc sur place pour voir quoi.
Trois défis pour cette nouvelle production à Bastille donnée dans un espace comble : faire chanter un opéra français par des non-francophones ; rendre justice à cette superbe musique à la fois wagnérienne (usages orchestraux, rôles des leitmotivs, réinvestissement amoureux des mythes…), française (rôle des airs et de la mélodie) et accessible (trois parties entre 35 et 50 minutes) ; relever le niveau médiocre de la mise en scène constatée ces derniers semestres à l’opéra Bastille. Nous étions donc sur place pour voir quoi.
L’histoire : les Hébreux se lamentent puis se révoltent sous la pression de Samson. Abimélech le Philistin veut les mater mais se fait tuer par Samson (c’est ce que dit le livret, pas la mise en scène). Le grand prêtre philistin s’en émeut et maudit Israël. Les Hébreux fêtent la fin de l’esclavage, mais la Philistine Dalila séduit Samson, même s’il lui résiste – fin de l’acte I, 50’. Dalila promet au grand prêtre de se venger du salopard. Samson débaroule pour rompre, mais il finit par céder aux (ch)armes intéressé(e)s de la belle et, comme preuve d’amour, la laisse amputer les cheveux qui font sa force (c’est ce que dit le livret, etc.) – fin de l’acte II, 45’. Yeux crevés, Samson, enchaîné, tourne une meule (c’est ce que dit, etc.) et se fait invectiver par ses sujets. Les Philistins, eux, célèbrent leur victoire. Guidé par un enfant (c’est ce que, etc., puisque Dalila, grotesque, joue ce rôle), Samson est conduit au cœur du Temple. Retrouvant sa force sans ses cheveux, il fait tout écrouler, na – fin de l’acte III, 35’.
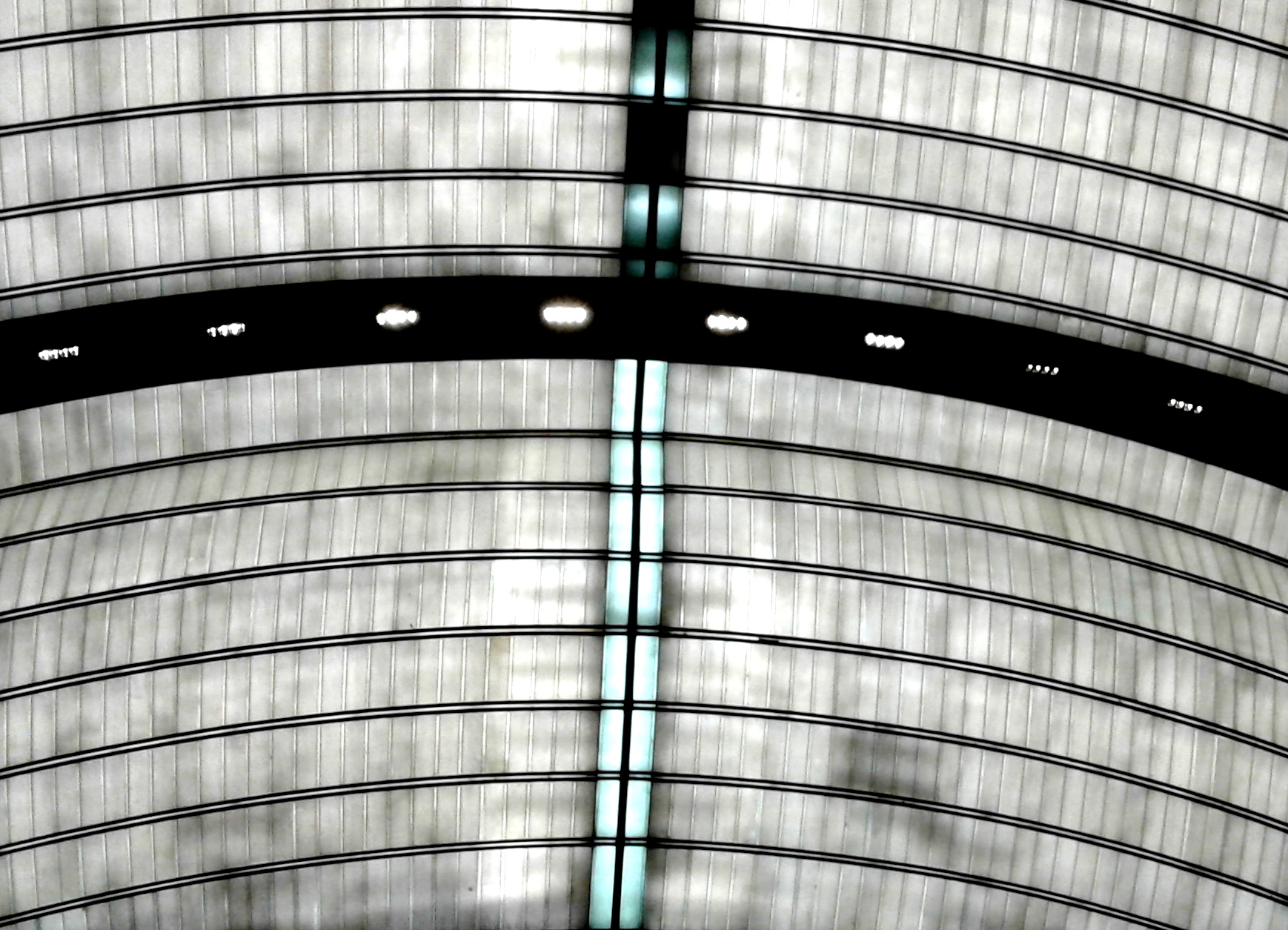 La musique : alors que l’on s’escagasse une fois de plus de l’incorrection des musiciens répétant leurs traits jusqu’à l’entrée du chef, l’orchestre se révèle de nouveau fiable et malléable. Sur des tempi que l’on eût rêvés parfois plus énergiques donc plus contrastés (le prélude liminaire laisse craindre le pire), Philippe Jordan conduit son monde à bon port en veillant à respecter les breaks et guider avec précision les chanteurs, y compris l’omniprésent chœur, souvent émouvant. Aucun de ceux-ci ne démérite techniquement. Hormis les moments les plus intenses, Anita Rachvelishvili (Dalila) fait même souvent l’effort de prononcer cette langue bizarre qu’est le français, ce qui permet de mieux apprécier son art du changement de registre avec des graves très maîtrisés. Aleksandrs Antonenko (Samson), lui, ne prend pas autant de précaution pour baragouiner un sabir aussi incompréhensible à nos oreilles que le français doit l’être à son cerveau. Egils Silins, jadis Abimélech dans ce même opéra, opère désormais en grand prêtre et fait du Egils Silins : scéniquement toujours sur le registre de l’agressivité, même quand il drague Dalila (restes d’Abimélech ?) ; techniquement souvent juste ; phonétiquement quelquefois pas trop loin des mots attendus – sans être trop proche non plus. C’est peu dire que l’on est donc heureux d’entendre notre langue redevenir intelligible dans la bouche de Nicolas Testé, Abimélech éblouissant (présence scénique et vocalité idéale pour le rôle), et de Nicolas Cavallier, vieillard hébreu se délectant de ses graves profonds pour notre plus grand plaisir – l’on regrette cependant que, sans doute brimés par le metteur en scène, ils ne daignent pas venir saluer après le I, et ne soient plus présents à 22 h 30 pour le salut final. Les trois choristes du Chœur de l’Opéra (John Bernard, Luca Sannai et Jian-Hong Zhao), ont sans doute trop peu de temps pour séduire car, même si l’initiative de faire chanter en solistes des choristes est louable, leurs interventions manquent de puissance et d’incarnation pour emballer la grande salle. En résumé, un plateau plutôt acceptable techniquement, mais que l’on renie artistiquement : faire chanter du français à des non-francophones est sans doute rentable fiscalement, mais peu convaincant en l’espèce – d’autres versions aux rôles-titres non francophones ont prouvé que, en portant l’accent sur le texte, on pouvait rendre l’opéra intelligible, de quelque origine soient les interprètes, à condition de l’exiger, suppute-t-on.
La musique : alors que l’on s’escagasse une fois de plus de l’incorrection des musiciens répétant leurs traits jusqu’à l’entrée du chef, l’orchestre se révèle de nouveau fiable et malléable. Sur des tempi que l’on eût rêvés parfois plus énergiques donc plus contrastés (le prélude liminaire laisse craindre le pire), Philippe Jordan conduit son monde à bon port en veillant à respecter les breaks et guider avec précision les chanteurs, y compris l’omniprésent chœur, souvent émouvant. Aucun de ceux-ci ne démérite techniquement. Hormis les moments les plus intenses, Anita Rachvelishvili (Dalila) fait même souvent l’effort de prononcer cette langue bizarre qu’est le français, ce qui permet de mieux apprécier son art du changement de registre avec des graves très maîtrisés. Aleksandrs Antonenko (Samson), lui, ne prend pas autant de précaution pour baragouiner un sabir aussi incompréhensible à nos oreilles que le français doit l’être à son cerveau. Egils Silins, jadis Abimélech dans ce même opéra, opère désormais en grand prêtre et fait du Egils Silins : scéniquement toujours sur le registre de l’agressivité, même quand il drague Dalila (restes d’Abimélech ?) ; techniquement souvent juste ; phonétiquement quelquefois pas trop loin des mots attendus – sans être trop proche non plus. C’est peu dire que l’on est donc heureux d’entendre notre langue redevenir intelligible dans la bouche de Nicolas Testé, Abimélech éblouissant (présence scénique et vocalité idéale pour le rôle), et de Nicolas Cavallier, vieillard hébreu se délectant de ses graves profonds pour notre plus grand plaisir – l’on regrette cependant que, sans doute brimés par le metteur en scène, ils ne daignent pas venir saluer après le I, et ne soient plus présents à 22 h 30 pour le salut final. Les trois choristes du Chœur de l’Opéra (John Bernard, Luca Sannai et Jian-Hong Zhao), ont sans doute trop peu de temps pour séduire car, même si l’initiative de faire chanter en solistes des choristes est louable, leurs interventions manquent de puissance et d’incarnation pour emballer la grande salle. En résumé, un plateau plutôt acceptable techniquement, mais que l’on renie artistiquement : faire chanter du français à des non-francophones est sans doute rentable fiscalement, mais peu convaincant en l’espèce – d’autres versions aux rôles-titres non francophones ont prouvé que, en portant l’accent sur le texte, on pouvait rendre l’opéra intelligible, de quelque origine soient les interprètes, à condition de l’exiger, suppute-t-on.
 Le spectacle : côté mise en scène, de nouveau, la consternation s’abat sur le spectateur. Tout fatigue. L’absence de direction d’acteur qui contraint les artistes à caresser le décor, à se rouler par terre et à se prendre la tête entre les mains pour donner l’impression qu’il se passe quelque chose. Les indispensables figurantes à soutien-gorge (ou simple voilage) et le figurant à string, façon sous-Olivier Py de kermesse. Les ajouts consternants (les lesbiennes qui caressent Dalila à la fin du I). Les modifications « modernisantes » (flingues et mitrailleuses à la place d’épées, rendant incompréhensible l’action ; décor façon télévision surannée ; automutilation de Samson ; préfiguration de sa fin par une danse anticipant la chute de manière figurative ; danse de discothèque sur la teuf techno des Philistins, avec distribution de billets et ambiance orgiaque pendant le III). Les décors et costumes abrutissants (ambiance Dallas, carafe de whiskey et costumes-cravates inclus). Les suppressions débiles (la meule, la prison, la localisation). L’habillage sur scène lors de la bacchanale. La douche au champagne et l’arrosage au jerrycan. Les chougneries bruyantes de Dalila. Pourtant, on n’est pas si obtus que l’on essaye de paraître, ou alors on lutte : on aimerait donc être séduit par l’interconnexion des époques, le jeu sur les boîtes dont on sort et on entre (comme le mythe sort et entre des représentations qui l’emprisonnent), le travail sur les seuils (le rideau de scène du I et du III, arrivant à mi-plateau en hauteur, qui devient translucide puis s’efface comme pour signifier le caractère artificiel de nos limites ; le rideau qui ne voile que ce qui n’a pas à être dévoilé dans le III)… Las, l’ensemble sonne pauvre, dépoétisé, sans ambition, vulgaire – à la hauteur de ces agents d’accueil qui scannent votre billet sans bonsoir ni merde, de cette ouvreuse (parterre premiers rangs à gauche) qui mastique son mâchouillon avec ostentation, ou de cette absence de distributions (petits cartons A6) que la direction de Lissner n’a pas prévu en assez grand nombre, ce qui est d’une pingrerie répugnante. Ayant récupéré un programme abandonné par un spectateur, j’ai pu lire les esssplicafions du metteur en scène : affligeant, sauf à considérer que l’avis d’un élève gnagnan redoublant en sixième peut élever le débat. Cette création de Damiano Michieletto (m.e.s), Paolo Fantin (décor) et Carla Teti (costumes) poursuit piètrement l’ère Lissner.
Le spectacle : côté mise en scène, de nouveau, la consternation s’abat sur le spectateur. Tout fatigue. L’absence de direction d’acteur qui contraint les artistes à caresser le décor, à se rouler par terre et à se prendre la tête entre les mains pour donner l’impression qu’il se passe quelque chose. Les indispensables figurantes à soutien-gorge (ou simple voilage) et le figurant à string, façon sous-Olivier Py de kermesse. Les ajouts consternants (les lesbiennes qui caressent Dalila à la fin du I). Les modifications « modernisantes » (flingues et mitrailleuses à la place d’épées, rendant incompréhensible l’action ; décor façon télévision surannée ; automutilation de Samson ; préfiguration de sa fin par une danse anticipant la chute de manière figurative ; danse de discothèque sur la teuf techno des Philistins, avec distribution de billets et ambiance orgiaque pendant le III). Les décors et costumes abrutissants (ambiance Dallas, carafe de whiskey et costumes-cravates inclus). Les suppressions débiles (la meule, la prison, la localisation). L’habillage sur scène lors de la bacchanale. La douche au champagne et l’arrosage au jerrycan. Les chougneries bruyantes de Dalila. Pourtant, on n’est pas si obtus que l’on essaye de paraître, ou alors on lutte : on aimerait donc être séduit par l’interconnexion des époques, le jeu sur les boîtes dont on sort et on entre (comme le mythe sort et entre des représentations qui l’emprisonnent), le travail sur les seuils (le rideau de scène du I et du III, arrivant à mi-plateau en hauteur, qui devient translucide puis s’efface comme pour signifier le caractère artificiel de nos limites ; le rideau qui ne voile que ce qui n’a pas à être dévoilé dans le III)… Las, l’ensemble sonne pauvre, dépoétisé, sans ambition, vulgaire – à la hauteur de ces agents d’accueil qui scannent votre billet sans bonsoir ni merde, de cette ouvreuse (parterre premiers rangs à gauche) qui mastique son mâchouillon avec ostentation, ou de cette absence de distributions (petits cartons A6) que la direction de Lissner n’a pas prévu en assez grand nombre, ce qui est d’une pingrerie répugnante. Ayant récupéré un programme abandonné par un spectateur, j’ai pu lire les esssplicafions du metteur en scène : affligeant, sauf à considérer que l’avis d’un élève gnagnan redoublant en sixième peut élever le débat. Cette création de Damiano Michieletto (m.e.s), Paolo Fantin (décor) et Carla Teti (costumes) poursuit piètrement l’ère Lissner.
En conclusion : Samson et Dalila est un opéra très agréable à entendre et fort stimulant à écouter ; mais, alors qu’il approche des mille représentations à l’Opéra de Paris, il peut être honteusement gâché par des chanteurs ne daignant pas prononcer le français correctement, et par un metteur en scène jugeant le mythe indigne de son intérêt. C’est très regrettable, car la musique de Camille Saint-Saëns est bonne, bonne, bonne quand elle sonne, sonne, sonne.

