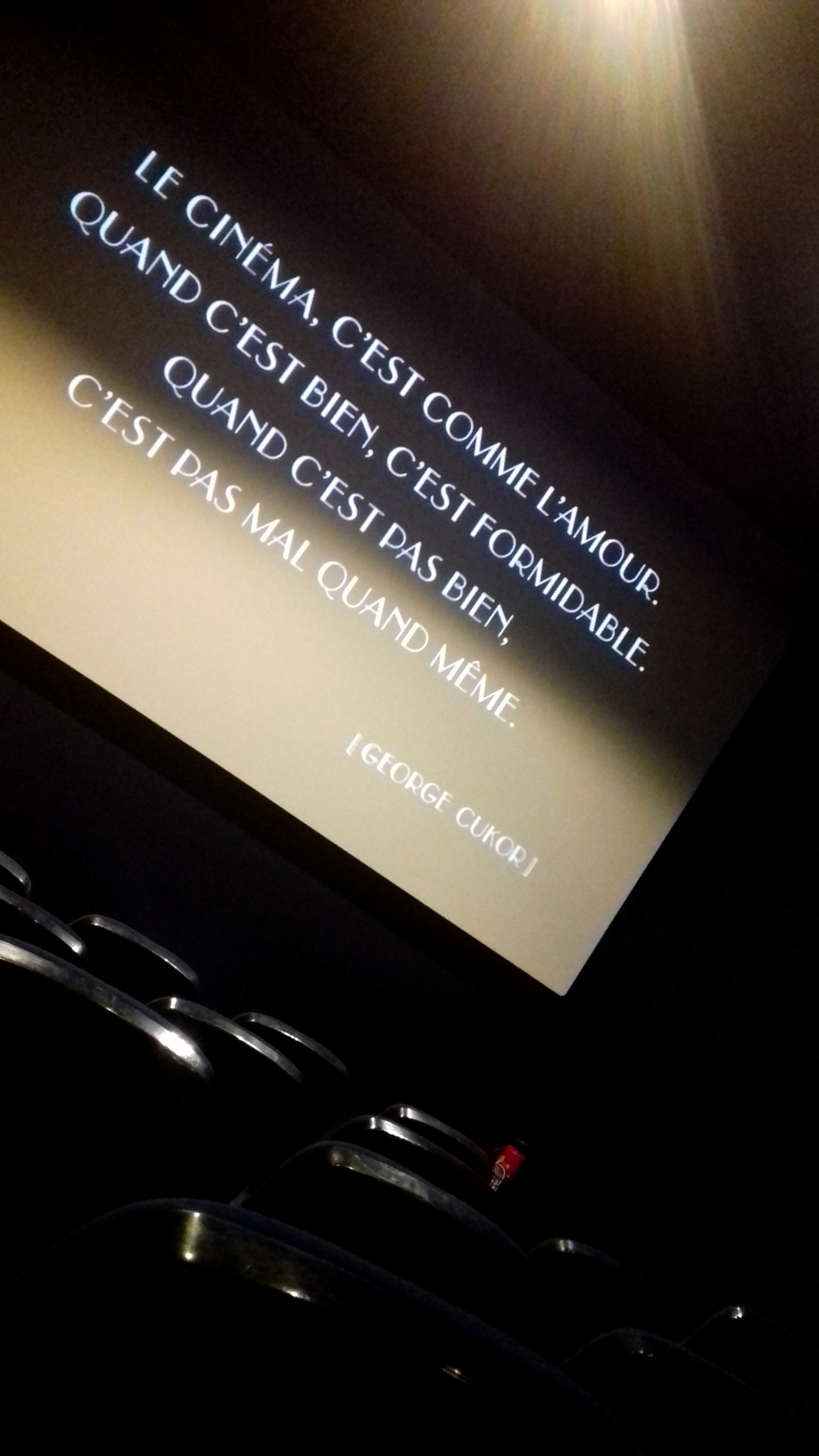Faute d’amour, Andrei Zviaguintsev, Cinéma des cinéastes, 25 septembre 2017
 L’histoire : Boris et Genia divorcent. En attendant de vendre leur appartement, ils cohabitent un peu, quand ils ne copulent pas avec leurs nouveaux partenaires. Ils n’osent pas encore avouer la vérité à leur fils Aliocha, douze ans. Las, celui-ci, bien sûr, sait tout, pleure et, un jour, disparaît. Les recherches entre forêt, cachette, maison familiale, hôpitaux et morgue ne donnent rien. Donc la vie continue.
L’histoire : Boris et Genia divorcent. En attendant de vendre leur appartement, ils cohabitent un peu, quand ils ne copulent pas avec leurs nouveaux partenaires. Ils n’osent pas encore avouer la vérité à leur fils Aliocha, douze ans. Las, celui-ci, bien sûr, sait tout, pleure et, un jour, disparaît. Les recherches entre forêt, cachette, maison familiale, hôpitaux et morgue ne donnent rien. Donc la vie continue.
Le film : Andrei Zviaguintsev, acclamé pour Leviathan et primé à Cannes pour cette nouvelle réalisation, semble construire son travail sur le contraste entre trois pôles : la contemplation de natures mortes (nature naturelle, comme telle forêt enneigée ou triste, et nature artificielle comme tel appartement chic ou tel magasin pour future maman) ; l’insertion de séquences narratives n’abusant pas du champ – contrechamp (entretiens avec la police, échanges entre futurs ex-époux, reportage sur les battues) ; et la plongée dans la médiocrité du quotidien, écho de la solitude d’humains rongés par la rancœur, la peur, la déception. Le principal intérêt du film est alors de travailler sur le franchissement des lisières séparant les pôles. En témoigne le refrain visuel constitué par la fenêtre – vitre pluvieuse par laquelle on est regardé en train de regarder lors de longs travellings avant, baie par laquelle on ne regarde pas tomber la neige lors de longs plans fixes. L’illustre aussi le bouclage sur la séquence initiale, où la bande de rubalise est à la fois intégrée à la nature tout en faisant écho à l’histoire narrée par ce film… et en renvoyant l’enfant à la solitude du disparu. De la sorte, le réalisateur paraît interroger les limites de la communication et des liens qui unissent donc désunissent les êtres.

Genia (Maryana Spivak) et Aliocha (Matvey Novikov) , dans le flou du mensonge,ne se regardent pas – et bientôt, disparaîtront à leurs yeux. Photo : Pyramide films.
Dès lors, ce film sur un couple en déréliction travaille aussi bien l’interpénétration des individus et de leur destin, incarnée par des séquences érotiques esthétisées, que leur répulsion et leurs expulsions mutuelles – séquence où Genia est boutée hors de la voiture, plan sur le ventre rond annonçant l’imminence d’une nouvelle naissance, peur d’être licencié donc d’être expulsé des gens-comme-il-faut. De nouveau, ce sont toutes les strates intermédiaires de cette tension entre intégration et désintégration de l’homme dans ses microsociétés qui finissent par se mêler, déclinant alors la notion d’amour, notion spectrale allant de la haine au désir en passant par l’amitié, l’intérêt et le fatum familial – avec, in fine, la certitude que l’on ne sait pas plus aimer que l’on s’est aimé.
La place, réduite puis nulle, de l’enfant marque cette « faute d’amour » que pointe le titre français. Faire un enfant, c’est fauter – Genia accuse Boris de l’avoir récupérée à cause d’Aliocha ; et comment aimer une faute d’amour… faute d’amour ? De fait, le film joue sur le procès perpétuel que chacun intente à l’autre pour ses fautes (tu as gâché ma vie, tu es une fille perdue, tu vas abandonner ta nouvelle compagne quand votre enfant aura dix ans) ou craint pour lui-même (accusation d’avoir tué Aliocha ou de ne plus être un employé correct). Andrei Zviaguintsev parvient fort bien à montrer la fixation de la parole dans une sorte de judiciarité perpétuelle, où les rapports interpersonnels sont régis par des attendus, des codifications et des stéréotypes délétères, autant dans les déclarations d’amour sans réponse que dans les invectives ou les silences. À l’évidence, dans ce Moscou où noir et blanc, sépia et couleurs sales se succèdent, personne ne sait vraiment se parler : la police craint de s’investir pour ne pas crouler sous la paperasse ; les proches, quand ils s’approchent, dégainent l’injure avec la délectation de celui qui gratte une croute en sachant qu’il vaudrait mieux la laisser sécher ; les couples marqués peinture fraîche sont déjà félurés (Genia est plus intéressée que son nouveau mec, Boris est trop distant au goût de sa nouvelle blonde) ; les parents ne savent parler à leur fils ; et les seuls qui croient savoir écouter, ces fameuses associations parapolicières qui pullulent en Russie, ont beau abuser du talkie-walkie, ils seront aussi vains que les autres acteurs. Alors, pour se rassurer et montrer que l’on est comme les autres, on se selfise, on réseaute social, mais, à l’arrivée, on ne saura rien de ce qui anime l’autre, donc ce qui m’a(n)ime, moi. Faute d’amour, de soi comme de l’autre.
Sous cet angle de vue, Faute d’amour est un film-sens. Échafaudé sur un plot creux, il fixe lentement la façon dont le rien peuple nos vies : le rien de l’incommunicable ; le rien à quoi l’on sert quand on reste « bien en ligne » pour chercher un enfant métaphorique donc introuvable, un gilet fluo sur le dos ; le rien du changement qui, par-delà la satisfaction animale, renvoie l’homme à sa finalité inacceptable qu’une visite à la morgue figure de manière saisissante – Genia y passe pour identifier son fils, crier que ce n’est pas lui, s’entendre néanmoins exiger une recherche d’ADN et coller une tarte à son mari. En juxtaposant des séquences quasi muettes, des monologues verbeux ou des échanges de taiseux, en alternant paysages et acteurs puis en les confondant, Andrei Zviaguintsev paraît saturer l’espace visuel et sonore sous la chape de plomb d’une fatalité lancinante où tout se mêle pour ensuquer l’homme dans la médiocrité de ses quelques coups d’éclat et de ses nombreuses trahisons (lâcheté devant l’enfant, mensonge pour feindre d’être moralement nickel afin de ne pas perdre son job, colère extravertie de la grand-mère pour cacher sa détresse, construction d’un couple sur le sable des faux-semblants, du besoin sexuel et des regrets ressassés, etc.). À l’instar de ce piano aux cordes étouffées que ramène sans cesse à la surface la bande originale, le scénario ténu étire sur plus de deux heures la déréliction moyenne de l’homme moderne – lente berceuse, désespoir sourd.
En conclusion, Faute d’amour semble mettre en scène une vision de la société où l’homme, fatigué et lâche, cherche à survivre grâce aux femmes, réseauteuses conformistes et victimes en révolte, afin de reproduire une humanité que sa médiocrité rassure. On peut à la fois en accepter l’augure, reconnaître le travail visuellement intéressant, et repartir un peu déçu par l’absence d’un je-ne-sais-quoi (radicalité sporadique, twist, effet de surprise…), certes difficilement envisageable si l’objectif est de souligner, par la parabole de l’enfant disparu, l’implacabilité de ce point de vue, mais qui eût été précieux pour donner au spectateur l’impression que le film, au contraire de nos vies, peut décoller à tout moment grâce au talent du réalisateur.